 La solitude et la mort
La solitude et la mort
par Claire Julier
James Joyce a quitté l’Irlande en 1904. Exilé par choix, il marche à reculons, les yeux fixés sur son passé. L’Irlande est le lieu de mémoire, celui de l’écriture. Le monde de Gens de Dublin est inséparable du monde du Portrait de l’artiste et d’Ulysse. Après avoir écrit des poèmes, des pièces de théâtre et des critiques, Joyce se met à la nouvelle. Gens de Dublin, écrit de 1903 à 1906, n’a pu paraître à Londres qu’en 1914, deux nouvelles étant jugées licencieuses et l’ensemble pouvant heurter les Dublinois tant les portraits sont frappants de ressemblance.
Dans une préface écrite en 1921, Valéry Larbaud présente ainsi le recueil : […]« Par la hardiesse de sa construction, par la disproportion qu’il y a entre la préparation et le dénouement, Joyce prélude à ses futures innovations, lorsqu’il abandonnera à peu près complètement la narration et lui substituera des formes inusitées et quelquefois inconnues des romanciers qui l’ont précédé : le dialogue, la notation minutieuse et sans lien logique des faits, des couleurs, des odeurs et des sons, le monologue intérieur des personnages, et jusqu’à une forme empruntée au catéchisme : question, réponse ; question, réponse. »
Amours non avouées, passions contenues, humiliations tues, l’histoire de l’Irlande en toile de fond, Dublin au premier plan : employés aux écritures, employées de maison, tenancières de pension de famille, boutiquiers qui « montent la garde auprès de barils de têtes de porcs », étudiants désargentés, écoliers qui font l’école buissonnière, curés de la paroisse, jésuites chargés de cours, chanteurs de rues qui égrènent d’anciennes ballades sur les troubles du pays, discoureurs politiques, buveurs de stout, inadaptés sociaux – une faune qui rit, s’amuse, prie, gaspille, s’enivre ou attend la rencontre qui changera le cours de la vie. Petits évènements – virées au bar du samedi soir, réceptions rituelles, promenades dominicales, jeunes gens en goguette, soirées musicales impromptues, jeux adolescents de Peaux Rouges – peinture naturaliste d’une cité fourmillante, haute en couleur, animée, que Joyce croque avec une clarté absolue et une ironie mordante.
Plus on avance dans le récit, plus chaque mot fait sens. Les niveaux de lecture deviennent multiples. Les personnages semblent sûrs d’eux sous le regard des autres mais ils sont pris de tremblements lorsque – à un silence, un son, un mot – ils pressentent leur vrai moi. La réalité les envahit comme une révélation. Leur nature secrète leur apparaît alors pitoyable.
La solitude est omniprésente dans ces reproductions de vies étriquées, aigries, soupçonneuses, sans envergure, sans espoir. Oui, la solitude se décline à chaque page : celle du jeune garçon qui ne peut pas aller à la kermesse parce que son oncle arrive trop tard pour lui donner de l’argent ; celle du poète incompris qui ne parvient pas à calmer les pleurs de son nourrisson; celle de l’employé humilié par tous au bureau, puis par ses amis au pub et qui, lorsqu’il rentre chez lui, se venge en frappant son jeune fils ; celle des deux galants qui séduisent une servante ou celle de deux jeunes garçons qui sont à la fois attirés et terrifiés par les propos d’un pervers ou encore de la mère qui cherche à tous prix – quitte à y perdre sa dignité – à ce que sa fille soit payée pour sa « prestation » musicale.
Elle atteint son apogée dans la dernière nouvelle - Les morts (The Dead) - où lors d’une fête annuelle, une femme révèle à son mari qu’elle a vécu l’intensité de l’amour avec un jeune homme aujourd’hui disparu. Mort pour elle. John Huston poussé par le désir d’entendre une dernière fois un texte aimé l’a magnifiquement mis en scène dans son ultime film. (Gens de Dublin, 1987)
« Oui, les journaux avaient raison, la neige était générale en toute l’Irlande. Elle tombait sur la plaine centrale et sombre, sur les collines sans arbres, tombait mollement sur la tourbière d’Allen et plus loin, à l’occident, mollement tombait sur les vagues rebelles et sombres du Shannon. Elle tombait aussi dans tous les coins du cimetière isolé, sur la colline où Michel Furey gisait enseveli. Elle s’était amassée sur les croix tordues et les pierres tombales, sur les fers de lance de la petite grille, sur les broussailles dépouillées. Son âme s’évanouissait peu à peu comme il entendait la neige s’épandre faiblement sur tout l’univers comme à la venue de la dernière heure sur tous les vivants et les morts. »
James Joyce, Gens de Dublin, traduit de l’anglais par Jacques Aubert, 250 pages, Editions Folio.
Cet article a paru dans le numéro 70 du Passe-Muraille, venant de paraître en cet avril 2006.




 La solitude et la mort
La solitude et la mort L'Auteur démasqué (5)
L'Auteur démasqué (5) Ce texte est tiré de Plume d'Henri Michaux. Il n'a été identifié qu'avec l'aide d'un moteur de recherche, au déni des règles élémentaires quoique non écrites du jeu papou. Nul ne recevra donc de récompense.
Ce texte est tiré de Plume d'Henri Michaux. Il n'a été identifié qu'avec l'aide d'un moteur de recherche, au déni des règles élémentaires quoique non écrites du jeu papou. Nul ne recevra donc de récompense.
 L’Auteur démasqué (2)
L’Auteur démasqué (2)



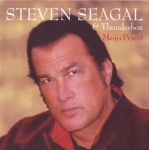
 triment des deux auteurs qui l’accusent d’avoir plagié leur ouvrage ? Ceux-ci, qui n’ont vendu « que » 2 millions d’exemplaires de leur titre, se seraient-ils pareillement acharnés s’il n’avait pas dépassé, lui, les 40 millions d’exemplaires ? Et le juge n’a-t-il pas fait une fleur à Dan Brown du seul fait de son mondial succès ? Le verdict de non-plagiat est-il un progrès en matière d’honnêteté intellectuelle ? Pour ma part, je n’en crois rien, mais il faut dire que je me fais une idée très particulière du plagiat. Plus précisément, le plagiat qui compterait à mes yeux est impossible.
triment des deux auteurs qui l’accusent d’avoir plagié leur ouvrage ? Ceux-ci, qui n’ont vendu « que » 2 millions d’exemplaires de leur titre, se seraient-ils pareillement acharnés s’il n’avait pas dépassé, lui, les 40 millions d’exemplaires ? Et le juge n’a-t-il pas fait une fleur à Dan Brown du seul fait de son mondial succès ? Le verdict de non-plagiat est-il un progrès en matière d’honnêteté intellectuelle ? Pour ma part, je n’en crois rien, mais il faut dire que je me fais une idée très particulière du plagiat. Plus précisément, le plagiat qui compterait à mes yeux est impossible. Notes à la volée
Notes à la volée