Rencontre avec Francis Reusser
C'était en 1976, la chute de Saigon n'était plus qu'un souvenir lointain mais la Révolution culturelle chinoise nourrissait encore maintes illusions chez les gauchistes occidentaux. Au Festival de Locarno, cette année-là, le Léopard d'or fut attribué à Francis Reusser pour Le grand soir, également couronné au Festival de Hyères. L'accueil des camarades du cinéaste, jugé politiquement incorrect, fut en revanche globalement négatif, qui lui reste aujourd'hui encore en travers de la gorge. Un article incendiaire, et non signé, du journal Rupture le traitait ainsi de renégat et lui prédisait un avenir d'infâme suppôt de l'art bourgeois. Un quart de siècle plus tard, l'affreux « déviationniste » n'en a pas moins retrouvé ceux avec lesquels il partagea, au tournant des années 70, maints combats, dont celui du Comité Action Cinéma et de Lôzane bouge. Son dernier film, réalisé pour la télévision, n'a rien pour autant de la commémoration d'anciens combattants ...
— Quelles sont, Francis Reusser, les origines de votre rébellion ?
— C'est d'abord l'histoire d'un orphelin (j'ai perdu ma mère en ma deuxième année, et mon père à 13 ans) qui bascula dans la petite délinquance avant de se retrouver en maison de correction. Fils d'ouvrier veveysan, j'avais fait un bout de collège et deux ans à l'Ecole de photographie de la grande époque, avant de me retrouver, chenapan chopé pour un larcin dans les vestiaires du tennis-club, « casé » dans une institution pilote de la région genevoise, où le jeune éducateur Louis Emery, dont le père avait arrêté Mussolini, m'a tenu lieu de substitut paternel. Comme je le dis dans le film, j'ai pris là de salutaires coups de pied au cul, tout en amorçant un boulot d'assistant cameraman à la télé romande, avec des gars comme Soutter et Goretta qui m'ont beaucoup appris. Il n'y avait que le patron de la télé, René Schenker, qui savait où je rentrais le soir ... Par ailleurs, j'avais déjà commencé à écrire et à faire un peu de théâtre. Le cinéma, auquel j'ai été initié par le club Fip-Fop de Nestlé (rires) ne devait venir que plus tard. Question politique, contrairement à l'ouvrier mon père qui ne voyait en l'URSS qu'une horreur absolue, j'ai été proche des communistes genevois et j'ai collaboré à un journal anarchiste. Mais le premier vrai choc, à côté de la guerre d'Algérie, fut l'attentat contre le consulat d'Espagne à Genève, auquel a participé le futur éditeur écrivain Claude Frochaux, le premier de mes « acteurs » à s'exprimer dans le film.
— Vous définissez celui que vous avez été, dans les années 70, comme un cinéaste maoïste. Que cela signifie-t-il ?
— En fait, nous avons été plus soixante-huitards avant 68 qu'après ! La date clé, pour moi, fut 1967, où je suis allé à Prague. J'avais déjà réalisé l'un des sketches de Quatre d'entre elles et j'y ai rencontré les cinéastes tchèques que nous connaissions déjà grâce à Freddy Buache. Là je joue au foot avec Forman, je vais voir tourner Jiri Menzel, et c'est le malentendu total: j'arrive avec mon marxisme et je tombe sur des gens qui font un cinéma formidable et ne rêvent que d'Occident parce que Novotny règne sur le pays. En 1967, j'assiste à un récital de poésie d'Allen Ginsberg dans une cave à jazz de Prague, et l'année qui suit ce sont les chars soviétiques ... Quant au maoïsme, après 68, ce sera la perspective d'une alternative. Le premier et le seul groupe auquel j'adhère vraiment sera Rupture, où je vais rester deux ou trois ans. C'est alors toute une aventure politique et humaine que je raconte dans le film, avec l'imprimerie de Vaugondry, Armand Dériaz, le film sur les Palestiniens (Biladi, une révolution, 1971) qu'on va montrer partout en Suisse et en Europe, le journal Rupture qui cristallise la créativité formidable d'un tas de gens.
— Pourquoi le choix du style carnet personnel ?
— C'est un vieux débat que j'ai déjà eu à propos de la pseudoobjectivivité de la TV. On n'avance pas masqué: il y a quelqu'un qui dit « je » et qui assume. Par ailleurs, c'est un portrait de groupe qui n'a rien d'exhaustif. J'ai choisi des gens que je connaissais et dont l'expérience de vie m'a paru significative et intéressante. Certains « acteurs » pressentis se sont défilés qui, eux, n'assument pas ce passé-là. L'un d'eux m'a même menacé de représailles si je le citais. Un autre, que je sais l'un des auteurs de mon « exécution » dans Rupture, et qui occupe aujourd'hui une belle place de directeur, a lui aussi décliné. Passons ...
— Le bilan politique de ces grandes espérances déçues n'apparaît pas vraiment dans le film. Pourquoi cela ?
— Si je fais ce film trente ans plus tard, c'est faute de n'avoir pu le faire tout de suite, dans une atmosphère de tensions exacerbées entre les groupes. C'est pourtant sur cette base critique que, par le biais de la fiction, j'ai réalisé Le grand soir. Résultat: j'ai été traîné dans la boue et dans des termes inimaginables aujourd'hui ... — d'ailleurs, un Jacques Basler ou une Diane Gilliard reconnaissent qu'il est heureux que le pouvoir ne soit pas tombé entre leurs mains ! Par la suite, la critique de la stratégie révolutionnaire esquissée dans Le grand soir, d'ailleurs modérée, a été largement reprise et partagée. A ce que je sais, le bilan du maoïsme a été fait par le groupe avant sa dissolution, mais je n'y étais plus. Or ce qui m'intéresse, aujourd'hui, c'est ce que ces gens sont devenus. Comment ils restent fidèles à eux-mêmes par-delà le dogmatisme, et ce qu'ils transmettent. Au-delà de toutes les conneries que nous avons dites ou faites, il y a des valeurs que nous n'avons pas à renier dans la société très dure où nous vivons aujourd'hui. Mon film s'achève au printemps 2003, sur les images des bombardements de Bagdad, et je parle d'un film réalisé par mon fils de 20 ans et ses camarades. La vision de ceux-ci, croyezmoi, n'est pas rose. Et la question se pose plus que jamais: « Que faire ?» é
Le chant des vies non alignées
La première et la dernière image des Printemps de notre vie est un coin de terre entre lac et ciel, ce que Francis Reusser le ramuzien voit par sa fenêtre d'enfant du pays, et ce pourrait être un cliché, comme toute sa chronique d'une jeunesse rêvant à la révolution pourrait se réduire à de l'imagerie convenue, si celui qui parle et raconte, et l'imagier, et le capteur de sons et de voix, n'était avant tout un auteur: une espèce d'écrivain doublé d'un poète du visible, accessoirement archiviste et témoin vivant du temps présent.Avec la vélocité généreuse de l'impatient qui aimerait tout dire en recollant vite vite tous les morceaux du souvenir et de l'instant présent, ici et partout, mais en suivant la basse continue très précise et sensible d'un texte écrit, Reusser accueille aussitôt d'autres voix dans son patchwork « in progress », et c'est alors une polyphonie d'accents mais aussi de visages. Il y a Claude le visionnaire et Serge l'artisan coachant son Antillaise au football des filles, Marlène la pasionaria de naguère et Jacques le sculpteur à la dégaine de vivant forcené, l'autre Jacques traînant sa patte et portant toujours haut son cœur solidaire, Sylvain se partageant entre drogués et mômes perdus, Daniel que son travail dans l'humanitaire justifie au meilleur sens politique, Philippe qui revient de la délinquance sans abjurer son engagement, d'autres, et Céline et Julie qui, de leur bateau, regardent leurs « vieux » tout en scrutant leur printemps à elles. Car ce poème à la résistance est aussi une histoire de tribu et de filiation, et comme toujours tout reste à réinventer.
Francis Reusser. Les printemps de notre vie. A voir sur DVD

 Autre détail: j’ai relevé ce matin, sur le rapport quotidien des visites de ce blog, que j’avais reçu 2071 coups d’œil durant cette première quinzaine d’août, et là encore je me suis dit : gare à l’illusion : un clic et tout ça s’évapore comme neige de baleine au soleil assassin…
Autre détail: j’ai relevé ce matin, sur le rapport quotidien des visites de ce blog, que j’avais reçu 2071 coups d’œil durant cette première quinzaine d’août, et là encore je me suis dit : gare à l’illusion : un clic et tout ça s’évapore comme neige de baleine au soleil assassin…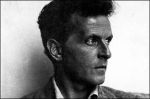 conque pour connaître « le monstre », lui qui l'avait côtoyé en son adolescence, au collège de Linz ? Telles sont les questions qui se posent assez insidieusement à la lecture de ce (remarquable) petit livre, en lequel il faut voir une variation romanesque bien plus qu'un début de mise en accusation.
conque pour connaître « le monstre », lui qui l'avait côtoyé en son adolescence, au collège de Linz ? Telles sont les questions qui se posent assez insidieusement à la lecture de ce (remarquable) petit livre, en lequel il faut voir une variation romanesque bien plus qu'un début de mise en accusation.



 che, dans la contrition manifestée, et nous nous retrouvons au cabaret du juif Jankiel. Nous prendrons un parti ou l’autre dans les litiges du tribunal local, en présence de l’huissier aux pieds nus. Nous nous rendrons à la foire haute en couleurs, au bourg voisin, puis nous connaîtrons la « double mélancolie des chagrins passés et des soucis d’avenir », dans la tristesse fantomatique des lourdes journées pluvieuses. Puis ce sera jour de noces, avec ses réjouissances que ne tarderont à étouffer les neiges d’hiver. Alors nous suivrons les travaux éreintants des bûcherons. Et viendra Noël, pacifiant jusqu’aux plus terribles conflits.
che, dans la contrition manifestée, et nous nous retrouvons au cabaret du juif Jankiel. Nous prendrons un parti ou l’autre dans les litiges du tribunal local, en présence de l’huissier aux pieds nus. Nous nous rendrons à la foire haute en couleurs, au bourg voisin, puis nous connaîtrons la « double mélancolie des chagrins passés et des soucis d’avenir », dans la tristesse fantomatique des lourdes journées pluvieuses. Puis ce sera jour de noces, avec ses réjouissances que ne tarderont à étouffer les neiges d’hiver. Alors nous suivrons les travaux éreintants des bûcherons. Et viendra Noël, pacifiant jusqu’aux plus terribles conflits. en félicitent, qui nous en détournent. Ceux-là qui, même d’un jugement nuancé, ne retiennent que les aspects négatifs et nous tapent dans le dos en nous lançant avec quelle douteuse satisfaction: “Ah ça, comme tu l’as descendu...”
en félicitent, qui nous en détournent. Ceux-là qui, même d’un jugement nuancé, ne retiennent que les aspects négatifs et nous tapent dans le dos en nous lançant avec quelle douteuse satisfaction: “Ah ça, comme tu l’as descendu...”