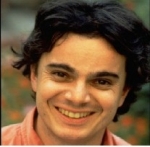A La Désirade, ce 21 août 2005
A La Désirade, ce 21 août 2005
Il fait nuit encore aux fenêtres de La Désirade, et silence absolu, mais ce mot d'approximation m'a soudain amené à ma table pour y jeter ces quelques propos sur la conversation que me sembe une lecture féconde, comme je la vis ces jours en revenant à tout moment au Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig.
Une bonne façon de converser, avec soi-même autant qu’avec autrui, tient à ne pas hurler en cas de désaccord. Je ne regrette pas le temps idéologisé à outrance où, lorsqu’une idée ou une position déplaisaient l’on se mettait à hurler. On s’imaginait alors faire preuve de caractère, et c’était évidemment une faiblesse d’endoctrinement. Ces discussions finissant dans les cris et parfois les pleurs, qui étaient le propre de certains groupes ou de certains individus en mal de pouvoir, m’ont vite fatigué, comme tout ce qui hurle dans l’idéologie. J’ai perdu beaucoup de supposés amis qui hurlaient dès que nous étions en désaccord. A l’inverse, mon amitié pour Charles Du Bos n’a fait que se renforcer, même si je ne le lis que rarement, mais je sais que demain je reviendrai à lui comme je reviens ces jours au Dictionnaire égoïste de la littérature française, pour converser tranquillement.
Tranquillement ne veut pas dire sans passion. Une conversation sans opinion personnelle affirmée, ponctuée de « j’sais pas », « j’veux dire», et autres « tu vois ce que j’veux dire », est aussi assommante qu’un échange de vociférations énervées. La tranquillité est une force, comme disait l’autre scout, et c’est le terme d’approximation, dont Charles Du Bos s’est servi pour intituler la série de ses essais de lecture, qui me semble convenir le mieux à cette disposition intérieure que j’affine à la lecture de Dantzig comme, disons, à la lecture de toute pensée en mouvement.
Nous ne lisons pas à l’instant tout à fait comme nous lirons tout à l’heure, même si nous changeons peu sur l’essentiel. Nos sentiments les plus personnels ont la finesse et la précision de rayons laser venus de je ne sais où, et je constate pour ma part que l’appareil était prêt lorsque j’avais sept ans, comme celui de Dantzig évoquant ses premières choses sues (qui lui donnaient le culot de corriger au même âge les erreurs de sa prof communiste teigneuse, genre c’est-moi-qui-sais), même si cinquante ans plus tard je me trouve souvent aussi naïf et niaiseux à d’autres égards qu’à neuf ans et demi.
Ce que dit Dantzig sur la poésie par exemple, de si férocement pertinent, et qui touche si juste en ce qui concerne plus précisment le culte du vague et de l'ineffable auquel s'adonne l'actuelle poésie romande, relève à mes yeux d’une vérité fulgurante non moins qu’approximative. Je veux dire que le sentiment-laser, ou la pensée-laser, est absolument juste, pour lui à ce moment-là, comme pour moi à l’instant où ça fait tilt, mais le jugement n’en est pas moins un objet (il parle lui-même de la poésie sous l’aspect de l’objet) qu'on va regarder de tous côtés comme Cézanne la pomme ou la fesse de baigneuse, et reconsidérer au besoin, nuances à l’appui.
La langue française est appropriée à ces clairs de la pensée, mais c’est souvent le piège des ardents obscurs ou des égomanes furieux, comme l'illustre un Marc-Edouard Nabe entre tant d'autres. Charles Dantzig n’est pas de ceux-là, qui me semble puissamment doux jusque dans ses traits les plus vifs, gentil et modeste en dépit de ses flèches de feu et de son apparente superbe. Dantzig ne craint pas de se rappeler, contre les cuistres prétendant avoir découvert Flaubert et Balzac à trois ans, que c’est La plus mignonne petite souris qui lui a valu ses premiers émois de lecteur, et qu'il a racheté le livre plus tard comme on relit le Dostoïevski de ses seize ans à quarante ans passés, pour faire des retouches à notre lecture. Toute lecture est retouche, me semble-t-il, et à n‘en plus finir. Non pour se déjuger mais pour affiner. D’approximation en approximation nous avançons ainsi dans un univers de plus en plus intéressant, il me semble, à proportion de notre curiosité relancée à chaque nouvelle rencontre.