Séquences proustiennes

«C’est par ses péchés qu’un grand homme nous passionne le plus, écrivait Octave Mirbeau. C’est par ses faiblesses, ses ridicules, ses hontes, ses crimes et tout ce qu’ils supposent de luttes douloureuses, que Rousseau nous émeut aux larmes, et que nous le vénérons et le chérissons.» D’une manière analogue, et bien plus que par voyeurisme ou fétichisme, les moindres détails, des plus sordides au plus touchants, qui se rapportent à la nébuleuse indistincte de la vie et de l’oeuvre de Proust n’en finissent pas de susciter la curiosité émue de ses lecteurs. Que serait-il devenu s’il n’avait succombé , le 18 novembre 1922, à la pieuvre («demander pitié à notre corps, c’est discourir devant une pieuvre»...) de son corps, lui qui était né la même année que Valéry (mort en 1945) et auquel Claudel (plus âgé que lui de trois ans) survécut jusqu’en 1955 ? Jean Cocteau lui aurait-il fait jouer son propre rôle dans Le sang d’un poète, et les siens eussent-ils été inquiétés par les lois antijuives ? Questions moins vaines qu’il n’y paraît, s’agissant d’un fantôme qui ne cesse de nous rendre le monde et l’humanité plus réels.
Jamais filmé ni enregistré, Proust a été évoqué plus souvent qu’à son tour, et Jérôme Prieur, qui ne peut que regretter de n’avoir pu lui consacrer l’un des portraits cinématographiques de ses Hommes-Livres, se console et nous captive par cette suite de petites séquences d’un film ouvert à toutes les rêveries.
Jérôme Prieur. Proust fantôme. Le Promeneur. Gallimard, 158p.

Pschitt citron
C’est une histoire qui finit comme elle a commencé, disons: sur la pointe des pieds. «Je m’étais attendue à une apocalypse», remarque la narratrice qui se demande ce qui va se passer. Puis de conclure: «En fait, il ne se passa rien: le téléphone n’a plus sonné. Ca n’a pas trop été brutal comme transition.»
Or, le début de son récit annonçait plus ou moins la couleur: «Nous étions assis sur un banc des Halles, sous une espèce de pergola en bois. Il faisait bon. Il m’a dit je ne t’aime pas»...
Elle au contraire est, sinon folle, du moins passablement mordue de ce drôle de type qui se surnomme lui-même l’Agrume, avec un citron pour effigie dont il a créée l’icône dans son ordinateur. Bruno de son prénom, étudiant la physique et le japonais et jouant sur plusieurs tableaux simultanés en matière de relations féminines, apparaît ici comme le type du vieux gamin à la fois original et égoïste qui trouve de la beauté dans les choses les plus inattendues, par exemple de la crème de lait à la surface d’une tasse, un bouchon de lavabo durci et craquelé ou des empreintes de tanks au milieu d’un désert. Tout à fait étranger aux convenances, il est d’un culot monstre en société et d’un manque total d’égards envers ses amies.
Bref, on comprend que la jeune fille en pince pour l’Agrume, qui a son charme, mais on ne s’étonne guère de la conclusion douce-acide de cette fine novelette.
Valérie Mréjen. L’Agrume. Editions Allia, 80pp.

Intermède oriental
«L’Egypte est peut-être le seul pays qui ressemble vraiment à ses cartes postales», écrivait Alexandre Vialatte dans un article de L’Epoque daté du 16 août 1938, un an après qu’il eut été nommé professeur au lycée franco-égyptien d’Héliopolis. Cependant, les observations qu’il consigne alors font valdinguer tous les clichés, marqués au sceau de la fantaisie poétique qui caractérisera plus tard ses merveilleuses chroniques, ainsi que l’illustre par exemple ce croquis: «Le buffle aux yeux lamartiniens, coiffé de cornes mélancoliques qui retombent comme les anglaises des jeunes filles Louis-Philippe, passe parfois, inconsolable et désolé; le buffle est un veuf de naissance»...
Dix ans après la parution de son premier roman, Battling le ténébreux, et sans se douter qu’il sera mobilisé à l’automne 1939 (mais sa chère Allemagne l’inquiète depuis longtemps déjà) , le jeune écrivain vit son rêve oriental «au coin de l’infini et de la rue la plus fréquentée», ne se lassant pas d’interroger le désert tout en savourant la bonne vie grouillante du peuple égyptien. «La distinction, la bonté naturelle des petites gens en Egypte méritent une page de louanges», relève-t-il avec tendresse, tout en célébrant aussi la vitalité d’un pays moderne dont les étudiants le réjouissent autant que le fatalisme serein qui lui fera conclure malicieusement tant de chroniques ultérieures sur le fameux «et c’est ainsi qu’Allah est grand».
Alexandre Vialatte. Au coin du désert. Egypte 1938. Le Dilettante, 93p.
Enigmes d’amour
Danièle Sallenave, qui poursuit une oeuvre exigeante et substantielle à l’écart des estrades, est familière des zones où s’interpénètrent la narration romanesque et le récit autobiographique, comme l’illustre aussi bien son dernier livre.
De quoi est-il question dans ce double récit de deux vies que la narratrice entremêle et qui semblent ne rien avoir en commun ? D’amour en effet, mais d’amour comme redécouvert après la remémoration tâtonnante et la mise en mots, qui aboutissent à la fois à un surcroît de lucidité et d’acceptation, mais trop tard le plus souvent.
En l’occurrence, les deux vies rapprochées ont valeur de symboles, et leurs fins s’apparentent puisque l’une est un suicide brutal et l’autre une mort volontaire différée. D’un côté, une belle femme faite pour vivre et séduire, que son corps a prise en traître pour faire d’elle, le salaud, une «vieille guenon ridée», et qui n’a pas survécu à la mort de celui qu’elle aimait - se jetant alors sous un train.
De l’autre, un homme intelligent et raffiné, que la narratrice a aimé et qui a dégringolé après leur éloignement. Et dans les deux cas, derrière les faits qui n’expliquent rien: deux énigmes que, par l’introspection et la rêverie romanesque, Danièle Sallenave interroge avec beaucoup de délicatesse sensible. Il en résulte un livre qui fait écho à d’autres ouvrages de l’auteur (notamment à L’Amour fantôme), aux enjeux dépassant tout égocentrisme.
Danièle Sallemave. D’Amour. Gallimard, 219p.
Une errance rêveuse
L’exergue de ce petit livre, emprunté à François Bon, en annonce bien la couleur, relevant qu’«à un âge de soi-même le besoin est là de partir et d’aller droit devant, de faire pour après ces réserves où comptent les ciels et le goût qu’a l’air». Or c’est sans réfléchir que le narrateur plaque à dix-sept ans ses parents, laisse tomber sa première place sur un chantier en banlieue, saute dans le train et se retrouve à Toulouse dont la lumière rose lui convient déjà mieux.
Cela se passe à la fin des années 60, à une époque où le parti communiste fait encore figure de grande famille, comme l’illustre le magazine fadasse intitulé Nous les garçons et les filles, pendant «politisé» du fameux Salut les copains. Quant au militantisme du protagoniste, il va s’éroder peu à peu, pour céder au désenchantement, en automne 1968, à l’entrée des chars soviétiques à Prague.
Entretemps, c’est de tout autre chose que de politique qu’il est question en ces pages marquées par une sorte de constant décalage entre celui qui parle et le monde qui l’environne. «J’ai toujours aimé l’inconu, j’ai toujours aimé partir, voir, être ailleurs que là où j’aurais dû être», remarque cette espèce de vagabond solitaire jamais assouvi (l’amour fou auquel il goûte ne dure que le temps d’une passade), dont l’errance évoque les dérives de Simenon ou la tristesse souriante d’un Henri Calet.
Bernard Ruhaud. On ne part pas pour si peu. Stock, 88p.
Servante et reine
La romancière québecoise est-elle en panne d’inspiration, pour consacrer un livre entier à sa femme de ménage espagnole ? Bien au contraire, même si l’appellation de «roman», commerce oblige, ne correspond pas tout à fait à l’économie de ce récit, certes «romanesque», mais en somme dicté par la vie de Madame Perfecta.
Cela étant, rien d’une «histoire de vie» au premier degré dans cette magnifique remémoration, très vivante, émouvante et non moins intéressante du point de vue historique, qu’Antonine Maillet a conçu, après la mort de Madame Perfecta, en forme d’hommage chaleureux à cette femme qu’elle a aussitôt «reconnue» dès leur première rencontre, qui est devenue ensuite la bonne fée de son foyer et plus encore: une amie, dont elle a découvert peu à peu la richesse personnelle et les blessures, notamment liées à des drames survenus pendant la guerre civile.
Personnalité rayonnante, reine au milieu des siens et nullement humiliée par la tâche qu’elle accomplit chez les autres avec autant de conscience que de compétence, Madame Perfecta n’est pas «de l’étoffe dont on fait des écritures, mais de l’oralité», et pourtant c’est grâce aussi à son amie «mamozelle Tonine» qu’elle acquiert ici, après sa fin poignante sous les coups répétés du cancer, son aura et sa «gloire» auprès du lecteur...
Antonine Maillet. Madame Perfecta. Leméac/Actes Sud, 153p.

-
-
Briscards du blues

John Mayall a toujours pas mal d'allure en septuagénaire chenu (on peut rappeler qu'il est né en 1933 dans les parages industriels de Manchester) et, quarante ans après le premier enregistrement qu'affiche sa discographie officielle (John Mayall plays John Mayall), le compagnon de route de Clapton assure encore superbement avec ses Bluesbreakers dernière couvée, sous un titre nous renvoyant aux grands espaces des chevauchées mécaniques dans le genre des anges à gros cubes ou des routiers de l'Ouest burinés par les pluies acides …
Le départ (Road Dogs) se fait en déménageuse à gros pneus et suspension rythmique binaire, guitares flambantes et litanie d'introduction du vieux loup de terre, « destination partout ». Tout de suite après, avec relents autobiographiques de sale gosse chialant le blues à l'instar de papa, Short Wave Radio enchaîne avec du Mayall de pure filiation, saluant Muddy Waters au passage de sa démarche chaloupée ; et la virée va faire alterner, ensuite, les climats sucré-salé, les tonalités rock-blues-folk (So Glad ou Forty Days, entre autres) et les vraies ballades lyriques (To Heal The Pain, avec sa touche country) ou plus dramatiques, comme le somptueux Beyond Control, avec une palette de sons que les jeunes loups à dents de lait devraient envier au magistral vioque …
John Mayall et les Bluesbreakers Road Dogs Eagle
-
Salamalec aux 1212

La Désirade, 1er juillet 2005
Il y a moins d’un mois que j’ai ouvert ce blog, dont le relevé de ce matin m’indique 1212 visiteurs, sur lesquels 819 ne se sont pointés qu’une fois. J’en conclus que plus de 300 y sont revenus, et cela me touche et m’intrigue. Qui sont-ils donc ? Qui est ce Bruno, qui est cette Soledad, qui est ce Loïc, qui est ce Greco qui m’ont gratifié d’un message ? Qui est attiré par ce mot de Littérature définissant cette communauté ? Et à quoi tout cela rime-t-il diable ?
Il y a trois mois encore, je n’avais que vaguement entendu parler de cette nouvelle pratique du blog, que j’assimilais à la débauche de tchatche qui sévit sur le web. Je l’apprends d’ailleurs aujourd’hui : il y aurait actuellement 15 millions de blogs au monde, et comme il s’en ouvre un toutes les x secondes ça fait x fois plus, non mais c’est l’océan clapoté sur écran ces blogs de malheur !
Pour ma part, une première expérience m’avait d’ailleurs plus ou moins échaudé après quelque temps, à l’enseigne du Forum Littérature sur Hotmail. Les échanges y étaient pourtant sympathiques, et parfois intéressants, mais à la longue on se lasse de parler à des pseudonymes, étant soi-même un personnage imaginaire – alors je m’appelais Livia et j’étais concierge à Bruxelle après une vie compliquée… et puis ces discussions virtuelles impliquent souvent des malcontents, pour ne pas dire des frustrés, qui se mettent bientôt à attaquer celui-ci ou à persifler celle-là, et voilà que ça dégénère comme une fois sur trois à l’enseigne de la République des livres de Pierre Assouline à qui, soit dit en passant, béni et maudit soit-il, je dois l’idée de ce blog.
C’est en effet un début de conversation sur le blog littéraire de Pierre Assouline qui m’a révélé, d’un jour à l’autre, l’univers de la blogosphère, ensuite documenté par un article du Nouvel Observateur, lequel m’a fait découvrir qu’il était possible, sur le site HautEtFort, de créer son blog interactif gratos et subito.
Mais qu’est-ce au juste qu’un blog ? A vrai dire je l’ignore quoique sachant que toute une Ethique du Blog se constitue à la vitesse de la lumière jusque chez les Bushmen de Tanzanie forestière. Pour ma part j’y vois, pour l’instant, une occasion de classer mes divers papiers et autres textes inscrits sur tablettes de cire ou de silicium et de construire une espèce d’Abbaye de Thélème virtuelle où rencontrer chacune et chacun au coin du soir. Je suis parfaitement conscient du fait que ce recoin de bibliothèque peut se volatiliser d’un instant à l’autre, et je trouve cela très bien. Jusque-là, je n’ai pas trouvé vraiment urgentissime d’ouvrir un nouveau salon où l'on glose, donc je fais plutôt dans le genre librairie de province et voilà, finalement cette manie du blog est épatante, ou quoi ?
Yes tout est bien si l’on garde son style. On se fiche de l’instrument n’est-ce pas ? sauf que celui-ci est d’une appréciable commodité, même ne disposant que d’un mince fil tombant d’un chalet de montagne (La Désirade se situe à 1212m, ça ne s’invente pas) dans l’abîme où croupit le smog pollué.
A l’instant je dépose une galette du bluesman Tab Benoit sur mon vieux Digital Sound et vous adresse un clin d’œil. Cela s’intitule Night Train et les voyageurs sont les bienvenus…

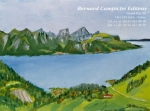
-
Imagier des auras
Le grand art de Horst Tappe
On entre dans le repaire montreusien de Horst Tappe par un véritable défilé de la gloire artistique et littéraire, dont la tête d’un Picasso torse nu à dégaine d’empereur inca domine la perspective. Impressionnante première vision que cette galerie de portraits de créateurs illustres tapissant les murs de l’étroit corridor, sans rien pour autant de figé ou de léché genre studio mondain.

De Vladimir Nabokov, l’hôte célébrissime du Montreux-Palace, à Noël Coward en son castel des Avants, en passant par Stravinski, Kokoschka, Garcia Marquez et tant d’autres nobélisés ou nobélisables, ils sont là comme autant de présences tutélaires, chacun saisi avec son rayonnement personnel. Somerset Maugham, en contre-plongée, a l’air d’un vieux bonze asiate momifié à peau de lézard. La silhouette noire du génial Ezra Pound, proscrit et sombré au tréfonds de la déprime silencieuse, s’éloigne dans une venelle vénitienne accompagné d’un chat errant. Ou c’est Patricia Highsmith, en sa naturelle élégance d’éternelle vieille jeune fille bohème, qui siège les mains jointes, belle et perdue.
Ce qui frappe le plus, dans les portraits signés Horst Tappe, c’est la conjonction de la perfection formelle et de la vie frémissante, saisie au vol. Evitant à la fois l’anecdote et la pose désincarnée, le photographe est à la fois peintre dans ses compositions et sculpteur d’ombres et de lumières, sans que la recherche esthétique ne gèle jamais l’expression. Chaque portrait suppose une véritable rencontre, et c’est d’ailleurs cela même que Tappe a toujours recherché en priorité: la relation humaine.
Question technique, la boîte hautement perfectionnée, du point de vue optique, et discrète dans son maniement, du Haselblad, la « Rolls du reflex », est depuis longtemps son instrument définitif. Comme on s’en doute, en outre, un long apprentissage est à la base de son art.
Passionné de photo dès son enfance (à 12 ans il avait déjà son labo), Horst Tappe acquit les bases de son métier chez un maître artisan de sa ville natale de Westphalie, avant de suivre à Francfort les cours de Martha Hoeffner, représentante notable de l’esthétique du Bauhaus. C’est alors qu’il allait étoffer son bagage artistique en étudiant la composition et en faisant même de la peinture à l’imitation des maîtres anciens.
Au début des années soixante, une bourse lui permit ensuite de se perfectionner, en matière de reportage, à l’Ecole de photographie de Vevey, notamment auprès du Haut-Valaisan Oswald Ruppen. Evoquant cette arrivée en Suisse romande, Horst Tappe rayonne bonnement : « Après l’Allemagne d’Adenauer, si lourdement matérialiste, je me suis senti revivre au bord du Léman ! »

A l’occasion d’un séjour sur la Côte d’azur, une première rencontre lui permet de faire le portrait d’un écrivain de renom, en la personne de Jean Giono. On relèvera dans la foulée que le jeune homme est un passionné de lecture depuis son adolescence et qu’il rêve d’approcher les créateurs marquants de ce temps. Or ils sont encore nombreux à cette époque, et notamment sur la Riviera vaudoise, où vit le grand peintre Oskar Kokoscha, établi à Villeneuve et qui partagera volontiers son « lait », le scotch dont il use et abuse à l’insu de sa femme… Puis c’est à Rapallo et à Venise que le photographe va débusquer Ezra Pound, qui le chargera de transporter… ses urines jusqu’à Vevey où le fameux docteur Niehans est censé participer à sa réhabilitation physique.
D’une génie à l’autre, Horst Tappe découvre bientôt que Vladimir Nabokov est son voisin, qui l’invite à la chasse aux papillons sur les flancs du Cervin. C’est sous les trombes d’un orage, là-haut, qu’il prend une photo désormais célèbre du père de Lolita.
Autre document quasi légendaire : le portrait de Noël Coward siégeant sur une chaise curule sur fond d’ailes de plâtre largement déployées qui font du comédien anglais une sorte de hiérarque des légions célestes (ou lucifériennes), et dont l’intéressé fut si content qu’il invita le photographe à Londres, où sa secrétaire lui remit seize lettres de recommandation. En découlèrent autant de rencontres, parfois immortalisées, avec Ian Fleming, Alec Guiness ou John Huston.
Le prestige de son vis-a-vis n’est pas, cependant, ce que recherche essentiellement Horst Tappe. S’il est certes heureux d’avoir tiré le portrait (et quel !) de Pablo Picasso, il semble plus encore touché d’évoquer les circonstances familières, presque complices, de leur rencontre à Antibes. De la même façon, il ironisera sur le « grand cirque » de Salvador Dali, relèvera la grande gentillesse de Nabokov ou la prétention glacée de certains autres…
Diffusé dans le monde entier par l’agence Camera Press et de nombreux sous-traitants, le travail de Horst Tappe reste plutôt méconnu dans l’aire française, alors qu’il a exposé ses oeuvres en Allemagne, en Russie et en Suisse, notamment. Dernier signe de reconnaissance réjouissant : la présentation de son exposition morgienne par Charles-Henri Favrod, fondateur du Musée pour la photographie de l’Elysée.

Horst Tappe, Kokoschka. Editions Merian.

-
Le mariole de la tribu
Dans L’original, Yves Laplace campe un type de sexeur cynique qui « ba
 ise » le monde
ise » le monde
Le nouveau désordre mondial exalte, de toute évidence, une espèce inédite de relativisme “absolu”, si l’on ose dire, qui pousse d’aucuns à conclure que plus rien n’a d’importance et que seule la jouissance immédiate se justifie encore. Cette forme de carpe diem n’est guère originale, et pourtant, sur fond de bien-être généralisé et d’entropie existentielle, dans un monde où les “personnages”, et les vices autant que les vertus, se trouvent de plus en plus nivelés en dépit de leur sur-représentation sous forme d’”icônes”, la figure du Don Juan à la sauce actuelle, “sexeur” se targuant de “braver les tabous”, peut encore apparaître comme un symbole de liberté. Du moins cette idée oriente-t-elle le propos de L’Original, dernier ouvrage d’Yves Laplace à caractère explicitement autobiographique, qui fait alterner les dits de Bernard, rapportés par son “énervant” cadet, et le récit de celui-ci portant sur ses débuts en écriture.
Bernard Seigneur, présenté ici comme l’”original”, incarne à vrai dire une espèce assez souvent représentée dans les marges de la famille moyenne ou carrément populaire de notre pays. On sait, depuis Cendrars., l’importance des oncles dans les familles. A la vie régulière (et plate) des pères s’oppose le rêve aventureux des oncles. Il n’y a pas de père chercheur d’or, tandis que l’oncle peut trafiquer de l’ivoire, et le cousin bénéficie du même préjugé favorable. Dans le cas de L’original, le protagoniste tient à la fois du “bon type” et du “mauvais sujet”, mélange de jeune rebelle autostoppeur objecteur de conscience et de débrouillard tous azimuts consacrant ses paies d’infirmier au tourisme sexuel multinational avant la lettre. Son cousin Bernard révéla le football au futur arbitre Yves Laplace: on comprend donc la reconnaissance de celui-ci, sans le suivre pour autant dans la fascination qui le fait célébrer son aîné comme le parangon de l’homme libre.
Bernard, dit la Bernouille, se voudrait le représentant le plus à la coule de la tribu des Tanneurs. Marié quatre fois en moins d’un quart d’heure, il se targue d’avoir possédé plus de mille femmes sous toutes les latitudes. Passons sur ses goûts particuliers à la Houellebecq (il ne lui est de plus grande jouissance que d’éjaculer sur le visage de sa muse...), pour nous arrêter sur sa vision “métaphysique” du sexe. Bernard Seigneur considère ainsi que l’amour tient essentiellement à se “vidanger dans le vide”. Logiquement alors, la procréation lui semble une saloperie avérée. Comme un Cioran, il voit en la paternité un “crime”. N’est-ce pas d’un chic total ?
Lui qui n’a “aucune foi en la vie”, reconnaît cependant que certaines dames avortent plus volontiers que d’autres: “Les meufs ne sont pas toujours d’égoïstes femelles. Elles se plient si tu poses l’exigence et si tu abrèges l’explication”. On a les élégances qu’on peut...
Nihiliste soi-disant éclairé pour qui “la femme est un repas”, il dit, “ne pas connaître “d’être plus libre parmi les humains que l’aliéné dans sa chambre capitonnée”. Faut-il lui souhaiter, et à l’auteur, une bonne petite séance d’électrochocs ? Lui qui considère la femme occidentale comme “analphabète de son corps” et se demande s’il est un “plus grand désastre que d’être promu cadre chez Swissair”, dit aussi, en passant, qu’il a “toujours rêvé de la Femme sans la trouver” et qu’il n’a “aucune foi en la vie”.
Pourtant il semble se croire plus vivant que les autres, comme le lecteur, abusé par la vivacité du texte, pourrait le conclure à première approche. Mais au regard plus attentif, ce Bernard “sonne” froid, pur mec brandissant son sceptre phallique. Et finalement, méritait-il tant d’attention de le part de son cousin ? Le feuilleton est déclaré “à suivre”. Est-il sûr que ce soit une bonne idée ?
Yves Laplace. L’original. Stock, 227p.
-
Le réalisme critique de Jacques-Etienne Bovard
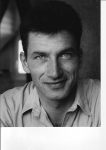
Dans Le pays de Carole, son septième ouvrage, le romancier détaille une double crise, conjugale et sociale, avec maestria.
Les écrivains romands ont-ils quelque chose à dire du monde qui les entoure ? Quels romans de nos auteurs, parus ces cinquante dernières années, s´intègrent-ils dans le tableau à facettes de ce qu´on pourrait dire un « miroir suisse romand »? Et pour ce qui touche au présent, ici et maintenant, est-il un ouvrage qui puisse être conseillé à un Huron de passage auquel on dirait: « Voilà, ce livre parle des gens de ce pays, il les montre tels qu´ils sont, il dit leurs aspirations et leurs doutes, leurs particularités, prenez et lisez ... »
Nous nous posons ces questions depuis des années, et notamment en observant, par effet de contraste, ce qui se passe dans les littératures étrangères, par exemple en Irlande qu´il nous semble connaître, sans y avoir jamais mis les pieds, grâce à des auteurs tels John MacGahern, Joseph O´Connor, Edna O’Brian et quelques autres.
Or, il est rare, dans le sillage lointain du Ramuz de Vie de Samuel Belet ou plus proche de quelques romancières significatives à cet égard (une Alice Rivaz, une Yvette Z´Graggen, une Anne Cuneo ou une Mireille Kuttel), qu´un livre paru récemment dans notre pays nous fasse l´impression d´exprimer l´atmosphère d´une terre, et la mentalité de ses gens, ou plus exactement le changement de mentalité et de mœurs en cours, avec autant de justesse — mélange de connaissance intime et de distance critique — que celle qui caractérise Le pays de Carole, cinquième roman de Jacques-Etienne Bovard, dont le regard et la plume se font soudain plus aigus et plus graves.
Ce livre rend compte, en effet, d´une mutation profonde, qui affecte notre communauté et l´atomise de multiples façons. C´est le roman d´une crise du couple, sur fond de rupture culturelle profonde. C´est cependant bien plus qu´un document psycho-existentiel sur la dérive de deux trentenaires, ou qu´une analyse sociologique des déboires de la petite paysannerie à l´ère de la globalisation: c´est un roman d´amour lancinant et le tableau en pleine pâte d´un pays, une galerie de portraits vivants, une suite d´observations incisives sur une société où tout a l´air de se déglinguer et, entre les lignes, une méditation sur le sens de la vie que nous menons dans nos cages d´écureuils hyperactifs — plus précisément encore sur le travail créateur.
Au moment où Paul, bientôt 34 ans, commence à tenir ce journal sur son « portable » (telle étant la modulation formelle du livre) pour « faire le point », le couple qu´il forme avec Carole depuis huit ans se trouve « enlisé » alors qu´un « gros truc silencieux » les sépare. Tandis que la jeune femme, indépendante et ambitieuse, se démène à l´hôpital, où elle va bientôt passer son FMH, Paul vit tant bien que mal sa condition d´homme au foyer, incarnant « le nouveau mec postrévolution féministe » sous le regard plus ou moins narquois de ses voisins.
Car, il faut le préciser, Paul le Lémanique s´est laissé entraîner dans « le pays de Carole », ce Haut-Jorat « lumineux et secret » où l´on dit volontiers que le « beau menace », peuplé de paysans taiseux et « rumineux » dont la condition est en train d´en prendre un rude coup. Malgré sa foncière bonne volonté et la franche tendresse qu´il voue à ces hautes terres (superbement évoquées par l´auteur, soit dit en passant) et à leurs habitants, ceux-ci ont quelque peine à prendre Paul au sérieux, toujours à se « royaumer » et à faire des tas de photos, tant il est vrai que notre homme a des penchants artistes. Du moins ce « grand gentil » sait-il aussi se rendre utile, et puis on appréciera tantôt qu´il ait réalisé de si beaux portraits photographiques du vieil Albert, juste avant le décès d´icelui, puis des vaches de John, quitte à lui reconnaître, en prime, un réel talent.
L´impression que tout se disloque est accentuée, encore, par le malaise généralisé régnant dans les familles, où les parents ont frayé la voie du divorce, si l´on peut dire. Avec autant d´acuité que de sensibilité, et complètement dégagé d´une raillerie plus extérieure caractérisant naguère ses Nains de jardin, Jacques-Etienne Bovard évoque l´éclatement de la cellule familiale tout en soulignant le besoin d´affection ou de reconnaissance des uns et des autres. A cet égard, les retrouvailles, à la fois pudiques et « éloquentes », de Paul et de son navigateur de père en virée sur le lac avec leur bateau retapé, sont un des moments forts du livre.
Cela étant, le noyau de celui-ci reste la relation de Paul et Carole, momentanément brisée par une infidélité de celle-ci, qui va suivre son « patron » aux Etats-Unis en faisant valoir un beau projet « scientifique ». La situation pourrait relever du cliché de téléfilm, mais les personnages de Bovard n´ont rien de pantins sans entrailles, et c´est avec beaucoup d´empathie qu´il traite cette relation déliquescente. Instinctif et terrien, Paul choisit pourtant de rester dans le pays de Carole, après le départ de celle-ci, où il compensera son chagrin par un travail artistique acharné et de plus en plus porteur de sens et de beauté. Quant au dénouement, nous laisserons au lecteur la surprise de le découvrir ...
Il faut en revanche souligner, avec insistance, la progression remarquable de l´écrivain dans sa maîtrise de la narration et du dialogue, la subtilité qui préside à son observation des rapports entre hommes et femmes ou entre générations, la foison de détails portant sur la vie quotidienne, l´économie, la politique, le sexe ou les sentiments, enfin la bienveillance profonde qu´il manifeste à l´égard de tous ses personnages et le souffle de pureté qui rapproche finalement les deux protagonistes, également épris de liberté et désireux d´échapper aux accommodements médiocres. Jacques-Etienne Bovard a certes passé le cap de la quarantaine, mais il conserve une fraîcheur singulière, mélange de candeur et de bonne foi, qui rejaillit sur ses personnages et le climat intérieur de ce beau roman de maturation.
Jacques-Etienne Bovard. Le pays de Carole. Bernard Campiche, 276 pp. Du même auteur, Demi-sang suisse vient d´être réédité dans la collection CamPoche.
-
Marchands de bonheur
Il y a plus de vingt ans qu’ils ont cessé d’enchanter leur public - leur dernier concert date de janvier 1982 -, et pourtant le souvenir des Frères Jacques pétille toujours dans les mémoires, relancé en 1996 par un formidable hommage collectif où Ricet-Barrier, le groupe T.S.F. et diverses autres formations (ChansonPlus Biflu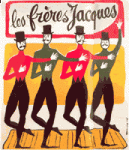 orée, Orphéon Celesta, le Quatuor, etc.) reprirent, devant les quatre vieux compères pétulants à souhait, quelques-unes de leurs chansons, toujours aussi riches de virtualités humoristico-poétiques. C’est d’ailleurs sur ce concert au Casino de Paris, après l’autre manifestation de reconnaissance des Molière fêtant leur cinquantenaire, que s’achève la série « historique » que Pierre Tchernia présente ici sur le deuxième disque de cet indispensable hommage aux Frères Jacques.
orée, Orphéon Celesta, le Quatuor, etc.) reprirent, devant les quatre vieux compères pétulants à souhait, quelques-unes de leurs chansons, toujours aussi riches de virtualités humoristico-poétiques. C’est d’ailleurs sur ce concert au Casino de Paris, après l’autre manifestation de reconnaissance des Molière fêtant leur cinquantenaire, que s’achève la série « historique » que Pierre Tchernia présente ici sur le deuxième disque de cet indispensable hommage aux Frères Jacques.
Retour donc sur 36 ans de chansons, dès le lendemain de la guerre (1946), durant lesquels les compagnons (deux frères seulement, André et Georges Bellec, François Soubeyran et Paul Tourenne), entourés de fidèles amis de la première heure (Yves Robert notamment), allaient perpétuer une formule assez vite constituée par de jeunes gens libérés des armées et se retrouvant à Paris à l’enseigne de Travail et Culture, visant d’abord les comités d’entreprise. Evoquant cette genèse, Paul Tourenne raconte que les quatre lascars ont commencé à fredonner les chansons de feux de camp, d’auberge, de route ou de folklore qu’ils connaissaient, y ajoutant des negro spirituals alors en vogue. D’abord avec des foulards rouges et des chaussures de raphia, ensuite en collants, d’apparitions à la radio en concerts, le quatuor allait bientôt trouver son nom à l’imitation des quatuors américains (Brothers X et Sisters Y…) et se trouver mêlé à un spectacle musical à grand succès, en août 1945, intitulé Les gueux au paradis, avec une première chanson bien d’époque : « Nous sommes quatre compagnons/Nous avons fait le tour du monde », etc. Le premier document filmé où apparaissent Les Frères Jacques ne date cependant que de 1957, qui les montre en footballeurs jouant un tableau animé (et chantant) du Douanier Rousseau !
Quant au « graphisme » typique du quatuor, exercé devant un miroir, il va cristalliser autour d’une première chanson marquant aussi le début de l’inspiration comique du groupe, intitulée L’entrecôte. Le costume, stylisé par Jean-Denis Malclès, va compléter l’image aujourd’hui mythique des Frères Jacques, avec collant (rembourré au bon endroit) et gilet, chapeaux à transformations et (rares) accessoires. Suivra l’arrivée, décisive elle aussi, du pianiste-compositeur Pierre Philippe, qui va les driller férocement, leur imposant des répétitions de solfège à n’en plus finir. Un extrait filmé de La gavotte des bâtons blancs, datant de 1958, montre que le quatuor est alors « sur orbite », prêt à entamer sa vie au cabaret, au music-hall, à la télévision et autour du monde.
A l’enseigne de La Rose Rouge, les Frères Jacques vont devenir ensuite des figures marquantes de Saint-Germain-des-Prés, aux côtés de Boris Vian ou de Juliette Gréco, bientôt conduits vers Jacques Prévert (Barbara) par Jacques Canetti, avant d’autres complicités nouées : avec Ricet-Barrier, Gainsbourg (Le poinçonneur des lilas), Francis Blanche ou jean Cosmos. Avec beaucoup d’humour, Paul Tourenne raconte à Tchernia comment, pour composer leur programme lui et ses compères attribuaient des rubans de couleur à chaque chanson en fonction de sa tonalité, répartissant ensuite les rubans par terre en quête de la bonne harmonie. Autre astuce : la « troisième pédale » accrochée sous le piano, permettant au pianiste d’ordonner environ 110 changements de lumière. Et cette révélation piquante : que la chanson Méli-mélo, composée par le chanoine suisse Bovet, fut choisie comme entrée en matière systématique du fait de son incompréhensibilité totale (quatre textes différents qui s’entremêlent pour déboucher sur une seule phrase répétée) permettant aux spectateurs tardifs de s’installer sans gêner le public…
Belle histoire de copains que celle des Frères Jacques, qu’on voit ici jusque dans leurs retraites respectives. Mais les voici chanter sur scène : formidables de musicalité et de finesse, d’élégance gestuelle et de comique, à voir et revoir ici en public (28 enregistrements) ou en studio (15 de plus) constituant un florilège d’humour (La queue du chat, Les fesses, Les tics, La confiture), d’observation mordante (Le fric, Chanson sans calcium) ou de poésie (La lune est morte, Les boîtes à musique), à la fois populaire et raffiné à souhait. Du bonheur qui ne se flétrit pas.
Les Frères Jacques. Avec Pierre Philippe ou Hubert Degex au piano. Réalisation Pierre Tchernia. 2 DVD. RYM VIDEO.
« Athlètes complets de la chanson »
1945 : Création du groupe.
1950-1958 : Rencontre décisive avec la compagnie Grenier et Hussenot. Pierre Philippe devient leur pianiste. Jean-Claude Malclès invente leur costume. Figures célèbres de Saint-Germain-des-Prés.
1982 : Dernier concert. Raymond Barrat leur consacre une émission référentielle à la TSR : « Salut les frères Jacques ».
1996 : Molière et hommage au casino de Paris.
Les Frères Jacques, en 36 ans et 7500 représentations, ont usé 1300 paires de gants, 450 collants et 140 paires de chaussures…