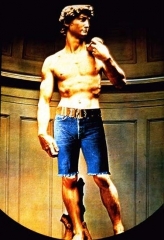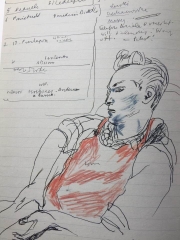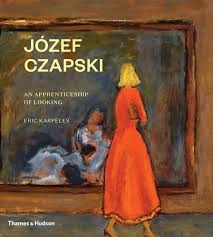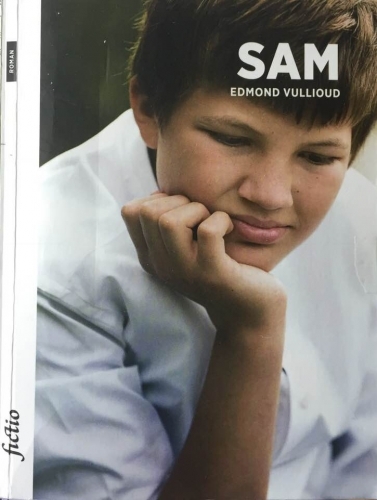Entretien avec Gaston Cherpillod.
Gaston Cherpillod, au tournant de ses 85 ans, n’a rien perdu de sa sainte colère de révolutionnaire, ni de sa verve de poète. Né en 1925 dans une famille d’ouvriers, poussé par son père aux études et devenu lui-même professeur, il fut de la Promotion Staline, comme l’indique le titre d’un de ses livres, et viré de l’enseignement pour cela même. Avec Le Chêne brûlé, qu’il publia en 1969 la quarantaine passée, il s’imposa par la force et la singularité d’une voix en marge de la littérature « bourgeoise», après un essai d’inspiration marxiste consacré à Ramuz l’alchimiste (1958).
Ayant rompu avec le Parti ouvrier populaire en 1959, de plus en plus critique envers la gauche institutionnelle et les mouvances contestataires issues de mai 68, Gaston Cherpillod est toujours resté actif dans les marges de la Cité, à l’extrême-gauche proche des Verts. Dans son œuvre, cependant, la célébration de l’Eros, au sens très plein, passe avant le discours politique. Le trait polémique le dispute à la confession candide au fil d’une vaste chronique autobiographique où la plus tendre empathie (surtout marquée à l’égard des humbles) va de pair avec la rage du moraliste resté fidèle à l’idéal foulé au pied par ses anciens camarades. Les étapes marquantes de cet ensemble kaléidoscopique seront le récit d’Alma Mater (1971), les nouvelles du Gour noir (1972), le roman plus ambitieux, peut-être son chef-d’œuvre, que représente Le Collier de Schanz (1972), suivi de nombreux autres livres frappés au même sceau d’un style sans pareil, à la fois puissant et chantourné, mêlant une façon de verve populaire et de recherche précieuse.
Or ce qui nous semble caractériser la démarche et l’écriture de Gaston Cherpillod est cette «manipulation alchimique» dont il parle lui-même, consistant à transmuter son expérience vécue en légende, au fil d’une opération qui engage à la fois la porosité fluide du poète et les tours de mains de l’infatigable artisan des lettres. Il y a du mystique inspiré et du croisé rouscailleur chez cet empêcheur de lénifier en rond, de l’aristocrate chez ce fils de prolétaires jamais guéri des humiliations subies par les siens - du contemplatif et du juste aussi.
- Qu’évoque pour vous le mot de carrière ?
- Le mot carrière, pour moi, n’a aucun sens. Un écrivain, ou un artiste, fait une œuvre, qui est reçue, ou pas. La mienne a été plutôt fraîchement accueillie. Je ne demanderais pas mieux que d’être considéré - je ne suis pas un monstre, n’est-ce pas ? Mais mon aspect rédhibitoire a voulu qu’on se signât à ma seule vue, naguère. Aujourd’hui l’on s’en fout. Mais on ne se refait pas. À ce propos, quand on me demande, non sans reproche, pourquoi j’ai tout le temps les yeux fixés sur les vilenies des hommes, je réponds que je ne peux pas m’en abstenir pour complaire à ma prochaine ou mon prochain. C’est comme ça. Et puis j’objecte qu’il n’y a pas que ça dans mes livres : il y a le rire aussi, il y a la tendresse, il y a les jaculations érotiques, il y a les merveilles de la nature et de la vie. Mais pour en revenir à la carrière, je dirais que l’œuvre a tous les droits, et quant à l’homme, il n’a qu’à s’en arranger. Ai-je voulu devenir écrivain ? Je dirais plutôt que j’ai eu le courage, que j’appellerais la vertu, au sens latin, de ne pas refuser ce qui se présentait bel et bien comme une vocation. Pourtant je dirais un peu brutalement que ce n’est pas moi qui ai choisi la vertu mais que c’est elle qui m’a choisi.
- Qu’est-ce qui vous a valu d’être chassé de l’enseignement ?
- Au cœur de la guerre froide, on m’a demandé de choisir entre mes convictions et l’idéologie bourgeoise dominante, et sans nuances, à l’allemande : vous vous rendez ou vous vous en allez. Donc je m’en suis allé.
- Qu’est-ce qui vous dégoûte aujourd’hui encore ?
- Deux choses : d’abord la cupidité, qui se répand de plus en plus et qu’on caresse de tous les côtés. Jetez un œil sur cette infâme émission télévisée, soutenue par la Loterie romande et animée par un certain Jean-Marc Richard (1) : c’est d’une ignominie rare. Cette façon dont le public, qui n’est plus un peuple, se jette sur le pognon, me fait bonnement vomir. Quand je pense à tous ceux, dont je ne suis d’ailleurs pas, qui ont tant de peine à survivre, et que je vois ces enfarinés ramasser 50.000 balles en un soir à ne rien faire du tout, je me sens bouillir. Et puis il y a, aussi, cette volonté de plus en plus affirmée de ne rien apprendre, qui me semble une crucifixion pour un homme de pensée et de sentiment. Cela me semble prouver, autant chez les dominants actuels que dans ce qu’on appelle le peuple, qu’on n’a plus aucun sens du futur ! Un livre qui se vend aujourd’hui à 500 exemplaires deviendra peut-être, demain, un classique. Après ça, il est facile de se gausser de ceux qui n’ont pas reconnu Stendhal en son temps…
- Croyez-vous au Diable ?
- Je suis, religieusement parlant, presque un juste. Il est vrai que le Diable ne m’a jamais fait l’honneur de paraître, mais il est probable qu’il y ait un redoutable principe du Mal qui nous inspire, en masse et en détail, depuis notre enfance. Ce qu’il y a de sûr, en tout cas, c’est que j’ai rencontré dans ma vie des méchants constitutionnels. Malgré ce que disaient les Anciens, il y a des gens qui font le Mal pour lui-même, avec délectation. On dit que les hommes sont mauvais, par intérêt ou par passion : c’est en somme excusable. Mais j’ai vu des gens, et parfois de mon sang, faire le mal pour le mal en choisissant leur victime - un enfant par exemple ! Et puis il y a ceux qui font du mal en se cachant derrière une institution, comme on la vu sous le nazisme. L’esprit diabolique est là ! Bernanos a saisi cette présence mais Barbey d’Aurevilly (2), dans ses Diaboliques certes admirables, y a échoué.
- Vous sentez-vous des accointances avec Léon Bloy (3) ?
- Ce que j’aime chez Bloy, c’est sa folie. Son absence totale de concessions, qui va jusqu’à l’injustice, voire jusqu’au crime littéraire. Au moment où meurent Hugo ou Vallès, il se déclare heureux que la Terre soit débarassés de ces deux charognes. Léon, tout de même…
<image001.jpg>- Baudelaire a-t-il compté pour vous, alors que votre « maître » Jules Vallès (4) le vomit…
- Vallès n’a rien compris à Baudelaire, ni rien compris à la poésie en général, Pour moi, Baudelaire a énormément compté quand j’étais jeune, et puis il y a eu le grand coup de balai du début du XXe siècle avec Rimbaud et les surréalistes, mais c’est un très grand poète, incontestablement, qui tient le coup alors que je ne trouve plus que deux ou trois poèmes supportables de ce faux-cul catholard de Verlaine. Ceci dit, je trouve que Baudelaire ne sait pas parler d’amour. Mais quel visionnaire fabuleux quand il parle de la mort ! Il y a chez lui un ton jamais entendu et, par exemple dans L’Invitation au voyage, de merveilleuses illuminations…
- Aimez-vous la chanson, vous qui connaissez des milliers de vers par cœur ?
- Je considère la chanson comme un art en soi, tout à fait distinct de la poésie. A cet égard, il y a quelqu’un que je n’aime pas, figurez-vous, et c’est Georges Brassens, anar de salon et bâtard des deux genres. Mais il y a de vrais génies de la chanson, et notamment en France, de longue tradition, jusqu’à un Trenet qui a peut-être eu le tort de ne pas s’arrêter sur La Mer, et Ferré que je respecte plus que Brassens pour sa personnalité et ses vraies convictions, enfin il y a aussi le grand Brel dont les chansons dégagent une vraie poésie sans être des poèmes…
- Quels sentiments vous inspirent les trois auteurs romands les plus considérés que sont Maurice Chappaz, Georges Haldas ou Jacques Chessex ?
- Il y a un vrai poète en Maurice Chappaz, mais il ne faut pas me parler de son Portrait de Valaisans, d’un folklorisme aussi douteux que celui du Portrait des Vaudois, ni de son verbeux Evangile de Judas. Pour Chessex, un journaliste qui le haïssait m’a appelé six fois après sa mort pour aller clamer ma joie, mais je ne danse pas sur les tombes. J’eusse juste pissé, volontiers, sur celle d’Yves Montand, mais c’était au Père-Lachaise, trop loin de chez moi. Quant à Chessex, je l’ai trouvé bon prosateur sous-érotique dans Carabas, après quoi je n’ai guère suivi le développement de ses écrits, et puis un pornographe répond en somme à la demande actuelle de tous ceux qui ont la trouille du véritable Eros dans lequel on n’engage pas que sa vie et son corps mais aussi son âme !
<image002.jpg>- Parlons alors de l’âme de Georges Haldas…
- De Georges Haldas, j’ai aimé les chroniques, comme Boulevard des Philosophes, en hommage à son père, notamment. Mais j’ai été gêné, par la suite, de voir l’ancien compagnon de route des communistes abjurer un totalitarisme, comme je l’ai fait moi aussi, pour en embrasser un autre, en l’espèce du catholicisme, ce parangon mondial du totalitarisme. Et puis une certaine exaltation de la Présence, avec un grand P, chez Haldas, m’agace en cela que l’homme est aussi un être de la fuite, du manque, du rêve, de l’obsession, de l’indifférence à l’autre et de la solitude - et tout cela nous constitue ! Mais il y a bien pire dans la bondieuserie, et je la trouve dans nos partis de gauche, par exemple chez notre cher Joseph Zysiadis (5), théologien fondu en démagogie qui a voulu nous vendre les Jeux olympiques ! De fait, quel pire avatar de l’opium du peuple, je vous le demande, que le sport mercantile ? En d’autres temps, pareille forfaiture eût valu à ce Pantalon les foudres et l’exclusion de nos chers Bolchos locaux Muret (6) ou Vincent (7), dont j’ai subi les foudres ! Or j’ai plus de respect et plus de tendresse pour un Jean Ziegler qui, dans le domaine politico-financier, est un polémiste magistral. On me dira que ça fait une belle jambe au peuple, dont on me dira qu’il n’a pas accès à la culture, mais je répondrai, moi fils d’ouvrier et de servante, que le peuple d’aujourd’hui se complaît lui-même dans son ignorance ! J’ai connu une époque où des gens qui n’avaient que peu de moyens financiers et qui n’avaient passé que par l’école primaire, absorbaient avec ferveur les chefs d’œuvre du temps présent ou passé en sorte de mieux damer le pion au bourgeois. Mais je sais que ce souci est toujours une minorité qui ne s’est pas soucié que de son ventre et de son bas-ventre, et je ne serai pas l’homme à tirer l’échelle derrière lui, ignorant d’ailleurs ce que sont et ce que font les jeunes gens d’aujourd’hui. Et puis il y a tout ce qui se passe dans le reste du monde, loin de nos pays de nantis amortis, qui me rend un peu d’espoir. Je découvre ainsi tel grand auteur turc, ou tel romancier négro-africain, latino-américain, et je salue !
- Et Ramuz ?
- Je ne suis pas dupe de la vénération académique qui le ressuscite pour mieux l’embaumer, mais les nouvelles de Ramuz, je ne citerai que Le cheval du sceautier ou Mousse, sont d’un pur génie - d’une profondeur de sentiment sans pareille.
- Vous avez dit être « presque un juste ». Qu’entendez-vous par là ?
- Je dirai qu’un juste est quelqu’un qui ne supporte pas que ses semblables soient traités comme des objets. Un juste sait qu’il est un cannibale involontaire. Qu’il profite, quelle que soit sa peine, quelle que soit sa probité, du malheur de la majorité. Cela fait partie de notre situation historique : on l’admet ou on en est consterné. Le juste en est consterné. Pour ma part, si l’espoir de voir le monde s’améliorer pour les hommes, en égalité et en savoir, devait passer par la restriction de mon très modeste train de vie, je l’accepterais avec des pleurs de joie. Hélas, je crois que je ne risque rien pour le moment…
Notes
1) Jean-Marc Richard. Animateur de radio et de télévision très populaire en Suisse romande. Le jeu télévisé en question s’intitule La Poule aux œufs d’or.
2) Jules Barbey d’Aurevilly. Ecrivain et critique français (1808-1889) majeur . Romancier et nouvelliste, auteur des Diaboliques et d’Une vieille maîtresse, notamment. Son approche métaphysique de l’érotisme et du mal est proche de Baudelaire.
3) Léon Bloy. Ecrivain et penseur français de la droite catholique anarchisante. Romancier (La femme pauvre) et essayiste, il a signé les pamphlets les plus virulents contre l’esprit bourgeois, dont l’Exégèse des lieux communs. Son travail d’orfèvre sur la langue évoque parfois celui de Cherpillod.
4) Joseph Zysiadis. Politicien vaudois. Théologien de formation, il a siégé au plus haut niveau cantonal et suisse du Parti ouvrier populaire (POP). Conseiller national.
5) André Muret. Figure marquante du communisme vaudois, représentant du Parti Ouvrier Populaire (POP) à la Municipalité de Lausanne, et conseiller national.
6) Jean Vincent. Figure marquante du communisme genevois, membre fondateur du Parti suisse du travail.
Pour lire Gaston Cherpillod
Une voix parmi d’autres…
« En tant que tel, le scribe n’agit point. Son efficacité ? Incommensurable ; en tout cas, médiate. Quelquefois, il incite à la mise en cause pratique. Son monde imaginaire alors provoque à la reconstruction du monde réel. Moi, je ne pèche point avec les belles-lettres.» Telle est, crâne, la profession de foi de l’écrivain dans le collectif Pourquoi j’écris, recueil de dix-neuf témoignages paru à l’enseigne de La Gazette Littéraire, en 1971, avec une préface de Franck Jotterand. Le texte a été repris dans Album de famille. (cf. ci-dessous).
Le rebelle déclaré
On redécouvre une Suisse insoupçonnée, à tout le moins oubliée de nos jours, dans ce premier récit autobiographique de l’écrivain né en milieu ouvrier, dont la mère et le père s’échinaient à travailler dur sans parvenir à nouer les deux bouts. Su ce fond d’âpre nécessité, qu’adoucissent cependant les sentiments et les valeurs défendus par les siens, l’auteur raconte, dans sa langue à la fois directe et chantournée, lyrique et rebelle, son parcours de fils de prolétaire accédant à l’Université, dont l’engagement (au POP de 1953 à 1959) lui vaudra l’exclusion de l’enseignement public.
Le Chêne brûlé. L’Age d’homme, coll. Poche suisse, No 14.
Maître de l’autofiction
Au nombre des ouvrages de Cherpillod relevant de l’autobiographie romancée, tel Alma Mater (1971), ce roman-autofiction constitue sans doute la ressaisie la plus ample des expériences sociales, professionnelles, littéraires et « privées » de l’écrivain, avançant ici sous le masque de François Péri. Tableau vivant et souvent mordant de la « société-fric » d’une époque, où la place de l’écrivain est en question, Le collier de Schanz est également une plongée dans les profondeurs de la relation érotique, au sens le plus large, entre homme et femme, et une belle évocation de l’amitié. À relever aussi la fusion constante de l’univers verbal du poète et de l’environnement naturel omniprésent.
Le collier de Schanz. L’Age d’Homme, collection Poche suisse, No 121.
Sourcier de mémoire
Gaston Cherpillod n’a jamais vraiment été romancier, au sens d’une narration « objective » à multiples personnages. Plutôt chroniqueur de faits vécus, mémorialiste minutieux, il excelle dans le portrait acéré et parfois adouci par la tendresse, autant que dans l’évocation lyrique ou la bouffée gaillarde. Souvenirs du militant de gauche ou de l’enseignant, démêlés sociaux ou professionnels avec les philistins du conformisme bourgeois ou de la bureaucratie, retours de mémoire en multiples méandres, mélancolie du « conjoint survivant » et de l’éternel amoureux se rappelant les « minutes heureuses » de sa jeunesse : il y a de tout cela dans ce recueil de quatre récits reliés les uns aux autres par un acharné travail de mémoire.
Une écrevisse à pattes grêles. L’Age d’Homme, coll. Poche suisse, No 208.
Le mémoraliste
Le titre de ce recueil d’une quarantaine de textes annonce-t-il une remémoration parentale ? Nullement. La famille est ici politique et poétique, et le propos relève de l’explication plus que de l’implication. Sous l’égide de Politica, l’écrivain y salue d’abord Davel, le héros (récupéré) de l’indépendance vaudoise, que Cherpillod compare au prêtre et guerillero Camillo Torres confondant la cause des opprimés et celle du Seigneur. « Je suis et reste un vieux républicain », affirme-t-il ensuite en « fils d’esclave » affranchi, qui tend parfois à se répéter dans son plaidoyer pro domo de rebelle incompris. À L’enseigne de Poetica, en seconde partie, les thèmes de la désillusion politique cèdent le pas aux préoccupations du littérateur « poète et paysan » avec une révérence appuyée aux dames de son cœur .
Album de famille. L’Age d’Homme, 1989.
Le conteur
C'est bien « le » cloche de Minuit qu’il faut lire, désignant un clochard, un « guenillard » se tenant à la porte d’une église, le soir de Noël, auquel l’agnostique Pimor « file dix balles » alors que les bons chrétiens regardent ailleurs. La nouvelle éponyme, dernière d’une douzaine, évoque celles que Léon Bloy a réunies dans Le sang du pauvre. La comparaison ne vaut pas toujours, hélas, pour le style, parfois à la limite du galimatias: « L’hôpital non plus n’était le lieu où les pauvres étaient accueillis au son des fifres dont l’exaltation se communiquait des apprentis-cadres aux badauds qui s’étaient massés sur le parcours qu’emprunta le cortège dont l’incision de son abdomen, récente, l’évinçait, Michaël »…
Le cloche de Minuit et autres contes. L’Aire, 1998.
Le poète « classique »
Après qu’il eut publié deux sonnets de forme toute classique dans l’Almanach du Groupe d’Olten, l’un de ses pairs écrivains lui reprocha ces « futiles, voire coupables essais », mais Cherpillod n’en a pas moins persisté et signé dans cette lignée quadri-centenaire dont Baudelaire a marqué le dernier sommet. Or, cette trentaine de sonnets va bien au-delà du vain exercice de style, où le poète se joue d’une forme rigoureuse avec un peu plus que de la virtuosité : de la grâce. Ainsi du premier quatrain de ce Souvenir d’enfance : « Mes douze ans sont entrés sur la pointe des pieds / Ce n’est là cependant qu’une triste demeure / Mais le vieillard qui veut que son trésor ne meure / Ne distingue plus trop l’église du clapier »…
Idées et formes fixes. Sonnets. L’Age d’Homme, 2001.



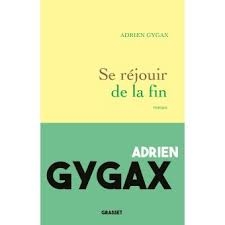

















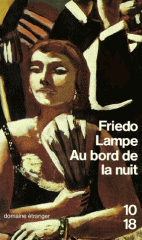
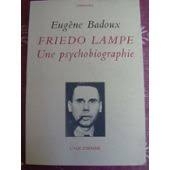
 À plusieurs reprises, en lisant les deux romans et les récits de Friedo Lampe, nous avons pensé au Fellini des souvenirs autobiographiques, dans Roma et Amarcord notamment. Sans pousser la comparaison trop loin, disons que la liberté de narration du cinéaste italien s'apparente à celle de Friedo Lampe, alors que celui-ci témoigne de la même attention aux êtres, de la même acuité d'observation, de la même gentillesse ironique: nous pensons en particulier aux scènes du cabaret, dans Au bord de la nuit (un catcheur tombe amoureux de son huileux adversaire; un gosse est exploité par son père hypnotiseur, etc.), à la part faite à l'enfance et à l'adolescence, ou au merveilleux qui entoure le départ de l' Adélaïde dont les sirènes, entendues de toute la ville, rappellent l'apparition fabuleuse du paquebot dans Amarcord.
À plusieurs reprises, en lisant les deux romans et les récits de Friedo Lampe, nous avons pensé au Fellini des souvenirs autobiographiques, dans Roma et Amarcord notamment. Sans pousser la comparaison trop loin, disons que la liberté de narration du cinéaste italien s'apparente à celle de Friedo Lampe, alors que celui-ci témoigne de la même attention aux êtres, de la même acuité d'observation, de la même gentillesse ironique: nous pensons en particulier aux scènes du cabaret, dans Au bord de la nuit (un catcheur tombe amoureux de son huileux adversaire; un gosse est exploité par son père hypnotiseur, etc.), à la part faite à l'enfance et à l'adolescence, ou au merveilleux qui entoure le départ de l' Adélaïde dont les sirènes, entendues de toute la ville, rappellent l'apparition fabuleuse du paquebot dans Amarcord.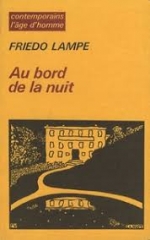


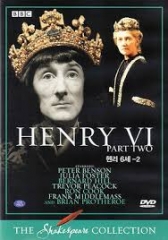






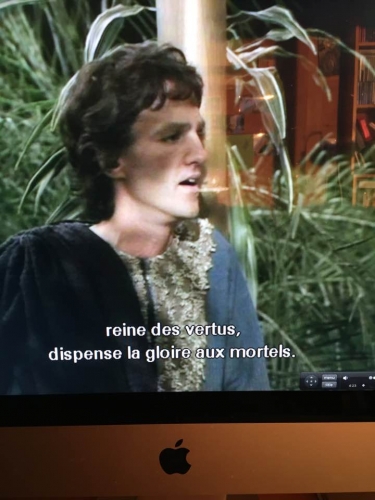

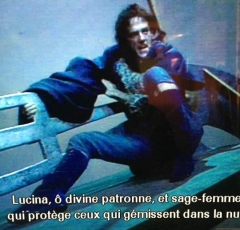



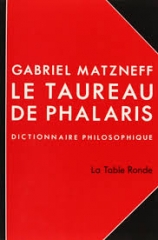
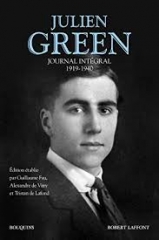








 CORINNE LA DINGUE. - Corinne Desarzens , dans une page de son journal, raconte par exemple comment un gosse probablement grec et bronzé se soulage sous un arbre méridional, et cela donne là encore des phrases qui vivent.
CORINNE LA DINGUE. - Corinne Desarzens , dans une page de son journal, raconte par exemple comment un gosse probablement grec et bronzé se soulage sous un arbre méridional, et cela donne là encore des phrases qui vivent.