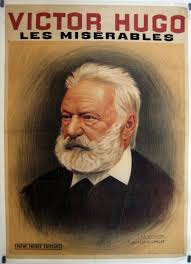
Simon Leys écrit, à propos des Misérables, que c’est « moins un roman, au sens conventionnel du mot, qu’un immense poème en prose, peut-être la dernière (sinon la seule) épopée de l’âge moderne. La passion que Hugo nourrissait pour la langue a trouvé là son déversoir le plus vaste et le plus fou. Le livre est un Niagara de mots, écumant et mugissant ; c’est aussi une ahurissante bigarrure de piècesrapportées : non seulement le fil du récit est constamment interrompu par des considérations socio-politico-philosophiques, mais il y a encore d’innombrables morceaux de comédie, de drame, de satire, des épisodes d’une action haletante ; il y a de tendres élégies, des croquis réalistes,d’immenses fresques historiques ; des essais sur le sujets les plus hétéroclites (la structure de l’argot, l’économie du recyclage des égouts), un prodigieux étalage de curiosités encyclopédiques (sur un modèle dont Jules Verne se souviendra), et en même temps, ces mille fragments hétérogènes sont charriés par l’élan unanime d’une vaste fleuve aux affluents innombrables ».
°°°
À partir d’un certain moment, le roman devient un entonnoir où tout se trouve aspiré pour être traité et transformé. J’en suis à ce moment avec La Vie des gens.
°°°
 Victor Hugo :« Propos de table et propos d’amour : les uns sont aussi insaisissables que les autres ; les propos d’amour sont des nuées ;les propos de table sont des fumées ».
Victor Hugo :« Propos de table et propos d’amour : les uns sont aussi insaisissables que les autres ; les propos d’amour sont des nuées ;les propos de table sont des fumées ».
Et ceci à mettre en face des considérations un peu sentencieuses (mais combien justifiées pourtant) de Jean Clair décriant les jeux de mots plus ou moins débiles qui affectent les titres des journaux : « Le calembour est le fiente de l’esprit qui vole. Le lazzi tombe n’importe où ; et l’esprit, après la ponte d’une bêtise, s’enfonce dans l’azur. Une tache blanchâtre qui s’aplatit sur le rocher n’empêche pas le condor de planer. Loin de moi l’insulte au calembour. Je l’honore dans la proportion de ses limites ; rien de plus »
Du moins Jean Clair a-t-il raison, dans son Journal atrabilaire, de s’en prendre à l’abus abrutissant des jeux de mots dans les titres à la manière de Libé, qui finissent par tout tourner en dérision à l’enseigne d’un perpétuel ricanement. Et de fustiger le très digne Figaro littéraire qui croit malin de saluer la parution des écrits sur l’art de Malraux par ce titre en effet imbécile :« Malraux brandit les temps d’art »…
Mais le cher Hugo remet les choses en plus souriante perspective : « Tout ce qu’il y a de plus auguste, de plus sublime et de plus charmant dans l’humanité et peut-être hors de l’humanité, a fait des jeux de mots. Jésus-Christ a fait un calembour sur saint Pierre, Moïse sur Isaac, Eschyle sur Polynice, Cléopâtre sur Octave,etc.
°°°
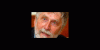 Simon Leys à propos des Misérables : « Sa nature même aurait dû condamner un tel ouvrage à demeurer intraduisible. Et pourtant il fit bientôt partie de l’imaginaire universel, touchant des millions de lecteurs dans des douzaines de langues différentes. Quel mystérieux pouvoir habite donc l’original, pour qu’il réussisse à survivre à des traductions parfois maladroites, et à conserver son rayonnement, même dans des formes simplifiées ou mutilées ? Les Misérables possèdent une puissante dimension mythique qui s’alimente aux sources profondes de notre commune humanité. C’est de la littérature populaire – dans le sens où Homère est de la littérature populaire : une littérature qui s’adresse aux hommes de tous les temps et de toutes les cultures. Le livre fut d’abord publié à Bruxelles (1er avril 1862) ; d’autres éditions suivirent rapidement, de façon presque simultanée, à Paris, Madrid, Londres, Leipzig, Milan, Naples, Varsovie, Saint-Pétersbourg, Rio de Janeiro. D’emblée, son succès fut universel ; la publication originale avait été retardée à l’imprimerie par les larmes des typographes qui s’étaient plongés dans la lecture des pages dont ils devaient composer les épreuves ; leur émotion et leur enthousiasme furent bientôt partagés par les lecteurs les plus divers, français et étrangers, jeunes et vieux, naïfs ou blasés. À l’autre extrémité de l’Europe, Tolstoï se procura un exemplaire sans tarder et fut conquis. On peut dire sans exagération que Les Misérables ont précipité la création de La Guerre et laPaix. Les géants engendrent des géants ».
Simon Leys à propos des Misérables : « Sa nature même aurait dû condamner un tel ouvrage à demeurer intraduisible. Et pourtant il fit bientôt partie de l’imaginaire universel, touchant des millions de lecteurs dans des douzaines de langues différentes. Quel mystérieux pouvoir habite donc l’original, pour qu’il réussisse à survivre à des traductions parfois maladroites, et à conserver son rayonnement, même dans des formes simplifiées ou mutilées ? Les Misérables possèdent une puissante dimension mythique qui s’alimente aux sources profondes de notre commune humanité. C’est de la littérature populaire – dans le sens où Homère est de la littérature populaire : une littérature qui s’adresse aux hommes de tous les temps et de toutes les cultures. Le livre fut d’abord publié à Bruxelles (1er avril 1862) ; d’autres éditions suivirent rapidement, de façon presque simultanée, à Paris, Madrid, Londres, Leipzig, Milan, Naples, Varsovie, Saint-Pétersbourg, Rio de Janeiro. D’emblée, son succès fut universel ; la publication originale avait été retardée à l’imprimerie par les larmes des typographes qui s’étaient plongés dans la lecture des pages dont ils devaient composer les épreuves ; leur émotion et leur enthousiasme furent bientôt partagés par les lecteurs les plus divers, français et étrangers, jeunes et vieux, naïfs ou blasés. À l’autre extrémité de l’Europe, Tolstoï se procura un exemplaire sans tarder et fut conquis. On peut dire sans exagération que Les Misérables ont précipité la création de La Guerre et laPaix. Les géants engendrent des géants ».
°°°
 Je regarde un nouvel épisode de Six Feet under, qui me renvoie chez Hugo, puis je lis de nouveaux chapitres des Misérables, évoquant le martyre de Cosette et la chute de Fantine, et nous revoici au sixième dessous de l’humanité humiliée et offensée. On peut me dire que cette série américaine véhicule des clichés doloristes : on peut dire la même chose du roman vériste de Victor Hugo, sans voir que lesdits « clichés » sont des traits humains à chaque fois autres puisqu’il s’agit d’autres situations et d’autres peaux, d’autres visages et d’autres mots.
Je regarde un nouvel épisode de Six Feet under, qui me renvoie chez Hugo, puis je lis de nouveaux chapitres des Misérables, évoquant le martyre de Cosette et la chute de Fantine, et nous revoici au sixième dessous de l’humanité humiliée et offensée. On peut me dire que cette série américaine véhicule des clichés doloristes : on peut dire la même chose du roman vériste de Victor Hugo, sans voir que lesdits « clichés » sont des traits humains à chaque fois autres puisqu’il s’agit d’autres situations et d’autres peaux, d’autres visages et d’autres mots.
Le roman de Victor Hugo, pour un Flaubert, était « un livre fait pour la crapule catholico-socialiste ». Or après 350 pages de ce livre« crapuleux », ma religion est faite.
°°°
 Les esprits forts, dont un Alain Finkielkraut, voient en l’Internet une poubelle, et notre ami Dimitri poussait jusqu’à conclure à l’Enfer, dont une annexe serait aujourd’hui représentée par les réseaux sociaux. Autant de généralisations ineptes à mes yeux, même si la crétinerie se déploie sur la Toile à l’exponentiel et si Facebook apparaît souvent comme le réceptacle de toutes les fantasmagories, de toutes les frustrations et de toute la branloire compulsive.
Les esprits forts, dont un Alain Finkielkraut, voient en l’Internet une poubelle, et notre ami Dimitri poussait jusqu’à conclure à l’Enfer, dont une annexe serait aujourd’hui représentée par les réseaux sociaux. Autant de généralisations ineptes à mes yeux, même si la crétinerie se déploie sur la Toile à l’exponentiel et si Facebook apparaît souvent comme le réceptacle de toutes les fantasmagories, de toutes les frustrations et de toute la branloire compulsive.
Dans le chaos de Facebook, j’ai pourtant rencontré pas mal de braves gens, maintes personnes (souvent des femmes seules) émouvantes ou intéressantes, maintes gens qui ne font que passer et d’autres qui reviennent, des bien vieux comme tel religieux souverainiste en sa retraite de Lozère, ou de très jeunes comme ce Maveric qui pourrait être mon petit-fils et parle russe et m’explique l’économie du Brésil en préparant son concours aux grandes écoles, ou mon autre occulte ami Alban en veine de phrases inouïes, tels aussi mes complices écrivains (un JMO ou un PYL ou Jacques ou Jean ou Flynn ou Lambert ou Sergio ou Sébastien ou Jean-Yves et quelques Philippe pour faire bon poids) ou libraires (l’ami Claude aimé de tous ou le compère Jaussy de la Pensée sauvage), ou mes deux Anne-Marie à la douce et caustique présence, une Miss Fafa qui lit et peint comme je peins et écris, et tant d’autres à la porte d’à côté ou sur d’autres continents, Aude ici et Mira là, ou Nathalie, Alassane à Dakar ou Sinzo Aanza à Lubumbashi, David à l’autre bout du canton, Francis au chemin des Mouettes ou Fabrice je ne sais où, et tous les livres, les films, les musiques, les paysages, les virées que ça brasse – tant et tant de gens de la vie comme les accueille le Père Claude en sa paroisse des rues et comme j’aimerais les évoquer dans La Vie des gens…
°°°
Victor Hugo :« Tout grand artiste à son avènement refait l’art tout entier à son image ».
 À La Désirade, ce mercredi 24 décembre. – Après notre revoyure de l’autre soir avec Max le Bantou, de retour du Cameroun où, au cœur d’une jungle, il a rencontré la très vieille dame-mémoire dont il fera la narratrice de son prochain roman africain, je me rappelle tout ce qu’il m’a raconté de la corruption qui mine et ruine son pays pourtant riche et hyperactif, dont la richesse et la vitalité sont parasitées par les nouveaux maîtres du monde et leurs laquais, ou encore son évocation du charlatanisme religieux en pleine expansion.
À La Désirade, ce mercredi 24 décembre. – Après notre revoyure de l’autre soir avec Max le Bantou, de retour du Cameroun où, au cœur d’une jungle, il a rencontré la très vieille dame-mémoire dont il fera la narratrice de son prochain roman africain, je me rappelle tout ce qu’il m’a raconté de la corruption qui mine et ruine son pays pourtant riche et hyperactif, dont la richesse et la vitalité sont parasitées par les nouveaux maîtres du monde et leurs laquais, ou encore son évocation du charlatanisme religieux en pleine expansion.
Or, traversant hier le marché de Noël de Montreux aux centaines de cabanes identiques (les mêmes qu’à Bruxelles, Varsovie ou Munich) remplies, à quelques produits artisanaux près, de la même pacotille scintillant sur fond de mélodies écoeurantes et de fumées de vin cuit ou de gaufres sucrées à l’excès, je me dis que nous n’avons rien à envier aux Africains en matière de cultes frelatés, la famine en moins – jusqu’à l’indigestion et le dégoût à gerber.
°°°
 En pédalant mes 30 bornes sur place, je regarde deux nouveaux épisodes de Six Feet under, dont une kyrielle de détails me renvoient à mille observations faites dans nos vies et leurs avatars.
En pédalant mes 30 bornes sur place, je regarde deux nouveaux épisodes de Six Feet under, dont une kyrielle de détails me renvoient à mille observations faites dans nos vies et leurs avatars.
Maveric me demandait hier soir si je croyais au destin, et je lui ai répondu que j’y voyais au mieux l’accomplissement de nos virtualités, sans rien de sûr ni de systématique pour autant. Est-ce le destin qui a fait que Dimitri se crashe sur une route de France le jour de la commémoration d’une bataille (perdue) sur le Champ des Merles, au fondement de la nation serbe ? C’est ce qu’a prétendu le pope à l’enterrement de notre ami, mais pour ma part je ne sais trop. L’idée d’une intervention directe de Dieu dans l’Histoire m’a toujours révulsé, et plus encore aujourd’hui où elle justifie invasions et massacres. Mais je n’exclus pas pour autant quelque mystère dans les coïncidences, ou quelque chose de providentiel, ou de fatal, dans ce qui nous arrive de meilleur ou de pire.
°°°
 Que dirait le Christ surgissant, aujourd'hui, dans le Big Bazar préludant à sa naissance, fêtée aujourd'hui comme une opération commerciale entre tant d'autres ? Qui pourrait le dire, pontife ou mendiant, mécréant ou fidèle de quelque confession que ce soit ? Voici ce que je me demande depuis tant d'années à vitupérer les temples de la Consommation, n'oubliant rien des humbles Noëls de notre enfance. Et voilà ce qu'en quelques pauvres mots je confesse de mon Christ à moi...
Que dirait le Christ surgissant, aujourd'hui, dans le Big Bazar préludant à sa naissance, fêtée aujourd'hui comme une opération commerciale entre tant d'autres ? Qui pourrait le dire, pontife ou mendiant, mécréant ou fidèle de quelque confession que ce soit ? Voici ce que je me demande depuis tant d'années à vitupérer les temples de la Consommation, n'oubliant rien des humbles Noëls de notre enfance. Et voilà ce qu'en quelques pauvres mots je confesse de mon Christ à moi...
Mon Christ à moi est au milieu de nous jusqu’à la fin du monde. Ce matin il se trouvait peut-être à genoux au milieu d’un trottoir lausannois, sous les traits d'une mendiante au regard plein de ressentiment, à ce qu'il m'a semblé, qui m'a fait la maudire et me détourner - et je me le reproche encore à l'instant.
Ce Christ-là avait les mêmes longs cheveux sales que celui qui s’est jeté du pont aux suicidés, en plein Lausanne, il y a trente ans de ça, et dont la vision de la tête ensanglantée, dépassant de la couverture jetée sur son cadavre, me restera toujours présente comme l'icône de la désespérance.
Un autre Christ m’est apparu une autre nuit, à Paris, quand les nautoniers de la Seine ont relevé, des eaux huileuses, ce corps qui s’est défait de ses derniers vêtements au moment où il est apparu dans la lumière lunaire, blanc comme l’ivoire d'une autre vie.
Le Christ est en agonie jusqu’à la fin du monde, et pendant ce temps il ne faut pas dormir, disait à peu près Pascal le croyant, et après lui Chestov mon frère l'hésitant.
Je l’ai vu en agonie au service des soins intensifs d’une division de pédiatrie, crucifié dans le corps d’une petite fille dont les tortures furent exacerbées par l’incurie des supposés patrons, mais soignée tous les jours par des anges soignants.
Mon Christ à moi est cette petite fille, mon église vivante est celle des compatissants qui se sont agenouillés autour de sa tombe, et tout le reste n’est qu’un bal de vampires.
Mon Christ est cette petite fille martyre à laquelle je pense en melevant dans la splendeur de chaque matin du monde, présente lorsque je ferme les yeux face à la mer ou lorsque des amants s'étreignent. Mon Christ est ce pauvre sourire au milieu des milliers de visages défilant aux murs des couloirs d’Auschwitz. Faute de croire en la divinité du Christ, je pense que le Christ est notre humanité en devenir, notre salut avant la mort, non pas la force du « Christ des nations » mais la faiblesse du plus humilié et du plus offensé - notre nullité transmuée en aura.
 À La Désirade, ce mercredi 24 décembre. – Ce jour de fête présumée, présumée fête de la joie, nous n’aurons cessé d’échanger des vœux e tde nous congratuler, en toute sincérité d’ailleurs, avant de nous retrouver, Lady L. et moi, seuls à La Désirade et pas fâchés de l’être avant l’arrivée, demain, de nos filles et de leurs jules.
À La Désirade, ce mercredi 24 décembre. – Ce jour de fête présumée, présumée fête de la joie, nous n’aurons cessé d’échanger des vœux e tde nous congratuler, en toute sincérité d’ailleurs, avant de nous retrouver, Lady L. et moi, seuls à La Désirade et pas fâchés de l’être avant l’arrivée, demain, de nos filles et de leurs jules.
Ce qu’attendant nous regardons, innocents, l’épisode le plus sombre de Six Feet under, dont la dernière séquence culmine dans le cri déchirant, réellement insoutenable, de Nate qui vient d’enterrer, selon les vœux de Lisa, les restes de celle-ci monstrueusement gonflés par la noyade et à moitié dévorés par les requins. Autrement dit : l’horreur sous le sapin, que je me suis excusé d’avoir imposé à ma bonne amie à la lisière de la fameuse stille, heilige Nacht dont elle avait passé l’après-midi à arranger le décor…
°°°
Autant que les tranches de vie de Six Pieds dessous, d’une si remarquable honnêteté dans leur réfraction de la vie des gens, du côté de Raymond Carver ou d’Alice Munro, le misérable sort de Cosette en proie aux sinistres Thénardier, et la chute de Fantine jusqu’au tréfonds de la déréliction, auront bel et bien marqué mon Noël 2014, et cela sans le moindre penchant morbide, éclairés en outre en fin de soirée par la lecture du bon Georges Piroué, qui n’avait que cinq personnes à son enterrement, et dont le Victor Hugo romancier, préfacé par Henri Guillemenin, est un modèle de pénétration et de justesse dans son effort de recentrer la perception évangélique du furieux anticlérical.
°°°
Hugo le mégalo, le grandiloquace, le ridicule Torugo aux yeux des habiles et des « petitsmarquis » de la République des Lettres, retrouve sa place centrale avec L’Homme qui rit, Les Misérables ou Les derniers jours d’un condamné, notamment, en amont de Dostoïevski dont le princeMuichkine serait le saint héritier de Jean Valjean.
°°°
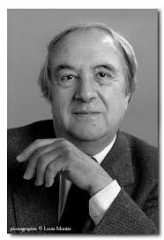 Georges Piroué sur Victor Hugo : « Quelle misère que l’intelligence quand c’est le cœur qui parle. (…) Hugo me plonge dans mon enfance. Je me souviens d’une soirée. Mon père lisait Les Misérables, les deux coudes sur la table, les mains à platcontre les oreilles. Passant derrière lui, je me suis mis à lire par-dessus sonépaule. Le roman penchait vers sa fin. Au moment où Jean Valjean tire de lavalise noire les vêtements de Cosette et les aligne sur le lit. Je devinais quemon père pleurait, Les larmes me vinrent aussi aux yeux. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Pas le moindre bruit de sanglot, pas le moindre reniflement. Un grand silence que j’entends encore. J’ignore s’il a su que je pleurais et je savais qu’il pleurait. Je ne le regrette point. Ceci doit rester incertain, pressenti plutôt que vu. Comme le chapitre s’achevait, il n’a pas levé la tête et j’ai quitté la pièce. Je garde cependant le souvenir de son épaule contre ma poitrine et lui, peut-être, de ma poitrine contre son épaule.
Georges Piroué sur Victor Hugo : « Quelle misère que l’intelligence quand c’est le cœur qui parle. (…) Hugo me plonge dans mon enfance. Je me souviens d’une soirée. Mon père lisait Les Misérables, les deux coudes sur la table, les mains à platcontre les oreilles. Passant derrière lui, je me suis mis à lire par-dessus sonépaule. Le roman penchait vers sa fin. Au moment où Jean Valjean tire de lavalise noire les vêtements de Cosette et les aligne sur le lit. Je devinais quemon père pleurait, Les larmes me vinrent aussi aux yeux. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Pas le moindre bruit de sanglot, pas le moindre reniflement. Un grand silence que j’entends encore. J’ignore s’il a su que je pleurais et je savais qu’il pleurait. Je ne le regrette point. Ceci doit rester incertain, pressenti plutôt que vu. Comme le chapitre s’achevait, il n’a pas levé la tête et j’ai quitté la pièce. Je garde cependant le souvenir de son épaule contre ma poitrine et lui, peut-être, de ma poitrine contre son épaule.
Ainsi Hugo est associé à mes plus chères affections ».


 Hanif Kureishi. Le dernier mot. Christian Bourgois. ****
Hanif Kureishi. Le dernier mot. Christian Bourgois. **** Philippe Jaccottet. Œuvres complètes. La Pléiade. *****
Philippe Jaccottet. Œuvres complètes. La Pléiade. *****

 Taïeb Louhichi. L’Enfant du soleil. Tunisie, 2013.
Taïeb Louhichi. L’Enfant du soleil. Tunisie, 2013.



 Simon Leys à propos de Simenon: "La force de Simenon, c'est d'employer des moyens ordinaires pour créer des effets inoubliables. Sa langue est pauvre et nue (comme le langage de l'inconscient), ce qui fait d'ailleurs de lui le plus universellement traduisible de tous les auteurs - il ne perd rien à passer en esquimau ou en japonais. On serait bien en peine de composer une anthologie de ses meilleures pages: il n'a pas de meilleurs pages, il n'a que de meilleurs romans, dans lesquels tout se tient, sans une seule couture".
Simon Leys à propos de Simenon: "La force de Simenon, c'est d'employer des moyens ordinaires pour créer des effets inoubliables. Sa langue est pauvre et nue (comme le langage de l'inconscient), ce qui fait d'ailleurs de lui le plus universellement traduisible de tous les auteurs - il ne perd rien à passer en esquimau ou en japonais. On serait bien en peine de composer une anthologie de ses meilleures pages: il n'a pas de meilleurs pages, il n'a que de meilleurs romans, dans lesquels tout se tient, sans une seule couture". Comme s’il était tellement plus que ceux-là, n’est-ce pas ? Comme s’il n’était pas, lui aussi, un intellectuel - et pourquoi s’en défendre ? Diderot n’était-il pas un intellectuel, de même que Rousseau, quand bien même ils nous parlent aujourd'hui encore en leur qualité de grands écrivains ? Or Régis Debray peut-il se dire plus qu’un écrivant ?
Comme s’il était tellement plus que ceux-là, n’est-ce pas ? Comme s’il n’était pas, lui aussi, un intellectuel - et pourquoi s’en défendre ? Diderot n’était-il pas un intellectuel, de même que Rousseau, quand bien même ils nous parlent aujourd'hui encore en leur qualité de grands écrivains ? Or Régis Debray peut-il se dire plus qu’un écrivant ? Je vais m’efforcer ces prochains jours de remettre en cause les conclusions de L’Homme achevé, où Claude Frochaux prétend que tout a été dit et fait: qu’ayant liquidé Dieu et toute transcendance, nous ne pouvons plus créer rien qui nous dépasse et que nous ne pourrons désormais que ressasser et répéter sans aucune chance d’innover – ce qui est à la fois vrai à certains égards et certainement outré voire faux, mais dire alors en quoi…
Je vais m’efforcer ces prochains jours de remettre en cause les conclusions de L’Homme achevé, où Claude Frochaux prétend que tout a été dit et fait: qu’ayant liquidé Dieu et toute transcendance, nous ne pouvons plus créer rien qui nous dépasse et que nous ne pourrons désormais que ressasser et répéter sans aucune chance d’innover – ce qui est à la fois vrai à certains égards et certainement outré voire faux, mais dire alors en quoi… Il est peu d’essayistes contemporains en matière littéraire et politique, et pratiquement aucun en langue française, dont je me sente aujourd’hui plus proche que de Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, hélas décédé en août dernier. De fait,chaque page que je lis ou relis de lui, comme ces jours les essais de L’ange et le cachalot, me captivent à la fois par leur substance, la liberté de ton de l’auteur et sa voix, plus encore par sa hauteur de vue sans condescendance et son ouverture aux cultures les plus diverses. Ainsi est-il aussi à l’aise en évoquant les œuvres de Stevenson ou de Simenon, de Michaux ou de D.H. Lawrence, de Gide ou de Victor Hugo, qu’en parlant de Confucius ou du Grand Timonier, d’Orwell confronté à l’horreur de la politique ou de Malraux le mythomane accommodant l’Histoire à sa sauce perso.
Il est peu d’essayistes contemporains en matière littéraire et politique, et pratiquement aucun en langue française, dont je me sente aujourd’hui plus proche que de Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, hélas décédé en août dernier. De fait,chaque page que je lis ou relis de lui, comme ces jours les essais de L’ange et le cachalot, me captivent à la fois par leur substance, la liberté de ton de l’auteur et sa voix, plus encore par sa hauteur de vue sans condescendance et son ouverture aux cultures les plus diverses. Ainsi est-il aussi à l’aise en évoquant les œuvres de Stevenson ou de Simenon, de Michaux ou de D.H. Lawrence, de Gide ou de Victor Hugo, qu’en parlant de Confucius ou du Grand Timonier, d’Orwell confronté à l’horreur de la politique ou de Malraux le mythomane accommodant l’Histoire à sa sauce perso. Je retrouve assez exactement, à travers les critiques formulées par Simon Leys à propos des œuvres et des postures de l’homme à la mèche rebelle et aux tics affreux, autant que dans sa reconnaissance du génie singulier de ce grand fou, tout ceque j’ai éprouvé en observant le personnage par médias interposés (son inénarrable hommage funèbre à Le Corbusier, entre tant d’autres exemples) ou en lisant La condition humaine et L’Espoir, avant les Antimémoires et le Musée imaginaire dont je suis content de constater que SimonLeys, comme souvent je l’ai pensé, n’y voit qu’un pillage de l’immense Elie Faure jamais cité par ailleurs…
Je retrouve assez exactement, à travers les critiques formulées par Simon Leys à propos des œuvres et des postures de l’homme à la mèche rebelle et aux tics affreux, autant que dans sa reconnaissance du génie singulier de ce grand fou, tout ceque j’ai éprouvé en observant le personnage par médias interposés (son inénarrable hommage funèbre à Le Corbusier, entre tant d’autres exemples) ou en lisant La condition humaine et L’Espoir, avant les Antimémoires et le Musée imaginaire dont je suis content de constater que SimonLeys, comme souvent je l’ai pensé, n’y voit qu’un pillage de l’immense Elie Faure jamais cité par ailleurs…  Ainsi de Vladimir Nabokov, par ailleurs connu pour la fréquente injustice de ses jugements (un Gore Vidal a justement dégommé le prof par trop pontifiant réduisant par exemple Faulkner à du pop corn), mais dont une métaphore ferroviaire vaut la citation : «Depuis l’enfance, je me souviens d’une inscription en lettres d’or qui me fascinait : Compagnie internationale des Wagons-lits et des Grands Express européens. L’œuvre de Malraux relève de la Compagnie internationale des Grands Clichés ».
Ainsi de Vladimir Nabokov, par ailleurs connu pour la fréquente injustice de ses jugements (un Gore Vidal a justement dégommé le prof par trop pontifiant réduisant par exemple Faulkner à du pop corn), mais dont une métaphore ferroviaire vaut la citation : «Depuis l’enfance, je me souviens d’une inscription en lettres d’or qui me fascinait : Compagnie internationale des Wagons-lits et des Grands Express européens. L’œuvre de Malraux relève de la Compagnie internationale des Grands Clichés ». 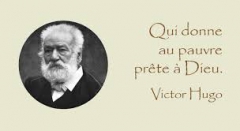 ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de « bonne amie » dans le pays. Il n’avait pas eu le temps d’être amoureux ».
ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de « bonne amie » dans le pays. Il n’avait pas eu le temps d’être amoureux ». Il y a, dans la vision de la société et des gens que module Six Feet under, c’est à savoir plus précisément Alan Ball, dont j’avais déjà aimé sa fresque d’American Beauty, quelque chose d’assez proche de l’observation sociale et psychologique d‘Alice Munro, avec une acuité non conformiste et une bienveillance comparables.
Il y a, dans la vision de la société et des gens que module Six Feet under, c’est à savoir plus précisément Alan Ball, dont j’avais déjà aimé sa fresque d’American Beauty, quelque chose d’assez proche de l’observation sociale et psychologique d‘Alice Munro, avec une acuité non conformiste et une bienveillance comparables.  Ce qui est sûr, en attendant, c’est qu’on est loin de la perception fine non convenue et de la narration très variée et constamment adéquate de Six Feet under, quimultiplie les observations grinçantes sur la société contemporaine, avec une série de grands thèmes récurrents (l’individu devant la mort, la solitude, l’évolution des mœurs, le choc des générations ou des cultures, la jobardise des intellos, etc.) qui s’incarnent par le truchement de personnages plus attachants les uns que les autres.
Ce qui est sûr, en attendant, c’est qu’on est loin de la perception fine non convenue et de la narration très variée et constamment adéquate de Six Feet under, quimultiplie les observations grinçantes sur la société contemporaine, avec une série de grands thèmes récurrents (l’individu devant la mort, la solitude, l’évolution des mœurs, le choc des générations ou des cultures, la jobardise des intellos, etc.) qui s’incarnent par le truchement de personnages plus attachants les uns que les autres. Or je me réjouissais de me replonger dans les couleurs et les visions de Vallotton et plus encore d’Hodler, sans penser que l’exposition serait d’une telle qualité, avec pareille quantité de réelles merveilles. Des Hodler et des Vallotton jamais vus, quelques Anker touchants chipés à Blocher, mais aussi des choses plus anciennes et non moins étonnantes (de Böcklin et Füssli) ou de grands artistes moins connus que le trio fameux (Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Segantini ou « notre » Bocion), toutes issues d’une prodigieuse collection encore ignorée du public, rassemblée par un seul mécène du nom de Bruno Stefanini à l’enseigne de sa Fondation pour l’art, la culture et l’histoire.
Or je me réjouissais de me replonger dans les couleurs et les visions de Vallotton et plus encore d’Hodler, sans penser que l’exposition serait d’une telle qualité, avec pareille quantité de réelles merveilles. Des Hodler et des Vallotton jamais vus, quelques Anker touchants chipés à Blocher, mais aussi des choses plus anciennes et non moins étonnantes (de Böcklin et Füssli) ou de grands artistes moins connus que le trio fameux (Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Segantini ou « notre » Bocion), toutes issues d’une prodigieuse collection encore ignorée du public, rassemblée par un seul mécène du nom de Bruno Stefanini à l’enseigne de sa Fondation pour l’art, la culture et l’histoire.  Jean Clair : « Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants et les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».
Jean Clair : « Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants et les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».

 Sa remarquable virtuosité pourrait ramener son expression, en surface, aux dimensions de la (meilleure) bande dessinée, mais un élément plus fondamental, une force plus ,sourde, l’émanation d’un sentiment du monde cohérent et profond habitent ses visions et les irradient, pour ainsi dire, entre à-pics vertigineux et scènes de la vie ordinaire. Une espèce de panique hante les
Sa remarquable virtuosité pourrait ramener son expression, en surface, aux dimensions de la (meilleure) bande dessinée, mais un élément plus fondamental, une force plus ,sourde, l’émanation d’un sentiment du monde cohérent et profond habitent ses visions et les irradient, pour ainsi dire, entre à-pics vertigineux et scènes de la vie ordinaire. Une espèce de panique hante les  D’un autre point de vue, qu’on pourrait dire moral, ou même affectif, me frappe alors, précisément par le détail, l’humanité du regard de RobertI ndermaur, frotté de tendresse. Rien chez lui de morbide ou d’un parti catastrophiste poussant tout au noir, comme si souvent aujourd’hui à grand renfort d’images apocalyptiques. S’il y a de la catastrophe dans les visions de Robert Indermaur, c’est que la catastrophe est bel est bien une composante majeure du XXe siècle et des lendemains du 11 septembre 2001, mais l’Apocalypse est autre chose.
D’un autre point de vue, qu’on pourrait dire moral, ou même affectif, me frappe alors, précisément par le détail, l’humanité du regard de RobertI ndermaur, frotté de tendresse. Rien chez lui de morbide ou d’un parti catastrophiste poussant tout au noir, comme si souvent aujourd’hui à grand renfort d’images apocalyptiques. S’il y a de la catastrophe dans les visions de Robert Indermaur, c’est que la catastrophe est bel est bien une composante majeure du XXe siècle et des lendemains du 11 septembre 2001, mais l’Apocalypse est autre chose.



![10245412_10203977306899872_1376158147990268425_n[1].jpg](http://carnetsdejlk.hautetfort.com/media/01/01/853977648.jpg) …
…
 S’agissant du personnage de légende qui a fait rêver peu ou prou les jeunes gens de notre génération, point aussi frelaté sans doute que son clone BHL, Simon Leys ne lui passe rien quant aux faits historiques maquillés, qu’il s’agisse de la révolution chinoise ou de la guerre d’Espagne, sans oublier la libération de Paris qui nous vaut une évocation tordante de sa rencontre avec Hemingway.
S’agissant du personnage de légende qui a fait rêver peu ou prou les jeunes gens de notre génération, point aussi frelaté sans doute que son clone BHL, Simon Leys ne lui passe rien quant aux faits historiques maquillés, qu’il s’agisse de la révolution chinoise ou de la guerre d’Espagne, sans oublier la libération de Paris qui nous vaut une évocation tordante de sa rencontre avec Hemingway.  Parangon du modèle romantique d’une jeunesse idéaliste en mal d’action directe, Malraux reste, pour le meilleur, une « icône » historique avant la lettre, bientôt singée, pour le pire - ses tics devenant grimaces médiatiques et parodie au carré -, par un BHL dûment fessé, ailleurs, pour sa Chine fantasmée à lui, par le même admirable non moins qu'intraitable Simon Leys.
Parangon du modèle romantique d’une jeunesse idéaliste en mal d’action directe, Malraux reste, pour le meilleur, une « icône » historique avant la lettre, bientôt singée, pour le pire - ses tics devenant grimaces médiatiques et parodie au carré -, par un BHL dûment fessé, ailleurs, pour sa Chine fantasmée à lui, par le même admirable non moins qu'intraitable Simon Leys. 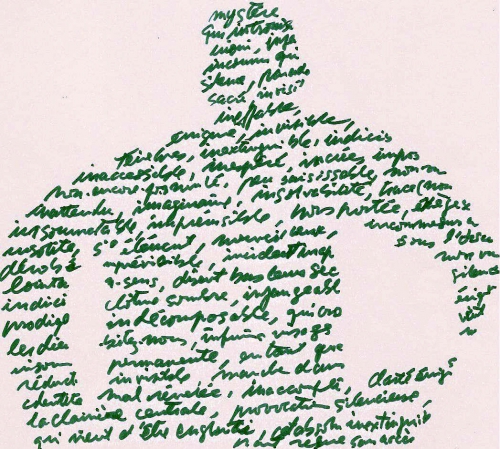


 À propos de Marie Heurtin, film de Jean-Pierre Améris de la meilleure intention et d'évidente qualité. Mais encore ?
À propos de Marie Heurtin, film de Jean-Pierre Améris de la meilleure intention et d'évidente qualité. Mais encore ?
 À la fin de Broadchurch, on comprend qu’un ado s’est senti trahi par son meilleur ami qui lui a dit en avoir « trouvé un autre », sans savoir évidemment qui était l’autre. On ne saura rien du détail de cette amitié, possiblement dénuée de toute connotation sexuelle, mais là n’est même pas l’important; d’ailleurs les voies de l’affectivité et de la sensualité, surtout à l’adolescence, sont souvent imprévisibles voire impénétrables.
À la fin de Broadchurch, on comprend qu’un ado s’est senti trahi par son meilleur ami qui lui a dit en avoir « trouvé un autre », sans savoir évidemment qui était l’autre. On ne saura rien du détail de cette amitié, possiblement dénuée de toute connotation sexuelle, mais là n’est même pas l’important; d’ailleurs les voies de l’affectivité et de la sensualité, surtout à l’adolescence, sont souvent imprévisibles voire impénétrables.  Ce qui m’intéresse là-dedans est la réflexion collective (producteurs, scénaristes, réalisateurs) qui aboutit à la présentation de ce drame, finalement très riche en composantes contradictoires, aboutissant à un constat nuancée du capitaine Alex Harry, lequel conclut sans moraliser une seconde en pointant les zones obscures, voire insondables, de la nature humaine.
Ce qui m’intéresse là-dedans est la réflexion collective (producteurs, scénaristes, réalisateurs) qui aboutit à la présentation de ce drame, finalement très riche en composantes contradictoires, aboutissant à un constat nuancée du capitaine Alex Harry, lequel conclut sans moraliser une seconde en pointant les zones obscures, voire insondables, de la nature humaine.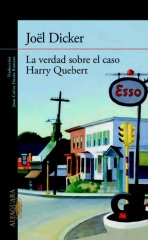 Ceux qui méprisent les séries télévisées (comme cela m’est arrivé) pour leur vision stéréotypée de la réalité, feraient bien d’y aller voir de plus près. À cet égard, Broadchurch me semble un bon indicateur du niveau de compréhension et d’expression de multiples aspects de nos sociétés évoluées, rompant avec les simplifications primaires en dépit d’indéniables stéréotypes, dont témoigne un genre discrédité par nombre de gardiens du temple de la Culture.
Ceux qui méprisent les séries télévisées (comme cela m’est arrivé) pour leur vision stéréotypée de la réalité, feraient bien d’y aller voir de plus près. À cet égard, Broadchurch me semble un bon indicateur du niveau de compréhension et d’expression de multiples aspects de nos sociétés évoluées, rompant avec les simplifications primaires en dépit d’indéniables stéréotypes, dont témoigne un genre discrédité par nombre de gardiens du temple de la Culture. 
 Cependant les conseils de Michael Frei chez Karloff, à Lausanne, véritable caverne d’Ali-Baba de la vidéo tous genres confondus jusqu'aux raretés et aux chefs-d'oeuvre, m’ont incité à réviser complètement mon jugement.
Cependant les conseils de Michael Frei chez Karloff, à Lausanne, véritable caverne d’Ali-Baba de la vidéo tous genres confondus jusqu'aux raretés et aux chefs-d'oeuvre, m’ont incité à réviser complètement mon jugement.  Dans la foulée, ressortant l'autre jour de chez Karloff, c’est avec l’intégrale des enquêtes très britiches de l'inspecteur Barnaby et les séries The Bridge et Broadchurch, entre autres films d’auteurs (James Ivory pour ma bonne amie et Senso de Visconti pour myself) que nous sommes remontés à notre alpe au bord du ciel tels de fringants baudets cinéphages.
Dans la foulée, ressortant l'autre jour de chez Karloff, c’est avec l’intégrale des enquêtes très britiches de l'inspecteur Barnaby et les séries The Bridge et Broadchurch, entre autres films d’auteurs (James Ivory pour ma bonne amie et Senso de Visconti pour myself) que nous sommes remontés à notre alpe au bord du ciel tels de fringants baudets cinéphages.  Enfin, le dénouement, très inattendu, évite complètement les poncifs relatifs au « monstre » mal-aimé-de-sa-mère-ou-abusé-par-son-père-donc-forcément-pédo, pour inciter à une réflexion moins confortable et sûrement mieux accordée à l’insondable nature humaine.
Enfin, le dénouement, très inattendu, évite complètement les poncifs relatifs au « monstre » mal-aimé-de-sa-mère-ou-abusé-par-son-père-donc-forcément-pédo, pour inciter à une réflexion moins confortable et sûrement mieux accordée à l’insondable nature humaine. 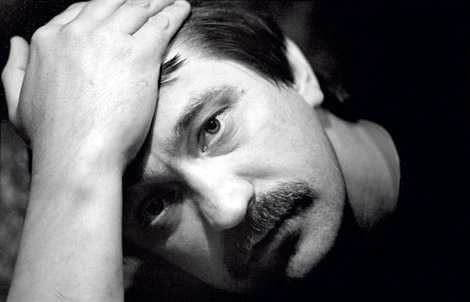
 Le film date de 1995. Il résulte d’un reportage, tourné en vidéo en 1994, sur la situation des soldats garde-frontières se trouvant sur la frontière du Tadjikistan pour résister aux talibans. Ce conflit « para-afghan » était alors ignoré du public russe, dont l’attention se concentrait sur la Tchétchénie. Les soldats russes ne sont pas, ici, en situation de force impérialiste, mais ils défendent les frontières d’un nouvel Etat indépendant sans moyens. Cela doit être souligné, car Sokourov ne nous éclaire en rien, dans le film, sur les circonstances exactes de la mission des soldats qu’il observe. On pense au Désert des Tartares en assistant à leur longue attente et à leurs errances au bout de nulle partir, dans ces montagnes arides où l’ennemi n’est jamais vu - la seule opération violente se trouvant éludée. La plupart des soldats présents sont très jeunes. Les appelés ne pensent qu’à rentrer chez eux. Avec la grande tendresse qui le caractérise, Sokourov les regarde, les montre en train de ne rien faire, montre leurs visages, montre leurs regards, montre leurs bottes dépareillées, montre leur matériel misérable, saisit des bribes de conversation, regarde une tortue bousculer deux fusils, regarde un criquet poussiéreux escalader un éboulis, regarde les regards troublés par la romance d'une chanteuse passant à la radio, regarde ces garçons écrire des lettres qui mettront trois mois à arriver à destination, regarde les gestes d’amitié de ces types qui partagent tout quelque temps et ne se reverront plus jamais, regarde les cultures abandonnées à cause de la guerre, regarde un petit rapace, entend un mitrailleur mitrailler Dieu sait quoi, regarde ces énormes machins que sont les avions militaires hors d'âge, regarde ce drôle de monde des hommes et recommande chacun à la protection des anges.
Le film date de 1995. Il résulte d’un reportage, tourné en vidéo en 1994, sur la situation des soldats garde-frontières se trouvant sur la frontière du Tadjikistan pour résister aux talibans. Ce conflit « para-afghan » était alors ignoré du public russe, dont l’attention se concentrait sur la Tchétchénie. Les soldats russes ne sont pas, ici, en situation de force impérialiste, mais ils défendent les frontières d’un nouvel Etat indépendant sans moyens. Cela doit être souligné, car Sokourov ne nous éclaire en rien, dans le film, sur les circonstances exactes de la mission des soldats qu’il observe. On pense au Désert des Tartares en assistant à leur longue attente et à leurs errances au bout de nulle partir, dans ces montagnes arides où l’ennemi n’est jamais vu - la seule opération violente se trouvant éludée. La plupart des soldats présents sont très jeunes. Les appelés ne pensent qu’à rentrer chez eux. Avec la grande tendresse qui le caractérise, Sokourov les regarde, les montre en train de ne rien faire, montre leurs visages, montre leurs regards, montre leurs bottes dépareillées, montre leur matériel misérable, saisit des bribes de conversation, regarde une tortue bousculer deux fusils, regarde un criquet poussiéreux escalader un éboulis, regarde les regards troublés par la romance d'une chanteuse passant à la radio, regarde ces garçons écrire des lettres qui mettront trois mois à arriver à destination, regarde les gestes d’amitié de ces types qui partagent tout quelque temps et ne se reverront plus jamais, regarde les cultures abandonnées à cause de la guerre, regarde un petit rapace, entend un mitrailleur mitrailler Dieu sait quoi, regarde ces énormes machins que sont les avions militaires hors d'âge, regarde ce drôle de monde des hommes et recommande chacun à la protection des anges. Dans Le rêve d’un soldat, court métrage qui fait pendant aux quatre épisodes « guerriers » du journal, un jeune soldat voit, en rêve, un ange représenté en peinture par je ne sais quel réaliste russe, sous la forme d’une jeune fille aux yeux bandés, assise, l’air accablé, sur un brancard porté par deux adolescents hagards. Cette dernière image, comme saturée de non-dit tragique, renvoie à la sublime première partie du film, constituant une ouverture musicale en trois mouvements.
Dans Le rêve d’un soldat, court métrage qui fait pendant aux quatre épisodes « guerriers » du journal, un jeune soldat voit, en rêve, un ange représenté en peinture par je ne sais quel réaliste russe, sous la forme d’une jeune fille aux yeux bandés, assise, l’air accablé, sur un brancard porté par deux adolescents hagards. Cette dernière image, comme saturée de non-dit tragique, renvoie à la sublime première partie du film, constituant une ouverture musicale en trois mouvements.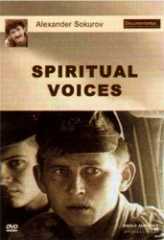 Alexandre Sokourov, Spiritual Voices. 2DVD. Facets Video. Toutes zones. Sous-titres français, anglais, allemand, italien, espagnol.
Alexandre Sokourov, Spiritual Voices. 2DVD. Facets Video. Toutes zones. Sous-titres français, anglais, allemand, italien, espagnol.



 « Il avait la passion de l’art (…) et il avait la passion beaucoup plus commune de l’argent », note un biographe. Et David Solkin, maître d’œuvre du catalogue de l’exposition du Grand Palais, de préciser : « La clé du succès économique de Turner résidait dans son empressement et sa capacité à produire un éventail étonnamment vaste de biens artistiques de grande qualité ». Ces données « triviales», liées au marché artistique de l’époque et à la furieuse concurrence qui y régnait, sont d’autant plus intéressantes qu’elles révèlent un Turner à multiples faces, immensément ambitieux et non moins attaché au perfectionnement de son métier, curieux du travail des autres (il pleure en découvrant le tableau d’un rival qu’il craint de ne pouvoir égaler) et aspirant à égaler les plus grands : il voudra par testament que son legs à la National Gallery permette à ses plus beaux tableaux d’être accrochés près de ceux de Claude Lorrain...
« Il avait la passion de l’art (…) et il avait la passion beaucoup plus commune de l’argent », note un biographe. Et David Solkin, maître d’œuvre du catalogue de l’exposition du Grand Palais, de préciser : « La clé du succès économique de Turner résidait dans son empressement et sa capacité à produire un éventail étonnamment vaste de biens artistiques de grande qualité ». Ces données « triviales», liées au marché artistique de l’époque et à la furieuse concurrence qui y régnait, sont d’autant plus intéressantes qu’elles révèlent un Turner à multiples faces, immensément ambitieux et non moins attaché au perfectionnement de son métier, curieux du travail des autres (il pleure en découvrant le tableau d’un rival qu’il craint de ne pouvoir égaler) et aspirant à égaler les plus grands : il voudra par testament que son legs à la National Gallery permette à ses plus beaux tableaux d’être accrochés près de ceux de Claude Lorrain... Captivante par ses rapprochements, l’exposition Turner et ses peintres montrait autant les admirations du maître anglais que l’affirmation de sa propre vision. L’exercice était passionnant, prouvant à quel point un paysage, loin d’être la seule représentation de la nature, est à la fois pensée et point de vue. Des Italiens classiques aux Flamands « quotidiens », des Français néoclassiques aux Suisses romantiques, Turner enjambe les frontières et les siècles en quête de « sa » vision. Celle-ci tend à se dépouiller de toute « littérature » pour aller vers le chant pur de la couleur et des énergies formelles, mais tirer Turner vers « nous » est peut-êtreexcessif. Le maître ancien était plein lui aussi d’une frémissante jeunesse, comme en témoignent ses merveilleuses aquarelles sans âge, et le pur voyant n’existerait pas sans la double patience de la pensée et de l’art.
Captivante par ses rapprochements, l’exposition Turner et ses peintres montrait autant les admirations du maître anglais que l’affirmation de sa propre vision. L’exercice était passionnant, prouvant à quel point un paysage, loin d’être la seule représentation de la nature, est à la fois pensée et point de vue. Des Italiens classiques aux Flamands « quotidiens », des Français néoclassiques aux Suisses romantiques, Turner enjambe les frontières et les siècles en quête de « sa » vision. Celle-ci tend à se dépouiller de toute « littérature » pour aller vers le chant pur de la couleur et des énergies formelles, mais tirer Turner vers « nous » est peut-êtreexcessif. Le maître ancien était plein lui aussi d’une frémissante jeunesse, comme en témoignent ses merveilleuses aquarelles sans âge, et le pur voyant n’existerait pas sans la double patience de la pensée et de l’art. Une réduction sans souffle
Une réduction sans souffle Cela pour quelques traits anecdotiques, auxquels s’ajoute, pour le meilleur, la rencontre tardive du peintre vieillissant et d’une veuve Booth sensible et bonne, qui l’accueille et le protège. Le meilleur du film est peut-être à chercher, d’ailleurs, dans cette dimension d’humanité à la Dickens, où la bonté prime sur l’intelligence ou le brillant social.
Cela pour quelques traits anecdotiques, auxquels s’ajoute, pour le meilleur, la rencontre tardive du peintre vieillissant et d’une veuve Booth sensible et bonne, qui l’accueille et le protège. Le meilleur du film est peut-être à chercher, d’ailleurs, dans cette dimension d’humanité à la Dickens, où la bonté prime sur l’intelligence ou le brillant social. 
