 Simon Leys à propos de Simenon: "La force de Simenon, c'est d'employer des moyens ordinaires pour créer des effets inoubliables. Sa langue est pauvre et nue (comme le langage de l'inconscient), ce qui fait d'ailleurs de lui le plus universellement traduisible de tous les auteurs - il ne perd rien à passer en esquimau ou en japonais. On serait bien en peine de composer une anthologie de ses meilleures pages: il n'a pas de meilleurs pages, il n'a que de meilleurs romans, dans lesquels tout se tient, sans une seule couture".
Simon Leys à propos de Simenon: "La force de Simenon, c'est d'employer des moyens ordinaires pour créer des effets inoubliables. Sa langue est pauvre et nue (comme le langage de l'inconscient), ce qui fait d'ailleurs de lui le plus universellement traduisible de tous les auteurs - il ne perd rien à passer en esquimau ou en japonais. On serait bien en peine de composer une anthologie de ses meilleures pages: il n'a pas de meilleurs pages, il n'a que de meilleurs romans, dans lesquels tout se tient, sans une seule couture".
°°°
L’intéressante question se pose, de savoir si celui qui a vécu la guerre en a vu plus que le commun des mortels ? L’idée m’en revient à la lecture d’un recueil d’entretiens avec Olivier Roy, qui pensait, entre vingt et trente ans, qu’il ne comprendrait pas leur pays sans s’être battu aux côtés des Afghans. La guerre est-elle le Réel absolu, comme on le dirait pompeusement aujourd’hui, ou n’est-elle qu’une instance extrême de la réalité confrontée à la violence et à la mort ? Olivier Roy s’en faisait une idée romantique de jeune idéaliste, puis il a vu la saleté et la trivialité de la guerre...
Pour ma part, je n’en ai humé qu’un fumet éventé, sur les hauts de Dubrovnik, en 1993, dans les ruines de maisons serbes incendiées et couvertes de tags haineux, entre lesquelles erraient quelques enfants, non loin des champs sur lesquels fumaient encore des restes d’herbe brûlées par des obus tirés le matin même des pentes surplombant les lieux. J’étais à moitié ivre, après le repas partagé avec les écrivains du P.E.N-club en leur congrès ; les deux compères journalistes allemands qui m’avaient amené là-haut me recommandaient de ne pas m’aventurer dans les prés voisins, minés à les en croire ; bref on était au bord de « la guerre » que j’avais ressentie dès notre débarquement à Dubrovnik, dans les regards des jeunes gens et dans les paroles hystériques des débats menés par les Croates - mais la « vraie » guerre est ailleurs, dont je présume que la seule réalité « absolue » est celle d’un assaut ou de tout épisode « à la vie à la mort » vécu au front...
°°°
La question de la responsabilité de l’intellectuel a été posée l’autre jour à Régis Debray, à l’émission radiophonique romande Forum, avant un débat le même soir, à Carouge, avec Jean Ziegler. À la journaliste qui lui demandait en vertu de quelle légitimité les intellectuels s’expriment, Régis Debray a répondu, non sans démagogie, qu’en effet ceux-là n’ont guère plus de légitimité à parler que quiconque, et que lui-même se sent aujourd’hui insulté par ceux qui le rangent au nombre des intellectuels français…
 Comme s’il était tellement plus que ceux-là, n’est-ce pas ? Comme s’il n’était pas, lui aussi, un intellectuel - et pourquoi s’en défendre ? Diderot n’était-il pas un intellectuel, de même que Rousseau, quand bien même ils nous parlent aujourd'hui encore en leur qualité de grands écrivains ? Or Régis Debray peut-il se dire plus qu’un écrivant ?
Comme s’il était tellement plus que ceux-là, n’est-ce pas ? Comme s’il n’était pas, lui aussi, un intellectuel - et pourquoi s’en défendre ? Diderot n’était-il pas un intellectuel, de même que Rousseau, quand bien même ils nous parlent aujourd'hui encore en leur qualité de grands écrivains ? Or Régis Debray peut-il se dire plus qu’un écrivant ?
°°°
 Je vais m’efforcer ces prochains jours de remettre en cause les conclusions de L’Homme achevé, où Claude Frochaux prétend que tout a été dit et fait: qu’ayant liquidé Dieu et toute transcendance, nous ne pouvons plus créer rien qui nous dépasse et que nous ne pourrons désormais que ressasser et répéter sans aucune chance d’innover – ce qui est à la fois vrai à certains égards et certainement outré voire faux, mais dire alors en quoi…
Je vais m’efforcer ces prochains jours de remettre en cause les conclusions de L’Homme achevé, où Claude Frochaux prétend que tout a été dit et fait: qu’ayant liquidé Dieu et toute transcendance, nous ne pouvons plus créer rien qui nous dépasse et que nous ne pourrons désormais que ressasser et répéter sans aucune chance d’innover – ce qui est à la fois vrai à certains égards et certainement outré voire faux, mais dire alors en quoi…
Il y a en effet à prendre et à laisser dans L’Homme achevé, dont je vais m’efforcer de démêler les observations pertinentes et les conclusions péremptoires souvent hâtives, voire irrecevables.
À l’auteur qui prétend que l’homme a désormais dominé la nature, j’ai envie d’objecter que cela se tient en théorie mais pas dans les faits et que, surtout, notre espèce est loin d’avoir dominé sa propre nature, à la fois géniale et destructrice, et que de la lutte contre la régression pourraient encore découler maintes œuvres nouvelles.
°°°
 Il est peu d’essayistes contemporains en matière littéraire et politique, et pratiquement aucun en langue française, dont je me sente aujourd’hui plus proche que de Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, hélas décédé en août dernier. De fait,chaque page que je lis ou relis de lui, comme ces jours les essais de L’ange et le cachalot, me captivent à la fois par leur substance, la liberté de ton de l’auteur et sa voix, plus encore par sa hauteur de vue sans condescendance et son ouverture aux cultures les plus diverses. Ainsi est-il aussi à l’aise en évoquant les œuvres de Stevenson ou de Simenon, de Michaux ou de D.H. Lawrence, de Gide ou de Victor Hugo, qu’en parlant de Confucius ou du Grand Timonier, d’Orwell confronté à l’horreur de la politique ou de Malraux le mythomane accommodant l’Histoire à sa sauce perso.
Il est peu d’essayistes contemporains en matière littéraire et politique, et pratiquement aucun en langue française, dont je me sente aujourd’hui plus proche que de Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, hélas décédé en août dernier. De fait,chaque page que je lis ou relis de lui, comme ces jours les essais de L’ange et le cachalot, me captivent à la fois par leur substance, la liberté de ton de l’auteur et sa voix, plus encore par sa hauteur de vue sans condescendance et son ouverture aux cultures les plus diverses. Ainsi est-il aussi à l’aise en évoquant les œuvres de Stevenson ou de Simenon, de Michaux ou de D.H. Lawrence, de Gide ou de Victor Hugo, qu’en parlant de Confucius ou du Grand Timonier, d’Orwell confronté à l’horreur de la politique ou de Malraux le mythomane accommodant l’Histoire à sa sauce perso.
 Je retrouve assez exactement, à travers les critiques formulées par Simon Leys à propos des œuvres et des postures de l’homme à la mèche rebelle et aux tics affreux, autant que dans sa reconnaissance du génie singulier de ce grand fou, tout ceque j’ai éprouvé en observant le personnage par médias interposés (son inénarrable hommage funèbre à Le Corbusier, entre tant d’autres exemples) ou en lisant La condition humaine et L’Espoir, avant les Antimémoires et le Musée imaginaire dont je suis content de constater que SimonLeys, comme souvent je l’ai pensé, n’y voit qu’un pillage de l’immense Elie Faure jamais cité par ailleurs…
Je retrouve assez exactement, à travers les critiques formulées par Simon Leys à propos des œuvres et des postures de l’homme à la mèche rebelle et aux tics affreux, autant que dans sa reconnaissance du génie singulier de ce grand fou, tout ceque j’ai éprouvé en observant le personnage par médias interposés (son inénarrable hommage funèbre à Le Corbusier, entre tant d’autres exemples) ou en lisant La condition humaine et L’Espoir, avant les Antimémoires et le Musée imaginaire dont je suis content de constater que SimonLeys, comme souvent je l’ai pensé, n’y voit qu’un pillage de l’immense Elie Faure jamais cité par ailleurs…
S’agissant du personnage de légende qui a fait rêver peu ou prou les jeunes gens de notre génération, point aussi frelaté sans doute que son clone BHL, Simon Leys ne lui passe rien quant aux faits historiques maquillés, qu’il s’agisse de la révolution chinoise ou de la guerre d’Espagne, sans oublier la libération de Paris qui nous vaut une évocation tordante de sa rencontre avec Hemingway.
Comme l’ont avéré divers biographes sérieux, et parfois en phase sympathique avec leur sujet, le récit que fait Malraux de sa rencontre avec Mao (moins d’une demi-heure avant de se faire poliment éconduire, alors qu’il parle d’une sorte de dialogue au sommet), relève du même type d’affabulation gonflée que ses hauts faits en Espagne, que les témoignage de George Orwell ou d’Arthur Koestler ramènent à leur piètre dimension. En ce qui concerne les œuvres de Malraux, Simon Leys cite les jugemenst carabinés de grands contemporains de Malraux, à prendre évidemment avec un grain de sel.

Ou Jean-Paul Sartre : « Malraux a du style. Mais ce n’est pas le bon ». Ou encore à propos de La condition humaine, déclarant à Simone de Beauvoir que la chose est « entachée de passages ridicules »et d’autres « mortellement ennuyeux ».
À la décharge de Malraux, après avoir constaté que « notre âge aura été jusqu’au bout celui de la Frime et de l’Amnésie », Simon Leys reconnaît à l’écrivain « du génie », non sans bémol cruel : « Mais le génie de quoi exactement ? On ne sait pas trop ».
Relevant enfin la fascination prodigieuse exercée par André Malraux sur tous ceux qui l’ont approché, à commencer par les femmes, - dont la première fut particulièrement malmenée quoique consentante -, Simon Leys constate que l’illustre ministre de Charles de Gaulle, pas plus dupe que d’autres (« Bah, Malraux est fou, mais il amuse le Général »), avait au moins pour lui ceci : il « pouvait être visionnaire et ridicule, héroïque et obscur – il ne fut jamais médiocre ».
Et pour conclure en semblables nuances : « Aujourd’hui, il est difficile de le relire à froid : ses écrits nous paraissent pompeux, confus, creux, obscurs et verbeux. Mais chaque fois que nous sommes remis en présence de sa personne (…) quelque chose de sa magie légendaire opère ». Parangon du modèle romantique d’une jeunesse idéaliste en mal d’action directe, Malraux reste, pour le meilleur, une « icône » historique avant la lettre, bientôt singée, pour le pire - ses tics devenant grimaces médiatiques et parodie au carré -, par un BHL dûment fessé, ailleurs, pour sa Chine fantasmée à lui, par le même intraitable SimonLeys.
°°°
En poursuivant ma lecture des Misérables, je suis touché par le récit des premières tribulations de Jean Valjean, « criminel » par misère, condamné par une justice de classe sans pitié pour le vol d’un pain. Et dans la foulée je note ceci qui m’amuse pour l’expression régionaliste de « bonne amie » relancée par Hugo: « Sa jeunesse se dépensait 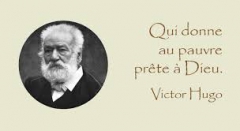 ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de « bonne amie » dans le pays. Il n’avait pas eu le temps d’être amoureux ».
ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de « bonne amie » dans le pays. Il n’avait pas eu le temps d’être amoureux ».
°°°
Même tant d’années après, la série américaine du début des années 2000, Six Feet under, m’a tout de suite intéressé par la qualité d’empathie de son observation, sa justesse de ton et son humour souvent grinçant. Cette histoire d’entrepreneurs de pompes funèbres californiens m’a rappelé l’irrésistible roman d’Evelyn Waugh, Le cher disparu, et la frise des personnages, à la fois typés et surprenants, parfois même émouvants, qui se déploie dans la filiation d’un Carver, me rappelle aussi les Short cuts que Robert Altman à tirés des nouvelles de celui-là. De surcroît, ces tranches de vie ne manquent de nous renvoyer à maints épisodes de nos propres vies…
°°°
Plus j’avance dans la lecture des Misérables et plus je suis impressionné par la double qualité éthique et poétique de ce livre, à commencer par la saisissante introduction consacrée au « juste » évêque Bienvenu, type du vieil homme de cœur combien différent des ordinaires princes del’Eglise, et qui nous plonge ensuite au cœur de la déréliction avec le double péché de Jean Valjean, lequel trahit son hôte charitable et piétine un ado innocent avant de prendre conscience de son abjection. Grandiose passage que celui des larmes purificatrices qui lui viennent après son ignoble comportement à l’égard du petit Gervais, où l’on sent passer le souffle de Satan avec un accent à la Bernanos.
°°°
 Il y a, dans la vision de la société et des gens que module Six Feet under, c’est à savoir plus précisément Alan Ball, dont j’avais déjà aimé sa fresque d’American Beauty, quelque chose d’assez proche de l’observation sociale et psychologique d‘Alice Munro, avec une acuité non conformiste et une bienveillance comparables.
Il y a, dans la vision de la société et des gens que module Six Feet under, c’est à savoir plus précisément Alan Ball, dont j’avais déjà aimé sa fresque d’American Beauty, quelque chose d’assez proche de l’observation sociale et psychologique d‘Alice Munro, avec une acuité non conformiste et une bienveillance comparables.
Aux Thermes d’Ovronnaz, ce dimanche 14 décembre. – Nous sommes arrivés ce midi en ces lieux de bien-être planifié, où nous allons passer une semaine entre baignades, balades, lecture et, pour moi, ce que je pourrai d’écriture. Je me trouve toujours un peu mal l’aise en ces lieux de wellness, mais nous sommes là pour faire plaisir à nos enfants qui nous ont fait ce cadeau, Lady L.s’y trouve bien et je ne vais pas faire mon difficile; il y a pire sort en ce bas monde, n’est-il pas ?
°°°
J’ai commencé ce soir à regarder la série israélienne Hatufim, consacrée au retour au pays de deux prisonniers de guerre retenus dix-sept ans au Liban, où ils ont été coupés du monde et torturés. Cela part un peu à l’américaine, sur une cadence frénétique et avec des personnages par trop caricaturaux à mon goût (la lycéenne cynique qui n’en a rien à fiche de revoir son père, etc.) mais on sent que la chose va se nuancer et s’étoffer, ou du moins je l’espère...
 Ce qui est sûr, en attendant, c’est qu’on est loin de la perception fine non convenue et de la narration très variée et constamment adéquate de Six Feet under, quimultiplie les observations grinçantes sur la société contemporaine, avec une série de grands thèmes récurrents (l’individu devant la mort, la solitude, l’évolution des mœurs, le choc des générations ou des cultures, la jobardise des intellos, etc.) qui s’incarnent par le truchement de personnages plus attachants les uns que les autres.
Ce qui est sûr, en attendant, c’est qu’on est loin de la perception fine non convenue et de la narration très variée et constamment adéquate de Six Feet under, quimultiplie les observations grinçantes sur la société contemporaine, avec une série de grands thèmes récurrents (l’individu devant la mort, la solitude, l’évolution des mœurs, le choc des générations ou des cultures, la jobardise des intellos, etc.) qui s’incarnent par le truchement de personnages plus attachants les uns que les autres.
°°°
Aux Sources d’Ovronnaz, ce jeudi 18 décembre.– Comme il faisait ce matin un temps exécrable, nous avons décidé de pousser une pointe jusqu’à la fondation Gianadda pour y voir la nouvelle exposition consacrée, notamment, à trois grands noms de la peinture suisse, à savoir Albert Anker, Ferdinand Hodler et Félix Vallotton.
 Or je me réjouissais de me replonger dans les couleurs et les visions de Vallotton et plus encore d’Hodler, sans penser que l’exposition serait d’une telle qualité, avec pareille quantité de réelles merveilles. Des Hodler et des Vallotton jamais vus, quelques Anker touchants chipés à Blocher, mais aussi des choses plus anciennes et non moins étonnantes (de Böcklin et Füssli) ou de grands artistes moins connus que le trio fameux (Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Segantini ou « notre » Bocion), toutes issues d’une prodigieuse collection encore ignorée du public, rassemblée par un seul mécène du nom de Bruno Stefanini à l’enseigne de sa Fondation pour l’art, la culture et l’histoire.
Or je me réjouissais de me replonger dans les couleurs et les visions de Vallotton et plus encore d’Hodler, sans penser que l’exposition serait d’une telle qualité, avec pareille quantité de réelles merveilles. Des Hodler et des Vallotton jamais vus, quelques Anker touchants chipés à Blocher, mais aussi des choses plus anciennes et non moins étonnantes (de Böcklin et Füssli) ou de grands artistes moins connus que le trio fameux (Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Segantini ou « notre » Bocion), toutes issues d’une prodigieuse collection encore ignorée du public, rassemblée par un seul mécène du nom de Bruno Stefanini à l’enseigne de sa Fondation pour l’art, la culture et l’histoire.
À la lecture du catalogue de l’expo, j’ai découvert le non moins sidérant personnage de ce nonagénaire fils d’ouvrier italien devenu l’égal des plus grands collectionneurs helvétiques à la Oskar Reinart, qui a consacré sa fortune de ponte de l’immobilier à l’acquisition de tableaux et de sculptures (plus de 8000 pièces, avec une attention particulière à la genèse des oeuvres et à leur évolution dans le temps), d’objets d’intérêt historique de toute sorte (une fameuse collection d’arbalètes, un cristal géant de 15 millions d’années, et le château de Grandson…) entre autres pièces rassemblées dans le bon vieil esprit de la « défense spirituelle » helvétique.
Réellement anachronique – et cela me ravit au moment où la bourgeoisie snob ne jure que par un fumiste cynique à la Jeff Koons -, Bruno Stefanini relève de la race des « sauveteurs », dont la collection dépasse l’intérêt personnel lucratif pour constituer un legs commun à venir. Peu soucieux de publicité ou de gloriole, il a rassemblé ce qui représentera « la plus vaste collection d’œuvres d’art et d’objets historique jamais réunie dans notre pays », dont l’inventaire reste à parachever. Or ce qui frappe, dans l’immédiat, c’est la qualité particulière des œuvres présentées ces jours chez Gianadda, qui signale un vrai regard.
°°°
 Jean Clair : « Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants et les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».
Jean Clair : « Le silence a disparu. La musique aussi. Dans les boutiques, les restaurants et les taxis, l’agression sonore ne cesse plus. Pulsation répétitive, vulgaire, violente, grésillements et stridences d’un moteur dont les pistons ne faibliraient jamais ».
Tout à fait ça, et pourtant je sais, moi, où trouver du silence encore, et des clairières. Tout n’est pas foutu : mais non…
Commentaires
Silence et clairière sans doute avec cette exposition à la fondation Gianadda... Prendre les eaux mène à tous les bonheurs...