
Le discours d'Accra répercuté par Africultures
Contrairement au Président Sarkozy à Dakar en juillet 2007, le Président Obama ne s'est pas adressé aux Africains en donneur de leçons. Il n'a pas développé une litanie anthropologique mais a très concrètement, sans condescendance, proposé quatre pistes, traitant de la gouvernance, de l'économie, de la santé et de la résolution des conflits. Nous en publions ci-dessous le texte intégral. (Africultures)
Le président : (Son d'une trompette.) Ça me plaît ! Merci, merci. Je pense que notre Congrès a besoin d'une de ces trompettes. J'en aime bien le son, cela me rappelle Louis Armstrong.
Bon après-midi à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être à Accra et de parler aux représentants du peuple ghanéen. Je suis très reconnaissant de l'accueil que j'ai reçu, tout comme le sont Michelle, Malia et Sasha Obama. L'histoire ghanéenne est riche, les liens entre nos deux pays sont forts, et je suis fier que ce soit ma première visite en Afrique subsaharienne en qualité de président des États-Unis d'Amérique.
Je voudrais remercier la présidente et tous les membres de la Chambre des représentants de nous accueillir aujourd'hui. Je voudrais remercier le président Mills pour ses qualités extraordinaires de direction. Aux anciens présidents - Jerry Rawlings, l'ancien président Kufuor - au vice-président, au président de la Cour suprême, je vous remercie tous pour votre hospitalité extraordinaire et pour les merveilleuses institutions que vous avez bâties au Ghana.
Je vous parle à la fin d'un long voyage. Je l'ai commencé en Russie par une réunion au sommet entre deux grandes puissances. Je me suis rendu en Italie pour la réunion des grandes puissances économiques du monde. Et me voici, enfin, au Ghana, pour une simple raison : le XXIe siècle sera influencé par ce qui se passera non seulement à Rome ou à Moscou ou à Washington, mais aussi à Accra.
C'est la simple vérité d'une époque où nos connexions font disparaître les frontières entre les peuples. Votre prospérité peut accroître la prospérité des États-Unis. Votre santé et votre sécurité peuvent contribuer à la santé et à la sécurité du monde. Et la force de votre démocratie peut contribuer à la progression des droits de l'homme pour tous les peuples.
 Je ne considère donc pas les pays et les peuples d'Afrique comme un monde à part ; je considère l'Afrique comme une partie fondamentale de notre monde interconnecté, comme un partenaire des États-Unis en faveur de l'avenir que nous souhaitons pour tous nos enfants. Ce partenariat doit se fonder sur la responsabilité mutuelle et sur le respect mutuel : c'est ce dont je tiens à vous parler aujourd'hui.
Je ne considère donc pas les pays et les peuples d'Afrique comme un monde à part ; je considère l'Afrique comme une partie fondamentale de notre monde interconnecté, comme un partenaire des États-Unis en faveur de l'avenir que nous souhaitons pour tous nos enfants. Ce partenariat doit se fonder sur la responsabilité mutuelle et sur le respect mutuel : c'est ce dont je tiens à vous parler aujourd'hui.
Nous devons partir du principe qu'il revient aux Africains de décider de l'avenir de l'Afrique.
Je dis cela en étant pleinement conscient du passé tragique qui hante parfois cette partie du monde. Après tout, j'ai du sang africain dans les veines, et l'histoire de ma famille englobe aussi bien les tragédies que les triomphes de l'histoire de l'Afrique dans son ensemble.
Certains d'entre vous savent que mon grand-père était cuisinier chez des Britanniques au Kenya, et bien qu'il fût un ancien respecté dans son village, ses employeurs l'ont appelé "boy" pendant la plus grande partie de sa vie. Il était à la périphérie des luttes en faveur de la libération du Kenya, mais il a quand même été incarcéré brièvement pendant la période de répression. Durant sa vie, le colonialisme n'était pas simplement la création de frontières artificielles ou de termes de l'échange inéquitables ; c'était quelque chose que l'on éprouvait dans sa vie personnelle jour après jour, année après année.
Mon père a grandi dans un tout petit village où il gardait des chèvres, à une distance impossible des universités américaines où il irait faire des études. Il est devenu adulte à un moment de promesse extraordinaire pour l'Afrique. Les luttes de la génération de son propre père ont donné naissance à de nouveaux États, en commençant ici au Ghana. Les Africains s'éduquaient et s'affirmaient d'une nouvelle façon. L'histoire était en marche.
Toutefois, malgré les progrès obtenus - et il y a eu des progrès considérables dans certaines parties de l'Afrique - nous savons aussi que cette promesse est encore loin de se réaliser. Des pays tels que le Kenya, dont le revenu par habitant était supérieur à celui de la Corée du Sud lorsque je suis né, ont été fortement distancés. Les maladies et les conflits ont ravagé plusieurs régions du continent africain.
Dans de nombreux pays, l'espoir de la génération de mon père a cédé la place au cynisme, voire au désespoir. Certes, il est facile de pointer du doigt et de rejeter la responsabilité de ces problèmes sur d'autres. Il est vrai qu'une carte coloniale qui n'avait guère de sens a contribué à susciter des conflits, et l'Occident a souvent traité avec l'Afrique avec condescendance, à la quête de ressources plutôt qu'en partenaire. Cependant, l'Occident n'est pas responsable de la destruction de l'économie zimbabwéenne au cours des dix dernières années, ni des guerres où des enfants sont enrôlés comme soldats. Durant la vie de mon père, ce sont en partie le tribalisme et le népotisme dans un Kenya indépendant qui, pendant longtemps, ont fait dérailler sa carrière, et nous savons que cette forme de corruption est toujours un fait quotidien de la vie d'un trop grand nombre de personnes.
Or, nous savons que ce n'est pas là toute l'histoire. Ici au Ghana, vous nous montrez un aspect de l'Afrique qui est trop souvent négligé par un monde qui ne voit que les tragédies ou la nécessité d'une aide charitable. Le peuple ghanéen a travaillé dur pour consolider la démocratie, au moyen de passages pacifiques répétés du pouvoir, même à la suite d'élections très serrées. Et à cet égard, je voudrais dire que la minorité mérite tout autant de louanges que la majorité. Grâce à une meilleure gouvernance et au rôle de la société civile naissante, l'économie ghanéenne a enregistré un taux de croissance impressionnant.
Ce progrès ne possède sans doute pas l'aspect dramatique des luttes de libération du XXe siècle, mais que personne ne s'y trompe : il sera, en fin de compte, plus significatif. Car de même qu'il est important de se soustraire au contrôle d'une autre nation, il est encore plus important de se forger sa propre nation.
C'est pourquoi je suis convaincu que la période actuelle est tout aussi prometteuse pour le Ghana et pour l'Afrique que celle pendant laquelle mon père est devenu adulte et que de nouveaux États sont apparus. C'est une nouvelle période de grande promesse. Seulement cette fois-ci, nous avons appris que ce ne seront pas de grandes personnalités telles que Nkrumah et Kenyatta qui décideront du destin de l'Afrique. Ce sera vous, les hommes et les femmes du Parlement ghanéen et le peuple que vous représentez. Ce seront les jeunes, débordant de talent, d'énergie et d'espoir, qui pourront revendiquer l'avenir que tant de personnes des générations précédentes n'ont jamais réalisé.
Maintenant, pour réaliser cette promesse, nous devons tout d'abord reconnaître une vérité fondamentale à laquelle vous avez donné vie au Ghana, à savoir que le développement dépend de la bonne gouvernance. C'est l'ingrédient qui fait défaut dans beaucoup trop de pays depuis bien trop longtemps. C'est le changement qui peut déverrouiller les potentialités de l'Afrique. Enfin, c'est une responsabilité dont seuls les Africains peuvent s'acquitter.
Quant aux États-Unis et au reste de l'Occident, notre engagement ne doit pas se mesurer uniquement à l'aune des dollars que nous dépensons. Je me suis engagé à augmenter fortement notre aide à l'étranger, ce qui correspond à l'intérêt de l'Afrique et à celui des États-Unis. Toutefois, le véritable signe de réussite n'est pas de savoir si nous sommes une source d'aide perpétuelle qui aide les gens à survivre tant bien que mal, mais si nous sommes des partenaires dans la création des capacités nécessaires pour un changement transformateur.
Cette responsabilité mutuelle doit être le fondement de notre partenariat. Aujourd'hui, je parlerai tout particulièrement de quatre domaines qui sont essentiels pour l'avenir de l'Afrique et de tous les pays en développement : la démocratie, les possibilités économiques, la santé et le règlement pacifique des conflits.
Premièrement, nous devons soutenir les démocraties puissantes et durables.
Comme je l'ai dit au Caire, chaque nation façonne la démocratie à sa manière, conformément à ses traditions. Mais l'histoire prononce un verdict clair : les gouvernements qui respectent la volonté de leur peuple, qui gouvernent par le consentement et non par la coercition, sont plus prospères, plus stables et plus florissants que ceux qui ne le font pas.
Il ne s'agit pas seulement d'organiser des élections - il faut voir ce qui se passe entre les scrutins. La répression revêt de nombreuses formes et trop de pays, même ceux qui tiennent des élections, sont en proie à des problèmes qui condamnent leur peuple à la pauvreté. Aucun pays ne peut créer de richesse si ses dirigeants exploitent l'économie pour s'enrichir personnellement, ou si des policiers peuvent être achetés par des trafiquants de drogue. Aucune entreprise ne veut investir dans un pays où le gouvernement se taille au départ une part de 20 %, ou dans lequel le chef de l'autorité portuaire est corrompu. Personne ne veut vivre dans une société où la règle de droit cède la place à la loi du plus fort et à la corruption. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie, même si de temps en temps on y sème une élection ça et là, et il est temps que ce style de gouvernement disparaisse.
En ce XXIe siècle, des institutions capables, fiables et transparentes sont la clé du succès - des parlements puissants et des forces de police honnêtes ; des juges et des journalistes indépendants ; un secteur privé et une société civile florissants, ainsi qu'une presse indépendante. Tels sont les éléments qui donnent vie à la démocratie, parce que c'est ce qui compte dans la vie quotidienne des gens.
Les Ghanéens ont à maintes reprises préféré le droit constitutionnel à l'autocratie, et ont fait preuve d'un esprit démocratique qui permet à leur énergie de se manifester. Nous le voyons dans les dirigeants qui acceptent la défaite gracieusement - le fait que les concurrents du président Mills se tenaient là à ses côtés lorsque je suis descendu de l'avion en dit long sur le Ghana - et dans les vainqueurs qui résistent aux appels à l'exercice de leur pouvoir contre l'opposition de manière injuste. Nous voyons cet esprit se manifester dans les journalistes courageux comme Anas Aremeyaw Anas, qui a risqué sa vie pour relater la vérité. Nous le voyons dans des policiers comme Patience Quaye, qui a contribué à faire traduire en justice le premier trafiquant d'êtres humains au Ghana. Nous le voyons dans les jeunes qui s'élèvent contre le népotisme et qui participent à la vie politique.
Dans toute l'Afrique, nous avons vu de multiples exemples de gens qui prennent leur destinée en main et qui opèrent des changements à partir de la base. Nous l'avons vu au Kénya, où la société civile et le secteur privé se sont unis pour aider à stopper la violence postélectorale. Nous l'avons vu en Afrique du Sud, où plus des trois quarts des citoyens ont voté dans la dernière élection, la quatrième depuis la fin de l'apartheid. Nous l'avons vu au Zimbabwé, où le Réseau de soutien au vote a bravé la brutale répression pour faire valoir le principe selon lequel le droit de vote d'un citoyen est sacré.
Alors ne vous y trompez pas : l'histoire est du côté de ces courageux Africains, et non dans le camp de ceux qui se servent de coups d'État ou qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions.
L'Amérique ne cherchera pas à imposer un système quelconque de gouvernement à aucune autre nation. La vérité essentielle de la démocratie est que chaque nation détermine elle-même son destin. Ce que fera l'Amérique, en revanche, ce sera d'accroître son aide aux personnes et aux institutions responsables, en mettant l'accent sur l'appui à la bonne gouvernance : aux parlements, qui maîtrisent les abus de pouvoir et s'assurent que les voix de l'opposition peuvent s'exprimer ; à la règle de droit, qui garantit l'égalité de tous devant la justice ; à la participation civile, afin que les jeunes soient actifs dans la vie politique ; et à des solutions concrètes à la corruption telles que l'expertise comptable, l'automatisation des services, le renforcement des lignes d'appel d'urgence, la protection de ceux qui dénoncent les abus afin de promouvoir la transparence, et la responsabilité.
Et cette aide, nous la fournissons. J'ai demandé à mon gouvernement d'accorder davantage d'attention à la corruption dans notre rapport sur les droits de l'homme. Tous les gens devraient avoir le droit de démarrer une entreprise ou d'obtenir une éducation sans avoir à verser de pots-de-vin. Nous avons le devoir de soutenir ceux qui agissent de façon responsable et d'isoler ceux qui ne le font pas, et c'est exactement ce que fera l'Amérique.
Cela nous conduit directement à notre deuxième domaine de coopération - le soutien à un développement qui offre des débouchés aux gens.
Avec une meilleure gouvernance, je ne doute pas que l'Afrique tiendra sa promesse de créer une plus vaste base pour la prospérité. Témoin en est le succès extraordinaire d'Africains dans mon propre pays d'Amérique. Ils se portent très bien. Ils ont donc le talent et ils possèdent l'esprit d'entreprise - la question est de savoir comment s'assurer qu'ils réussissent ici dans leur pays d'origine. Ce continent est riche en ressources naturelles. Et que ce soient des chefs d'entreprises spécialisées dans la téléphonie portable ou des petits agriculteurs, les Africains ont montré leur capacité et leur volonté de créer leurs propres possibilités. Mais il faut également rompre avec de vieilles habitudes. La dépendance vis-à-vis des matières premières - ou d'un seul produit d'exportation - a tendance à concentrer la richesse au sein d'une minorité, laissant la majorité vulnérable à la récession.
Au Ghana, par exemple, le pétrole crée de magnifiques possibilités, et vous vous êtes préparés à ces nouveaux revenus de façon responsable. Mais comme le savent de nombreux Ghanéens, le pétrole ne peut pas simplement remplacer le cacao. De la Corée du Sud à Singapour, l'histoire montre que les pays réussissent lorsqu'ils investissent dans la société et dans leur infrastructure ; lorsqu'ils multiplient les industries d'exportation, se dotent d'une main-d'œuvre qualifiée et font de la place aux petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois.
Alors que les Africains se rapprochent de cette promesse, l'Amérique va leur tendre la main de façon plus responsable. En réduisant les sommes qui vont aux consultants occidentaux et au gouvernement, nous voulons mettre plus de ressources entre les mains de ceux qui en ont besoin, tout en apprenant aux gens à faire plus pour eux-mêmes. C'est pourquoi notre initiative de 3,5 milliards de dollars en faveur de la sécurité alimentaire est axée sur de nouvelles méthodes et technologies agricoles, et non pas sur la simple expédition de biens et services américains vers l'Afrique. L'aide n'est pas une fin en soi. L'objectif de l'aide à l'étranger doit être de créer les conditions dans lesquelles elle ne sera plus nécessaire. Non seulement je veux voir les Ghanéens autosuffisants sur le plan alimentaire, je veux vous voir exporter des produits alimentaires à d'autres pays et gagner de l'argent. Cela, vous le pouvez.
Certes, l'Amérique peut faire plus pour promouvoir le commerce et les investissements. Les pays riches doivent réellement ouvrir leurs portes aux biens et services de l'Afrique d'une manière significative. Ce sera d'ailleurs un des engagements de mon gouvernement. Et là où il y a une bonne gouvernance, nous pouvons étendre la prospérité par le truchement de partenariats entre les secteurs public et privé qui investiront dans l'amélioration des routes et des réseaux électriques ; de programmes de formation qui apprendront aux gens comment développer leur entreprise ; et de services financiers non seulement pour les villes mais pour les régions pauvres et les zones rurales. Cela aussi dans notre propre intérêt - parce que si les gens se sortent de la pauvreté et que de la richesse se crée en Afrique, il s'ensuit que de nouveaux marchés s'ouvriront pour nos propres produits. Tout le monde y gagne.
Un secteur qui représente à la fois un danger indéniable et une promesse extraordinaire est celui de l'énergie. L'Afrique émet moins de gaz à effet de serre que toute autre région du monde, mais elle est la plus menacée par le changement climatique. Une planète qui se réchauffe propagera les maladies, réduira les ressources en eau, épuisera les récoltes, et créera les conditions favorables à plus de famine et plus de conflits. Nous avons tous - en particulier le monde développé - le devoir de ralentir ces tendances, en réduisant les effets du changement climatique et en changeant la façon dont nous utilisons l'énergie. Mais nous pouvons également coopérer avec les Africains pour transformer cette crise en occasion de progrès.
Ensemble, nous pouvons coopérer en faveur de notre planète et de la prospérité, et aider les pays à accroître leur accès à l'énergie tout en sautant, en contournant les phases les plus polluantes du développement. Pensez-y : dans l'ensemble de l'Afrique, il existe de l'énergie éolienne et solaire en abondance, ainsi que de l'énergie géothermique et des biocarburants. De la vallée du Rift aux déserts de l'Afrique du Nord ; de la côte de l'Afrique de l'Ouest aux récoltes de l'Afrique du Sud - les dons inépuisables que procure la nature à l'Afrique peuvent lui permettre de créer sa propre énergie et d'exporter de l'énergie propre et rentable à l'étranger.
Il ne s'agit pas seulement de chiffres de croissance sur un bilan comptable. Il s'agit de savoir si un jeune doté d'une éducation peut trouver un emploi qui lui permettra de nourrir sa famille ; si un agriculteur peut amener ses produits au marché ; ou si un homme d'affaires armé d'une bonne idée peut démarrer une entreprise. Il s'agit de la dignité du travail. Il s'agit d'une chance que doivent pouvoir saisir les Africains au XXIe siècle.
De même que la gouvernance est une condition essentielle du progrès économique, elle revêt également une importance cruciale dans le troisième domaine que je voudrais à présent aborder, l'amélioration de la santé publique.
Ces dernières années, des progrès énormes ont été accomplis dans certaines parties de l'Afrique. Les gens sont beaucoup plus nombreux à vivre avec le VIH/sida de manière productive et à obtenir les médicaments qu'il leur faut. Je viens de visiter une merveilleuse clinique, un hôpital spécialisé dans la santé maternelle. Mais trop d'Africains périssent toujours de maladies qui ne devraient pas les tuer. Lorsque des enfants meurent d'une piqûre de moustique et que des mères succombent lors d'un accouchement, nous savons qu'il reste des progrès à faire.
Or du fait des incitations, souvent fournies par les pays donateurs, beaucoup de médecins et d'infirmiers africains s'en vont à l'étranger, ou travaillent à des programmes qui luttent contre une maladie unique. Cette situation crée des lacunes en matière de soins primaires et de prévention de base. Par ailleurs, il appartient à tout un chacun de faire sa part. Il faut faire des choix responsables de nature à prévenir la propagation de la maladie et à promouvoir la santé publique dans la collectivité et dans le pays.
Ainsi, d'un bout à l'autre de l'Afrique, nous voyons des exemples de gens qui s'attaquent à ces problèmes. Au Nigéria, des chrétiens et des musulmans ont mis en place un programme interconfessionnel de lutte contre le paludisme qui est un modèle de coopération. Ici au Ghana et dans toute l'Afrique, nous observons des idées novatrices visant à combler les lacunes du système de santé, par exemple des initiatives d'échanges d'informations médicales par Internet qui permettent à des médecins exerçant dans de grandes villes d'aider ceux des petites agglomérations.
Les États-Unis appuieront ces efforts dans le cadre d'une stratégie de santé exhaustive et mondiale. Car au XXIe siècle, nous sommes appelés à agir selon notre conscience mais aussi dans notre intérêt commun. Lorsqu'un enfant meurt à Accra d'une maladie évitable, cela nous diminue partout. Lorsque dans un coin quelconque du monde on néglige de s'attaquer à une maladie, nous savons qu'elle peut se propager à travers les océans et d'un continent à l'autre.
C'est pourquoi mon gouvernement s'est engagé à consacrer 63 milliards de dollars à relever ces défis - 63 milliards de dollars. En nous fondant sur les solides efforts du président Bush, nous poursuivrons la lutte contre le VIH/sida. Nous ne cesserons de chercher à enrayer la mortalité due au paludisme et à la tuberculose et nous travaillerons à éradiquer la polio. Il ne s'agit d'ailleurs pas de s'attaquer aux maladies isolément : nous investirons dans des systèmes de santé publique à même de prévenir la maladie et de promouvoir le bien-être, en mettant l'accent sur la santé maternelle et infantile.
En même temps que nous unissons nos efforts en faveur d'une meilleure santé, nous devons également stopper la destruction causée non pas par la maladie, mais par les êtres humains. C'est pourquoi le dernier domaine que je vais aborder se rapporte aux conflits.
Soyons bien clairs : l'Afrique ne correspond pas à la caricature grossière d'un continent perpétuellement en guerre. Mais si l'on est honnête, pour beaucoup trop d'Africains, le conflit fait partie de la vie ; il est aussi constant que le soleil. On se bat pour des territoires et on se bat pour des ressources. Et il est toujours trop facile à des individus sans conscience d'entraîner des communautés entières dans des guerres entre religions et entre tribus.
Tous ces conflits pèsent sur l'Afrique comme un véritable boulet. Nous sommes tous répartis selon nos identités diverses, de tribu et d'ethnie, de religion et de nationalité. Mais se définir par son opposition à une personne d'une autre tribu, ou qui vénère un prophète différent, cela n'a aucune place au XXIe siècle. La diversité de l'Afrique devrait être source de force et non facteur de division. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous partageons tous des aspirations communes : vivre dans la paix et dans la sécurité ; avoir accès à l'éducation et à la possibilité de réussir ; aimer notre famille, notre communauté et notre foi. Voilà notre humanité commune.
C'est la raison pour laquelle nous devons nous élever contre l'inhumanité parmi nous. Il n'est jamais justifiable - jamais justifiable - de cibler des innocents au nom d'une idéologie. C'est un arrêt de mort, pour toute société, que de forcer des enfants à tuer dans une guerre. C'est une marque suprême de criminalité et de lâcheté que de condamner des femmes à l'ignominie continuelle et systémique du viol. Nous devons rendre témoignage de la valeur de chaque enfant au Darfour et de la dignité de chaque femme au Congo. Aucune religion, aucune culture ne doit excuser les atrocités qui leur sont infligées. Nous devons tous rechercher la paix et la sécurité nécessaires au progrès.
On voit d'ailleurs des Africains se mobiliser pour cet avenir. Ici aussi, au Ghana, nous vous voyons contribuer à montrer la voie. Soyez fiers, Ghanéens, de vos contributions au maintien de la paix au Congo, au Libéria ou encore au Liban, ainsi que de votre résistance au fléau du trafic de stupéfiants. Nous nous félicitons des mesures que prennent des organisations telles que l'Union africaine et la CEDEAO en vue de mieux régler les conflits, de maintenir la paix et de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et nous encourageons la vision d'un cadre sécuritaire régional puissant, capable de mobiliser une force efficace et transnationale lorsque cela s'avère nécessaire.
Il incombe aux États-Unis de travailler avec vous en tant que partenaire à promouvoir cette vision, non seulement par des paroles mais aussi par des appuis qui renforcent les capacités de l'Afrique. Lorsqu'il y a génocide au Darfour ou des terroristes en Somalie, ce ne sont pas simplement des problèmes africains : ce sont des défis mondiaux à la sécurité, exigeant une riposte mondiale.
C'est pourquoi nous sommes prêts à agir en partenariat, tant par la diplomatie que par l'assistance technique et l'appui logistique, et que nous soutiendrons les efforts visant à contraindre les criminels de guerre à rendre des comptes. En outre, je tiens à le dire clairement : notre Commandement pour l'Afrique ne vise pas à prendre pied sur le continent, mais à relever ces défis communs afin de renforcer la sécurité des États-Unis, de l'Afrique et du reste du monde.
À Moscou, j'ai parlé de la nécessité d'un système international où les droits universels des êtres humains soient respectés et où les violations de ces droits soient combattues. Ceci doit inclure un engagement à soutenir ceux qui règlent les conflits pacifiquement, à sanctionner et à arrêter ceux qui ne le font pas, et à aider ceux qui ont souffert. Mais en fin de compte, ce seront des démocraties dynamiques telles que le Botswana et le Ghana qui diminueront les causes de conflit et élargiront les frontières de la paix et de la prospérité.
Comme je l'ai déjà dit, l'avenir de l'Afrique appartient aux Africains. Les peuples d'Afrique sont prêts à revendiquer cet avenir. Dans mon pays, les Afro-Américains - dont un grand nombre d'immigrés récents - réussissent dans tous les secteurs de la société. Cela, nous l'avons accompli en dépit d'un passé difficile et nous avons puisé notre force dans notre héritage africain. Avec de puissantes institutions et une ferme volonté, je sais que les Africains peuvent réaliser leurs rêves à Nairobi et à Lagos, à Kigali et à Kinshasa, à Harare et ici-même à Accra.
Vous savez, il y a cinquante-deux ans, les yeux du monde étaient rivés sur le Ghana. Et un jeune prédicateur du nom de Martin Luther King est venu ici, à Accra, pour voir amener les couleurs de l'Union Jack et hisser le drapeau du Ghana. Cet événement précédait la Marche sur Washington et l'aboutissement du mouvement des droits civiques dans mon pays. On a demandé à Martin Luther King quel sentiment lui avait inspiré la vue de la naissance d'une nation, et il a répondu : "Cela renforce ma conviction que la justice finit toujours par triompher."
Aujourd'hui, ce triomphe doit être, une fois de plus, renouvelé, et c'est vous qui le devrez le faire. Ici, je m'adresse particulièrement aux jeunes, à travers toute l'Afrique et ici-même au Ghana. Dans des endroits comme le Ghana, vous représentez plus de la moitié de la population.
Et voici ce que vous devez savoir : le monde sera ce que vous en ferez. Vous avez le pouvoir de responsabiliser vos dirigeants et de bâtir des institutions qui servent le peuple. Vous pouvez servir vos communautés et mettre votre énergie et votre savoir à contribution pour créer de nouvelles richesses ainsi que de nouvelles connexions avec le monde. Vous pouvez conquérir la maladie, mettre fin aux conflits et réaliser le changement à partir de la base. Vous pouvez faire tout cela. Oui, vous le pouvez. Car en ce moment précis, l'histoire est en marche.
Mais ces choses ne pourront se faire que si vous saisissez la responsabilité de votre avenir. Ce ne sera pas facile. Cela exigera du temps et des efforts. Il y aura des souffrances et des revers. Mais je puis vous promettre ceci : l'Amérique vous accompagnera tout le long du chemin, en tant que partenaire ; en tant qu'amie. Cependant, le progrès ne viendra de nulle part ailleurs, il doit découler des décisions que vous prendrez, des actions que vous engagerez et de l'espoir que vous porterez dans votre cœur.
Ghana, la liberté est votre héritage. À présent, c'est à vous que revient la responsabilité de bâtir sur cette fondation de liberté. Si vous le faites, nous pourrons, bien des années plus tard, nous remémorer des lieux comme Accra et nous dire que c'est à ce moment-là que la promesse s'est réalisée, que la prospérité s'est forgée, que la douleur a été surmontée et qu'une nouvelle ère de progrès a débuté. Ce moment peut être celui où nous verrons, une fois de plus, triompher la justice. Oui, nous le pouvons. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.
Note JLK: Ce discours a été diffusé sur le site de la revue Africultures. http://www.africultures.com. Il me semble bon de le retransmettre ici.
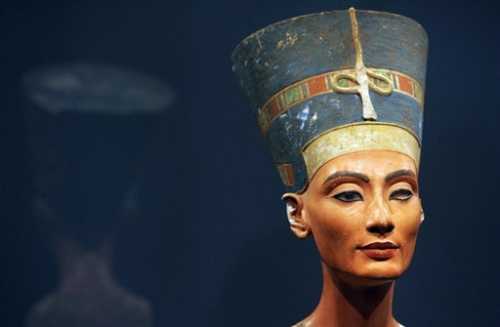
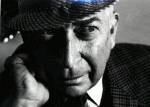 Un vrai goût du faux
Un vrai goût du faux 
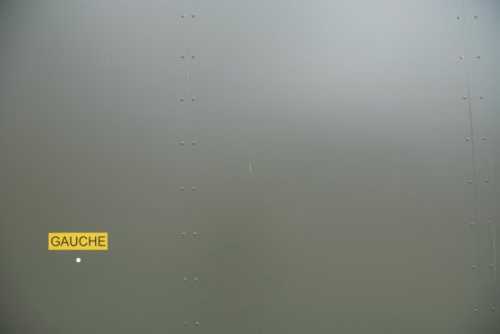
 …Little Fury tu es un amour, je ferme les yeux pour-être plus près de toi, tu as raison mon chéri, mon Schubert est un blaireau à côté du nouveau CD de Rob Zombie que tu m’as offert, il y a là-dedans un rythme revitalisant, c’est fou, surtout quand il se la pète, comme tu dis si joliment, je me sens rajeunir, tu n’as pas idée, et la prochaine fois, promis, tu me répètes ça : je vais t’en mettre une pile sur Black Sabbath - oh oui mon tout petit…
…Little Fury tu es un amour, je ferme les yeux pour-être plus près de toi, tu as raison mon chéri, mon Schubert est un blaireau à côté du nouveau CD de Rob Zombie que tu m’as offert, il y a là-dedans un rythme revitalisant, c’est fou, surtout quand il se la pète, comme tu dis si joliment, je me sens rajeunir, tu n’as pas idée, et la prochaine fois, promis, tu me répètes ça : je vais t’en mettre une pile sur Black Sabbath - oh oui mon tout petit…
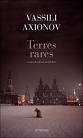 Les livres traduits en français de Vassili Axionov sont disponibles aux éditions Gallimard (L’oiseau d’acier ou Une Saga moscovite) et Actes Sud (À la Voltaire ou Terres rares), notamment.
Les livres traduits en français de Vassili Axionov sont disponibles aux éditions Gallimard (L’oiseau d’acier ou Une Saga moscovite) et Actes Sud (À la Voltaire ou Terres rares), notamment.
 De Michel Le Bris à Gilles Lapouge, en passant par Jean-Paul Kauffmann et Mariusz Wilk, Marguerite Yourcenar et Blaise Hofmann...
De Michel Le Bris à Gilles Lapouge, en passant par Jean-Paul Kauffmann et Mariusz Wilk, Marguerite Yourcenar et Blaise Hofmann... Michel Le Bris. Nous ne sommes pas d’ici. Grasset, 420p.
Michel Le Bris. Nous ne sommes pas d’ici. Grasset, 420p.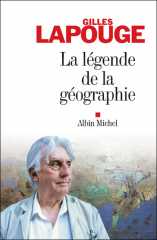 Au jardin du monde
Au jardin du monde  Rêver à la Courlande
Rêver à la Courlande Marguerite Yourcenar
Marguerite Yourcenar Blaise Hofmann
Blaise Hofmann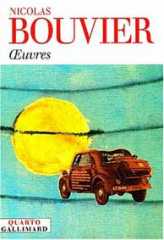 Les oeuvres de Nicolas Bouvier, richement documentées, ont fait l'objet d'un volume de la collection Quarto, chez Gallimard.
Les oeuvres de Nicolas Bouvier, richement documentées, ont fait l'objet d'un volume de la collection Quarto, chez Gallimard.