
J’étais sous la table et je captais des bribes de ce que disaient les grandes personnes, selon l’expression de notre grand-mère paternelle, qui leur intimait de tenir leur langue eu égard aux jeunes oreilles qu’il y avait là-dessous ; j’étais sous la table et c’est comme si je m’y trouvais encore à l’instant, imaginant notre mère-grand qui nous désignait à voix basse, jeunes oreilles aux aguets que nous étions - je me revois là-dessous avec l’un ou l’autre de mes frère et sœurs ou de mes cousins et cousines, à capter plus ou moins ce que disent les grandes personnes et si possible ce que nos jeunes oreilles ne sont pas censées entendre ; et chaque mot que j’ai retenu, chaque expression qui me revient me ramènent à la fois un visage ou un personnage avec son intonation de voix propre et ses traits particuliers.
J’entends ainsi cette voix plaintive - ce doit être celle de la cousine Pauline, dont l’obésité commence à peser sur ses mouvements et son moral -, qui égrène son chapelet de lamentations sur ces années où l’on a tant lutté, selon son expression, et c’est sur le même ton que notre mère aussi nous rappellera, parfois avec un accent frisant le reproche, combien nous autres, qui n’avons pas connu la guerre, avons de la chance de n’avoir pas dû tant lutter. Et Pauline de rappeler qu’en ce temps-là tout était rationné et qu’on a même parfois manqué, selon l’expression, surtout vers la fin, et qu’un seul œuf par mois a constitué une épreuve, et que les biscuits à la pomme de terre en ont été une autre, et que la soupe du boucher ne valait guère mieux sans doute que celle de ces camps allemands où l’on affamait les gens.
Mais le ton soupirant de la tante Pauline a le don d’exaspérer notre oncle Victor, son conjoint, protestant que ces jérémiades de bonnes femmes, selon son expression, ne doivent pas nous faire oublier la chance que nous avons eue grâce au Général, et notre grand-père aussi réagit aux plaintes de sa fille qui se rebiffe et va pour faire la tête, selon l’expression, et notre oncle Norbert et son frère, notre père, s’entremettent alors en conciliateurs tandis qu’à la voix plaintive de la tante Pauline se joignent les voix plaintives de notre mère et d’une cousine dont j’oublie le nom, mais notre grand-mère rallie l’autre camp de son conjoint à elle et de son gendre, et bientôt on ne s’entend plus, là-haut, quand une voix d’homme posé à l’accent américain, qui ne peut être que celle du professeur Barker, l’ami du Président, relève que, même s’ils ont enduré quelques privations, les habitants de ce pays préservé de la guerre ne sauraient comparer leurs conditions de vie à celles des populations envahies ou déportées, bombardées ou massacrées, après quoi l’on entend un long silence froid que notre mère-grand interrompt en annonçant le café et les pousse-café.
 De dessous la table j’entends ce mot DÉPORTÉS pour la première fois, comme j’entends pour la première fois l’expression CAMP DE CONCENTRATION, dont mon grand-père me montrera plus tard des images dans un livre illustré plein de maigres corps nus qui me troublent et de visages épouvantés, intitulé Plus jamais ça, mais sous la table tout cela ne signifie rien à mes yeux et quand j’entends, un autre jour, le mot JUIF, cela ne me dit rien non plus, mais je me rappelle distinctement cette voix qui dit là-haut : Juifs et Arabes, c’est le même nez crochu, sans trop savoir si je dois rire ou pas…
De dessous la table j’entends ce mot DÉPORTÉS pour la première fois, comme j’entends pour la première fois l’expression CAMP DE CONCENTRATION, dont mon grand-père me montrera plus tard des images dans un livre illustré plein de maigres corps nus qui me troublent et de visages épouvantés, intitulé Plus jamais ça, mais sous la table tout cela ne signifie rien à mes yeux et quand j’entends, un autre jour, le mot JUIF, cela ne me dit rien non plus, mais je me rappelle distinctement cette voix qui dit là-haut : Juifs et Arabes, c’est le même nez crochu, sans trop savoir si je dois rire ou pas…
Mon père et son frère ne se querellent jamais, notre tante Pauline se lamente, comme se lamentent parfois, aussi, notre mère et sa sœur Greta, et Victor qui ne parle que de sport automobile les charrie, selon l’expression de notre mère-grand, qui le gourmande volontiers comme s’il n’était qu’un vaurien alors qu’elle le dit capable dans sa partie, de même qu’ elle le dit de notre grand-oncle Cédric, conjoint de la demi-sœur de notre grand-mère, et de ses deux fils, chacun reconnu capable dans sa partie, et n’est-ce pas ce qui compte pour se faire une place au soleil, selon l’expression ?
À leur voix, de mon poste d’observation de dessous la table, je m’exerce à reconnaître les prénoms de mes tantes et de mes oncles à chacun du repas du dimanche à la villa la Pensée, et lors des fêtes c’est à tout un monde que je m’efforce de rendre son prénom comme, dans l’antichambre, les enfants, nous nous amusons à identifier les manteaux de chacun et de nous en déguiser en imitant la voix de chacun.
Pourtant ce ne sont pas que des traits personnels que je m’efforce de me remémorer : c’est plutôt une façon de parler mais aussi de se taire, une façon de se tenir et d’écouter les autres, telle ou telle façon de se retenir ou de se protéger tout en regrettant peut-être de se trouver pareillement empêché par ce qu’on pourrait dire de ce qu’on dit - c’est tout cela que j’entends bouronner et bourdonner, à l’instant, dans le silence revenu de ceux que je dirai les miens – de notre smala que je dirai comme d’un pays entier ou d’une entière humanité de gens ordinaires, dans ces maisons et dans les autres.
Car il y a d’autres maisons, et dans la même maison, dès qu’il y a deux frères il y a conflit possible entre le grand et le petit Ivan ; dès qu’il y a frères et sœurs, cousins et alliés, mariages puis héritages, royaumes et dominations, toute maison, fût-elle bien habitée, selon l’expression de notre mère-grand, devient possible Maison de l’Araignée, comme dans la terrible légende que nous ont racontée maintes fois nos bonnes tantes Greta et Lena. On a beau former ainsi comme une tribu, quoique déjà subdivisée en deux parties : il y a encore d’autres lits, selon l’expression de notre mère-grand, et c’est là que tout se complique : là que je rapplique aussi, mauvais esprit que je suis, en sorte de faire parler les silencieux, quand bien même il y aurait des choses qui ne se disent pas, selon l’expression de notre grand-mère paternelle.
Du côté, précisément, de notre mère-grand ne peut s’ignorer, depuis toujours, la question du second lit, selon son expression, avec ces gens-là dont on parle le plus souvent à voix basse, crainte que rumeurs et ragots ne parviennent aux jeunes oreilles qu’il y a sous la table, qu’on envoie d’ailleurs bientôt jouer ailleurs…
En tout cas, pendant la guerre on se portait mieux parce qu’on mangeait moins, remarque notre grand-père en ne refusant point un petit supplément du dessert de mère-grand, qui remarque comme ça, au vol, qu’il y avait quand même des privations. Et d’ajouter aussitôt : sauf que certains se sont arrangés, faisant allusion à ceux du second lit, selon son expression, qui étaient de mèche avec ceux du marché noir et qui ont même fait des affaires tandis que les honnêtes gens en étaient réduits, ou peu s’en fallait, à manger leur propre main, comme on dit.
Ceux du second lit, cependant, conformément à la Parole selon laquelle les premiers seront les derniers, sont bel et bien devenus les derniers après la guerre, mais on n’en saura pas plus, on n’en dira pas plus, on sait simplement ce qu’on sait sur ceux du second lit, étant entendu qu’il n’y a pas de fumée sans feu, et ce qui a été dit et répété, même s’il est convenu qu’il n’est pas joli de colporter des bruits, ce qui a été rapporté d’une maison à l’autre et d’année en année fait que les maisons se sont éloignées les unes des autres - mais comment dire ce qui s’est passé vraiment ?
La page noire de la nuit de neige d’avant l’aube aura creusé, devant moi, tout ce temps d’invoquer les disparus, qui me sont à vrai dire chaque jour plus présents, cette étendue de silence dans laquelle ils se sont perdus les uns après les autres, comme dans un désert ou dans une forêt, se fuyant les uns les autres ou s’ignorant les uns les autres pour des motifs de plus en plus anodins - puis la neige a fondu et les jours ont recommencé de grandir.
(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chantier)








 Celui qu’a sidéré la démagogie mondiale suscitée par
Celui qu’a sidéré la démagogie mondiale suscitée par


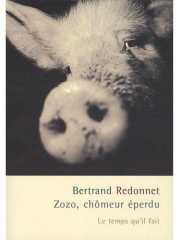


 De dessous la table j’entends ce mot DÉPORTÉS pour la première fois, comme j’entends pour la première fois l’expression CAMP DE CONCENTRATION, dont mon grand-père me montrera plus tard des images dans un
De dessous la table j’entends ce mot DÉPORTÉS pour la première fois, comme j’entends pour la première fois l’expression CAMP DE CONCENTRATION, dont mon grand-père me montrera plus tard des images dans un
 Marc Levy, Le Premier jour. Robert Laffont, 498p.
Marc Levy, Le Premier jour. Robert Laffont, 498p.