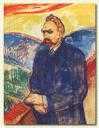HOMMAGE Mort d’un des derniers monstres sacrés du roman américain.
C’est un écrivain tantôt formidable et tantôt affligeant, un romancier surpuissant quoique fort inégal, un intellectuel courageux et parfois égaré, un égomane effréné portant sur lui la superbe des States, mais aussi leurs névroses, jusqu’à la folie meurtrière, qui vient de disparaître en la personne de Norman Mailer, mort samedi dernier des suites d’une insuffisance rénale, à l’âge de 84 ans.
On a parlé de « trublion » à l’annonce de sa disparition, et l’amnésie galopante de l’époque aidera ceux qui ne l’ont pas « fréquenté » à grimacer l’air entendu après avoir lu quelques descentes en flammes de son dernier roman (Un château en forêt) évoquant la destinée d’Adolf Hitler; or s’il est vrai que ce trente-neuvième roman fait assez pataude et confuse figure mystico-psychanalytique, en dépit de forces créatrices toujours impressionnantes, l’œuvre antérieure de Norman Mailer aura marqué son temps avec cinq ou six grands livres, dans le sillage de Dos Passos et Hemingway, ses maîtres, aux côtés de Saul Bellow et de son vieux frère ennemi Gore Vidal, notamment.
Sans préjuger des arrêts de la postérité, qui oubliera les frasques de l’histrion mégalomane au « conservatisme de gauche », chantre de l’orgasme cosmique (disciple de Wilhelm Reich), phallocrate marié six fois et candidat à la mairie de New York, entre autres titres de gloire plus spécifiquement littéraires, tels deux prix Pulitzer et une mention récurrente au Nobel, quelques romans majeurs devraient « rester » comme des stèles de la mémoire du XXe siècle et du rêve américain mis à mal.
 Les nus et les morts (1948) est le plus "évident" qui, sous couvert d’un roman de guerre, est une première approche de l’homme américain sous quatre aspects opposés (le général autocrate, son aide de camp gauchisant, un prolétaire anarchiste et un sergent bestial) avec lequel le tout jeune Mailer (né en 1923 dans une famille juive du New Jersey), diplômé d’Harvard et pilote dans le Pacifique, est aussitôt propulsé au premier rang de la scène littéraire.
Les nus et les morts (1948) est le plus "évident" qui, sous couvert d’un roman de guerre, est une première approche de l’homme américain sous quatre aspects opposés (le général autocrate, son aide de camp gauchisant, un prolétaire anarchiste et un sergent bestial) avec lequel le tout jeune Mailer (né en 1923 dans une famille juive du New Jersey), diplômé d’Harvard et pilote dans le Pacifique, est aussitôt propulsé au premier rang de la scène littéraire.
A travers les années 60-70, Norman Mailer sera acteur, témoin, sismographe vivant des secousses qui vont ébranler son pays, dont l’observation polémique donne lieu à des expériences d’écriture non moins « en phase » où le pop art, la parodie des nouveaux médias (dans Pourquoi nous sommes au Vietnam, en 1967, où nous sommes essentiellement… au Texas du futur Bush!), le roman-reportage (Les Armées de la nuit, autre grand livre relatant la manifestation de 1969 devant le Pentagone), le pamphlet, la biographie (Hemingway, Marylin, Picasso) alternent jusqu’à cet autre pic de l’œuvre que représente Le Chant du bourreau (1979), roman-vérité qui, à partir de la trajectoire d’un condamné à mort – le double meurtrier Gary Gilmore suivi de sa naissance à son exécution par lui-même exigée -, brosse la fresque d’un monde impitoyable, rappelant à l’évidence le mythique De sang-froid (1966) de Truman Capote, plus « en pleine pâte » et dans la tonalité de cette nouvelle décennie et de ses traumatismes collectifs annonciateurs d’autres lendemains qui déchantent.
Or de ceux-ci, Norman Mailer fut le prophète diversement inspiré, et plus encore le médium passionné, avouant enfin, récemment encore, qu’il n’aura jamais été « qu’un écrivain » - mais pas des moindres !
Cet hommage a paru dans l'édition de 24Heures du 12 novembre 2007.
-
-
Le cercle des niaiseux
Cercle de Yannick Haenel ou la quadrature du vide. Le Prix Décembre 2007 conforte les Gallimardeux. Mais JLK persiste et signe, le blaireau...
Il est divertissant de suivre, de loin, les ronds-de-jambes ou les coups d’épée dans l’eau que provoque, depuis sa parution, le livre le plus niais de la rentrée littéraire, je veux parler évidemment de Cercle d’Yannick Haenel. Qu’on le porte aux nues en faisant de ce pavé de vent un « roman total », comme Sébastien Lapaque dans le Figaro littéraire, ou qu’on en fasse le vortex de l’abjection plagiaire ainsi que s’y emploie Alina Reyes dans une polémique aussi bécassine que son bécasson d'objet, celui-ci reste évidemment ce qu’il est à nos yeux éberlués : une espèce de course du rat chic dans un dédale toc.
Si l’auteur de Cercle avait dix-sept ans et qu’il déboulât avec son air crâne et sa jolie plume dansante, ses références en veux-tu en voilà et ses pastiches d’un peu tout, dès la première scène du pont sur la Seine d’où le protagoniste jette son ancienne vie à l’instant, hop, de sauter dans la nouvelle et de s’écrier : chic c’est la joie, je revis, enfin je vais pouvoir mettre le doigt au cul de Clarine et me palucher en lisant Moby Dick, si tout cela était le fait d’un paluchon ludique et que son premier bouquin eût trois cent pages de moins, oui certes, oui-da, nous marcherions plus volontiers, comme nous marchons le pied-léger à travers les cinq premières pages, qui en deviennent hélas cinq cents. Mais Yannick Haenel a quarante balais et n'est plus ingénu que de posture en sémillant émule du pape Sollers.
Et cinq cents pages pour dire quoi ? Rien que de convenu, rien que de pseudo-rimbaldien, rien que de sous-sollersien dans la conjonction d’un hédonisme de pacotille et d’un usage germanopratin de la semi-culture. Cela se veut alerte, ouvert, oui-disant et dansant, mais sans quitter la manière du petit marquis, et ensuite non moins affecté dans le simulacre de gravité puisque du cul de Clarine il faut bien passer au trou noir de l’Histoire. Or tout cela est lourd quand cela se veut ludique, et léger devant le tragique.
Enfin quel roman total ? Du total chiqué sans doute. Et cela vaut-il la moindre polémique ? Qu’on lui colle plutôt un prix (c'est fait !) et le cercle se bouclera comme on l'espère du piapia niaiseux qui en a émané à grosses bubulles…
Yannick Haenel. Cercle. Gallimard, L’Infini.
-
Freud et Dieu causent grave
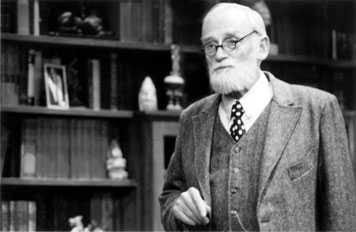
Le visiteur d’Eric Emmanuel Schmitt, mis en scène par Gildas Bourdet
Mais qu’est-ce que ce truc ringard ? Voilà ce qu’on pourrait se demander d’abord en découvrant le décor brunâtre représentant un intérieur viennois fleurant le vieux rat savantasse, où apparaissent d’abord un octogénaire chenu et sa fille quadra plus vraiment bimbo... Ensuite le thème, mes aïeux : Sigmund Freud qui reçoit, en 1938, la visite d’un drôle de type, qui est peut-être un dingue échappé de l’asile ou Dieu déguisé en dandy magicien, avec lequel il va « causer grave » pendant qu’Anna, sa fille, se fait interroger par les brutes de la Gestapo ! Autant dire : la totale.
Et c’est exactement ça, près de quinze ans après la création du Visiteur, qui a glané 3 Molière dans la foulée et fut représenté dans le monde entier, alors que le texte a été vendu à plus de 40.000 exemplaires: la totale non moins que tardive (!) surprise d’une pièce grave et belle, qui n’a pas pris une ride alors qu’elle relève d’un genre remontant à l’époque de Sartre et Camus, servie par des interprètes également remarquables, à commencer par Benoît Verehaert dans le rôle adorablement méphistophélique de Dieu, face auquel Alexandre von Sivers campe un Freud en héros de la Raison poignant d’humanité.
Gildas Bourdet signe la mise en scène de cette version qui accentue magnifiquement le dessin de chaque personnage, pour mieux détailler et éclairer le grand débat qui s’y joue.
Lausanne. Espace culturel des Terreaux, dernière le 11 novembre à 17h. -
Sollers l'enfant bleu

Des aléas de la lecture panoptique
Sollers exagère : il prend toute la place. J’ai sept livres en lecture suivie, à part Proust évidemment tout le temps, j’ai le Bob Dylan de François Bon, j’ai La Nuit du destin de mon amie arabo-proustienne Asa Lanova, j’ai le formidable Achever Clausewitz de René Girard et Benoît Chantre, j’ai l’épatant Juste un jour de mon ami Antonin Moeri, j’ai la non moins épatante Vie mécène de mon non moins cher compère Jean-Michel Olivier, j'ai le superbe Insurgés de mon camarade Alain Dugrand, enfin j’ai Nullarbor de David Fauquemberg, ça fait sept et il y en a d’autres encore (j’avais juste besoin du chiffre sept), mais Sollers se campe au milieu de la photo avec ses Mémoires qui n’en sont pas (ou disons qu’il réinvente le genre) et m’impose en somme, autant par sa présence poétique personnelle que par ses admirations, le partage de sa passion.
« La passion, c’est l’impératif de présence », écrit Philippe Sollers à propos d’une de ses première amantes d’adolescent, mais on pourrait étendre la définition à tous les aspects de sa présence au monde, cristallisée en poésie.
Un vrai roman est-il un vrai roman ? Ce qui est sûr c’est que c’est un impératif de présence qui aimante formidablement, on pourrait dire qu’il touche « direct au système nerveux », comme Sollers le disait de la peinture de Bacon, à cela près que Sollers peint avec des mots, et que ces mots sont à tout le monde et viennent de loin.
Il faut se le représenter en enfant demeuré, petit roi, tyranneau, vélocipédiste ailé qui découvre le monde entre les bibliothèques des siens et les seins des boniches des siens.
Philippe Joyaux a décidé tout enfant d’être invisible en tant que Sollers, et il tient bon, le crack. Tout ce qu’on dit de lui est à côté, sauf ce qui est dit par ceux qui ont comme lui l’art de marcher la nuit sur des fils de funambule, car il va de soi que Sollers est de l’aréopage ailé des enfants somnambules.
J’avais rendez-vous ce matin à Sauternes avec Sollers, puis j’ai pensé qu’un crochet par SinCity s’imposait au préalable pour évoquer la lecture croisée extraordinairement tonique et pénétrante de La Divine Comédie de Dante que module un entretien éponyme de 700 pages qu'ont mené Benoît Chantre et Philippe Sollers, mais ça n’ira plus ce matin : trop tard : j’ai rencard avec Rita la coiffeuse. Donc je fais faux bond à mes 900 lectrices et lecteurs occultes de ces jours, salut les enfants bleus… -
Gallimard gallimarde

Le Goncourt à Gilles Leroy pour Alabama Song, et le Renaudot à Daniel Pennac pour Chagrin d'école
C'est finalement à l'un des moins «attendus» des cinq derniers papables du Goncourt qu'est revenu hier le plus convoité des prix littéraires français avec la désignation, après 14 tours et par 4 voix contre 2 à Olivier Adam, d'Alabama Song, du journaliste écrivain Gilles Leroy, paru au Mercure de France. Evoquant à la première personne la vie passionnée de Zelda Fitzgerald, épouse d'un des plus grands écrivains américains du XXe siècle, l'auteur reprend la thèse de certains biographes estimant que Zelda fut la victime, à bien des égards, du vampirisme de son génial conjoint. A l'évidence, Gilles Leroy a fait plus que s'imprégner de la riche documentation (notamment la correspondance très significative) existant à propos du couple le plus brillant de la bohème artistique de l'entre-deux-guerres américain: il s'est véritablement coulé dans le personnage dont il module la voix en faisant alterner les inflexions de la brillantissime fille à papa de Montgomery, celle de l'artiste inaccomplie (elle rêvait de devenir la plus grande danseuse de son temps, comme Scott avait résolu d'être le plus grand romancier de tous les temps...) et celles de la femme vieillissante, souffrant de schizophrénie et promise à une mort atroce dans les flammes...
En décernant le Goncourt à Gilles Leroy, les jurés de l'Académie «offrent» au grand public un roman joliment ficelé sur une destinée aventureuse et glamour à souhait. A ce thème rebattu, l'essayiste Pietro Citati vient pourtant de donner, dans La mort du papillon, paru chez Gallimard (!) un nouvel éclairage plus incisif et profond, où justice est rendue aux deux parties... Ce qu'on peut regretter, surtout, c'est que l'élément «anecdotique» ait prévalu une fois de plus dans un choix dont ont été écartés des écrivains plus engagés ou originaux, tels Michèle Lesbre ou Olivier Adam, sans parler de moult «oubliés» des premières sélections, tels François Emmanuel ou Hubert Haddad...
Si le Goncourt à Gilles Leroy a étonné, le Renaudot attribué à Daniel Pennac a plus encore surpris du seul fait... qu'il ne figurait pas sur la sélection. Son Chagrin d'école, plaisant autoportrait d'un cancre en lequel on ne saurait deviner un futur auteur à la faconde stylée et aux succès répétés, intéresse à la fois par son propos autobiographique et par le regard que l'ex-enseignant, venu au roman par les sentiers buissonniers du polar gouailleur, jette sur les affres de l'école. Le livre rend aussi un bel hommage à certains profs «éveilleurs» autant qu'à sa mère centenaire, qui continue de s'inquiéter de son avenir (!), faisant écho à la variation pédagogique de Comme un roman.
Quant au Prix Renaudot de l'essai, il a été décerné à Olivier Germain-Thomas pour Le Bénarès-Kyoto, récit d'un périple évoquant, avec moult péripéties, la traversée asiatique d'un «étonnant voyageur» à la joyeuse érudition.
Gilles Leroy. Alabama Song. Mercure de France. Daniel Pennac. Chagrin d'école. Gallimard. Olivier Germain-Thomas. Le Bénarès-Kyoto, Le Rocher.Des jurés sous influence ?
Et c’est ça que vous appelez le meilleur de la littérature française en train de se faire? Voilà la question que le lecteur attentif serait enclin à lancer aux jurés respectifs de l’Académie Goncourt et du Prix Renaudot au vu des deux romans qui viennent d’obtenir les deux distinctions les plus cotées de l’automne littéraire. Un tant soit peu au fait des dessous de l’édition parisienne et de ses réseaux d’influence, l’impudent poussera le bouchon plus loin: plutôt que Gilles Leroy et Daniel Pennac, n’est-ce pas la seule maison Gallimard que vous avez primée par deux fois?, étant entendu que le Mercure de France où paraît le Goncourt est une filiale de la puissante maison, déjà triomphante l’an dernier avec Les Bienveillantes de Jonathan Littell, préalablement consacré par le public et l’Académie française… Ce qui frappe en tout cas, c’est que les deux lauréats de cette année apparaissent comme les bénéficiaires chanceux de tractations tordues: 14 tours (!) au final du Goncourt après l’éviction de «favoris» dont le handicap tenait au nom de l’éditeur: P.O.L. pour Marie Darrieussecq, Sabine Weispieser pour Michèle Lesbre, Stock pour Philippe Claudel et L’Olivier pour Olivier Adam (finaliste «à la Poulidor»). Souvent controversés pour la dépendance directe liant les jurés aux trois principales enseignes littéraires parisiennes (Gallimard, Grasset et Le Seuil, alias Galligrasseuil), les deux premiers grands prix de cette année trahissent une fois de plus un malaise évident. On ne dira pas pour autant que le Goncourt et le Renaudot 2007 sont sans intérêt ou promis à l’insuccès. Au contraire. Mais que penser d’une «course» privilégiant a priori les concurrents en fonction de leur appartenance à telle ou telle écurie?
Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures du 6 novembre 2007
-
La question humaine
 Retour sur un roman de François Emmanuel, adapté au cinéma
Retour sur un roman de François Emmanuel, adapté au cinéma
On se rappelle l’effroi que suscitèrent les attitudes et les propos d’Eichmann lors de son procès : au lieu de la bête immonde présumée, le personnage apparut sous les traits d’un blême bureaucrate qui affirmait n’avoir jamais fait qu’obéir aux autres et aux consignes techniques de rigueur. Celles-ci dirigent également le psychologue spécialisé en ressources humaines qui raconte, dans La question humaine, comment il a été amené à enquêter sur la dégradation des facultés mentales du directeur de la firme d’origine allemande qui l’emploie. Sous prétexte de « restructuration », il travaille lui aussi dans la « sélection » et l’ « évacuation », et le fait est que le vocabulaire de son investigation entre en consonance de plus en plus troublante avec celui des exécuteurs de la Solution finale.
Sans comparer l’incomparable, François Emmanuel n’en montre pas moins que certains termes « propres » du langage technique illustrent la même façon expéditive de résoudre liquidation de masse ou gestion du personnel… Or, loin de s’en tenir à une démonstration, le romancier incarne ses observations de telle façon que l’on se sent piégé au même titre que ses personnages.François Emmanuel, La question humaine. Stock, 2000. Réédité en poche. Adapté au cinéma en 2007 par Nicolas Klotz.
-
Nietzsche au matin
C’est le matin et je suis plein de joie de vivre. On aurait des raisons de désespérer (trop de souffrance pour trop de gens) mais on se sent cependant l'élan de faire quelque chose, au moins aussi bien sinon mieux qu’un singe. Nietzsche appelait de ses vœux un surhomme qui fît mieux que le singe, mais il sentait aussi, par son intuition de la faiblesse, que son appel à la sélection (même au sens spirituel) était une pensée dangereuse. Lui qui a tout fait pour que l’homme cesse de se leurrer s’est lui-même leurré par manque (je crois) de réalisme. Lui qui a si bien pressenti l’avènement du dernier homme (l’homme encarté du Bancomat) aurait sûrement rejeté Hitler au premier regard, car il restait une âme sensible en dépit de son génie surpuissant (donc très exposé) et il aurait trouvé Mussolini, et Goebbels, et Lénine, et Staline, et Ceausescu non moins repoussants, je présume… N'empêche qu'il n'a pas compris le réalisme du Christ.
Image: Nietzsche, par Edvard Munch