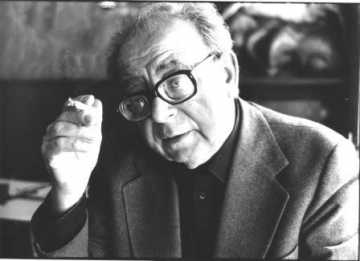
Souvenirs d'un ami, par François Debluë
Comme pour beaucoup d’autres, Georges Haldas aura été pour moi un extraordinaire passeur d’énergies. De combien de rencontres où je m’étais rendu d’humeur sombre ou maussade ne suis-je pas revenu vivifié, ressourcé, étonné d’avoir découvert de nouveaux territoires, de nouvelles raisons d’être – et impatient de me mettre au travail !
Je n’avais pas vingt ans; Haldas venait de franchir ses cinquante ans. Avec une passion contagieuse, engagé qu’il était dans l’aventure de vivre et d’écrire (ce qui ne faisait qu’un), le poète, le prosateur et l’infatigable lecteur que je rejoignais le plus souvent à Genève me révélait des continents entiers : ceux des littératures russe, espagnole, italienne ou américaine, où l’air et l’esprit circulent plus au large que chez les seuls français auxquels l’école et l’académie nous confinaient d’ordinaire.
Au-delà de ces littératures, pourtant, non pas contre elles mais avec elles, c’est le monde même que l’écrivain m’appelait à interroger : ses enjeux politiques, sociaux et spirituels, collectifs aussi bien qu’individuels.
Dans le même temps, c’était son œuvre qu’il m’était donné de découvrir. Ses premiers recueils poétiques, comme aussi, à une époque où il n’avait pas encore publié ses Carnets de L’Etat de Poésie, ses premières « chroniques », celles qui devaient me toucher le plus, de Gens qui soupirent, quartiers qui meurent au Livre des Passions et des Heures, en passant par Boulevard des Philosophes, Jardin des Espérances, La Maison en Calabre, Chute de l’Etoile Absinthe et Chronique de la Rue Saint-Ours. Un monde était en train de naître, des livres où se manifestaient une voix nouvelle et un regard d’une exceptionnelle acuité, à la faveur d’une forme profondément originale.
À ces chroniques, je choisissais bientôt de consacrer une première synthèse (dont Jacques Mercanton avait accueilli généreusement le projet). La prose de Haldas n’était pas toujours appréciée : elle dérangeait les conventions ; sa fécondité même paraissait suspecte ; elle se heurtait au scepticisme, aux réticences et aux silences de certains critiques bien-pensants. Pour moi, l’enjeu en était vital. Ces livres me révélaient à moi-même, angoisses, tourments et émerveillements, ils éclairaient mon chemin.
Loin des bibliothèques (que je fréquentais d’ailleurs assidûment), loin surtout de certains laboratoires formalistes et sectaires, nos soirées étaient aux « petits établissements » de Genève, dont Georges Haldas connaissait par cœur la géographie. Nous mangions d’incomparables entrecôtes mexicaines, buvions quelque savoureux chiroubles, et Georges Haldas, devenu Georges (mais toujours nous nous serons vouvoyés) m’accordait le plus précieux : son temps, son amitié, sa confiance. Mes premiers livres devaient ainsi paraître à l’enseigne de la collection du « Rameau d’Or » dont Vladimir Dimitrijevic lui avait confié la responsabilité aux éditions de l’Âge d’Homme.
Georges Haldas me parlait de ses travaux en cours ; plus allusivement (parce qu’il ne fallait pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué) de ses projets ; de ses lectures. Depuis longtemps, il interrogeait la Bible, le Don Quichotte (ô combien j’aurais souhaité qu’il écrive l’essai dont il me parlait à son sujet !), Homère et les tragiques grecs. Baudelaire, Charles-Louis Philippe, Léon-Paul Fargue, bien d’autres encore, lui étaient des compagnons de vie. Tous lui donnaient ce « courage d’être » dont avait parlé le théologien Paul Tillich. Et ce même courage, sans le savoir peut-être, Georges me le transmettait à son tour. Malgré les doutes, les gouffres, les vertiges – à leur mesure même – la vie reprenait sens ; du moins, la nécessité s’imposait de lui en trouver un. Dire, comme André Breton, que la vie est à « repassionner » ne suffisait pas : elle était urgence et passion !
Dans les rues de Genève, la nuit depuis longtemps venue, nous évoquions Rousseau, Amiel, Tchekhov, Kafka, Reverdy, mais aussi Jean Vuilleumier, notre contemporain, devenu si proche à son tour. D’autres de nos contemporains avaient droit, il est vrai, à quelques féroces et joyeuses méchancetés dont nous savions assez le peu de fondement et la parfaite gratuité. Revenu à plus de gravité, Georges me faisait parler de Proust et de Céline, dont il évitait la lecture : leur fréquentation aurait sans doute interféré avec sa propre écriture. C’est que Georges Haldas est un styliste ; il est de ceux, somme toute très rares, qui se trouvent une voix, un rythme, des inflexions à quoi on les reconnaît désormais sans hésiter.
Mais nous nous relayions alors, dans les rues maintenant presque désertes, pour évoquer tel passage d’Apollinaire :
Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué
De la belle aube au triste soir…
L’heure était à la mélancolie. La voix chargée d’émotion, dans l’impératif et tenace élan de vie qui n’a cessé d’être le sien en dépit des épreuves, Georges me récitait un poème des « Amis inconnus » de Supervielle :
On voyait le sillage et nullement la barque
Parce que le bonheur avait passé par là.
Je me méfiais, je me méfie encore de ce mot « bonheur ». Il m’a toujours paru imprudent sinon indécent de le prononcer, au risque de le compromettre immédiatement.
Aux côtés de Georges Haldas pourtant, je savais pouvoir partager quelque chose qui n’en devait pas être trop éloigné. Un élan. Une présence. Un amour du monde. Comme une intuition de cela même qui nous habitait et nous dépassait.
Je n’ai plus vingt ni trente ans. Le sillage ne s’est pas effacé pour autant. Ce que j’ai reçu continue de vivre en moi. Pour cela, cher Georges, je vous demeure à jamais reconnaissant.
En 1973, François Debluë proposait une première synthèse intitulée Les Chroniques de Georges Haldas, une œuvre au cœur de la relation. Plus tard, outre divers articles, il a dirigé et publié, en collaboration avec Jean Vuilleumier et Vladimir Dimitrijevic, un recueil d’essais et de témoignages sous le titre À la rencontre de Georges Haldas (L’Âge d’Homme, 1987). Poète et prosateur, lauréat du Prix Schiller 2004 pour l’ensemble de son œuvre, François Debluë a publié récemment Conversation avec Rembrandt (Seghers, 2006).
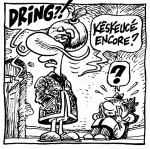
 Tels sont aussi bien les constats qui s'imposent à la fois au concombre masqué après la lecture de ce récit initiatique tout dédié à la quête de la Vérité Ultime, censée sortir du bain de minuit, et qui se matérialise sous une forme encore ouverte au prochain débat des militantes et militants. Mandryka signifie assurément, avec l’apparition du Fantasme incarné, en la personne de la craquante Zaza, que la Pin-Up en bikini représente plus que jamais l’Avenir radieux du plombier-zingueur, sans pour autant relancer une forme obsolète de réification machiste de notre amie la femme.
Tels sont aussi bien les constats qui s'imposent à la fois au concombre masqué après la lecture de ce récit initiatique tout dédié à la quête de la Vérité Ultime, censée sortir du bain de minuit, et qui se matérialise sous une forme encore ouverte au prochain débat des militantes et militants. Mandryka signifie assurément, avec l’apparition du Fantasme incarné, en la personne de la craquante Zaza, que la Pin-Up en bikini représente plus que jamais l’Avenir radieux du plombier-zingueur, sans pour autant relancer une forme obsolète de réification machiste de notre amie la femme. Mandryka. Le bain de minuit. Dargaud 2006, 56p.
Mandryka. Le bain de minuit. Dargaud 2006, 56p.


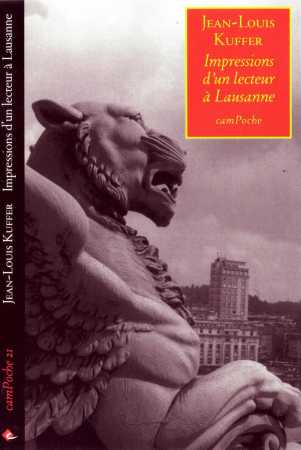

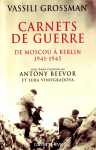 Vassili Grossman. Carnets de guerre. De Moscou à Berlin (1941-1945). Textes choisis et présentés par Antony Beevor et Luba Vinogradova. Calmann-Lévy, 390p.
Vassili Grossman. Carnets de guerre. De Moscou à Berlin (1941-1945). Textes choisis et présentés par Antony Beevor et Luba Vinogradova. Calmann-Lévy, 390p.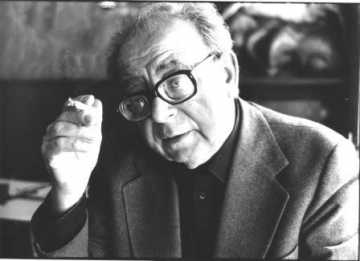


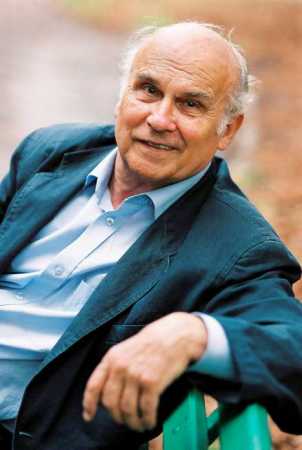
 Bientôt, correspondant de l’agence de presse polonaise pour… toute l’Afrique ( !) K sillonne le continent. Comme les autres, il court l’événement. La décolonisation suit son cours. Il tient la chronique des coups d’état, des révolutions, des guerres civiles. Mais au lieu de voler de capitale en capitale, d’hôtel pour occidentaux en ambassade, il partage le quotidien des populations, saute sur des camions, prend des trains, dort dans des cases, endure la chaleur, l’attente, les privations, la poussière… Aujourd’hui, on parlerait d’immersion. Au fil des ans, sa conception du métier évolue. Il comprend que rendre compte des faits et des embrasements ne suffit pas. Il faut tenter d’en saisir la genèse. Il enquête, interroge, lit, réfléchit. Il devient mouvement dans le mouvement du monde. Il devient, selon l’expression de certains, un « reporter absolu », flâneur inquiet, plongé dans la cage des méridiens et des parallèles.
Bientôt, correspondant de l’agence de presse polonaise pour… toute l’Afrique ( !) K sillonne le continent. Comme les autres, il court l’événement. La décolonisation suit son cours. Il tient la chronique des coups d’état, des révolutions, des guerres civiles. Mais au lieu de voler de capitale en capitale, d’hôtel pour occidentaux en ambassade, il partage le quotidien des populations, saute sur des camions, prend des trains, dort dans des cases, endure la chaleur, l’attente, les privations, la poussière… Aujourd’hui, on parlerait d’immersion. Au fil des ans, sa conception du métier évolue. Il comprend que rendre compte des faits et des embrasements ne suffit pas. Il faut tenter d’en saisir la genèse. Il enquête, interroge, lit, réfléchit. Il devient mouvement dans le mouvement du monde. Il devient, selon l’expression de certains, un « reporter absolu », flâneur inquiet, plongé dans la cage des méridiens et des parallèles.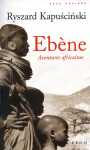 Sept livres de Ryszard Kapuscinski sont disponibles en français, notamment Ebène (Pocket, 2002) et Mes voyages avec Hérodote (Plon, 2006)
Sept livres de Ryszard Kapuscinski sont disponibles en français, notamment Ebène (Pocket, 2002) et Mes voyages avec Hérodote (Plon, 2006)

 « Les rives des lacs alpins fourmillent d’ombre russes », écrit Mikhaïl Chichkine dans l’introduction de La Suisse russe, formidable ouvrage qui vient de paraître en traduction, évoquant, avec autant de chaleur érudite que de piquant, plus d’un siècle de relations vives (de pâmoisons devant la nature en bâillements d’ennui) entre les Russes et notre pays.
« Les rives des lacs alpins fourmillent d’ombre russes », écrit Mikhaïl Chichkine dans l’introduction de La Suisse russe, formidable ouvrage qui vient de paraître en traduction, évoquant, avec autant de chaleur érudite que de piquant, plus d’un siècle de relations vives (de pâmoisons devant la nature en bâillements d’ennui) entre les Russes et notre pays.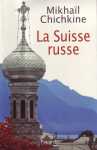 Mikhaïl Chichkine. La Suisse russe. Traduit du russe par Marilyne Fellous. Fayard, 516p.
Mikhaïl Chichkine. La Suisse russe. Traduit du russe par Marilyne Fellous. Fayard, 516p.