


Avec Fragile, son premier long métrage de fiction, le jeune réalisateur genevois Laurent Nègre démêle les relations exacerbées de deux frère et soeur. Marthe Keller, en mère frappée par l’Alzheimer, domine une interprétation de premier ordre.
Comment se fait-il que les êtres supposés le mieux se connaître peinent tant, parfois, à se comprendre, ou n’y parviennent que trop tard, à la faveur de tel ou tel drame ? Ce thème de la difficile communication entre individus très proches est au cœur du premier long métrage de fiction du Genevois Laurent Nègre, Fragile, qui impressionne d’emblée par ses qualités d’émotion et par sa direction d’acteurs. Il y est question d’une femme séparée (Marthe Keller), la cinquantaine, atteinte de la maladie d’Alzheimer, dont son fils Sam (Felipe Castro), artiste et sensible, s’occupe fidèlement à l’insu de son irascible sœur Catherine (Stefanie Günther) très absorbée par sa carrière de médecin et vivant une relation saphique plutôt orageuse avec son amie (Sandra Korol). Par delà leur agressivité mutuelle, les deux jeunes gens finissent cependant par se retrouver à l’instant même où Sam allait imiter le geste de sa mère, laquelle s’est suicidée pour ne pas être à charge et couper court à sa propre déchéance.
« Mon film parle essentiellement du manque d’amour, explique le jeune réalisateur (né en 1973 à Genève), et cela au sein même de la famille, où les pires malentendus se prolongent souvent sans se résoudre. Mes personnages, eux, se réveillent finalement, mais il aura fallu le suicide de la mère pour qu’ils se retrouvent in extremis. »
Le rôle de la mère, précisément, que Marthe Keller incarne avec autant de frémissante sensibilité que de justesse, en évitant tout pathos, a valu à Fragile la reconnaissance du jury de Soleure avec le Prix du meilleur second rôle à la comédienne. Mais comment, au fait, Laurent Nègre en est-il arrivé à solliciter Marthe Keller ?
« En fait, c’est elle que j’ai vue idéalement, en premier lieu, dans ce rôle. Je n’ai pas pensé « star » mais plutôt « aura » et présence, me rappelant plusieurs films où j’avais apprécié son rayonnement, comme Bobby Deerfield. Après un premier contact avec son agent, elle a eu le scénario en main et a tout de suite accepté. Les autres acteurs, issus du milieu genevois, ont été choisis sur casting, mais eux autant que Marthe se sont révélés les personnages que je cherchais. C’était la première fois que je me livrais à un vrai travail avec les acteurs, et je leur suis reconnaissant de m’avoir aidé, restant assez souple avec le dialogue et réécrivant parfois avec leur complicité. »
En présentant à Soleure son premier film, Laurent Nègre ne pouvait « couper » à la question sur sa position par rapport au cinéma suisse et, plus précisément, sur le débat lancé par Nicolas Bideau sur la notion du « populaire de qualité»… Visiblement méfiant à l’égard d’un préjugé national restrictif, en pariant pour le caractère « universel » du cinéma, le réalisateur de Fragile en convient pourtant : « La question du public est fondamentale. Ce scénario est-il lisible ? Ce dialogue est-il crédible ? Comme je ne fais pas de l’art brut, je me pose naturellement ces questions, qui vont d’ailleurs de pair avec la question de la qualité. Si personne ne s’intéresse à mon histoire, c’est peut-être qu’elle ne tient pas debout ou qu’elle est mal fagotée ? »
Ce qui est sûr, c’est que Fragile témoigne déjà d’une maîtrise artisanale remarquable. A trente-trois ans, diplômé de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Genève (section cinéma), à quoi il a ajouté une année de direction de photographie à Barcelone, le cofondateur de l’unité de production Bord Cadre Films vit pleinement sa passion (partagée avec celle de la BD) pour un art qui lui a littéralement appris, dit-il, à lire le monde et à l’interpréter. « Lorsque j’ai fait mon premier film d’école avec une petite équipe, ajoute Laurent Nègre, le moment du tournage a été un tel choc, ça a été si énorme que j’ai compris que c’était ça, vraiment, que je voulais partager »…
A fleur d'émotion
Le premier film de Laurent Nègre, d’une écriture toute classique, parfois même un peu conventionnelle, vaut en revanche par sa densité émotionnelle, la cohérence de son scénario du point de vue de sa progression psychologique (à l’exception de quelques flottements et d’un happy end un peu « téléphoné », style téléfilm), la justesse de ses dialogues (souvent si faibles dans le cinéma romand) et la qualité de son interprétation. Sans trop entrer dans le détail des (non)relations liant les trois protagonistes (auxquels s’ajoutent le père falot et l’amie de Catherine), le film décline les multiples aspects de la fragilité. Qui est le plus fragile de la mère dont la personnalité se disloque, du fils qui semble toute porosité sensible et de sa sœur paraissant au contraire dure et intraitable ?
Le paradoxe final du film est peut-être que sa fragilité, du point de vue artistique, tienne à sa tournure un peu trop « carrée ». Sa vraie force est au contraire d’illustrer la fragilité et ce qui la pallie : force d’amour…
En salle dès le 8 février 2006.
Cet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 8 février 2006

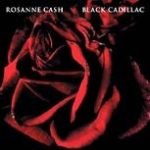

 Une lecture intégrale des Chants de Maldoror
Une lecture intégrale des Chants de Maldoror 






