Le premier roman d’Anna Gavalda

C’est une jeune femme qui vient de se faire «larguer», avec ses deux petites filles, par son Adrien de mari. «C’est drôle comme les expressions ne sont pas seulement des expressions», remarque Chloé. «Il faut avoir eu très peur pour comprendre «sueurs froides» ou avoir été très angoissé pour que «des noeuds dans le ventre» rende tout son jus, non ?» Et elle poursuit comme ça: «Larguée, c’est pareil. C’est merveilleux comme expression. Qui a trouvé ça ? Larguer les amarres. Détacher la bonne femme. Prendre le large, déployer ses ailes d’albatros et baiser sous d’autres altitudes».
Voilà ce qu’elle se dit au coin du feu, Chloé, une nuit d’hiver, après avoir renoncé à capter le moindre message, sur son portable, de son «albatros» en cavale. Mais entretemps, de façon tout à fait inattendue, c’est à un autre drôle d’oiseau qu’elle a commencé de s’attacher à son corps d’abord défendant: ce Pierre qu’elle a reçu comme beau-père en cadeau-mariage, du genre nuque raide et fermé comme une huître, chef de famille pète-sec comme il doit l’être de son entreprise, incapable du moindre abandon et auquel la lie pourtant un brin de complicité depuis qu’elle l’a comparé, devant les siens, à une «espèce de Martien perdu dans sa propre famille».
C’est d’ailleurs Pierre, à l’étonnement pincé de son épouse Suzanne, qui a «enlevé» Chloé et ses filles pour passer quelques jours dans la maison de campagne de la petite tribu, où il va tomber un masque après l’autre en multipliant d’abord ses petits soins de pépé-poule.
Vous trouvez ce début d’histoire un peu tarte ? Vous flairez déjà l’éloge de la bonne bûche rougeoyante style Delerm ou le Maman-Bobo de toute une littérature nombrileuse et coconesque au goût du jour ? Vous concluez à la sit-com minimaliste avant de commencer de lire à votre tour ? Eh bien vous auriez tort, car sous ses aspects de récit tout fluide et transparent, qu’aère encore la dentelle hyperdélicate du dialogue, le premier roman d’Anna Gavalda ne cesse de se densifier et de se charger d’énergie à mesure que ses deux personages, comme deux figures de théâtre isolées dans leur nuit respective, se révèlent l’un à l’autre au fil d’une confidence incessamment relancée.
A vrai dire, c’est essentiellement Pierre, présumé «vieux con» racorni, la soixantaine bien passée et que Chloé s’imaginait absolument indifférent à son égard, qui se découvre à elle, la stupéfie par sa volubilité, la «bassine» un peu à tant se répandre soudain en la distrayant de sa peine à elle, puis la captive à proportion de sa sincérité et de sa passion (le bougre a sacrément aimé, alors qu’elle l’en croyait incapable), enfin qui lui dit ce qu’elle a envie et besoin d’entendre à ce moment-là, à part la très belle histoire qu’il lui raconte: que «la vie, même quand tu la négliges, même quand tu refuses de l’admettre, est plus forte que toi. Plus forte que tout. Des gens sont revenus des camps et ont refait des enfants. Des hommes et des femmes qu’on a torturés, qui ont vu mourir leurs proches et brûler leur maison ont recommencé à courir après l’autobus, à commenter la météo et à marier leurs filles...»
La belle jambe que ça fait à Chloé, qui se demande évidemment où elle est dans tout ça ? Belle et bonne jambe pour avancer cependant, car on se dit que la révélation d’un visage vivant substitué à un masque ne pourra que lui donner à son tour plus de force.
Cela vous semble un lieu commun ? C’est possible. Souvent les belles histoires se réduisent à cela: un lieu commun, au sens propre. Un lieu où les gens «largués» se retrouvent. Or ce qui est tout de même peu commun, dans ce roman de pure émotion et de langue à fleur de mots, «travaillant» son sujet par une sorte d’acupuncture sensible, c’est l’intelligence du coeur qui s’y manifeste et la musique d’un écrivain.
Anna Gavalda. Je l’aimais. Le Dilettante, 217p
-
-
Collage à la sicilienne

On retourne à Vigàta - rendu célèbre par une kyrielle de romans policiers aussi singuliers par leur matière d’observation politico-sociale que par leur «pasticcio» linguistique -, pour une nouvelle histoire racontée de façon originale. Sans texte de liaison, Camilleri procède en effet à un montage de textes de toutes formes et de toutes provenances (article de journal, rapport de police, lettre de menace, avis de recherche, entre autres), constituant un dossier soumis au lecteur.
Après l’annonce, par Le Héraut de Montelusa, journal régional, de la représentation des Funérailles du Vendredi Saint à Vigàta, dans lesquelles le comptable Antonio Patò, par esprit de pénitence, tient chaque année le rôle de Judas, nous en apprenons un peu plus sur les origines de cette coutume locale puis lisons, en date du 22 mars 1890, le récit de la représentation assorti d’un rapport de de la Délégation royale à la sécurité publique relatif aux divers délits (larcins, crime d’exhibitionnisme, manifestation d’anarchie verbale) commis à l’occasion du spectacle. Or, un autre événement s’est produit à l’issue de la représentation où, englouti par une trappe de la scène, Judas («déchirante interprétation» du comptable, qui triompha pour «ses manières hypocrites et triomphantes») Antonio Patò a bel et bien disparu. Le dossier, on l’aura compris, est celui de l’enquête menée sur cette disparition.
Andrea Camilleri. La disparition de Judas. Traduit de l’italien par Serge Quadruppani. Métailié, 247p.
-
Le coeur et l’esprit

Pietro Citati est à la fois un merveilleux critique et un écrivain dont la profonde et mélodieuse musique baigne et rythme chaque page. Le dernier texte de ce recueil de Portraits de femmes, intitulé L’Art du portrait, éclaire à la fois sa façon de vivre la lecture, de déchiffrer une oeuvre et, par delà l’analyse fine de sa machinerie vivante, d’en déceler la part intime et plus secrète - le noyau dur sur lequel est inscrit la formule de l’auteur.
Toutes les femmes écrivains dont Citati parle dans ce livre, dont certaines sont connues pour leur extrême délicatesse apparente, telles Jane Austen ou Katherine Mansfield, ont en commun ce même fonds implacable, pur et incorruptible en dépit de toutes les extravagances possibles, qui établit un cousinage entre les mystiques italiennes qu’il aborde au début, et la philosophe ouvriériste Simone Weil ou la compassionnelle et féroce nouvelliste du «sud profond» que fut Flannery O’Connor.
Le secret de Pietro Citati, c’est qu’il aime. Cela étant, et qu’il parle de Proust (dans l’admirable Colombe poignardée) ou de Karen Blixen, de Kafka (dans sa biographie référentielle) ou de Marina Tsvetaeva, l’essayiste italien allie la «recréation vivante» et la «claire analyse», à savoir le coeur et l’esprit. Des femmes exceptionnelles, ici, nous valent autant de vues pénétrantes sur les liens de l’art et de l’humain. C’est intelligent, touchant, subtil, parfois effarant, toujours passionnant!
Pietro Citati. Portraits de femmes. Gallimard, L’Arpenteur, 366pp.
-
Gide protéiforme

«Protée dans sa diverse inconstance est le moins existant des dieux» écrivait André Gide qui s’identifiait lui-même à beaucoup d’égards à ce dieu mineur, et notamment par sa célèbre disposition à féliciter untel pour son livre avant d’aller le débiner dans son journal intime, où il notait aussi: «Je me fais souvent l’effet d’être un affreux hypocrite, par un besoin suraigu de sympathie». Flattant pour être aimé, Gide vivait ses pires contradictions dans l’amour, conscient des souffrances qu’il infligea à Madeleine mais n’en éprouvant aucun regret, allant même jusqu’à regretter que la morale stricte de sa femme lui ait interdit de lui rabattre, à la fin de sa vie, des enfants à peloter... Qu’on ne déduise pas de ces notes que Simon Leys fait ici le procès de Gide. Simplement, en recoupant divers témoignages (à commencer par celui de Béatrix Beck), il montre quel personnage complexe voire monstrueux, à certains égards, fut cet écrivain statufié par le Nobel.
Avec la lucidité sans faille qui fit de lui le premier contempteur du maoïsme, Simon Leys amorce cette suite d’essais par de savoureuses variations sur les débuts de romans («C’était durant une nuit sombre et tempétueuse»…), une brève méditation sur Don Quichotte en relation avec la «religion des perdants», et certain délire mégalomane de Victor Hugo, que le génie du poète (et du peintre aussi) éclipse assurément.
Simon Leys. Protée et autres essais. Gallimard, 151pp.
-
Un témoin singulier
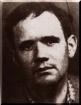
Garçon pur et dur, François Sentein écrivait dans sa fraîche vingtaine «que ça ne sert pas à grand-chose de vivre au-delà de quinze ans», et son étonnante maturité ne l'empêchait pas de considérer les «monstres adultes» avec l'implacable souci de justesse et de justice des enfants - chose redoutable dans la France littéraire de 1944 dont il observa les retournements de vestes et autres virages byzantins.
Après les Minutes d'un libertin (1938-1941) et les Nouvelles minutes d'un libertin (1942-1943), nous retrouvons ce jeune passionné de littérature, ami de Jean Genet et de Cocteau, sous l'uniforme d'un cadre de centre de jeunesse, aussi distant des collaborateurs que des résistants, mais nullement cynique pour autant. Ainsi montre-t-il beaucoup plus de compassion pour son ami Max Jacob, qui vient de mourir en déportation, qu'un certain Picasso, de même qu'il va jusqu'à «planquer» Julien Benda en province. Son dévouement envers le taulard Genet (qui a risqué lui aussi le camp de concentration) est aujourd'hui éclipsé par les services possiblement visibles de Cocteau, mais le jeune homme fait toujours la part de la faiblesse humaine et du talent, ou du génie lorsque l'ingrat Genet l'humilie. Tableau d'une époque (en campagne autant qu'à Paris, où passent Sartre et Leiris, Montherlant ou Peyrefitte), ce journal non aligné est aussi l'oeuvre d'un critique pénétrant et d'un écrivain très singulier.
François Sentein. Minutes d'un libéré (1944).Le Promeneur, 212p.
-
Harry Potter fait lire...
...n’en déplaise au pape
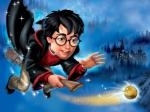
Benoît XVI s’inquiète de la phénoménale popularité du petit Potter, et cela se comprend. D’abord parce que l’Empire catholique n’a jamais trop aimé la concurrence de masse. Ensuite du fait que cette myriade de petits paroissiens lisant autre chose que le catéchisme est un mauvais exemple pour leurs parents. Enfin le contenu même des romans de cette Anglaise, qui exalte la révolte contre l’Autorité et entretient le culte de l’imagination, de la magie et autres pratiques « démoniaques », fait décidément problème.
A en croire le successeur de Jean Paul II, Harry Potter menacerait nos enfants de perversion. Est-ce à dire que le sixième volume de ses aventures, mis en vente aujourd’hui même, risque de figurer demain à l’Index ? Dieu seul le sait, qui s’en fiche complètement au demeurant. Parce que le Bon Dieu aime bien Harry Potter lui aussi, qui lui rappelle les lectures de sa propre jeunesse, genre Cendrillon, Dickens, Sans famille et consorts. S’il était prof d’anglais ou critique littéraire catholique, Dieu pourrait objecter que J.K. Rowling n’est pas le supertop dans son genre, ou que les contes frottés de fantastique d’un C.S. Lewis sont plus édifiants que les histoires du magicien à lunettes, mais Dieu n’est que Dieu, dont le faible pour les livres de jeunesse est notoire.
Il y a une trentaine d’années de ça, Dieu s’est ainsi régalé à la lecture de la collection Signe de Piste, célébrant l’amitié, la nature sauvage, l’horreur de l’injustice, dans un climat de douce ambiguïté que corsaient des illustrations dont on fustigerait aujourd’hui la pédophilie latente. Mais qu’Il sache, la hiérarchie catholique n’a jamais taxé ces romans de perversité. Et le scientiste sceptique Jules Verne ? Et Tintin qu’on ne voit jamais à la messe ? Et les Pieds Nickelés ?
Comme bien l’on pense, car il a de l’humour, Dieu n’irait pas jusqu’à faire une religion de ce charmant Harry Potter. Mais J.K. Rowling n’a pas non plus cette prétention, et de multiples exemples rappellent qu’elle aussi est pleine d’humour et de réserve ironique, notamment par rapport à la sorcellerie. Déceler une once de satanisme dans Harry Potter est au mieux un contresens : au pis, la projection d’un esprit peu sûr de sa foi. Or Dieu, qui croit dur en Lui-même, ne fera pas un fromage du fait que Lord Voldemort prenne la vedette au sieur Satanas, et le fait que l’insolent Harry malmène les Dursley, ces rats, ne lui semble que justice.
« La plus belle chose que nous puissions connaître est le mystère. C’est la source de tout art et de toute science véritable », écrivait Albert Einstein, cité en exergue d’un livre épatant intitulé Harry Potter et la science (Flammarion, 2003) et dont l’auteur, Roger Highfield, va jusqu’à prétendre que « le monde magique de Harry éclaire d’un jour étonnant les sujets les plus intéressants de la recherche actuelle, sans jamais la contredire. »
De toute évidence, un obscur vulgarisateur scientifique se montre plus tolérant, à l’égard de fariboles imaginaires, que le vicaire de Notre Seigneur pourtant si impatient, celui-ci, d’accueillir les petits enfants, de marcher sur un lac ou de se transformer en colombe luminescente…
Ce qui compte enfin, c’est que le petit sorcier fasse lire nos rejetons séduits par les niffleurs, les pitiponks ou la langue rose d’un Boursouf en quête de crottes de nez. Comme le disent les papes de toutes les croyances ce qui importe n’est pas le But mais le Chemin. Et pourquoi vos enfants ne feraient-ils pas un bout de chemin en Ford volante, un Scrutoscope en poche, sus aux kappas et autres escargots venimeux ?
Cet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 16 juillet 2005
-
Le crash de Sollers

Retour sur L’étoile des amants
Philippe Sollers nous avait avertis: son roman à paraître serait «un 11 septembre éditorial». Tout aussitôt les uns furent tétanisés d'impatience, en attendant l'Evénement, tandis que les autres, fatalistes ou désabusés, y voyaient plutôt le supercrash annoncé. Plus précisément, ce qu’on peut en dire est que Philippe Sollers s'y est laissé aller, en jouisseur cynique et polymorphe, comme un vieux chenapan dans une mousse-party qui titillerait la minette Maud d'un doigt distrait tout en jetant, de son autre main sèche, de fines notes digressives sur un peu tout. De fait, ce livre qui se veut ludique brille surtout par sa cuistrerie, un roman qui n'en est pas un dans la mesure où nul personnage n'y vit à part le Moi-je magistral de l'auteur se trouvant si belle en son miroir, où rien ne se passe ni ne se pense de vraiment inattendu, où l'on s'embarque pour Cythère comme d'autres vont faire du trekking dans l'arrière-pays népalais ou du camping échangiste au cap d'Agde.
C'est entendu: Philippe Sollers méprise les «temps merdiques» que nous vivons, où Steevy remplacera demain Beigbeder qui remplaça hier Bernard Pivot, en attendant que Madonna se propulse au Vatican pour y succéder au successeur de saint Pierre. Ce dédain de l'homme cultivé, né coiffé et surdoué, puis macéré dans les décoctions de tous les «ismes» - du gauchisme de salon au structuralisme de transit, pour aboutir à l'hédonisme «dix-huitiémiste» et au cynisme enfin déployé toute honte bue -, cette morgue joyeuse de séducteur, son compère Dominique de Roux les avait repérés, il y a trente ans déjà, dans un portrait prémonitoire (l'un des chapitres de L'ouverture de la chasse, paru à L'Age d'Homme en 1969) où il le présentait comme le type du fils à papa déliquescent, accomplissant sous forme pseudo-révolutionnaire le suicide de toute une littérature bourgeoise tournant à vide. Evoquant les livres (actuellement illisibles) du Sollers de l'époque, Dominique de Roux reconnaissait à l'écriture de celui-là une brillance étincelante, qu'on retrouve dans L'étoile des amants, aussi lisible cette fois que les Mémoires de Loana.
Cependant, précisons pour les ignares (il pense que nous en sommes tous, sauf lui) que Sollers a plus de biscuits dans sa musette que Loana et Steevy réunis: à en lire Paris-Match, auquel il se confie, il serait même le plus grand connaisseur actuel et futur de la pensée chinoise. Son livre nous vaut d'ailleurs une excursion en Chine du VIIIe siècle, avec Maud. Se penchant sur Maud, Philippe lui explique la neige chinoise, la barque et la natte, avant de révéler à la même Maud qu'elle n'est qu'un «galet sur la plage». Beaucoup plus fort: Fifou découvre à Maud (dont le prénom lui évoque «modèle, modelage, modalité, module», et autres bidules) les noms des zoiseaux du monde, tels avocette et fou de Bassan, pluvier, tadorne de Belon, chevalier gambette et compagnie. Quelle découverte n'est-ce pas ? Mais Sollers sait-il discerner, ailleurs que dans le dictionnaire où il fourre son nez, un pétrel fulmar d'une marouette ponctuée? On se le demande quand même...
Ce qui est sûr en attendant, c'est que son éloge de la vie «ingénue» sonne terriblement creux. Qu'il critique la littérature actuelle, au fil de piètres pages «satiriques» où il dégomme le style Minuit ou le style P.O.L., ou qu'il prétende bousculer les parallèles avec «un livre entier sur la jouissance d'exister», Philippe Sollers romancier s'empêtre dans un épisode de feuilleton auquel lui-même ne croit guère à l'évidence. Céline disait que le roman français actuel se réduisait à la «lettre à la petite cousine». Or Sollers, tout mariole qu'il se la joue, s'y plie avec une veulerie d'époque qui ne trompera que les jobards dont il est le roi. Reste l'écrivain, hélas...
Philippe Sollers. L'étoile des amants. Gallimard, 175 pp.
-
Du blues qui cogne

Dès l’«attaque» du morceau éponyme de ce nouvel opus de Lucky Peterson, notre lascar montre qu’il tire toujours aussi vite que ses trois ombres (le chanteur, le guitariste et l’organiste) et qu’avec lui le blues est l’expression d’une bête blessée qui a encore du coffre à revendre... Les musiciens qui l’entourent en l’occurrence (notamment le guitariste Johnny Lee Schell, le batteur Tony Braunagel, les Taxacali Horns et la chanteuse Tamara Peterson) dans cette production de John Porter, contribuent en outre à l’amplitude sonore de cette virée sur les sentiers battus de la soul et du blues.
Parfois un peu «extérieur», voire par trop «déménageur» à notre goût, le blues de Lucky Peterson se fait plus intimiste et tripal dans When my blood runs cold qu’il a cosigné avec son père James. C’est également le cas dans 4 little boys, récit d’une «histoire vraie» où son père, auteur du texte, se remémore le souvenir de la mort de sa propre mère, laquelle le tenait dans ses bras alors qu’il n’avait que 16 mois.
Comme il l’a dit lui-même, ce nouveau disque de Lucky Peterson marque l’amorce d’un nouveau départ, qui va se concrétiser par des tournées aux States et en Europe. De quoi réjouir ses adeptes, et notamment ceux qui l’ont déjà applaudi en nos contrées.
Lucky Peterson. Double Dealing. Universal Music
-
Un ange passe
Le dernier roman d'Iris Murdoch

La romancière anglaise, décédée en 1999 des suites de la maladie d’Alzheimer (sa fin de vie a été racontée par John Bayley, son époux, dans la très émouvante Elégie pour Iris, parue à L’Olivier en 2001), n’avait pas son pareil dans la mise en évidence de l’étrangeté souvent mystérieuse des vies apparemment les plus quelconques. L’opposition des convenances sociales et d’une réalité humaine à la fois indomptable et insondable est particulièrement sensible dans son dernier roman, qui s’ouvre sur le coup d’éclat, shocking entre tous, d’un mariage sabordé le jour de sa célébration!
Benet, le retraité peinant sur son ouvrage de philosophie, et que passionnent plutôt les affaires d’autrui, avait pourtant tout arrangé: Edward et Marian étaient faits l’un pour l’autre, et ce serait son bonheur de les voir convoler, autant que le leur. Or voici que la mariée disparaît au jour J, semant le trouble et la consternation dans le cercle de ses amis (lesquels la voient déjà au bout d’une corde ou rejetée par le flot amer) avant que l’histoire ne rebondisse tout autrement, pour Marian et pour d’autres personnages se «reconnaissant» les uns les autres, au gré d’une «révélation» en cascade illustrant l’humour occasionnel de la destinée...
Une espèce d’ange préside, en douce, à ces singuliers mouvements d’humeur et d’amour, qui rappelle la personne bien singulière, voletant entre réalité et rêverie, que fut la romancière elle-même.
Iris Murdoch. Le dilemme de Jackson. Gallimard, Du monde entier, 359p.
-
Comme un théâtre panique

Le sourire de Mickey d’ Antonin Moeri
Le langage de chaque époque est une mine d'observations que certains écrivains exploitent mieux que d'autres. C'est ainsi que les poncifs de l'esprit bourgeois ont été répertoriés et analysés par Flaubert dans son Dictionnaire des idées reçues ou, avec plus de virulence visionnaire, par Léon Bloy dans son Exégèse des lieux communs. Plus récemment, un Michel Houellebecq s'est employé, dans Extension du domaine de la lutte, à capter les expressions typiques de la « novlangue » actuelle en usage dans notre société, où tout est désormais « géré » à tous les « niveaux du contexte », y compris ceux du « senti » et du « vécu » — et qui ne « gère » pas ses émotions aura droit à sa « cellule de soutien psychologique ».
Ce matériau verbal, au-delà de la satire facile, peut constituer une riche substance narrative, comme le prouve Antonin Moeri dans les nouvelles du Sourire de Mickey, son huitième livre marquant une belle avancée.
— Quelle est, Antonin Moeri, la place et le sens de l'écriture dans votre vie ?
— En vérité, la réception est passée avant la production. Je veux dire que j'ai beaucoup lu, écouté, rêvé, bourlingué, aimé, observé avant de fixer les limites de mon laboratoire intime. A l'origine, les histoires que racontait mon père me fascinaient. Sa pratique de médecin lui offrait un angle de vision particulier. Les personnages qu'il décrivait étaient frappés d'une dérision, dont je ne sais toujours pas si elle était voulue ou inconsciente. Il avait une manière de dépulper les êtres
qu'on pourrait qualifier de cruelle, mais qui faisait rire ses enfants. Un tel père, à l'heure actuelle, inciterait les services sociaux à intervenir. Ce qui s'entend a donc prédominé dans ma formation. J'aurais pu devenir musicien, mais la situation de désastre orthographique, dans laquelle je me suis trouvé à l'âge de 12 ans créa, au sein de la famille, une inquiétante atmosphère d'insécurité. Pour me sortir de cette impasse, mon père ne chercha pas à éviter le conflit: il me soumit autoritairement aux lois du langage en me dictant quotidiennement du Chateaubriand. Ces dictées m'ont rendu attentif à la sonorité et à la polysémie des mots, aux analogies et aux métaphores. Elles m'ont rendu attentif à un ordre symbolique où le mot ne renvoie pas à une chose mais à un autre mot.
— Qu'est-ce qui, dans la société actuelle, vous touche au point de vous faire réagir en écrivain ?
— Il me semble que c'est un enlisement dans la relation imaginaire qui est encouragé par le dispositif social actuel. Comme si l'on cherchait à fixer les gens dans une enfance qui ne connaîtrait que des besoins facilement repérables. Pourvu qu'ils s'amusent et se réjouissent sans désirer, ni juger ou critiquer, et la fête peut continuer. En effet, la fête est au cœur de la nouvelle civilisation. Une fête obligatoire où l'on vous somme de jouir sous peine d'une marginalisation promise à l'intervention souriante de l'appareil psychothérapeutique.
— Vous sentez-vous des parentés parmi les auteurs contemporains ?
— Pour mettre en scène cet impératif d'épanouissement généralisé, de dynamisme forcé et de conformisme halluciné, il me semblait que le récit bref convenait mieux que le roman. La minutie clinique, la grande attention que privilégient mes narrateurs pour raconter leurs histoires m'ont rapproché d'écrivains américains comme Hemingway, Salinger ou Carver. Je lisais leurs nouvelles avec enthousiasme lorsque j'élaborais ce livre. D'ailleurs, Raus !, >Le Mur et No Limit recèlent chacune un vibrant hommage à ces trois auteurs, dont les techniques narratives sont exemplaires. Mais il fallait aussi que je subvertisse ce genre littéraire pour me l'approprier.
— Que peut, selon vous, la littérature dans une société telle que la nôtre ?
— On m'a reproché un ton légèrement didactique dans la manière d'exposer les situations, mais ce ton est voulu. C'est celui d'un individu paniqué, qui se raccroche désespérément au langage comme à une bouée de sauvetage. La mutation anthropologique à laquelle il assiste le pousse à remplacer par des éclats de rire les clichés fixés par des expressions telles que « modeleur de comportement », « athlète d'entreprise », « travail d'écoute » et autres « potentialités créatrices », qu'on utilise pour terroriser les gens. Peutêtre est-ce alors à quoi la littérature pourrait prétendre dans une société telle que la nôtre: redonner au lecteur l'envie de se servir de ses propres yeux pour se diriger...
La dure loi du sourire
C'est un jeune couple à la coule qui dialogue à mots (très) couverts, dans un sushi, à propos d'une décision qu'elle devrait prendre à propos d'un « truc fait en quelques minutes » qu'elle devrait subir pour le soulager, lui, d'une naissance difficile à « gérer ». On a compris qu'il s'agit d'un avortement, mais « chez ces gens-là », comme disait Brel, ça ne se dit pas. Parce que lui pense surtout qu'ils devraient « s'éclater davantage », et par exemple en se payant un pull unisexe à l'effigie du Che comme ils en ont à la boutique No Limit. On n'en saura guère plus sur ce premier couple apparu dans l'univers en apesanteur, à la fois « relax », soumis à la « dure loi du sourire », et sourdement tendu, dans lequel Antonin Moeri va donner du scalpel de son regard. Or voici, dans un bureau, l'extension de la lutte s'appliquer au niveau des ressources humaines, où telle quinqua chargée de « modeler les comportements de l'entreprise » s'en prend à un type par trop séduisant et trop libre ; ou voilà, dans une école, une guérilla sévir entre un Mickey charmeur et jean-foutre, dopé par sa mère adorante, et son prof incarnant l'Autorité traumatisante.
Attention cependant: n'imaginez pas de simplistes affrontements entre classes, races ou générations. Dépassé tout cela: à vrai dire tous les personnages de ces nouvelles sont égarés dans le même dédale de mots qui ne savent plus ce qu'ils désignent, d'idées devenues slogans publicitaires, de sentiments maquillés par le simulacre, en ce monde « où les bons sentiments, l'altruisme et le chantage du cœur sont d'utiles paravents pour cacher ce qui nous est intolérable ».
Rendant le son de cette « rumeur » d'époque à la fois euphorique et déprimée, Antonin Moeri en dégage aussi, avec une espèce de compassion flottante, les sursauts individualisés de personnages qui ne se réduisent jamais à leur discours apparent. Et peut-être est-ce au moyen de ce langagegeste, qui déborde à tout moment des moules de la « novlangue » convenue, que Le sourire de Mickey mime le mieux une forme d'échappée libératrice.
Antonin Moeri. Le sourire de Mickey. Editions Bernard Campiche, 292 pp.
-
L'utopie enjouée de Michel Layaz
A propos de La joyeuse complainte de l'idiot

C'est toujours un bonheur que de voir un écrivain s'épanouir, et le sixième roman du Lausannois Michel Layaz, La joyeuse complainte de l'idiot, nous vaut ce plaisir autant pour l'originalité de sa vision — apparemment dégagée de tout réalisme et renvoyant cependant à notre monde avec une verve critique réjouissante — que pour l'éclat et les chatoiements de son écriture, jamais aussi libre et inventive qu'en ces pages. Rappelant la douce dinguerie hyperlucide d'un Robert Walser, et d'abord parce qu'il se passe dans un « débarras à enfants » assez semblable au fameux Institut Benjamenta du génial Alémanique, ce roman évoque également la figure tutélaire de Cendrars par ses dérives épiques, le goût du conte qui s'y déploie et sa faconde verbale.
Si le pensionnat pour jeunes gens fait partie d'une certaine mythologie littéraire helvétique (songeons à celui des Années bienheureuses du châtiment de Fleur Jaeggy, ou au Waldfried de L'Eté des Sept-Dormants nourrissant les rêveries pédérastiques de Jacques Mercanton), c'est plutôt en une abbaye de Thélème à la Rabelais que nous introduit le narrateur candide de La joyeuse complainte de l'idiot, qui se fera le chroniqueur de l'institution dirigée par Madame Vivianne (avec deux n, comme ses deux opulents nénés), mélange de déesse originelle et de mère adoptive aux méthodes éducatives peu conventionnelles.
En ce lieu est réunie une quarantaine de garçons qui sont tous « fondamentalement des êtres de bonne pâte », que Madame Vivianne et ses collaborateurs pétrissent à leur façon pour les délivrer, notamment, du « bât de la sottise » et du « piquet de la fadeur » autant que du « râtelier de l'insignifiance ». Sans s'attarder sur ses condisciples, à l'exception d'un David impatient de refaire le monde et d'un doux Raphaël goûtant aux choses et aux gens en les léchant avec une très innocente volupté, notre chroniqueur détaille en revanche les employés nombreux de la maison, tous liés entre eux par une sorte de complicité tribale. Il y a là Josette, la réceptionniste à « croupe vivace », vissée à sa chaise sur laquelle elle « toupillonne » à l'occasion en la saillante compagnie de Monsieur Hadrien, le jardinier ; le professeur Karl aux préceptes humanistes aussi peu maculés d'inculture que ses blanches chemises ; un Monsieur Guillaume qui a roulé sa bosse et n'en finit pas de le raconter ; deux jumelles cuisinières bien en chair et dont la chère prouve aux garçons qu'on peut « toucher l'éternité » dès ici-bas ; enfin l'étonnant docteur Félix grâce auquel le complexe d'Œdipe devrait se solutionner, puisqu'en la ville idéale qu'il rêve de fonder la procréation sera interdite aux mâles de moins de 85 ans et qu'on préservera l'enfant en bas âge de l'amour étouffant de sa mère.
De même que le nom de La Demeure est une antiphrase, puisque nul n'y reste, son statut « inversé » fait figure de fiction libertaire, alors que les murs de ses salles d'eau conservent encore le souvenir des clameurs des anciens « détraqués profonds » qu'on y bouclait jadis. Quand il se rend en ville avec Raphaël, le narrateur y est moqué par les jeunes gens « normaux » dont l'obsession consiste essentiellement à surveiller le « cours du Nasdaq » en sorte de faire fortune avant la trentaine ; mais l'utopie est allègrement vécue par la joyeuse bande, qui trouvera finalement la manière la plus poétique de sauver La Demeure au moment où le fils vénal du proprio défunté menacera de la vendre au plus offrant.
Ainsi, sous couvert d'enjouement et de fantaisie plus ou moins extravagante (parfois un peu appuyée à notre goût), le narrateur module-t-il tout un discours critique, voire satirique (notamment contre un journaliste fat à souhait, bien fait pour lui), moins innocent qu'il n'y paraît, qui marque les arêtes de cette espèce de fable hirsute.
Pour la bonne bouche, signalons enfin que Michel Layaz publie, simultanément, trois brefs textes étincelants sous le titre du Nom des pères, dont le titre du premier, Le Ciel à la marelle, annonce la couleur ...
Michel Layaz. La joyeuse complainte de l'idiot, Zoé, 155 pp. Le nom des pères, Mini-Zoé, 47 pp.
« L'idiot au sens du plus singulier »
— Quel est le déclencheur de ce roman ?
— A l'origine, c'est l'histoire du type qui, s'efforçant de saigner un mouton pour un méchoui, se tire une balle dans la main tant la bête rebelle se débat. A cela s'est greffée la figure de ce lieu clos qui, à l'inverse des institutions de détention ordinaire, représente un espace de liberté. Autre inversion: alors que les aliénistes considéraient l'idiot comme le rebut de la société, j'ai rendu à celui-ci sa dénomination étymologique de « singulier ». Quant à l'origine du lieu, peut-être qu'elle entre en résonance avec un lointain souvenir de l'Institut Benjamenta de Walser, mais je n'y ai pas pensé, alors que l'univers de l'Institut suisse de Rome, où j'ai séjourné, peut être signalé avec un grain de sel.
— Comment avez-vous travaillé ?
— De manière à la fois consciente et « conduite », plus que dans mes autres livres, comme si je devais obéir cette fois à la logique de la fiction. Ce qui m'a intéressé, c'est l'acuité et l'étrangeté fondamentale du regard de mon protagoniste, à la fois proche et différent de moi, qui m'amène à dire beaucoup de choses sans me plier à un discours critique argumenté. La narration ne « reflète » aucune réalité « au premier degré », mais il va de soi que le masque de la fiction et les jeux du langage ne sont pas gratuits pour autant.
— Quel rapport entretenezvous avec l'écriture ?
— Dès le début, j'ai entretenu un rapport quasiment charnel à l'écriture, avec cette aspiration constante à ce qu'elle soit une véritable offrande à la langue...
-
Une tragédie ordinaire
 La diffamation de Christophe Dufossé
La diffamation de Christophe Dufossé
L'annonce de la parution du deuxième roman de Christophe Dufossé n'a fait l'objet d'aucun battage, et pourtant nous ne serions pas étonné de voir La diffamation faire son chemin avec autant de sûreté que L'heure de la sortie, avec lequel l'auteur entra en littérature en 2002 et qui fut couronné par le Prix du premier roman avant d'être traduit en dix langues et retenu pour une adaptation au cinéma.
Après ce premier roman dont le suicide d'un jeune enseignant était l'élément déclencheur, La diffamation développe, de façon plus intimiste et lancinante, l'observation portée par l'écrivain sur le drôle de monde dans lequel nous vivons, apparemment préservé de tout danger (cela se passe dans la paisible Amboise, dans une atmosphère de confortable torpeur familière aux Suisses) et cependant en butte à une angoisse latente et, de loin en loin, à telle ou telle explosion de violence, à l'instar de tel massacre qui vient de se produire à Tours au début du roman.
Comme dans les romans psychologiques d'une Patricia Highsmith, que Graham Greene qualifiait justement de « poète de l'angoisse », Christophe Dufossé maîtrise l'art de la suggestion oppressante en nous associant au désarroi intérieur de sa narratrice, dont il va « construire » le personnage de l'intérieur avec une saisissante sensibilité et une vigueur égale.
Anna est le type de la femme « libérée » de notre temps, intelligente et généreuse. Prof de sociologie en année sabbatique, elle est censée écrire un livre sur la validité de thèses de Max Weber concernant l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, mais d'autres préoccupations la déstabilisent. Son fils Simon, surdoué de 14 ans aux inquiétantes poussées de cruauté, autant que son Vincent de mari, négociateur immobilier aux comportements visiblement perturbés par l'arrivée, à la tête de son agence, du fils « tueur » de l'ancien patron, la confrontent à une espèce de folie ordinaire affectant l'ensemble du monde environnant. Sans jamais tomber dans la démonstration, mais avec une foison d'observations d'une précision et d'une pertinence rares, l'auteur de La diffamation brosse ainsi, par le regard d'Anna, souffrant avec les siens, mais capable aussi de juger l'évolution des faits sociaux, le tableau d'une sorte de « dissociété » où les êtres les plus proches deviennent étrangers les uns aux autres. « Nous avons l'air de trois insectes préoccupés chacun par sa traînée chimique, ne se touchant que rarement les antennes », relève Anna qui estime pourtant sa famille unie et harmonieuse ...
Dans la foulée d'un Michel Houellebecq, divers romanciers nouveaux s'affairent aujourd'hui à l'observation « balzacienne » de la société française, et c'est fort bien.
Or à cette disposition, Christophe Dufossé ajoute un sens du tragique beaucoup plus rare. Son approche des êtres et la saisie, tout en finesse et en acuité, de leur oscillation entre la résignation soumise et l'explosion soudaine, est modulée par une narration tendue quoique souple, où les métaphores originales font florès. De l'ado vrillé à son ordinateur comme les hikikomori japonais, au jeune boss cynique et vulgaire qui va pousser Vincent à bout, en passant par maints personnages dessinés au vol d'un incisif trait de burin, le roman ressaisit tout un monde par la voix d'Anna qui tourne finalement, après le désastre final, à l'extrême éperdu de la lucidité.
A l'ère des coups médiatiques et du bluff, La diffamation est un roman de la détresse contemporaine à lire sérieusement, une phrase après l'autre. L'expression en est limpide et droite autant que l'éthique de l'auteur. Un romancier y traduit sa révolte et sa tendresse. Il mérite la plus grande attention.
Christophe Dufossé. La diffamation. Denoël, 295 pp. A lire aussi: L'heure de la sortie. Denoël, 2002, 342 pp.
-
Symphonie de la mémoire
Lecture et rencontre d'Alexandre Voisard
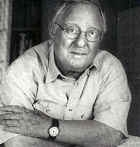
La femme de sa vie, ses proches et ses amis l'appellent Coco, et c'est vrai que c'en est un drôle, loustic dès son adolescence et chenapan à couteaux, jeune pillard des siens et saute-frontières du temps de guerre risquant sa peau à des jeux très dangereux, que cet Alex sacripant dont la chronique jurassienne accoutume de parler en termes désormais légendaires, célébrant le poète national de l'indépendance qui le vit lire ses poèmes devant de vastes foules.
On le savait pourtant: Alexandre Voisard n'a rien du Monument classé. Mais à lire Le mot Musique ou l'enfance
d'un poète, voici la vie même qui ressuscite, de toute une tribu d'A joie. Et c'est en ces terres, entre Porrentruy et Belfort, dans la ferme de Courtelevant où son épouse passa sa propre enfance, que le poète évoque son besoin de se livrer.
« Il y a très longtemps que je pensais à cette autobiographie, pour rendre plus explicites les événements fondateurs à travers lesquels j'ai passé », explique Alexandre Voisard. « Mon parcours a toujours fait jaser, On avait conscience que j'avais eu un destin singulier, et j'ai souvent eu la sensation d'être incompris. Or le problème était d'extraire, de toute une profuse matière, ce qui est réellement porteur de sens. Il y avait donc un grand travail de décantation à faire. La mort du père, en 1998, a été une première injonction à l'écriture, mais il m'a fallu des années pour trouver le ton juste et la bonne distance. »
Si l'ouverture du livre est consacrée à la mort du père, puis à l'évocation des figures hautes en couleur de ses aïeux Voisard et Jolidon, Le mot Musique est également un chant à la nature, nommée par le père comme l'E ternel au jardin originel, et une façon pour l'écrivain de sentir ses racines.
« Mon enracinement dans ce pays remonte à ma première perception du monde, dans une enfance de sauvageon marquée par la conscience immédiate d'une solidarité entre les êtres et les choses. De tout temps, j'ai tenté de conformer un paysage intérieur, qui s' est constitué en moi, au paysage réel. Il y a là comme une espèce de mystique d'appartenance. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir de la boue de mon pays sous mes talons. Ce pays c'est l'A joie, ou plus précisément le flanc de la montagne, qui descend vers la plaine et les rivières. C'est du flanc de la montagne que tout part: le rêve, le regard et le corps. »
Outre la nature, célébrée avec quel lyrisme et quelle sensualité, la musique, intensément vécue par le père, et réinvestie par le fils dans le chant de la poésie, est un motif omniprésent des Mémoires d'A lexandre Voisard. Autre thème essentiel de ce récit: la relation avec les autres et l'amitié. Hommage fervent à ses parents (même si son père et lui ont campé longtemps sur des positions opposées, l'auteur montrant par ailleurs autant de verve ironique à l'égard des siens qu' envers lui-même), Le mot Musique accorde une grande place à l'amitié et à ce que Voisard appelle plaisamment « l'université buissonnière des cafés ».
« C'est cet ami que j'appelle Loiseau », précise encore l'écrivain, « qui m'a le premier donné cette leçon, selon laquelle il me fallait être homme avant d'être poète. Durant mon adolescence, ma singularité n'a cessé de s' imposer de manière intempestive, puis j'ai appris à accepter le sort commun et concilier ma singularité et les exigences de la vie sociale. Par la suite, la prise de conscience de l'identité jurassienne a été déterminante dans ma relation avec la communauté. Dès la publication de la fondatrice Anthologie jurassienne, le patrimoine de notre littérature a été révélé, qui nous inscrivait dans un ensemble. Ensuite, le peuple jurassien nous a pris à témoins, nous autres écrivains, de sorte que nous ne pouvions nous dérober. Mais c'est une autre histoire …»
De fait, Le mot Musique ou l'enfance d'un poète, livre des fondations, n'aborde pas la saga de l'indépendance jurassienne telle que l'a vécue Alexandre Voisard. Le propos de ce livre est à la fois plus intime et plus universel. Symphonie de la mémoire, il inscrit l'enfance émerveillée et la folle jeunesse d'un poète dans une lumière d'éternelle matinée.
Le chant de vivre
La poésie romande est trop souvent corsetée, cultivée en serre par des lettreux exsangues. Avec Alexandre Voisard, c'est une autre chanson, nourrie de bonne sève et reliant l'individu au cosmos. La musique du monde et celle des mots sont liées dès l'origine dans le récit de son enfance. D'avoir entendu parler du « cœur de la terre » fait creuser l'enfant et découvrir un fruit étrange, avec le sentiment sacré d'avoir violé quelque secret. Puis de la première sève jaillissant de son corps lui vient la sensation d'une appartenance plénière (une page d'anthologie sur la divine surprise du sexe) que les sous-entendus d'un curé ne terniront jamais, alors que la conscience inextinguible d'un crime commis lui viendra du massacre d'un pauvre crapaud.
Scènes primitives ici fixées par de fortes images où tous se retrouveront. Scènes ensuite d'un théâtre d'enfance et d'adolescence où la pauvreté contraignant une grand-mère à voler son bois, l'incurie d'une mère menant seule sa barque pendant que le père « couvre la frontière », les frasques du jeune sauvage livré pour punition au redressement d'une famille paysanne puis aux internats alémaniques, s' intègrent dans le tableau foisonnant et savoureux de tout un pays.
Un ton en dessous, l'intermède genevois qui voit le jeune rebelle s' égarer quelque temps dans un début de carrière théâtrale débouche sur le retour de l'enfant prodigue, retrouvant sa place en intendant-cuistot de la tribu et jetant, avec moult bons compères, de nouvelles bases à sa future carrière de poète.
Alexandre Voisard, Le mot Musique ou l'enfance d'un poète, Bernard Campiche, 279 pp.
-
La petite dernière

Il a pu se faire, dans une grande famille française du XXe siècle, que le père, à vingt ans, soit un héros de la guerre de 14-18, et que sa fille benjamine, au même âge, vive Mai 68 comme une libération salvatrice.
Lorsqu’elle commence de s’adresser à celui qui fut, comme elle l’avouera, le véritable homme de sa vie, Fanny a cinquante ans, et l’imposant docteur Delbast, centenaire, dépend désormais de ses bons soins à la vive satisfaction de ses frères et soeurs qui l’ont toujours considérée, «numéro six», comme «une invitée arrivée en retard», longtemps maladive après une naissance problématique, et n’ayant jamais fait les choses comme les autres. Ainsi ses co-héritiers s’étonnent-ils de la voir réclamer, au moment d’un premier partage de ses affaires, les lettres de guerre de son père aux siens, qui vont lui permettre de devenir, en quelque sorte, sa mémoire. «Tu as vécu tes dix-huits ans dans un cimetière sans cercueil, écrit-elle ainsi, tu as connu la mort avant d’avoir pris le temps de vivre».
Histoire d’un amour gagné sur maintes cuisantes humiliations, portrait tout en nuances d’un père par sa fille, parcours aussi d’une tribu catholique à travers le «siècle des grands massacre», il y a de tout cela dans ce petit livre dense et vif, à l’écriture sensible et forte. Après Bord de mer (Actes Sud, 2001), Véronique Olmi signe un deuxième roman d’une justesse de ton sans faille.
Véronique Olmi. Numéro Six. Actes Sud,127p.
Un nouveau roman de Véronique Olmi est à paraître en août chez Grasset -
Dans la peau des autres

Rencontre de Pascale Kramer
Le nom de Pascale Kramer s'impose progressivement au nombre des romanciers de langue française les plus singuliers, et l'accueil favorable de la critique parisienne dont a bénéficié son cinquième roman, Retour d'Uruguay, n'a rien du phénomène artificiel. De fait, le moins qu'on puisse dire est que ce roman n'est pas du genre accrocheur, pas plus d'ailleurs que Les vivants, son précédent et aussi remarquable ouvrage. Avec une empathie rare et sans effets de style, Pascale Kramer parvient à saisir et traduire, dans une langue claire et simple, toute la complexité des relations entre des individus souvent peu portés à verbaliser ce qu'ils ressentent. Un mélange d'acuité dans le regard et de tendresse sensuelle la font apparaître comme une pure romancière d'instinct, dont les observations sur la société contemporaine se traduisent par le désarroi significatif de ses personnages.
Etablie à Paris depuis des années, Pascale Kramer n'en renie pas pour autant sa patrie d'origine, dont le climat physique est d'ailleurs très perceptible dans son dernier roman.
— Pascale Kramer, comment naissent vos romans ?
— Tous mes romans sont construits autour d'un thème, quelque chose de fort que je crois avoir compris des relations humaines. A partir de là, je construis une situation, qu'incarnent peu à peu des personnages. C'est un processus assez long, qui se passe de mots pendant des mois. Une fois que l'histoire est devenue aussi vraie que si je l'avais vécue, il n'y a plus qu'à la raconter.
— Plus précisément en l'occurrence, comment la substance de Retour d'Uruguay a-t-elle cristallisé ?
— Le hasard ou le destin (je ne sais jamais lequel des deux) m'a portée vers des gens d'un autre monde, que j'ai aimés, sans rien aimer pour autant de leurs valeurs. Avec Retour d'Uruguay, j'ai voulu faire partager cela, mon intérêt pour des êtres pas nécessairement aimables. Cela met beaucoup de gens mal à l'aise, pourtant je persiste à penser qu'on s'enrichit plus à chercher à comprendre qu'à condamner.
— Comment vous situez-vous par rapport à la littérature contemporaine, romande ou française ?
— A vrai dire, je ne me « situe » pas. Je ne veux pas dire par là que je me sente « à part », simplement je ne raisonne pas en ces termes. Je lis, beaucoup, uniquement de la littérature contemporaine, pas nécessairement française, même loin de là. Mais je lis en amateur, pas en écrivain, ni en analyste, puisque je n'ai pas étudié la littérature. Si j'ai de grandes grandes admirations littéraires, mes références sont dans la vie. Mon livre idéal serait un livre qui restituerait la force des drames tels que n'importe lequel d'entre nous peut en vivre. On me parle souvent de mon style, de mon utilisation du discours indirect, de l'absence de dialogue. Tout ça est né un peu malgré moi, du souci obsessionnel de rendre très exactement la vérité des situations et des personnages.
— Vous sentez-vous Suisse ?
— Je fais plus que me sentir Suisse, je SUIS Suisse, aussi indéniablement que je suis une femme. Vivre en France et obtenir la nationalité française n'a pas fait de moi quelqu'un d'autre. Cela m'a plutôt permis de mesurer à quel point on n'échappe pas à ce qu'on est.
— L'usage de la langue française a-t-il pour vous une signification particulière ?
— Non, il se trouve que c'est ma langue, c'est tout. Toute autre aurait parfaitement pu faire l'affaire.
— Qu'est-ce pour vous qu'un roman ?
— Je ne pourrais pas imaginer d'autres formes que le roman, puisque c'est la forme qui imite le mieux la vie, et que c'est la vie qui m'intéresse. Le roman à ceci de merveilleux qu'il nous permet d'entrer dans d'autres peaux. Il peut faire ressentir des choses insaisissables, parce qu'il ne fait pas nécessairement recours à la pensée, plus à l'intuition. Il laisse surtout une très grande part à l'interprétation.
Sentiments purs en eau trouble
Il est certains livres qui vous laissent, en mémoire, une marque unique, et tel est ce Retour d'Uruguay de Pascale Kramer, qui a cela de particulier qu'il nous touche et nous trouble sans qu'il ne s'y passe grandchose, ni que ses personnages soient particulièrement remarquables. On y resonge un peu comme à un souvenir acide et tendre d'adolescence, aux postures à la fois péremptoires et ondoyantes de l'enfance, à la naissante sensualité zigzaguant entre les âges, au besoin de reconnaissance qu'un jeune homme peut éprouver de la part d'un homme fait, enfin à ces sentiments-sensations qui fondent les corps individuels dans celui de la famille ou du clan.
Pour Adrien, qui approche de la vingtaine et que rasent un peu ses parents par trop conventionnels, l'arrivée de Raphaël, le quinqua fringant et ambigu, de retour de Montevideo et flanqué de sa petite tribu — dont la piquante Nina au prénom rimant plus tard avec celui de Lolita —, représente un appel d'air dans lequel il a tôt fait de s'engouffrer, s'installant bientôt dans une chambre de leur immeuble et les revoyant de loin en loin. Or les jours passent et des liens se tissent et s'entremêlent, sans que le garçon n'en établisse de bien solide avec le personnage à la fois libre et violent de Raphaël, dont il se retient de juger le trouble, voire l'abjection, malgré le déni des autres: Claire, son amie qui voit en Raphaël un « facho » vulgaire, ou Fabienne, sa fille qui le craint et le vomit pour ce qu'il fait subir à sa femme Béatrice, elle-même étrangement soumise.
Dans un climat d'intimité presque animale, où s'opposent une sorte d'innocence frisant la perversité et des ombres plus lourdement inquiétantes, Pascale Kramer observe le jeu des relations entre enfants, adolescents et grandes personnes plus ou moins déliquescentes, dans une traversée à valeur initiatique qui, d'un malentendu à l'autre, débouche sur une dernière révélation ressaisissant le protagoniste. Comme si la vie, l'enfance de la vie lui restait une source pure où se retremper ...
Pascale Kramer. Retour d'Uruguay. Mercure de France. 158 pp.
Un nouveau roman de Pascale Kramer est à paraître à la rentrée au Mercure de France