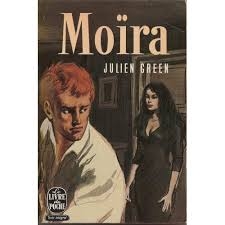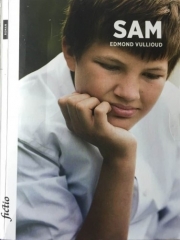À la Maison bleue, ce samedi 18 janvier 2020. - Revenant ce matin au dernier livre que m’a envoyé Lambert Schlechter, je tombe sur une page saisissante consacrée aux mères des cracheurs de feu du Sichuan, page 49, après avoir relevé, page 42, une phrase évoquant mes «obsessions matterhorniennes à l’aquarelle », alors que je n’ai jamais peint de Cervin à l’eau. Je l’ai fait remarquer illico à l’Auteur, qui m’a promis une correction dans le prochain (!) tirage.
Tout en le lisant, et parfois à voix haute en prenant Lady L. à témoin, je me disais : mais qui donc, aujourd’hui, peut lire ces «proseries», à part des gens de mon espèce en voie probable de disparition ? Or il y a là-dedans une poésie rare, d’inégale densité mais constante et souvent plus vivante, moins répétitive que les « minutes heureuses » de Georges Haldas auquel, soit dit en passant, je devrais revenir un de ces quatre.
MON JOURNAL. - Il fait clair et net ce dimanche matin sur la baie de Montreux, le lac bleu tendre m’apparaît au-dessus de la frange de pins « méditerranéens », de l’autre côté de la Grand-Rue, qui jouxtent la toiture du marché couvert au-dessus duquel j’aperçois les hauteurs enneigées de la dent d’Oche et du casque de Borée; au loin plus à l’ouest se profilent les crêtes également couvertes de neige du Jura, et je me sens tout serein devant ce nouveau décor à la fois lacustre et préalpin qui est le nôtre depuis deux mois, serein et préservé du tapage mondial et médiatique où les débats sur moult « affaires » tournent à vide ; Lady L. vient de sortir avec Snoopy que je vois traverser la route à l’aplomb de mon petit balcon à barrière de fer forgé blanc, la rue parcourue le soir de bolides exaspérants (les petit cons font rugir leurs GT de parvenus incultes mal rasés) est ce matin au grand calme dominical et je me rappelle le téléphone, hier, de mon ami Jean Ziegler apparemment enchanté par ma chronique sur son dernier livre et me racontant ses tribulations à l’hosto (il a passé un mois couché, sous morphine, après s’être brisé une vertèbre lombaire) subies en même temps que je me relevais de mon attaque cardiaque…
Tout à l’heure, encore couchés, je lisais à ma bonne amie des passages du Journal de Julien Green que je ne lâche plus depuis novembre dernier, notamment sur sa liberté d’écrivain soucieux de préserver son indépendance (il a 32 ans en 1932, travaille au Visionnaire et revient de Berlin où Robert et lui ont senti la sourde menace d’une violence nouvelle) et sur les talents de « la vie » en matière d’invention romanesque, qui lui fait noter ce paragraphe d’anthologie : « Quel bizarre romancier que la vie ! Comme elle répète ses effets, comme elle appuie de sa lourde main, comme elle écrit mal ! Ou vient, elle revient sur ce qu’elle a dit, elle oublie le plan qu’elle avait en tête, elle se trompe de destinée et donne à l’un ce qui devrait échoir à l’autre, elle rate le livre qu’elle tire à des millions d’exemplaires. Et tout à coup, de magnifiques éclairs de génie, des revirements comme Balzac n’en rêva jamais, une audace de fou inspiré qui justifie toutes les erreurs et tous les tâtonnements ».
En 1932, JG éprouve le même malaise, entre ses amis de droite (dont un Maritain) et de gauche (Gide au premier rang), la même prévention et jusqu’au dégoût que j’ai éprouvés moi-même dès mes vingt-cinq ans et plus que jamais aujourd’hui entre mes amis de droite et de gauche. Je sais que mon ami (et éditeur) Pierre-Guillaume de Roux vomit positivement mon ami Jean Ziegler, mais je n’ai le cœur et l’esprit ni de choisir ni d’exclure. Si l’un ou l’autre m’excluait pour le motif que je ne le choisis pas en excluant l’autre, il me perdrait illico ; mais JG pressent aussi, derrière les personnes, l’horreur à venir des partis, et comme le temps est déjà au pressentiment de la guerre les positions se durcissent et s’exacerbent entre les catholiques «politisés» ou les maurrassiens et les «compagnons de route» à la Gide qui se dit capable de « mourir pour l’URSS » sans se douter , le pauvre, de ce qui l’attend.
Or Green, en poète intuitif et en réaliste anglo-saxon, voit très bien ce qui cloche dans les raccourcis idéologiques de ces messieurs, tout pareils à ceux que j’ai observés dès ma vingtième année dans les groupuscules de gauche et chez les paroissiens de droite, et ensuite à L’Âge d’Homme dès qu’on passait du domaine littéraire aux arguties théologico-politiques.
PG s’est offusqué de ce qu’on publie le journal « intégral » de Julien Green, affirmant que la «part d’ombre» d‘un individu n’a pas à être dévoilée, mais l’écrivain lui-même a autorisé cette publication après sa mort et la disparition de ses proches, afin qu’on sache «tout de lui», et ce « tout », certes gratiné quant aux détails de ses cavalcades nocturnes, n’a rien pour autant de ce qu’on peut dire une «part d’ombre» puisqu’il parle de cul en restant bien net et clair au contraire, peut-être choquant pour les belles âmes mais sans chercher à provoquer, n’écrivant d’ailleurs que pour lui, quitte à nous livrer un tableau de ses mœurs et de son époque qui a valeur de constat.
Il s’en explique d’ailleurs le 14 novembre 1993 dans son journal expurgé intitulé Pourquoi suis-je moi ? (1993-1996), en toute sérénité rétrospective : « Voici la vérité sur moi-même : J’étais fait pour l’amour. Point. La sexualité chez moi n’a jamais pu envahir l’amour. Il s’agit de deux réalités sans rapport. La frénésie sexuelle que j’ai connue, dont j’ai eu ma part, n’a jamais pu se faire passer pour l’amour. Faire l’amour est une expression qui à mes yeux ne signifie rien. L’amour naît en nous, mais il ne se fabrique pas. On peut tomber amoureux d’un visage, parce que dans le visage se lit et se raconte l’amour, la grande histoire de l’amour que beaucoup ne connaissent pas. L’appareil sexuel n’a à nous offrir que la sensation. Faire raconter à la sensation ce qui dépasse tout est une façon de se jouer la comédie à soi-même », etc.
Et c’est exactement ce que se dit le lecteur honnête en découvrant, dans le journal «intégral», le récit honnête et parfois crûment décrit des épisodes sexuels du Julien trentenaire, qui drague et baise à qui mieux mieux, souvent d’ailleurs en compagnie de son amant Robert, mais aime celui-ci d’un amour réel et réciproque, attentif et infiniment tendre, qui n’a rien à voir avec les «passes» d’un soir.
Pour qui a vraiment connu l’amour et ne se joue pas la comédie, tout cela semble aller de soi, surtout pour moi qui l’ai vécu à ma façon.
Je n’en suis qu’à la page 530 du premier volume du journal intégral de Julien Green, qui en compte 1330, j’ai lu parallèlement ses romans de la même époque, à savoir Moïra et Mont-Cinère, Minuit et Le visionnaire sur lequel il est précisément en train de travailler en 1932, je découvre ce très grand écrivain (en lequel Jacques Maritain voyait le plus grand auteur français de son époque, dont il soulignait l’identité américaine…) à l’approche de mes 73 ans et c’est très bien comme ça, d’ailleurs le journal n’a pas pris une ride et je le lis comme si j’avais dix-huit ans, l’intelligence de la vie en plus…
DE LA PUBLICATION. - JG, au micro d’un Bernard Pivot, assez superficiel et niais le questionnant sur son Journal et faisant allusion aux méchancetés qu’il doit y avoir dans l’original, lui répond qu’il n’y en a aucune (ce qui me fait sourire) tout en relevant la différence décisive qu’il y a entre journal rédigé et journal publié ; et je me demande alors si je ne pratique pas trop, moi-même, l’autocensure, en tout cas depuis que j’ai publié L’Ambassade du papillon ; puis je me dis que je n’ai guère de secrets sauf par rapport à mes filles et à ma bonne amie, auxquelles je dois une réserve que je puis, peut-être , m’appliquer à moi-même – d’ailleurs je l’ai bien précisé dans mon Journal des Quatre Vérités…
Cela étant, il serait peut-être intéressant qu’un jour je «vide mon sac», dans un carnet Top Secret, à propos de mon inavouable privacy, n’était-ce que pour en souligner l’innocence ou le comique genre Little Boy – la bombe…
RENOIR. - Vu ce soir La Règle du jeu, après une présentation par trop dithyrambique d’Olivier Curchod, qui parle de « chef-d’œuvre » non sans admettre le côté fouillis de tout ça. Pour ma part, je trouve la fin « tragique » ratée, les personnages assez inégalement dessinés dans le tourbillon des mouvements (assez réussis en revanche dans le genre commedia dell’arte), les acteurs plutôt inégaux, Renoir brave ours mais trop th morceaux de virtuosité cinématographique, mais finalement un débridé mal foutu qui a ravi la Nouvelle Vague (Resnais complètement secoué) mais qui n’a pas le lien poétique du décousu de Fellini, enfin tout ça faisant un peu amateur folâtre à côté des Américains, des Italiens et des Japonais…
Ce mercredi 22 janvier. - Consulté ce matin en chirurgie angiologique, à Morges, chez le Dr Saucy : très bien, solide précis, m’inspirant pleine confiance à m’expliquer le détail de ma situation artérielle et à m’exposer son plan de traitement, à trois mois du précédent, donc le 13 mars prochain, soit angiogplastie soit, au pire, pontage. Me laisse entendre qu’il y a des risques, liés à une hémorragie éventuelle à quoi me disposent mes anticoagulants, mais va pour les risques.
BIOGRAPHIE. - Temps gris ce matin. Je lis, non sans effarement, dans la biographie de Julien Green tirée essentiellement, par un certain Nicolas Fayet, du journal publié de l’écrivain, que celui-ci aurait entretenu, avec Robert de Saint-Jean, une relation toute platonique. Dans son aveuglement très-catholique, le biographe fait de Green un aspirant à la sainteté juste freiné par des «troubles charnels » de prime jeunesse, en ignorant à peu près tout de la vie « réelle » de Green et de son amant, qu’il suce tous les trois jours et avec lequel il partage volontiers ses conquêtes de rues ou de salons, et je souris de cette candeur du Nicolas en question tout en me disant que, quand même , un biographe devrait se montrer plus scrupuleux quant à ses sources – le cher homme va jusqu’à avouer en avant-propos qu’il s’est bien gardé d’approcher les familiers de l’écrivain – ce qui ruine évidemment son entreprise où il y a pourtant, hélas, de bonnes choses…
PAUVRE GUSTAVE. - Ce soir lu le fragment du Journal de Gustave Roud dans Amiel & co, à vrai dire triste, voire pathétique en cela qu’on tremblote à propos de sentiments et de pulsions n’aboutissant jamais à la moindre caresse réelle, et que l’obsession, lancinante et larmoyante, tourne en somme à vide. « Mais qu’il aille donc se faire enculer une bonne fois ! », s’exclamait le délicat Auberjonois à son propos, et c’est en effet ce qu’on lui souhaite a posteriori, mais trop tard est trop tard…

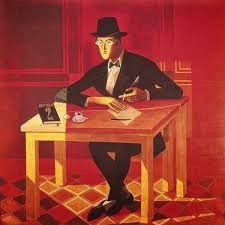
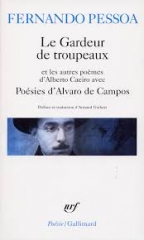




 PERSONA. - Nous pourrions certes, avec notre juriste Julie, disserter «sur la mort » en gens intelligents et concernés, comme on dit, mais ne serait-ce pas plutôt de la vie, de la fragilité de la vie, de la beauté des choses et de la bonté des gens que nous parlerions en évoquant la plus réelle des réalités dont le masque se dit Persona et que trahit toute représentation, fut-elle aporie poétique, faucheuse blafarde ou formule crédule de naïf ou de positiviste rassis ?
PERSONA. - Nous pourrions certes, avec notre juriste Julie, disserter «sur la mort » en gens intelligents et concernés, comme on dit, mais ne serait-ce pas plutôt de la vie, de la fragilité de la vie, de la beauté des choses et de la bonté des gens que nous parlerions en évoquant la plus réelle des réalités dont le masque se dit Persona et que trahit toute représentation, fut-elle aporie poétique, faucheuse blafarde ou formule crédule de naïf ou de positiviste rassis ?