
Paris, à La Perdrix rouge, ce lundi 4 novembre. - La neige est apparue ce matin sur les hauts du Grammont, et j’ai quitté Montreux à sept heures pour Paris où je vais passer quelques jours. La traversée s’est passée «sur» ma chronique consacrée à Amélie Nothomb, dont j’ai appris en début d’après-midi qu’elle n’avait pas décroché le Goncourt, ce qui n’a aucune importance eu égard au très piètre jury actuel où siègent une Virginie Despentes et un Eric-Emmanuel Schmitt…
JOURNAL DE JULIEN GREEN. - J’ai acheté hier la nouvelle édition intégrale du Journal de JG parue dans la collection Bouquins après que Roland Jaccard m’en a fait l’éloge l’autre soir chez Yushi. Or le même RJ m’avait apporté la dernière livraison du magazine Causeur, dans laquelle il a publié un long article sur ledit Journal, grossièrement intitulé L’esthète des pissotières mais où j’apprends que l’auteur de l’article a bien connu le grand écrivain...
À ce propos, Pierre-Guillaume me disait qu’il continuerait de lire le Journal dans l’édition de La Pléiade, affirmant que la part d’ombre des êtres doit être respectée et que cette version non expurgée ne fera qu’exacerber les curiosités de bas étage - et l’article de notre ami conduit en effet sur cette pente. Mais pour ma part je vois la chose autrement, comme une confrontation personnelle avec ce que j’ai noté et ce que j’ai évité de confier au papier; n’excluant pas la possibilité de tout dire, tout écrire et tout lire sans intentions louches de part ou d’autre.
Je vais sur mes 73 ans et je constate ce soir que j’ai passé à peu près complètement à côté de l’œuvre de Julien Green, abordée peut-être dans mes jeunes années (je retrouve un exemplaire du Visionnaire en livre de poche, daté de 1964) et retrouvé des années plus tard avec un essai de lire Adrienne Mesurat, dont rien ne me reste ( !), et curieusement le Journal ne m’a jamais vraiment attiré alors que j’ai été un lecteur assidu des Journaliers de Jouhandeau, puis du Journal littéraire de Léautaud. Or j’ai comme l’impression, en commençant de lire cette version intégrale du Journal (1919-1940) que je suis plus proche de Green que de Jouhandeau et de Léautaud, mais cela reste à vérifier au fil d’une lecture, dès ce soir, que je voudrais quotidienne, annotée très précisément, parallèlement à celle d’Audiberti.
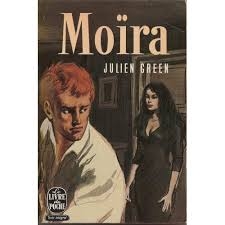
RENCONTRES. - Après une cinquantaine de pages seulement, je sais déjà les noms de tous les personnages de Moïra, que j’ai commencé de lire le soir alors que je poursuis la lecture du journal des années 1919 a 1940. Tout de suite j’ai été frappé par l’intensité, et même la violence du protagoniste de Moïra, pur et dur autant que l’est en partie l’Auteur, lequel est manifestement Joseph autant qu’il est Bruce ou David. Or pensant à ces prénoms, je me dis que le seul livre de cette trempe que j’aurais lu ces dernières années est le Sam d’Edmond, qui a quelque chose de Green. D’ailleurs ce sont mes deux grandes rencontres de cette fin d’année, par rapport auxquelles je vais me recentrer dès notre installation à la Maison bleue.

La Maison bleue, ce jeudi 21 novembre.- Premier réveil ce matin à la Maison bleue. Ensuite à Lausanne pour y retrouver, après l’hygiéniste, mon cher Edmond avec lequel nous avons passé trois bonnes heures. C’est un nouvel ami que je me suis fait là, qui commence par me dire qu’il se régale à la lecture de mon libelle, parvenu qu’il est au chapitre des rebelles consentants qu’il s’amuse à identifier - il a trouvé la Douairière bien épinglée, qui l’a snobé, mais j’insiste un peu hypocritement sur le fait que mon Open Space n’est pas «à clefs», sachant par ailleurs que c’est par là que l’on va probablement me chercher noise, ou sur l’affaire Millet. Nous sommes d’accord sur à peu près tout, je lui ai fait lire le début de ma chronique sur Sam et il s’en est dit très touché, puis il m’a éclairé sur les sources familiales du livre en m’apprenant dans la foulée que le modèle de Bassens n’est autre que Vufflens-la-ville où nous avons tant de souvenirs, dans la grande demeure dite le Château ou deux sœurs ont bel et bien été cloîtrées dans une chambre munie de grilles, et que le thème de la vengeance est un leitmotiv de sa légende familiale…
PURITAIN. - Je retrouve, dans le Journal de Julien Green, les quatre instances que j’ai invoquées au début de ce Journal des Quatre Vérités, du corps et du cœur, de l’esprit et de l’âme ; oui tout y est, et chez ce catholique puritain, cela donne un mélange parfois explosif dont les romans tirent leur puissance visionnaire.
Ce vendredi 22 novembre. - Bien dormi à la Maison bleue. Enchanté par nos parquets et nos verrières à l'ancienne. Du vieux qui semble tout neuf, comme je le suis en somme en esprit. Avant le café, je lis quelques pages du Journal de Julien Green qui m’épate par sa façon naturelle de faire cohabiter les univers apparemment opposés de la débauche caractérisée et de la pénétration intellectuelle ou spirituelle, alternant le récit précis de ses chasses nocturnes et de son travail studieux au coin du feu.
CRAVATÉS. - En lisant le Journal de Julien Green, puis en me rappelant la tenue de Czapski devant son chevalet, je pense à ces hommes qui restent – comme moi qui ne porte jamais de cravate – des sauvages sous contrôle ne perdant rien de leur élégance, de leur style et de leur dignité. Le contraste de l’homme habillé et de ce qu’il cache «derrière la cravate» est certes assez stupéfiant dans le Journal de Green, mais je n’y vois aucune forme d’hypocrisie pour y trouver, au contraire, quelque chose de juste et de sympathique en cela que son «tout dire» reste « entre soi » et non publié du vivant des « intéressés »…
Ce dimanche 1er décembre. - Je ressens ces jours, comme un poids sur le thorax, côté cœur, je dirais presque: comme une main qui pèse et serre. Je sens le muscle comme un «paquet» un peu durci, et assez confusément ce que me disait l’angiologue Kernen parlant de « souffle au cœur » ; en outre je me sens très fatigué et la moindre marche, n’était-ce que pour rallier le parking sis à 200 mètres de la Maison bleue, m’est très pénible. J’ai d’ailleurs téléphoné l’autre jour à l’angiologue Kern pour lui décrire ce que je vis, mais il m’a renvoyé à mon médecin traitant qui sans doute me renverra à lui – merci messieurs.
GÉNIE DE JULIEN GREEN. - Le premier décor du Journal de Julien Green, avant la vingtaine de celui-ci, est américain, correspondant au séjour du jeune homme à l’université de Virginie, et l’on sent aussitôt le déchirement qu’éprouve le jeune homme hésitant entre l’entrée dans les ordres, à quoi le pousse le Père Crété, son confesseur, sa nature très sensuelle, sa détestation croissante de l’Amérique matérialiste, sa vocation encore incertaine et son désir pressant de revenir en France pour y exprimer ce qui bouillonne en lui.
C’est d’ailleurs en France que se situera son premier roman, Mont-Cinère, mais l’invisible «main» de mon instinct m’a porté à lire en priorité, et parallèlement aux pages du Journal intégral relatives à ses années d’université, celui de ses romans, datant de 1950, intitulé Moïra et qui met en scène, précisément, un groupe d’étudiants gravitant autour d’un jeune homme à la fois effrayant, dans sa singularité de roux fou de Dieu, et non moins attachant par le combat qui se déchaîne en lui et qui le fait craindre ou détester, ou secrètement aimer par ses condisciples. L’un de ceux-ci, au prénom de Simon et au faciès ingrat, payera son attirance immédiate et innommée, au prix fort puisque, rejeté dédaigneusement par le roux, il se tirera une balle dans son recoin.
Le roux en question se nomme Joseph Day, il est descendu de ses collines puritaines pour s’instruire et sauver le monde dans la foulée, ses camarades l’ont bientôt surnommé l’ «ange exterminateur» à cause de son sérieux et de sa furieuse détestaton de la chair, à vrai dire proportionnée à la furieuse intensité de ses pulsions refoulées, et lisant le journal du jeune Julien Green l’on ne peut s’empêcher de penser qu’il y a de lui dans le personnage de Joseph, avant de penser qu’il y a aussi de lui dans tous ses personnages.
La première impression que j’aurai éprouvée, en entrant dans ce roman prodigieusement maitrisé dans toutes ses parties (personnages, paysages, dialogues annonçant le théatre, atmosphères psychologiques, dramaturgie, suggestions érotiques, archétypes de l’imaginaire au franges de l’onirisme par ailleurs hyper-présent dans le journal, controverses « bibliques », échappées spirituelles, substance verbale d’une impérieuse poésie, etc), m’a rappelé l’univers des grands auteurs à la Nathanaël Hawthorne (auquel le jeune Green a d’ailleurs consacré un travail universitaire) ou à la Flannery O’Connor brassant les thèmes liés aux passions humaines en prises avec les instances sacrées du Bien et du Mal, sous l’égide d’un puritanisme ardent (chez Hawthorne) ou d’un mysticisme catholique foudroyant (la terrible Flannery au mileu de ses poules et de ses paons hurleurs…) , alors même que le roman, d’une obscure limpidité - si l’on ose l’oxymore - nous prend par la gueule et la secoue jusqu’à l’horrible dénouement.
Moïra pourrait être dit, en partie du moins, le roman frénétique du refoulé et de son brutal et fatal retour, où la mauvaise plaisanterie de quelques étudiants ricanants pousse le protagoniste au bout de lui-même, provoquant la mort violente d’une jeune femme équivoque, chargée de séduire le beau roux coincé et jouant son rôle avec une rouerie cynique qui finit par se retourner contre elle.
Pour mieux saisir les tenants de ce roman datant de la maturité de Julien Green (paru en 1950 chez Plon), la lecture du journal intégral de l’écrivain, dont on sait qu’il a été tenté par les ordres vers ses dix-neuf ans et qui se traite lui-même d’érotomane dans sa trentaine, est éclairante. D’abord parce qu’il y développe déjà l’idée que chaque individu en contient dix ou vingt autres, et ensuite par sa façon d’envoyer promener ceux qui, comme Gide ou le grand philologue allemand Curtius lui pelotant un peu les fesses, d’écrire des romans plus explicites en matière d’homosexualité.
Or c’est justement là que Julien Green se distingue absolument de ce qu’on appelle la «littérature gay», où le malheureux homo est forcément une victime de la société ou d’une conception archaïque et punitive de la religion, en développant une vision beaucoup plus complexe, plus riche plus violemment contradictoire sans doute, mais plus intéressante et plus vraie de la complexion humaine aux cent visages.
Joseph Day est, ainsi, immédiatement puant dans son arrogance, et non moins impressionnant par sa rectitude apparente de garçon studieux et solitaire, lecteur de la Bible et convaincu de ce que la chair est une diablerie ; et tout de suite il entre en conflit avec l’un de ses condisciples, l’orgueilleux Bruce Praileau en lequel on pourrait voir son double, qui l’a persiflé et avec lequel il va se battre si durement que l’autre le taxe de virtuel «assassin».
Implacable avec un «fort», il ne l’est pas moins avec Simon Demuth, qui cherche ses bonnes grâces avec une gentillesse un peu collante qui l’horripile, et dont il provoquera plus tard le désespoir. Et puis il y a l’irénique David, bien décidé à devenir pasteur, qui l’identifie comme un «élu» dès leur première rencontre, l’aide obligeamment à échapper au cercle des lascars impatients d’aller se défouler dans la «maison» qu’on devine, et l’agace en même temps par son égalité d’humeur d’être parfait alors que lui-même se croit voué au feu glacial de l’enfer rien qu’à penser à ce qu’il pense – et il ne pense qu’à ça.
En outre, de la première logeuse de Joseph au cercle des moqueurs, dont certains ne cherchent qu’à faire tomber son masque de puritain, et jusqu’à Moïra qui le trouble dès sa première apparition, les personnages du roman composent un « décor » humain très vivant qui s’intègre dans le décor naturel superbement évoqué du campus d’université où tout se passe.
Au début des années 20, Julien Green écrit dans son journal que l’Amérique l’ennuie de plus en plus avec son matérialisme bas de plafond, et même l’horripile. Or trente ans plus tard, avec Moïra, il aura distillé toute son expérience d’alors, réelle ou fantasmatique, pour en faire un roman hyper-américian et bien plus que ça : un poème romanesque d’une noire beauté traversé par un tremblement constant de joie et de terreur mêlées.