De la lumière de Pâques, d'un livre recu d'Yves Leclair, des écrits de Lambert Schlechter, de l'atomisation contemporaine et de la société des êtres.
À La Désirade, ce dimanche 8 avril, jour de Pâques. – Il fait ce matin tout gris et tout bruineux sur nos monts, tout pluvieux et tout neigeux, mais le seul nom de Pâques me fait saluer ce jour lumineux. Cela noté sans qu’un instant je ne cesse d’éprouver et de plus en plus à ces heures le poids du monde, d’un clic je sais que je pourrais accéder à l’instant à toute la saleté du monde, mais à quoi bon y ajouter ? Je traverse la Toile et je passe comme, au même instant, des millions de mes semblables restent scotchés à la Toile ou la traversent et passent.
Et voici que dans cette lumière pascale j’ouvre un petit livre qui m’est arrivé hier de Saumur, que m’envoie le poète Yves Leclair, intitulé Le journal d’Ithaque et dont la dédicace fait allusion à nos « chemins de traverse » respectifs. Je présume que c’est sur mon blog perso qu’Yves Leclair a pris connaissance de ce que j’écris, dans mes Chemins de traverse à paraître bientôt, à propos de son Manuel de contemplation en montagne que j’ai aimé. Autant dire que c’est par la Toile, maudite par d’aucuns, qu’Yves Leclair m’a relancé après un premier échange épistolaire, et par un livre que nos chemins de mots se croisent, comme j’ai croisé ces derniers temps ceux du poète luxembourgeois Lambert Schlechter, ami de Facebook et compagnon de route occulte depuis des années dont je suis en train de lire les épatantes Lettres à Chen Fou.
Tel est l’archipel du monde contemporain où nous sommes tous plus ou moins isolés et reliés à la fois par les liens subtils des affinités sensibles et de passions partagées. Je retrouve ainsi, ce matin, la lumière des mots d’Yves Leclair dont la lecture du Journal d’Ithaque m’enchante aussitôt et d’autant plus que je viens d’entreprendre, de mon côté, un recueil de Pensées en chemin qui prolongeront mes Pensées de l’aube. Je lis ainsi le premier dizain de ces 99 minuscules étapes d’Odyssée, sous-intitulé Sur la route d’Ithaque, 10 août, avec Tour opérateur pour titre, et tout de suite je marche :
Tour opérateur
« Est-on dans une ville ? Où est-
on ? Car ce sont des cabinets
qu’on vous indique – d’expertise
comptable. Vous tombez au fond,
Par hasard, d’une avenue qui
vous conduit de rond-point en rond-
point entre les tours de béton.
Sinon, on vous indique aussi
la direction de l’hôpital
ou du grand centre commercial.
Sur la route d’Ithaque
10 août 2008 .
Juste avant j’avais noté l’exergue à ces Belles Vues, de Constantin Cavafis auquel je pensais l’an dernier à Salonique et que j’ai retrouvé dans le recueil Amérique de William Cliff récemment paru, et du coup la lumière sourde, intime, tendre, trouble un peu que j’aime chez Cavafis m’est revenue par ces mots : « Et même si elle est pauvre, Ithaque ne t’a pas trompé. Sage comme tu l’es, avec une expérience pareille, tu as sûrement déjà compris ce que les Ithaques signifient ».
Et de fait je les retrouve, mes Ithaques de Toscane ou d’Andalousie, d’Algarve ou de Mazurie, dans les stations de ce petit livre d’Heures d'Yves Leclair où je sens que je vais m’attarder et revenir, avec cette Ordonnance pour la route :
Ordonnance
Attends un peu sur le vieux banc,
au milieu du pré déserté.
Contemple, car rien ne t’attend
sauf la sorcière au noir balai.
Admire la lumière bleue
au soleil d’hiver généreux.
Viens voir en volutes la laine
de la fumée qui se défait
sur les toits des fermes lointaines.
Aime le calme instant de fée.
Le Sappey en Chartreuse
3 novembre 2008
Or il y a des jours et des semaines, des mois et des années que je me promets de parler de Lambert Schlechter, lui aussi évoqué dans mes Chemins de traverse et que j’aime retrouver à tout moment, l’autre jour à Bienne – Ithaque de Robert Walser -, au bord d’un lent canal vert opale, à commencer de lire ses Lettres à Chen Fou, et d’autres fois sur les hauts de Montalcino où se situent précisément des pages à fragments de La Trame des jours, suite de son Murmure du monde.
L’idée d’écrire à un lettré chinois d’un autre siècle est belle, qui convient tout à fait à la nature à la fois stoïque et contemplative de Lambert. Sa façon de décrire les choses du quotidien actuel (que ce soit l’usage d’un poêle à mazout ou d’une ampoule électrique) à un poète d’un autre temps pourrait s’appliquer aussi à l’usage de Facebook ou à la théorie des cordes, sans parler du monde des hommes qui n’est pas plus beau de nos jours que sous les Royaumes Combattants.
« Le livre que j’écris, les livres que j’écris, ce n’est que ça. Juxtaposer sur la même page le visage de Chalamov et l’éclosion des fleurs du pourpier dans la lumière du matin », note Lambert Schlechter dans La Trame des jours.
Ce matin il y avait de la neige sur le jaune de forsythias. J’ai encore copié ce Rimmel d’Yves Leclair comme un écho à ce que je voyais devant la maison :
Rimmel
La route est une agate blanche.
La course humaine ralentit.
Le ciel floconne dans la nuit.
La neige qui tombe en silence
chuchote une étrange élégie.
Comme si tout rimait sans peine,
dessus mon bonnet bleu marine,
mes cils, les pas de la vosine
et même sur les chrysanthèmes
La neige met l’ultime rime.
Retour du boulot
5 janvier 2009
Yves Leclair. Journal d'Ithaque. La Part commune, 127p. 2012
Lambert SChlechter. Lettres à Chen Fou. L'Escampette, 2012.


 De la formation des rêves, de la jobardise des intellectuels et des enseignements de Simon Leys.
De la formation des rêves, de la jobardise des intellectuels et des enseignements de Simon Leys. 
 Cette petite maison de pierre au toit couvert d’ardoises, serré dans ce bled perdu que surplombent de hautes et farouches pentes boisées de châtaigniers roux, sur l’ubac du val Maggia, est vraiment le dernier endroit où l’on imaginerait le gîte d’une romancière américaine mondialement connue dont le dernier livre paru, Catastrophes, traite des aspects les plus noirs de la vie contemporaine. Pour arriver à sa porte, j’ai traversé toute la Suisse, hier, ralliant Locarno d’où, par le car postal jaune flambant, j’ai débarqué à l’arrêt du bord de la rivière, à vingt minutes de marche d’Aurigeno, après quoi je n’avais plus qu’à suivre les indications téléphonées à voix toute douce : le chemin du haut, la fontaine et, visible tout à côté, la porte verte dont le heurtoir est une délicate main de femme…
Cette petite maison de pierre au toit couvert d’ardoises, serré dans ce bled perdu que surplombent de hautes et farouches pentes boisées de châtaigniers roux, sur l’ubac du val Maggia, est vraiment le dernier endroit où l’on imaginerait le gîte d’une romancière américaine mondialement connue dont le dernier livre paru, Catastrophes, traite des aspects les plus noirs de la vie contemporaine. Pour arriver à sa porte, j’ai traversé toute la Suisse, hier, ralliant Locarno d’où, par le car postal jaune flambant, j’ai débarqué à l’arrêt du bord de la rivière, à vingt minutes de marche d’Aurigeno, après quoi je n’avais plus qu’à suivre les indications téléphonées à voix toute douce : le chemin du haut, la fontaine et, visible tout à côté, la porte verte dont le heurtoir est une délicate main de femme…

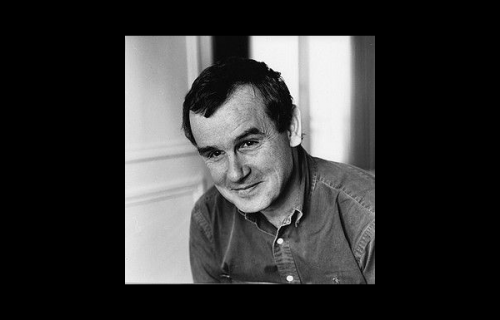

 Avec Fukushima, récit d’un désastre, Michael Ferrier élève le témoignage au rang du grand art.
Avec Fukushima, récit d’un désastre, Michael Ferrier élève le témoignage au rang du grand art.