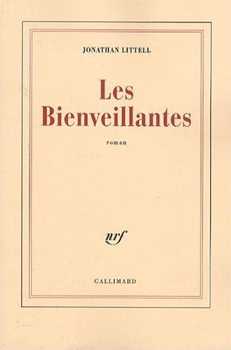Les notes de lectures qui suivent, d'une pertinence remarquable, m'ont été adressées par Pierre Levecque sous forme de commentaire. Le voici plus visible.
Sur un plan factuel, deux obstacles de base :
- On est d’emblée intimidé par le poids de ces plus de 900 pages, tassées, sans paragraphe, imprimées en caractère 6 …
- Il faut surnager, au début, dans la houle des …strumfurher et des vocables germaniques, dans la noria de noms ukrainiens ou caucasiens de lieux et d’organisations : ce trait, qui m’a assez gêné au début, participe, pourtant, sans doute, à la patine, au grain photographique du récit, qui prend le poids d’une réalité dense, par-delà la fiction. A noter que l’essentiel des patronymes, des endroits et des épisodes rapportés appartient à l’histoire et à la géographie du réel ( Wikipédia & Google vous seront , à ce niveau, des amis utiles. )
Si l’on surmonte ces deux obstacles et que l’on parvient à la page 125 sans trop d’épuisement, je gage qu’on ne quittera plus le récit jusqu’à sa finale convulsive.
Le récit est structuré comme une suite musicale de danses classique : toccata d’exposition, allemandes, courante, gigue et fugue.
Dans la Toccata, le narrateur expose ses motifs et ses moyens : du fond de son bureau de directeur d’une usine de dentelle au nord de la France, il entreprend sur le tard la rédaction minutieuse de son parcours de guerre, qui nous conduira de l’attaque-surprise du Reich contre la Russie stalinienne en 1941 à l’apocalypse berlinoise de 1945. Ses raisons ne sont pas clairement énoncées : tout au plus un besoin d’exonération , comme les matières fécales , en tout cas pas le regret ou le remords, à l’en croire.
La suite se compose de longs récits polyphoniques, pour se conclure dans une fugue démoniaque et haletante.
Max Aue cache une fracture originelle : enfant mal aimé, entre un père allemand ancien combattant tôt disparu et une mère française remariée, reflet sombre d’une sœur jumelle solaire, faisant office d’idéal féminin incestueux, Max se cherche sans trouver son unité. A la suite d’une scolarité rigoureuse et grise, d’internat en pension austère, Son penchant homosexuel commence à s’affirmer. Il se consacre à un doctorat en droit et, à sa majorité, choisit la nationalité paternelle : il rompt ses derniers liens familiaux et gagne l’Allemagne de Weimar à bout de souffle.
Esprit fin, assoiffé d’absolu, en quête d’objet, il est rapidement séduit par la radicalité du national-socialisme et adhère au culte du Volk. Au gré des circonstances, des rencontres et d’un fait-divers homosexuel dont il doit s’amnistier, ses compétences juridiques aidant, il rejoint la SS. Il quitte son poste administratif en 1941 , pour le front de l’est, dans les rangs de l’einzatgrup SS du sud , fraichement constitué, pour sécuriser les arrières de la Wermacht dans les vastes territoires rapidement conquis et y mettre en œuvre une épuration d’abord sur des critères idéologiques , puis rapidement raciaux. Le glissement progressif d’une mission d’un service spécial en guerre vers un processus, d’abord artisanal, pus organisé et peaufiné, coordonné et rationnalisé, à l’image du Fordisme dans l’industrie lourde, en vue de l’anéantissement définitif d’une « race » entière nous est rendu, par petites étapes successives, où s’observent tout le panel des réactions individuelles, dans cette descente infernale vers la transgression morale définitive.
Jonathan Littell nous emmène presqu’en douceur vers l’un des visages les plus hideux du Mal, à travers l’esprit rationnel , précis , subtil et conscient d’un être qui paraîtra longtemps proche de nous, malgré ses actes et sa dérive intérieure , proche par ses doutes et ses faiblesses , proche par les rares pépites de pureté qu’il héberge encore .
Les scènes d’action (massacres, accrochages) alternent avec des longues périodes d’attente, où les officiers se lancent dans des discussions aussi variées qu’imprévisibles. Les références fourmillent, à un corpus éclectique de savants , de philosophes ( Tertullien, Spinoza , Heidegger, … ) , d’écrivains ( Lermontov, Stendal , Maupassant) , de musiciens ( Rameau, Couperin, Monteverdi, Bach , évidemment ) .
La route chaotique de l’Est nous conduit de Kiev aux limites du Caucase, de la steppe aux montagnes volcaniques, où se côtoient splendeurs naturelles et culturelles, à peine obscurcies par les horreurs de cette guerre.
La course fatale de Max se termine dans la nasse de Stalingrad, dont Littell nous dépeint, avec densité et économie, l’atmosphère inhumaine et glaciale. Héros un peu malgré lui, gravement blessé, Max échappe in extremis à la capture.
Au terme d’une lente convalescence nostalgique sur les rives de la Baltique, il rejoint Berlin en 1944 pour reprendre sa place dans l’administration mortifère de la solution finale, dorénavant clairement énoncée et méthodiquement industrialisée et mise en œuvre, depuis la conférence de Wansee. Un court détour par la France lui offre l’occasion de franchir le point de non-retour , dans son parcours individuel, vers sa malédiction intime.
Dans la capitale d’un Reich déliquescent, Max côtoie un monde interlope où s’agitent, sous la caste de quelques seigneurs nazis, des petits comptables du crime, des nobles prussiens cyniques, des parvenus vulgaires, des veuves séduisantes, des escrocs. De la piscine au bistrot, puis du bar aux abris, sous le feu croissant des avions alliés, le temps paraît suspendu, au bord du vide de la défaite.
Dans son rôle bien rôdé d’évaluateur de la chaine de destruction, Max, sur l’injonction de Speer, va s’activer pour adoucir un peu la condition des déportés, du moins ceux qui pourraient représenter un potentiel de travail inestimable dans la guerre totale de Goebbels. Il se heurte aux obsessions purificatrices d’Himmler, aux visées carriéristes d’Eichmann, à l’inertie sadique des bourreaux de terrain.
Max s’inscrit à la stricte intersection d’une démence collective titanesque, dont il nous montre bien la multiplicité des ressorts et d’une folie personnelle autodestructrice et immanente, proche du fatum latin, coupable expiatoire d’une faute commune et d’un crime individuel.
L’explosion de folie finale, où Max révèle toutes les facettes de son « Dasein », dans le climat d’apoptose morbide et violente qui baigne Berlin en août 1945, nous en parait d’autant plus ambigüe.
La malédiction du peuple allemand lui répond en écho, comme, à l’opéra, le chœur au soliste.
Il en ressort une responsabilité collective, qui échappe à l’addition des culpabilités individuelles.
Le titre « Les Bienveillantes » fait référence au nom d’entités mythologiques primordiales, censées, dans la tragédie grecque, pourchasser sans répit les auteurs d’actes inexpiables – la légende des Atrides et la malédiction d’Oreste, matricide par la volonté des Dieux ( Eschyle ) .
Ce roman est un monument littéraire somptueux, impressionnant par son souffle épique, sa densité, sa richesse, ses multiples niveaux de lecture et de références, posant de façon originale les questions de la responsabilité et de la culpabilité, individuelle et collective de l’homme, et auscultant de façon troublante notre parenté au bourreau.
Style touchant au naturalisme, avec des échappées dans le baroque et l’onirisme.
Lecture qui donne à réfléchir, à s’interroger, à se souvenir et à ressentir, sur les questions essentielles de notre histoire et de notre civilisation.
Je me permets de citer, pour conclure, Alain Nicholas , chroniqueur littéraire de l’Humanité :
« Jonathan Littell, qui se confronte dès son premier roman à une matière pleine de risques, et au genre difficile du roman historique, se l’approprie avec maestria. Mieux encore, il le tire hors de ses codes, l’ouvre à la modernité sans sacrifier l’efficacité de la narration ni le réalisme de son univers. Le lecteur qui voudra bien accompagner cette démarche verra ses efforts récompensés. »
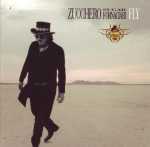

 Avec Das Fräulein, Andrea Staka signe un film admirable de sensibilité et d’intelligence, que deux grands prix ont déjà consacré à Locarno et Sarajevo.
Avec Das Fräulein, Andrea Staka signe un film admirable de sensibilité et d’intelligence, que deux grands prix ont déjà consacré à Locarno et Sarajevo.