
Notes liminaires
1. Un roman est d’abord une espèce de sentiment vague, auquel sont associées quelques images. Avec cette intention initiale de ma part cette fois : de raconter ou se faire raconter trois vieilles dames. Une dame serait un récit, deux dames une nouvelle ou une pièce de théâtre, mais trois vieilles dames font un roman. Voilà : ce sera donc le roman de trois vieilles dames. Trois vieilles dames de notre époque, qui sont nées toutes trois pendant la Grande Guerre (1915,1916, 1917) et ont traversé le XXe siècle, chacune à sa façon. Je vois déjà le roman de terre, de grand air, de tribulations et de bonté que cela peut donner, où se mêleront l’histoire du siècle (Marieke la Hollandaise), l’évolution du petit pays enrichi (Clara la gardienne du foyer) et la géographie du monde (Lena la trotteuse). Tout dès cet instant : lectures, observations, gamberge, tout va se déverser dans cet entonnoir. La traversée du XXe siècle en filigrane. Un roman d’humour et d’amour.
2. Les premières images sont celles d’un jardin public où les deux premières dames (Marieke et Clara) se rencontrent par hasard, sous un tulipier. Il y aurait le bateau blanc à aubes de la Compagnie Générale de Navigation que Marieke prendrait le plus souvent possible pour aller de l’autre côté. Je vois les hautes marches d’escalier descendant sous terre d’un tombeau de la Vallée des Rois. Des tea-rooms l’après-midi. Je vois aussi l’appartement de la célibataire (Lena la voyageuse) donnant sur une pelouse décente. Et le quartier de la veuve. Donc l’une (Clara) sera veuve et l’autre (Lena) célibataire. Et la troisième (Marieke) aussi est veuve. Deux seules ont des enfants. Un fils a tenté de se suicider. Deux filles ont épousé respectivement un Espagnol et un géomètre, notamment.
3. Le titre m’est venu soudain comme une évidence, oui c’est cela : Les bonnes dames.
4. Le territoire de chacune des trois bonnes dames est assez nettement défini, comme les caractérisent certains objets et autres accessoires. La maison, type de la villa familiale subventionnée des années 50, est le royaume de Clara, la maison et le jardin qui l’entourent. Marieke, pour sa part, m’évoque plutôt un pigeon dans son colombier, qui doit aller et venir. Quant à Lena, son aire est moins marquée. Elle vit surtout dans la relation. Elle a peu d’espace privé. Ou alors : net. Il y a en elle de la secouriste. Le service a occupé sa vie. Clara porte un petit sac à dos, Marieke une espèce de sacoche de cuir à franges indiennes. Aucune des trois ne fume. Marieke, la plus limitée question matérielle, se paie parfois un schnaps, histoire de se rappeler l’époque du Lac Bleu où, pendant la guerre, elle a trouvé son premier refuge.
5. M’importent les lumières. M’importent les objets éclairés. M’importent les tonalités respectives de chaque voix. Marieke toujours un peu ronchonneuse, malcontente du Gouvernement, au sens universel. Clara volontiers sentencieuse et plaintive pour se faire plaindre, mais solide au poste. Lena pleine de malice, cachant sa peine depuis une vie.
6. Importante également : la façon de chacune d’apparaître et de s’esquiver, comme au théâtre. Clara et Marieke sont immédiatement là, tandis que Lena apparaît d’abord par défaut, dans ce qu’elles racontent d’elle, alors qu’elle séjourne au Bouthan chez son amie Rosa. Importants les dialogues. Comme rapportés en discours indirect mais très vifs. Lena se parle à elle-même en riant sous cape. Rien ne perle cependant de sa douce folie dans son comportement de voyageuse humanitaire juste originale.
7. La construction serait comme d’un montage de cinéma, un peu à la manière du Monde désert de Pierre Jean Jouve, très claire et très elliptique, très à la pointe, sans jamais peser ni trop développer, mais avec de soudaine ruptures de ton, dans le drame ou le cocasse, le tragique ou le salace. Concentrer en 200 pages le contenu latent de 600.
8. Marieke. Mon Indienne. Ma femme du vent. Ma vieille écolo férue d’art et vouant un culte posthume à son frère peintre, emporté par la gangrène l’année de la mort de Staline. Enfuie d’Amsterdam en pleine guerre pour un motif secret. Débarquée en Suisse allemande où elle a rencontré le lieutenant Verrières, petit-fils de psychiatre (ami de Jung) et fils de colonel pro-nazi, originaires de Neuchâtel. Grands bourgeois ruinés en Argentine dans les années 30. Son lieutenant culturiste et sous la coupe de sa mère, une de Rougemont typique de la dominatrice d’aristocratie provinciale. Que Marieke, fils de leader socialiste hollandais, subira pour mieux défendre ses chiots, comme elle appelle ses enfants. Marieke ne parlera guère d’elle-même à Clara, mais son discours intérieur fait partie du portrait. Le lecteur en saura tout sans que rien ne passe la barrière de ses (fausses) dents. Marieke est tissée d’Histoire (avec une grande hache) et d’histoires. Elle a rempli l’enfance des jumelles (donc il y a des jumelles dans ce roman) de ses récits et autres affabulations à en plus finir.
Le grand regret de Marieke est de ne pas avoir eu l’occasion d’étudier. Elle a toujours été attirée par la philosophie. Elle lit toujours Sénèque, tout en enrageant de tout oublier à mesure. Clara lui reproche de couper les cheveux en quatre et se flatte d’avoir, elle, les pieds sur terre. « Moi, au moins, j’ai les pieds sur terre », dit Clara.
9. Clara, elle, est tissée de généalogie et de géographie. C’est la Femme au Foyer dont le jardin s’étend désormais au monde entier. Du vivant de son conjoint, elle a déjà « fait » l’Autriche et l’Espagne, l’Italie en camping dans les années 50-60 et la Grèce en croisière Hotelplan, puis l’Argentine (en visite chez l’une de ses filles) et le Mexique, mais elle rêve encore de la Vallée des Rois. Elle aime les balades en forêt et les randos à flanc de montagne. Quand on lui dit que le Zanskar est super, elle rétorque que le Lötschental est aussi très bien. Elle se vexe si l’on insinue qu’il y a mieux que la Suisse, mais les voyages ont aiguisé sa fibre socialiste. Elle a écrit récemment au ministre des finances pour lui dire ses doléances à propos de la situation des vieilles personnes et du quart monde en ce pays de nantis parachutes dorés. Elle collectionne les chèques de voyage.
10. Lena, sœur benjamine de Clara, est plutôt sciences naturelles et service social, à la dévotion de la Vraie Jeune Fille de partout. A ce titre, elle a enseigné dans le monde entier, longtemps en Australie puis à Salt Lake City, chez les Amish et au Donegal, avant de se retirer dans son canton primitif où elle tient l’orgue paroissial et classe son herbier, soixante ans de cueillette sous toutes les latitudes.
11. Brocante des trois personnages. Marieke ou la mule des pulls (pour Clara : des nids à poussière). Mais elle leur fait raconter des histoires. Les serre dans une malle et les sort de temps à autre, notamment pour les jumelles. Lena ne garde aucune relique, sauf un cahier rempli de micronotes et son herbier. Ne conserve qu’une paroi de livres. Dans un tiroir fleurant l’eucalyptus : un argus de Tasmanie dans un sachet de papier, et la petite photographie écornée d’un indigène des Samoa presque nu qu’on ne retrouvera même pas après sa mort car elle la brûlera avant la fin du roman. Clara vit avec les portraits des siens alignés sur une paroi. Divers objets décoratifs ramenés des quatre coins du monde. Son conjoint faisait du macramé et de la peinture sur bois. L’un de ses fils a la manie de lui offrir des cannes. Toutes finissent dans le même cagibi.
12. Esquisse de la première séquence intitulée Au Denantou, du nom du jardin public jouxtant le petit port lacustre, tout au bas de notre ville.
Au Denantou
Ce qui serait super, avaient-elle pensé, serait de se revoir au lieu même où elle s’étaient retrouvées la dernière fois par hasard, dans le grand jardin du bord du lac, au Denantou, et Marieke tint à préciser: sur ce banc d’où l’on a la meilleure vue de l’autre côté, et Clara conclut à sa façon, avec un allant qui l’étonnait elle-même: d’accord, nous nous retrouvons sur notre banc, le même jour dans une semaine, à une heure de l’après-midi, sauf s’il pleut.
A l’instant elles venaient de s’apercevoir de part et d’autre de l’allée. C’étaient deux très vieilles dames qui auraient aimé se faire de loin des signes folâtres de petites filles se réjouissant de se retrouver un après-midi de congé, mais elles s’en tenaient pour l’instant à leurs rôles aux contrastes marqués depuis des années au fil des très épisodiques rencontres de leurs tribus appariées, la philosophe et la marcheuse, se bornant à des constats de leur âge: il fait un temps extra, on est à l’heure, etc.
Marieke se dit in petto: elle a vraiment l’air de se maintenir, la p’tite Clara, elle ne se laisse pas aller, etc.
Et Clara: c’est décidément une originale avec sa jupe d’indienne, et pourtant elle est à l’heure, etc.
Elles restent un bon moment debout dans la lumière nette de lendemain de pluie de ce 14 juin de l’an 2000, à quelques pas de la vendangeuse de pierre dont Marieke célébrait l’autre jour les rondeurs opulentes, et c’est encore Marieke qui retient Clara sur place, l’impatientant à la fin avec ses congratulations:
- Non mais laissez-moi vous regarder : c’est qu’on vous donnerait vingt ans de moins ! Nom de bleu la Forme !
Et Marieke ne lâche pas le bras de Clara, qui n’a jamais trop apprécié les attouchements, sauf de la part de feu son conjoint, d’ailleurs peu porté là-dessus. Aussi lance-t-elle, pour faire diversion, tout en visant leur banc du regard:
- Vous savez que c’est aujourd’hui l’anniversaire de notre premier rendez-vous, il y a plus de soixante ans de ça, le 14 juin 1939, ça sentait déjà la guerre; et voilà qu’il y a juste vingt ans, en mars dernier, que Paul-Louis m’a été repris. Enfin je vous l’ai déjà seriné, je me répète : je m’excuse. On ne se rend pas compte ce que le temps passe tellement c’est long, et puis ça me fait du bien de vous parler... Il en aura fallu des années pour qu’on arrive enfin à trouver le contact… Jamais ne n’aurais pensé… Mais ne restons donc pas plantées...
Alors on les voit bras-dessus bras-dessous, comme deux soeurs ou des camarades longtemps séparées, qui se dirigent vers l’ombre claire, sous le tulipier là-bas, en ne cessant de parler avec animation.
Clara continue de se lamenter un peu malgré les protestations de cette fofolle de Marieke qui prétend que la vie est un miracle de chaque instant. C’est plus fort qu’elle : il faut que ça sorte. Le jour de leurs retrouvailles, tant d’années après le mariage de Loulou et Pascal, leurs enfants respectifs, elle a dit à Marieke que c’était la première fois qu’elle confiait à quelqu’un tout ce qui la chicanait - même à son amie Constance elle n’aurait pas osé. Peut-être, a-t-elle pensé ensuite, que cet abandon tardif lui est venu du fait que Marieke, pour la première fois, lui parlait directement à elle et sans qu’il fût question de leurs enfants, tout à coup, cra cra, elle lui a dit qu’elle pouvait vider son sac.
Clara a dit alors à Marieke tout ce qui lui pesait, et d’abord d’être si seule, malgré ses enfants et leurs propres enfants ou peut-être bien : à cause d’eux. C’est vrai qu’après tout ceux qui n’ont personne peuvent s’y faire : ils n’ont personne, tandis que les enfants vous les attendez. Et les enfants se font attendre.
« Mais c’est la loi de la vie », avait objecté Marieke. « Les enfants doivent couper. Je dirai même : il faut qu’ils nous bousculent, c’est aussi bien pour eux que pour nous ».
Et Clara : « Quand même vous exagérez, Marieke, les enfants restent les enfants » - «Allez, ma p’tite Clara, vous vous faites du mal à vous accrocher comme ça. Lâchez-leur les baskets et ils viendront sans se faire prier s’ils tiennent à vous. Sinon ça vous fait une belle jambe… »
Or Clara en convient à l’instant, après qu’elles se sont raconté leur semaine:
- Voui, vous aviez peut-être raison pour les enfants, je suis sûrement trop impatiente, mais tout a tellement changé depuis le temps où nous allions voir nos parents tous les dimanches après le culte.
- Tous les dimanches après le culte ! Vous vous rendez compte ? Vous les voyez là-bas, sur leurs rollers, vous les imaginez tous les dimanches après le culte ? C’était notre monde, tous les dimanches, et maintenant il n’y a plus de dimanche, p’tite tête, ou alors c’est tous les jours dimanche. Mais basta : on va se mettre en retard, l’Italie n’attendra pas…
13. Le retour au roman se fait sentir par un afflux de rêves et ce murmure d’avant l’aube qui représente à mes yeux la voix même du roman, tissée d’une voix filtrée par mon subconscient et de toutes les voix. Dans le murmure de ce matin il y avait donc cette voix et ce souvenir-sensation lié à la guêpe de mon enfance, dont la piqûre au fond de la gorge a failli m’étouffer. Sans la Porsche rouge du bon docteur Croisier : j’étouffais. Le souvenir m’en est revenu à partir de la phrase surgie comme ça à fleur de sommeil: « Ce fut une année de guêpes », et cette image d’une pièce bleue remplie de guêpes et du débat me concernant : il n’a pas droit à l’insecticide, vu qu’on ne sait pas de quel subterfuge il est capable. Je me sentais en effet toléré dans cette maison, mais non sans défiance. J’étais en somme le corps étranger, comme la guêpe était le corps prisonnier de ma gorge, qui se débattait, piquait et piquait encore et crevait dans ce gouffre obscur, glissant et fleurant bon le sirop d’une gorge d’enfant.
14. J’envisage une construction semblable au découpage séquentiel du cinéma, en tout cas pour avancer, en me rappelant le risque de la trop sage juxtaposition style Nos frères farouches ou L’œil clair. Eviter l’album à vignettes. Le montage doit rester soumis au tempo de l’écriture. C’est l’obscur jaillissant qui a le dernier mot de la structure. Celle-ci n’est qu’un système de loupiotes, utile dans une narration de ce type. Dans Le viol de l’ange, la structure ternaire et le jeu numérologique n’étaient même pas des béquilles : plutôt des signes ironiques que je m’adressais en brassant ce magma chaotique qu’On me dictait tous les matins.
15. Clara ou le besoin de s’activer – mais on sent en elle un vide et une agitation intérieure qui expliquent en partie l’importance de son dossier dermatologique. Elle est impatiente à proportion du vide qu’elle sent en elle. Elle frotte et brique à proportion des saletés qu’elle a découvertes tout près d’elle et dont seul son compagnon défunt pourrait la consoler. Elle se dit : je suis seule à porter ma croix. Un lourd secret lié à l’un de ses fils. Clara la claire, et l’obscure. Marieke : la pénombreuse. Lena : l’allumée. Clara est l’active et la soucieuse, constamment active et soucieuse de mieux faire alors que tous lui conseillent le lâcher-prise. Mais c’est plus fort qu’elle : même au cours de yoga des aînés elle reste obnubilée par ceci ou cela qu’elle a négligé de faire ce matin. Or cette hyper-activité est évidemment compulsive, mais il n’y a pas que ça.
16. Toutes trois sont d’une génération qui a les pieds sur terre (selon l’expression de Clara), qui fait face et sublime. Ou plutôt que de génération, c’est d’une société qu’il s’agit : de l’Europe d’entre-deux-guerres.
17. Les séquences de la première partie, toutes concentrées sur le 14 juin 1999, se distribuent comme suit : 1) Au Denantou. 2) Sur l’Italie. 3) Le souk de Brahim. 4) Place de la République. 5) Vieillir. 6) Les nudistes. 7) La femme du vent. 8) Château d’Ouchy. 9) Le fiston. 10) Ceux de la 6. 11) Dernières nouvelles de Juanito (Scrabble). 12) Au théâtre. 13) Spectateurs. 14) Une belle journée (Clara). 15) Murmures de Marieke. 16) Claus en Oncle Vania. 17) De la jeunesse. 18) Confidences d’un DJ. 19) Portraits de famille. 20) Insomnie. 21) Le cahier jaune. 22) Au bar du théâtre. 23) Mère et fils. 24) Une belle journée (Marieke). 25) Le vieux Simon. 26) Un dernier verre. 27) En pensée avec Lena. 28) Le mur. 29) Ce que savent les maisons. 30) Téléphonie occulte. 31) Ce que disent les rues. 32) Triple dose. 33) Le sommeil de Marieke.
18. De Marieke qui a le plus vécu on n’en apprendra qu’une infime partie, l’important étant ce qu’elle a filtré et d’où vient son savoir humain. Pourtant il m’importe de noter quelques détails, qui apparaîtront dans le roman ou non. Et d’abord que Marieke débarque d’Amsterdam au sortir de la guerre, avec une première vie derrière, deux enfants avortés et un premier blindage de méfiance à l’égard des hommes. Surtout elle rêve de Sud. Son idée est le Midi, si possible la Provence, mais elle manque de tout à ce moment-là. Par Lausanne dont elle découvre une première fois la rive du lac, elle gagne la Suisse dite primitive via Lucerne où un jeune marchand de casseroles auquel elle a proposé des timbres de collection (sa fortune présente) dans le train, l’accueille dans la ferme familiale où elle passe la nuit. Elle se rappellera toujours le fumier tressé, les oreillers remplis de noyaux de cerises et la pièce de cinq francs que lui a remise Frau Hilfiger au moment de leurs adieux. Le même jour elle arrive au bord du lac d’Ägeri où se trouve la pension pour enfants de nantis du Docteur Jawohl (c’est ainsi qu’elle le surnomme aussitôt) où elle est supposée faire le ménage, et dont le climat austère à l’excès la glace. Seul le Docteur l’amuse et la soutiendra dans les jours à venir. Le travail harassant qu’elle abat du matin au soir donne pleine satisfaction, d’autant que, le soir, elle s’attarde longuement auprès des enfants, ce qui lui gagne l’attention et l’affection du Dr Jawohl, pédiatre et pédagogue qui ne jure que par Pestalozzi. Le seul répit que trouve Marieke consiste en la rédaction quotidienne de ses impressions, qu’elle consigne dans ses lettres à son frère artiste Anton et à son amie Hella. Le désir de quitter ces lieux froids la tenaille après quelques semaines et le chef de la police locale, rencontré à l’auberge, promet de lui faciliter son transfert en Suisse française, où elle arrive avec quelques francs en poche. Une dame Miauton la recueille quelques jours, qui place les jeunes filles au pair et lui trouve un poste de sommelière dans un café de l’arrière-pays. C’est là qu’elle rencontrera le lieutenant Verrières, dont elle rabat le caquet de grande gueule avec autant de vigueur qu’elle repousse les avances des clients du café. Là encore, elle séduit le maître de maison habitué à voir ses serveuses passer d’un homme à l’autre, et son fichu caractère épate le lieutenant. De ses lettres à Anton de ces semaines, il ressort qu’elle s’impatiente de quitter ce trou de province aux philistins bornés. Le lieutenant Verrières assiège sa forteresse et lui propose de partager sa vie, mais elle gagne alors le Tessin avec ses économies de quelques mois. Cependant il pleut au Tessin, et quelque chose la fait revenir au lieutenant Verrières, qui lui semble réellement épris et décidé à se ranger des cavalcades. Après quoi Marieke se fiance, se marie, enfante à deux reprises et vit cinquante ans de plus. De tout cela n’apparaissant que des bribes dans ses rares récits à Clara et Lena, qui la cuisinent le plus souvent en vain, lui prêtant une vie de bohème ou dieu sait quoi. Elles en sauront beaucoup plus en revanche sur les tribulations de son fils, le plasticien anarchiste bien connu pour ses interventions subversives dans les milieux de l’art et de la politique…
19. La Suisse dans laquelle débarque Marieke est un pays en noir et blanc. Les hommes sont encore aux frontières (dans leurs têtes) et l’on y trouve de nombreux internés, dont les Polonais, les Français et les tuberculeux. Clara est déjà mère de deux enfants et, avec Andreas, pense à construire. Il y a des subventions pour le baby boom. Les parents de Clara les aideront. Clara est décidée à lutter, comme elle le rappellera jusqu’à la fin. Sa bicyclette ne dispose que d’une vitesse.
20. Les séquences de la deuxième partie, dont la majeure partie touche au voyage en Egypte des trois bonnes dames, au printemps 2000, se distribuent comme suit : 1) L’Offre Spéciale. 2) A la Croix-Fédérale . 3) Préparatifs. 4) Vol Swissair K7306. 5) Herr Doktor Fröhlich. 6. Le monde vu d’avion. 7) Le vent du soir. 8) Hôtel Osiris. 9) L’homme en morceaux. 10) Les felouquiers. Rêverie au bord du Nil. 11. Good night, sleep well. Souvenir de Grossvater au Royal du Caire. 12) Trois femmes dans la rue. 13) La bande de Saïd. 14) Négociation I. 15) Le taxi de Saïd. 16) Vallée des Rois. 17) Saïd. 18) La maison de Saïd. 19) Clair de lune. 20) Négociation II. 21) Continental Breakfast. 22) La chute. Première défaillance de Clara. 23) L’Américain. 24) Au souk. 25) Mélancolie. 26) Chez Omar. 27. Nos voyages et nos rivages. 28) Diapositives. 29) L’amour du Sud. 30) Très mauvaise nouvelle. 31) La gisante. 32) La Barque de la Nuit. 33) A la cafétéria.
21. Plus je vais et plus je me dis que le roman est pour moi la meilleure mise à distance, dans le plus juste rapport, enfin le roman : j’entends la fiction et la narration, la transposition même légère de ce qui a été vécu et de ce qu’on tend à partager le mieux possible. La lecture quotidienne de Proust, et ces jours plus précisément les démêlés de Charlus et de Morel évoqués au fil du voyage du Narrateur en petit train normand, me fait percevoir chaque jour un peu mieux cette bonne distance et ce juste rapport. Le romancier y est un peu comme un montreur d’ombres, à la fois tout proche et se faisant oublier par la magie du jeu, cela me rappelle à la fois le regard latéral d’Alfred Hitchcock et le dédoublement de Philip Roth en Zuckerman, la projection à distance variable de Boualem Sansal dans Le serment des barbares ou Dis-moi le paradis, enfin toutes ces modulations qui font du roman, ou disons plus généralement de la fiction, le filtre de la réalité et l’instrument d’une meilleure connaissance de celle-ci.
22. La troisième partie des Bonnes dames ne sera faite que de discours indirects et sous toutes les formes de la communication à distance, à l’exception d’une seule rencontre de Marieke et Lena à Sils-Maria et Soglio. Après la mort de Clara, Lena a recueilli un Cahier jaune dans lequel sa sœur a consigné ses douleurs secrètes depuis le début de la maladie de Paul-Louis, son conjoint. Des éléments de ce cahier fonderont la présence de Clara dans la troisième partie du roman, Lena ayant confié quelque temps ce journal intime à Marieke. Les douleurs de Clara font ressurgir celles de Marieke, informulées jusque-là.
23. Le roman s’inscrit dans la mémoire par le truchement d’objets, usuels ou symboliques. Ce peut être un sac à main ou ne certaine façon de renifler. L’idéal serait de pouvoir identifier le personnage à la seule mention de l’objet. Le cliché en la matière : l’imper de l’inspecteur Columbo et sa façon de lever une main lorsqu’il feint de se rappeler soudain quelque chose.
24. Dès qu’Elizabeth Costello apparaît dans L’homme au ralenti, le dernier roman de J.M. Coetzee, quelque chose se passe. Costello est à la fois le deus ex machina et la figure de l’intrus, la mère du récit et la vie, ou la mort, du protagoniste qui se sent lui-même un pantin manipulé, sans cesser de jouer sa partie pour autant. Et tout devient tout de suite plus réel dès qu’elle est là, cette peste.
25. Le souk d’Ousmane Boubacar le Sénégalais se compose, à part les babioles à touristes, statuettes pur Dogon fabriqués à Taiwan, de Senteurs, Saveurs & autres Sentences qu’il a lui-même recopiées dans les livres. Clara est fort impressionnée au premier chef, puis elle se détend au vu de la jovialité du personnage, qui la fait parler de sa sœur Lena, naguère très active aux Missions.
26. Ce qui sauve Clara est son humour. Cela lui reste d’une certaine Suisse terrienne et populaire. Elle a le sens du grotesque aussi, et le goût du cocasse. Elle ne sera jamais supérieure ou suffisante, jamais niaise non plus.
27. Clara se rend compte du fait qu’elle n’a jamais adressé la parole à aucun Noir, et qu’en somme il reste en elle une certaine peur à cet égard. Or ce qui la stupéfie est de constater que la personne d’Ousmane lui fait oublier complètement la couleur de sa peau.
28. Clara et Marieke se sont rencontrées par hasard, mais plus elles y pensent, chacune de son côté, plus elles conviennent qu’elles y étaient disposées à ce moment précis et que la vie les a, en quelque sorte, confiées l’une à l’autre.
29. La vérité, rien que la vérité, mais pas toute la vérité, ou disons plus précisément : pas livrée comme ça, jamais énoncée sans modulation préalable ou sans nécessité narrative. Plus exactement alors : un corps incarné en vérité ou une musique qui sonnerait vrai dans la moindre de ses parties.
30. Le thème des retrouvailles, comme celui de la rencontre, est à mes yeux un ressort important.
31. Ce qui intéresse le romancier chez les bonnes dames, c’est leur simplicité et leur dédain des chichis et des formes, des convenances et des conventions, chez Marieke surtout, non sans nuances pour autant que fait ressortir l’extravagance de la Comtesse. Laquelle se permet ce que personne ne se permet, du seul fait de son âge et de ses désillusions dûment théâtralisées – la Comtesse qui s’est ruinée et refaite au casino d’Evian, la Comtesse aux sept maris qui recommande à Loulou de bien s’occuper de son Jules parce qu’un Jules on n’en a qu’un dans la vie, etc.
32. Loulou, fille de Marieke, est donc la mère des jumelles Dolly et Molly, surnoms de Délie et Mélie.
33. Le côté de Marieke est le côté bohème, tandis que le côté de Clara est celui de la Suisse propre en ordre que toutes deux, au demeurant, raillent de concert.
34. Marieke persifle volontiers la Suisse tiptop, mais Clara ne le prend pas pour elle-même, d’ailleurs il n’y a pas de raison, son conjoint et elle ayant toujours abhorré le style nain de jardin. Le nom de leur maison, Petite Maison, est un signe de malice, lié à un certain secret amoureux entre eux deux.
35. Le Sénégalais a été successivement armailli dans les Préalpes vaudoises, pêcheur de corail avec le fils de Marieke et jardinier de la commune d’Abondance où il peaufine sa thèse sur Leopold Sedar Senghor le Poète Président.
36. Tout doit s’étoffer et se colorer de manière plus fruitée et savoureuse à tous les sens des sens. Aller pour cela sur les lieux. Chercher les mots dans les rues et sur les arbres. Mieux regarder les choses et les gens.
37. Diatribes de Marieke, dont le discours s‘enfle et s’enflamme comme s’enflait et s’enflammait le discours du citoyen Rousseau cheminant par les monts et les vaux.
38. Comme en peinture, il y a ce que dit la nature, et ce que dit la toile.
39. Le travail de ce roman est essentiellement une affaire de rythme. Il ne s’y passe à peu près rien, si ce n’est trois fois trois p’tits tours et s’en vont les bonnes dames, autour du lac, autour de Louksor et du Nil, puis autour d’une tombe fraîche, après la mort de Clara. Cependant l’impression doit être que tout pulse et que tout vibre et vibrionne comme dans une volière.
40. « Je n’ai plus toute ma tête », se plaint Marieke, à laquelle Clara fait valoir qu’elle devrait se réjouir de couper à l’Alzheimer. Clara console toujours les autres, à la manière de Pollyana, en leur faisant valoir un malheur bien pire que le leur, le Sahel ou le Rwanda…
41. Travailler par couches successives, comme en peinture. Je ne sais rien d’elles à la base, ou plus exactement : ce que je sais d’elles apparaît dans le seul mouvement d’émergence et de cristallisation du texte, de la phrase vivante qui représente à tout coup un segment du corps vivant du texte.
42. Les temps multiples de la narration marquent, entre autres, la constante variation des points de vue de la Narration. Plus que d’un Narrateur, je parlerais en effet pour ce roman de La Narration, comme une instance poreuse aux pouvoirs à la fois diffus et super-précis…
43. La philosophie de Clara est donc globalement celle de Pollyana, qui consiste à se réjouir, à chaque fois qu’on prend une tuile, de ne pas en prendre deux, et ainsi de suite. Ce qui ne va pas sans exaspérer Marieke, laquelle n’est pas du genre à se résigner non plus qu’à se voiler la face devant l’horreur de la réalité. Un débat vif peut donc s’ensuivre.
44. La figure du Nain Suissaud, qui a fait la célébrité controversée de l’Apache (dit aussi le tagueur insaisissable, fils chéri de Marieke poursuivi pour ses tags contestataires et ses actions critiques de toutes espèces), est un personnage référentiel dans le discours des bonnes dames, à la fois sujet de dispute (Clara ne peut donner raison à un anarchiste fauteur de déprédations) et de discussions complices.
45. Le signe que le roman se fait, c’est qu’on y pense tout le temps.
46. Il y a quelque chose de Basquiat dans les tags de l’Apache, mais en plus élaboré, en moins faussement brut, en plus parodique aussi. L’Apache est un authentique artiste virtuel, qui pense en matériaux et en formats divers, sans réaliser jamais hors de ses seuls carnets.
47. « Je suis le dernier des Mohicans », pourrait dire l’Apache. Un jour un mécène de l’industrie automobile et de la culture lui a proposé de le mettre sous contrat. Comme ce qu’il en a été de toutes les propositions des plus fameuses galeries, Tim a poliment décliné.
48. « Nous ne sommes pas une famille mais un clan, du genre tartare, ou une tribu, style apache ou cheyenne, enfin un petit groupe de gens qui se tiennent les coudes... » (Marieke dixit)
49. Attention à traiter tous les personnages d’une même encre, avec la même légèreté passante, sans peser. Rien là-dedans de la satire, en dépit de multiples aspects critiques et caustiques. Rien du roman psychologique non plus, malgré la psychologie très différenciée de chaque personnage. Pas un roman poétique non plus, quoique la poésie y soit. Surtout alors : un roman allant, un récit qui va de l’avant, une phrase qui roule.
50. Le dévoilement de chaque personnage se fait avec le temps. Rien ne doit être livré prématurément, sans nécessité narrative formelle. C’est une logique sous-jacente à observer très rigoureusement. Tim et Loulou, ou les jumelles, Lena ou Pablo, et tous les autres, vont faire leurs trois p’tits tours au fil du récit, chacun son quart d’heure de célébrité, trois p’tits tours et puis s’en iront – d’ellipse en éclipse.
51. Dès lors que le roman devient un plaisir, c’est qu’il est en train de prendre, à partir de quoi tout coule plus ou moins de source, tout devenant à la fois plus léger et plus juste - tout prenant véritablement consistance et forme. Alors on sent qu’on pourrait écrire du matin au soir, mais non : on va plutôt prendre son temps, qui est celui-là même du roman.
52. Au premier canevas se substituent peu à peu de nouveaux développements et autres variantes, procédant de la logique organique du roman, qui pousse où il veut. Le meilleur exemple en est l’apparition du Capitaine sur sa périssoire, qui annonce le thème de la Barque égyptienne des morts.
53. Clara se raccroche aux formules morales, dans la pure tradition protestante qu’illustre sa famille par alliance. God is my copilot pourrait en être un exemple, tiré des sermons du pasteur Amédée, lequel lui est toujours de bon conseil, genre Compagnon de Taizé. Dans le trolleybus No 6 elle a l’impression de vivre la métaphore de la vie. Nous montons parce que le véhicule est en contact avec le Courant - ce genre de choses. Elle incarne un certain pragmatisme chrétien assez typique, qui procède par trucs & recettes, mais avec des ouverture possibles, et des ruptures de tonus lui ouvrant des gouffres, liés à sa solitude.
54. Le passage à l’imparfait agit comme un zoom arrière, équivalent d’une mise à distance mentale.
55. Attention aux rimes intérieures. C’est vraiment la cheville à éviter, la ponctuation non désirée de la narration.
56. J’ai finalement modifié le rapport de Marieke et Clara, qui se connaissaient bien avant de se retrouver, par le truchement de leurs familles alliées. Sans tirer la narration du côté de l’autofiction, il m’importe de la recentrer par rapport à un sentiment personnel intense de leurs rapports et de leurs positions généalogiques respectives. Elles sont liées par les jumelles et par les parents des jumelles, leurs enfants respectifs. Plus intéressant : le fait qu’elles se redécouvrent « par hasard », alors qu’elles sont parentes. Situation typique d’aujourd’hui, relevant de la recomposition filiale.
57. Dans le même esprit, j’ai simplifié la figure du fils de Marieke, Adalbert dit l’Apache par les médias. N’apparaîtra que par réfraction, comme celui avec lequel on ne cesse de se chamailler tout en l’aimant fort. Le frère de Loulou a passé par la taule : cela du moins est important pour Marieke, qui parle la nuit au Capitaine.
58. Après avoir bouclé le récit de la virée en Savoie lacustre, je me suis aperçu que le soleil tombait beaucoup trop tôt pour un 14 juin. Toute la suite en a été faussée, de sorte qu’il faisait déjà nuit à six heures alors que la nuit ne tombe à cette saison que vers dix heures. Ajustement nécessaire, avec l’interversion de deux chapitres…
59. Ce que dit Alain Cavalier à propos du passage d’un plan à l’autre, au cinéma, est aussi valable, d’une certaine façon, pour le passage d’un paragraphe à l’autre dans ce type de récit elliptique qui saute une idée sur deux.
60. Ce qui me semble caractériser les bonnes dames, à l’égard du monde actuel, est leur foncière timidité.
61. J’ai finalement renoncé à la « construction » du personnage de l’Apache, décidément trop artificielle. Ce sera simplement le fils aîné et aimé, avec lequel Marieke ne cesse de se chamailler et dont ne sait que deux ou trois choses, à commencer par le fait qu’il a fait de la taule.
62. Clara peut recourir à la messagerie du Mac que lui a installé Joselito, dit le Petit, et communiquer ainsi avec Lena qui se trouve en Alberta jusqu’à la fin de la première partie, mais le meilleur moyen de communiquer entre elles est encore la transmission de pensées que leur ménage le romancier dans la dernière séquence de la première partie, intitulée Les voix de la nuit.
63. Les bonnes dames sont ainsi mises en réseau de manière occulte, si l’on peut dire, avant de se retrouver en trio pour la virée en Egypte de la deuxième partie.
64. La dernière séquence de la première partie se distingue en cela qu’elle illustre les virtualités du roman, qui va plus vite que le téléphone et le mail. On communique immédiatement d’auteur à lecteur. Le thème en était déjà très présent dans Le viol de l’ange, repris ici sur un ton plus débonnaire.
65. Mes bonnes dames m’aident à réfléchir et à m’expliquer diverses choses de la vie et des âges, ou sur les thèmes qui m’intéressent en l’occurrence, du tabou et de la permission, de l’adoption et de l’amitié, etc.
66. Elles sont à l’âge où l’on peut dire à peu près ce qu’on veut, sans barrière. Elles n’ont plus de raison de se censurer. Rappel de la Comtesse. Pour autant elles ne se permettent pas n’importe quoi, gardant une certaine tenue.
67. L’histoire qu’on se raconte n’est jamais celle qui se raconte au fil des mots. Il y a une part d’aléatoire dans le roman qui est aussi (et peut-être surtout) celle du subconscient. Où tout cela va-t-il ? C’est ce que tu ne découvres qu’en écrivant.
68. Lena est habitée par une indéfectible confiance en la bonne volonté. Elle croit que le monde est à réparer et qu’il faut s’y mettre tous les jours. Elle n’aime pas les grands mots ni les notions trop abstraites, pas plus que Clara. Mais elle n’en a pas moins sa philosophie de la vie.
69. Le narrateur est partout, sous la forme d’un « je » flottant.
70.La dernière séquence de la première partie, intitulée Les voix de la nuit, contient en germe la deuxième et la troisième partie du roman, l’Egypte et tout ce qui touche à la fois à la mort et à ce qui se devine par delà les eaux sombres.
71. Marieke retrouve, entre deux sommeils, les notions égyptiennes qu’elle tient d’un opuscule que lui a filé son fils, à propos de la pesée de l’âme et du jugement qui s’ensuit. Au soir le dieu Aton, vieilli par la journée, conduit vers l’Ouest la barque du soleil, pendant que Nout la déesse du ciel fait voûte au-dessus des dormeuses. Le soleil va passer par les douze portes du monde souterrain, mis a l’épreuve du grand serpent Apophis, symbole du néant de toute chose. Marieke se rappelle que les Egyptiens associent la beauté au sacrement de chaque chose et de chaque être. Ils se représentent qu’à l’instant de la mort le cœur du défunt est pesé sur une balance dont le second plateau porte une plume tirée de la chevelure de la déesse Maât, déesse de la vérité. Marieke a conscience du fait que le cœur du défunt doit s’alléger jusqu’à l’équilibre de la balance, pour couper à la dévoreuse d’ame à figure de crocodile.
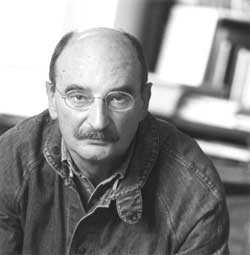

 Le dernier souvenir que je garde de Zouc est un pur moment d’âpre émotion, il doit bien y avoir vingt ans de ça, au Théâtre Municipal, dans sa bouleversante traversée de vies fracassées. Ce n’était pas la Zouc enjouée mais la fille du bord des gouffres à la manière helvète sauvage, proche de Louis Soutter et de Robert Walser. On conçoit que de celle-ci, Nathalie Baye ne puisse rien restituer. Reste un nom qui fait tilt comme le nom de Baye fait tilt pour les pipoles, et le nom de Guibert.
Le dernier souvenir que je garde de Zouc est un pur moment d’âpre émotion, il doit bien y avoir vingt ans de ça, au Théâtre Municipal, dans sa bouleversante traversée de vies fracassées. Ce n’était pas la Zouc enjouée mais la fille du bord des gouffres à la manière helvète sauvage, proche de Louis Soutter et de Robert Walser. On conçoit que de celle-ci, Nathalie Baye ne puisse rien restituer. Reste un nom qui fait tilt comme le nom de Baye fait tilt pour les pipoles, et le nom de Guibert. Guibert, Zouc et Godard procèdent par collage, comme Fellini et Montaigne aussi. Drôle de mélange, mais ça me botte de couper du bois en laissant tourner JLG sur le magnétoscope et en relisant de loin en loin, slurpant un café dans la foulée, des pages de Fou de Vincent de Guibert, ce si beau patchwork de fragments amoureux obscènes et doux.
Guibert, Zouc et Godard procèdent par collage, comme Fellini et Montaigne aussi. Drôle de mélange, mais ça me botte de couper du bois en laissant tourner JLG sur le magnétoscope et en relisant de loin en loin, slurpant un café dans la foulée, des pages de Fou de Vincent de Guibert, ce si beau patchwork de fragments amoureux obscènes et doux.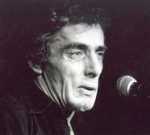 J’étais hier soir au cabaret de L’Esprit frappeur où passaient le blond Riquet houppé Thierry Romanens, le charme zazou et le talent doux-acide jeté en personne, puis l’immense Allain Leprest, toujours au bord de s’effondrer mais ouvrant tout grand son ciel d’âme pure.
J’étais hier soir au cabaret de L’Esprit frappeur où passaient le blond Riquet houppé Thierry Romanens, le charme zazou et le talent doux-acide jeté en personne, puis l’immense Allain Leprest, toujours au bord de s’effondrer mais ouvrant tout grand son ciel d’âme pure.

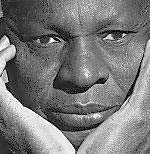
 Notes à la volée
Notes à la volée