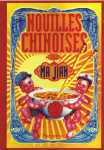L’Italie sauvage du groupe Assurd
« L’Italie du sud, vous savez, c’est déjà l’Afrique ! », lance Cristina Vetrone au fil de ses présentations pleines de verve, et les meilleures preuves en sont ses propres transes, son accordéon frénétique et sa formidable voix presque masculine rappelant les meilleure interprètes napolitains de la mythique Nuova compagnia di canto popolare, à quoi s’ajoutent les présences non moins incendiaires de Lorella Monti, à la voix plus « bel cantesque » et sensuelle, ou de la plantureuse Enzia Prestia au tambourin d’enfer.
Entre berceuses pour messieurs (sic) et tarentelles endiablées, chansons savoureuses des femmes du Mezzogiorno réglant leur compte, sur l’oreiller, aux « civilisateurs » du Nord emmenés par Garibaldi, ou évocations plus récentes des splendides Noirs américains débarquant en libérateurs sur la péninsule pour y semer des jolis enfants, le trio d’Assurd (un groupe formé en 1993, jouant aussi en quatuor) pratique la « chronique » chantée et dansée dans la meilleure tradition populaire italienne, telle que la perpétue aussi un Eduardo Bennato, avec lequel les luronnes ont d’ailleurs affûté leur art.
Sacré coup de boule dans le coffre. « Una vera zidanata ! »
-
-
L’injure faite à Zidane

La version du Guardian
Selon le quotidien anglais The Guardian, le litige opposant le défenseur italien Marco Materazzi et le capitaine français Zinedine Zidane, qui s'est soldé par un terrible coup de tête assené par Zidane, et qui a valu au meneur de jeu tricolore un carton rouge, se serait déroulé de la sorte: suite à une action française non fructueuse, et alors que les Italiens avaient récupéré le ballon et avaient débuté une contre-attaque, seuls quelques joueurs demeuraient dans la surface de réparation italienne: David Trezeguet, Gennaro Gatuso, Zinedine Zidane, Marco Materazzi et le gardien Gianluca Buffon.
Zinedine Zidane avait été, au cours de l'action précédente, très strictement surveillé par Marco Materazzi, qui le ceinturait fermement des deux bras, et lui tiraillait le maillot. Le ballon a été pris par Del Piero, et se trouvait déjà à ce moment au-delà du milieu de terrain. Les caméras live ont alors complètement déserté la scène où le litige a eu lieu. Mais pas les caméras off…
Tout au long de la rencontre, Marco Materazzi, qui était chargé desurveiller Zidane dans la surface de réparation, avait apparemment continuellement matraqué le capitaine français de paroles indélicates, voire même injurieuses, que le milieu de terrain français a longtemps fait mine de négliger.
Toutefois, après cette séquence, Zidane a signalé à Materazzi, en lui montrant la manche de son maillot: « Arrête de me tirer ! » Déclaration à laquelle Materazzi a répondu : « Tacci, enculo, hai solamente cio che merite..." (Tais toi enculé, tu n’as que ce que tu mérites...)
C'est à ce moment que Zidane s'est éloigné quelque peu du défenseur italien, qui aurait poursuivi, dans son dos: « Meritate tutti ciò, voi enculati di musulmani, sporchi terroristici" (vous méritez tous ça, vous les enculés de musulmans, sales terroristes)
C'est alors que Zidane, désabusé, fatigué, mentalement fragilisé, a porté son terrible coup de tête au torse du défenseur italien…
Nota bene : cette version est invérifiée pour l’heure. A suivre…Zinedine Zidane: "Mais dans quelle galère me suis-je embarqué sur ce coup de tête ?!"
-
Gondole de rentrée
Notes avant parution
La vague précédente n’est pas retombée que déjà la prochaine déferle avec, en point de mire, 683 nouveaux romans à paraître à l’automne. Des piles de livres ne cessant de s'amonceler, je tirerai sept titres après sept autres, d’abord en survol puis de manière plus détaillée. Or tel est mon premier choix :
1. Christophe Bataille. Quartier général du bruit. Grasset, 115p. Révélé par Annam, un premier roman paru chez Arléa et aussitôt distingué (prix du Premier roman et prix des Deux Magots, 1994), l’auteur a de la patte et l’on est curieux de le voir évoquer ici la figure de Bernard Grasset sous le regard d’un certain Kobald, à la grande époque des Saints-Pères.
2. Annie Saumont. Qu’est-ce qu’il y a dans la rue qui t’intéresse tellement ? Joëlle Losfeld, 77p. Par la nouvelliste la plus abondante et parfois la plus attachante « au niveau du quotidien », un nouveau petit recueil en forme de triptyque.
3. Jean-Marc Roberts. Cinquante ans passés. Grasset, 103p. L’auteur, directeur littéraire de Stock, est lui aussi un écrivain racé, qui dit bien les choses de la vie, comme on dit, avec la nonchalante complaisance des désabusés
4. Alain Mabanckou. Mémoires de porc-épic. Seuil, 229p. Après Verre cassé , l’auteur congolais le plus en vue du moment à Paris poursuit une œuvre alternant la pleine pâte du roman et les pointes de la réflexion. Il réinvestit ici l’esprit du conte à la manière africaine.
5. Pierre Charras. Bonne nuit, doux prince. Mercure de France, 115p. Dans un texte de pure sensibilité, voilé de pudeur, l’auteur de Comédien (prix Valery Larbaud 2000) rend ici un bel hommage à son père, du genre à ne jamais se mettre en avant.
6. Ariel Kenig. La pause. Denoël, 145p. Son premier roman, Camping Atlantic, s’était distingué du tout-venant de l’an dernier par son écriture mordante et sa façon de moduler la révolte sensuelle d’un adolescent. Du camping, on passe ici à la cité HLM.
7. Nancy Huston. Lignes de faille. Actes Sud, 487p. C’est le roman dont, pour ma part, j’attends le plus dans la nouvelle donne. Après son fameux Professeurs de désespoir, la romancière traverse un demi-siècle d’histoire contemporaine en entrecroisant les voix de quatre enfants (Sol, Randall, Sadie et Kristina) dont chacun est le parent du précédent.
-
Lectures de rentrée (2)

Qu’est-ce qu’il y a dans la rue qui t’intéresse tellement ?, trois nouvelles d’Annie Saumont
Annie Saumont, nouvelliste remarquable dont l’œuvre (couronnée par l’Académie française en 2003) se constitue en fresque kaléidoscopique de la vie des gens ordinaires, n’a pas son pareil pour saisir, à fleur de mots et de formules toutes faites, la détresse et le désir de s’échapper de ses personnages, le plus souvent pris au piège.
Le meilleur exemple en est l’homme résigné de la première nouvelle, éponyme, de ce triptyque, littéralement encagé par les petites phrases de sa femme, du genre « qu’est-ce que tu regardes ? », « tu as des pellicules j’en parlerai au pharmacien », « tu n’écoutes rien », « tu mangeras aussi une petite grillade c’est facile d’être raisonnable », et qui se rappelle de radieuses scènes de sa jeunesse en regardant par la fenêtre.
Sans peser, avec des ellipses qui supposent l’attention vive et même la participation active du lecteur, l’écrivain s’attache à capter les divers réseaux de parole qui s’entrecroisent, ici de l’épouse au sens pratique écrasant, de l’homme qui aimerait tant décider quelque chose mais n’en a plus l’énergie, de ce qu’on pourrait dire le langage des choses et de la poésie suggérant une autre vie plus harmonieuse et plus claire.
Ou c‘est, dans le métro (Ce serait un dimanche), Thérèse qui évoque in petto sa vie de paumée avec Ada, entre petits négoces de couture et petites fauches, sales mecs comme son père qui tentait de la forcer, échappées de tout ce qui pourrait advenir un dimanche au conditionnel des chimères et retour au foyer des sœurs de la Pitié. Enfin c’est (dans Méandres) le soliloque lancinant d’un homme que blesse la vulgarité du monde, et qui revient dans la ville de son enfance après un long séjour en prison.
A chaque fois, l’art de la nouvelliste aboutit, à sa manière très particulière où tout semble vocalisé « mentalement » sans rien perdre de sa densité physique et de sa charge émotionnelle, à restituer trois univers plombés par le poids du monde, avec autant de douce attention que d’âpre lucidité.
Annie Saumont. Qu’est-ce qu’il y a dans la rue qui t’intéresse tellement ? Editions Joëlle Losfeld, 77p. Ce recueil est déjà disponible en librairie.
-
La jungle des lois

La défense Lincoln de Michael Connelly
C’est un Connelly de grande cuvée que nous vaut le nouveau roman de l’auteur du Poète, de Créance de sang ou de L’oiseau des ténèbres, pour ne citer que trois des meilleurs d’une quinzaine de thrillers d’investigation de premier ordre qui ont tous le grand labyrinthe de Los Angeles pour creuset maléfique et non moins splendide toile de fond à la Michael Mann…
Comme dans L’envol des anges, et bien plus encore à vrai dire, l’univers « trop humain » de la justice – à savoir tissé de règles et de deals aussi tordus que dans toutes les sphères sociales de la galaxie urbaine de L.A. – constitue l’arrière-fond du roman, dont le protagoniste est un avocat aussi roué que mal vu de ses confrères, digne fils d’un ponte du barreau déjà porté sur la défense des plus paumés, et n’ayant (à ses propres yeux) qu’un gros regret à remâcher, lié à la condamnation à perpète d’un probable innocent, quelques années plus tôt.
Lorsqu’un autre prétendu innocent, fils à maman cousu de dollars qu’on accuse de viol et de tentative de meurtre, recourt à lui pour sa défense, Mickey Haller l’accepte d’autant plus volontiers que ce client est du genre « pactole », dont la cause très délicate va nécessiter autant de ruses que d’acrobaties et donc autant de dizaines puis de centaines de milliers de dollars.
Le premier intérêt de La défense Lincoln est alors, avec la clarté et la saisissante densité propres à l’auteur, la description détaillée des coulisses de la justice pénale américaine vues par un avocat un peu voyou en apparence mais plutôt du genre « humaniste », comme l’était le fameux inspecteur Bosch du même Connelly, et non moins attachant à vrai dire.
Cette même dimension « humaniste » prédomine d’ailleurs dans la partie la plus importante du roman, qui nous confronte au mal incarné en la personne de celui-là même que Michael est censé défendre – ce qu’il va faire aussi bien jusqu'au fin bord du gouffre, mais c’en est déjà presque trop dit…
On n’est certes pas chez Dostoïevski ou Bernanos, mais il est rare qu’un thriller communique, au lecteur, des sentiments aussi complexes et profonds - mélange de révolte et de tristesse, de lucidité et de mélancolie, d’abjection et de tendresse -, que ceux qu’on éprouve chez Connelly (comme il en allait aussi des romans noirs de Robin Cook), alors même que les personnages et les situations s’en tiennent plus ou moins aux stéréotypes du genre, n’était le formidable paradoxe narratif de ce dernier roman.
Comme un James Ellroy ou un James Lee Burke, Michael Connelly est assurément un écrivain de très forte trempe, dont les livres ont autant de valeur documentaire que d’impact critique, baignant enfin dans une espèce de poésie urbaine assez fascinante. Bref, c’est de la belle, de la toute belle ouvrage que La défense Lincoln, mais prévoyez d’y passer la nuit blanche si vous y « tombez » après midi…
Michael Connelly. La défense Lincoln. Traduit de l’américain par Robert Pépin. Seuil Policiers, 333p.
-
Aux sources du fleuve

A propos de Congo River
C’est en somme le fleuve Humanité qu’on remonte dans Congo River, le film somptueusement déchirant de Thierry Michel dont les images restituent d’abord la splendeur des paysages que traverse le cours d’eau en serpentant (le dieu qu’il incarne est d’ailleurs un serpent) au milieu des immensités de savane et de brousse. Au cours de la lente et cependant très vivante première partie, correspondant à l’aval des rapides en direction desquels on remonte, l’on suit la progression d’un inénarrable train de barges sur lesquelles s’entasse la population d’un véritable village flottant, chèvres et cochons compris ; et tout aussitôt cela sent bon l’Afrique à plein nez.
En contrepoint à ces images de navigation sous la vigilante garde d’un Commandant incessamment attentif au travail des sondeurs, crainte du fatal ensablement, des fragments de trépidants documentaires de l’époque coloniale rappellent ce que fut celle-ci, avec son mélange de développement et de pillage organisé, sur fond de paternalisme bon teint à la Tintin au Congo…
Au terme de la première partie de cette remontée, marquée par telle tragédie « ordinaire » (plus de deux cents noyés imputables à l’incompétence d’une compagnie) ou telle manifestation d’évangélisation de masse durant laquelle un prêcheur en costume chic fait cracher le dollar aux ouailles classées selon leurs ressources financières (plus tu allonges, plus tes péchés seront allégés, ma sœur mon frère…), le film change de tonalité avec l’apparition, à la hauteur des cataractes, des premiers militaires égrenant leurs chants guerriers. Et c’est alors, en crescendo, la progression vers le cœur des ténèbres, de champs de croix en villages abandonnés où rôde encore le spectre de la terreur, jusqu’à ce dispensaire où se retrouvent des milliers de femmes violées dont les tribulations se trouvent détaillées par un médecin colossal au parler délicat qui rend plus affreux encore ses insoutenables constats.
Rien pourtant d’accusateur ou de sentencieux, ni même de très explicatif dans ce voyage au bout de l’horreur dont tout est supposé connu, qu’on redécouvre ici par l’image, la hantise des choses qui sont là et des traces des êtres qui n’y sont plus - l’émotion nous prenant au ventre et à la gorge sans qu’aucun commentaire ne soit porté par l’emphase, la fin du film s'ouvrant d'ailleurs à un regain d'espérance, par la voix de l'archevêque de Kisangani.
Congo River s’achève enfin sur l'évocation d'un paradis terrestre avéré, avec la vision édénique d’une pièce d’eau dont les moires scintillent sous le feuillage lustral et poudroyant de lumière. Telle est la source du Congo. Tels sont les eaux et forêts. Tels sont les hommes. Telle est la vie...

-
Rire jaune de la Chine
Une satire carabinée de l’absurdité, entre communisme et capitalisme sauvage
De la Chine populaire actuelle, les affairistes et autres touristes occidentaux voudraient ne voir que ce qui les intéresse ou les fascine en passant, alors que le pays réel se débat entre les contraintes kafkaïennes de la fourmilière communiste et les soubresauts de plus en plus sauvages du capitalisme à tout-va. Or Ma Jian, exilé à Hong Kong en 1987, peu avant que ses livres soient interdits en Chine, et vivant aujourd’hui à Londres, est de ces observateurs cinglants qui, à partir des faits les plus ordinaires, parviennent à illustrer l’absurdité, le tragique et le comique d’une société à la fois paralysée et en pleine évolution. On pense d’ailleurs aux satires décapantes d’un Alexandre Zinoviev en suivant les tribulations des protagonistes de Nouilles chinoises, à commencer par la paire que forment l’écrivain et le donneur de sang. L’industrie que développe celui-ci, raté en puissance, qui va devenir millionnaire en se faisant pomper le sang, donne une première idée des situations extravagantes illustrées par Ma Jian. Lui-même a-t-il été tenté, comme son double ici présent, de figurer dans le Grand Dictionnaire des écrivais chinois à la condition d’ériger une statue littéraire à un quelconque Héros Positif ? On peut en douter… Dès les premières pages de Nouilles chinoises, le lecteur est en effet saisi par l’esprit sarcastique des séquences enchaînées à fond de train, dont l’apparente dérision (genre Reiser ou Deschiens, voire Bukowski le dégueu relooké style yeux bridés) va de pair avec la rage de l’exilé rêvant de son cher pays. De l’actrice « performant » son suicide sur la scène d’un cabaret, au patron de crématoire poussant à la consommation pour solutionner le problème de la surpopulation, il y a là-dedans de quoi rire… jaune à n’en plus pouvoir.
Ma Jian. Nouilles chinoises. Traduit de l’anglais par Constance de Saint-Mont. Flammarion, 236p.