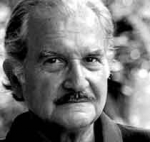
Sur Le siège de l'aigle de Carlos Fuentes
On est très vite entraîné dans le vif du dernier roman de Carlos Fuentes, par l’entremise d’une femme de tête, la cinquantaine et dans la haute politique mexicaine, qui drague épistolairement un fringant trentenaire qu’elle vient de rencontrer et qu’elle se propose d’aider à se mettre en selle avant de lui ouvrir son bunker privé. Cela se passe en 2020, alors que le président mexicain vient de damer le pion aux Américains en refusant de cautionner leur invasion de la Colombie et de s’opposer à la hausse du prix du pétrole. Par mesure de rétorsion, les USA ont coupé toute liaison entre le satellite qu’ils contrôlent et le Mexique, de sorte que celui-ci se trouve privé de toute forme de communication, obligeant les protagonistes du roman à s’exprimer par lettres. Et tout de suite ça vole très haut, c’est allant, dense et captivant. La grande silhouette de Machiavel ne tarde à se profiler à l’horizon, d’emblée les intrications de la passion du pouvoir et des menées humaines, sentimentales ou sexuelles, nourrissent ces vifs échanges, et ça y va. La distribution aligne donc Maria del Rosario Galvan, qui dit (entre autres) que le ressentiment est le vice national du Mexique et l’injustice l’écriture sacrée des terres latino-américaine; le jeune Nicolas Valdivia en lequel on pressent un Julien Sorel à dégaine de métis aussi séduisant de corps que d’esprit; ou encore Xavier Zaragoza dit Sénèque le conseiller du Président dont il flatte le « moi moral » tandis que son contraire, Tacito de la Canal, figure l’âme noire et servile de ces coulisses du théâtre d’Etat. Bref ça a l’air parti pour un beau grand roman de conjecture politique, dont les personnages sont immédiatement campés avec vigueur. On passera volontiers trois jours en leur compagnie, au lieu d’embêter la mère de Weyergans…
Carlos Fuentes. Le siège de l’aigle. Gallimard, 443p





 . Rencontre avec David Ayala.
. Rencontre avec David Ayala.
 La folle lucidité d’Artaud
La folle lucidité d’Artaud