
Lecture de Cosmos incorporated (4)
J’étais sur le point de laisser tomber. Dantec me semblait en train de se planter. A la page 264 de Cosmos incorporated j’ai buté sur cette phrase : «L’extension maximale du surpli dévoilé au « monde », l’expansion soudainement formatée de sa « conscience » au sein d’une matrice de signifiants ne surcodant plus qu’eux-mêmes, provoquaient en réaction une condensation infinie du point de rupture, c’est-à-dire le moment où tout dans son corps-esprit devenait point de rupture, le moment où le Néant-Être qu’elle était devenue faisait place à l’invasion globale du Monde, et de la souffrance – physique, psychique, absolue – qui lui est corrélative ».
Allais-je donc avaler cette sorte de galimatias ? Avant que je ne me décide à renvoyer Dantec à ses fumeuses cogitations, celles-ci se dissipaient soudain par un retournement du récit où tout, de la première partie du roman, allait prendre un sens nouveau, tandis que le voile se levait sur la genèse même et le projet du livre. Tout à coup on comprenait d’où venait le protagoniste, qui le guidait et à quoi rimait sa mission… On a dit que Faulkner consommait l’irruption de la tragédie grecque dans le roman noir. De la même façon, on pourrait dire que Cosmos incorporated marque la fusion du roman d’anticipation, de la contre-utopie polémique et de la mystique judéo-chrétienne.
Plus précisément on découvre, dans la seconde partie du roman, que celui-ci est né dans l’imagination fertile d’une jeune fille de feu tombée du ciel, née sur un Anneau orbital sis à 500 km de la terre, sérieusement versée dans les arcanes de la Tradition spirituelle, autant que son frère est imbibé de littérature, et qui a entrepris de créer un Golem avec la complicité momentanée d’un agent logiciel qu’elle baptise Métatron, ange gardien de Sergueï constituant la réplique futuriste du prophète biblique Enoch… Vous suivez camarade Fellow ?
Une fois encore, je ne suis pas très bon public en matière d’ésotérisme à la petite semaine, et guère non plus adepte de littérature mystico-politique, dans la lignée des René Guénon et autres Julius Evola. Mais Dantec est un fameux conteur combinant admirablement la part « naïve » de la SF populaire (avec intrigue, stéréotypes, décors et autres gadgets) et sa vision catastrophiste d’une humanité devenant machine-esclave d’elle-même, une interrogation latente sur le phénomène humain et la projection d’une nouvelle geste créatrice, où le récit de la Genèse (qu’il re-déchiffre avec pénétration, imaginant en outre que Dieu a créé l’écriture le huitième jour) se rejoue par l'homme-sacrifice Sergueï, mercenaire de métier voué à une nouvelle destinée d'homme libre...

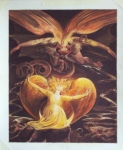 L’exergue de William Blake annonçait la couleur : « There is a Melancholy, O how lovely ‘tis, whose heaven is in the heavenly Mind, for she from heaven came, and where she goes heaven still doth follow her »… Et c’est ainsi qu’on parcourt un labyrinthe qu’on découvre initiatique au fur et à mesure que se précisent les signes et les symboles, comme sur un chemin de Damas, et l’on se rappelle aussi bien que Sergueï est soldat lui aussi, aux ordres de l’Ordre.
L’exergue de William Blake annonçait la couleur : « There is a Melancholy, O how lovely ‘tis, whose heaven is in the heavenly Mind, for she from heaven came, and where she goes heaven still doth follow her »… Et c’est ainsi qu’on parcourt un labyrinthe qu’on découvre initiatique au fur et à mesure que se précisent les signes et les symboles, comme sur un chemin de Damas, et l’on se rappelle aussi bien que Sergueï est soldat lui aussi, aux ordres de l’Ordre.

 dans Cosmos incorporated comme dans un cauchemar éveillé avec la sensation de participer psychiquement et physiquement à la genèse d’un espace-temps et d’un personnage se construisant à vue. D’emblée on ressent la même oppression que dans les premières pages de 1984, à cela près que la surveillance n’est pas ici que du Dehors bigbrotherisé mais de partout, puisqu’on vous scanne jusqu’à l’ADN et qu’on vous manipule du Dedans par contrôle et/ou injection d’information.
dans Cosmos incorporated comme dans un cauchemar éveillé avec la sensation de participer psychiquement et physiquement à la genèse d’un espace-temps et d’un personnage se construisant à vue. D’emblée on ressent la même oppression que dans les premières pages de 1984, à cela près que la surveillance n’est pas ici que du Dehors bigbrotherisé mais de partout, puisqu’on vous scanne jusqu’à l’ADN et qu’on vous manipule du Dedans par contrôle et/ou injection d’information.
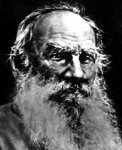
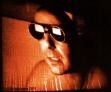
 e une vision que je suis impatient de voir se déployer…
e une vision que je suis impatient de voir se déployer…