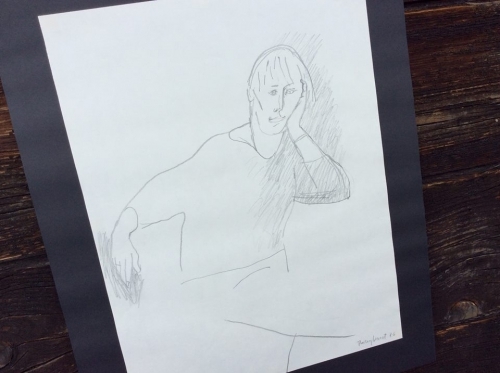
Portrait de Lady L. à la clope
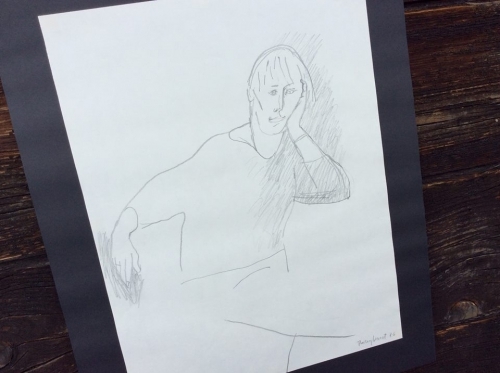
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
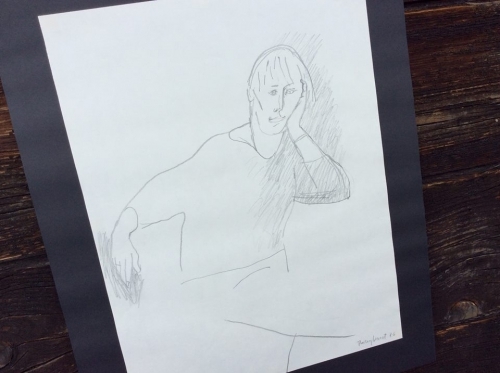

La question n’est pas de savoir s’il est plus élégant de patiner sur un iceberg ou sur un glacier de Terre de Feu : ce qui compte est le style qui s’y adapte à chaque fois.
Le style est un habitus: qu'on se le dise dans les églises. Le style n'est pas qu'une façon de parler ou de marcher sur les pieds du vulgum pecus: le style est une mesure exacte et la redistribution des générosités de la Nature dûment transformées. Le style est un savoir-boire et sans rêver tu oublies. Le style est l'art de l'oubli porté au biseau de la Mémoire.
Au bar, plus directement, le style découle aussi de sa capacité d'improviser selon l'immémoriale Tradition des banquises bipolaires et autres décors d'aurores boréales, car tout dépend à la fois d'un bon métier et des surfaces taillées au plus ou moins aigu des angles, autant que de la consistance cristalline de leurs effets de ciseaux - et quelle griserie c’est à tout coup de toupiller imaginairement sur son glaçon à la pointe de ses lames tout en laissant couler en soi la chaleur ambrée de son treizième Coca-cognac…
Image : Philip Seelen


A propos d’un mot d’Alain Finkielkraut
(Dialogue schizo)
Moi l’autre : - Et que penses-tu de ça ?
Moi l’un : - De quoi ?
Moi l’autre : - De ce que prétend Alain Finkielkraut. Qu’Internet serait une poubelle ?
Moi l’un : - Je pense qu’il a raison à 99%. Et que, pour le reste, la poubelle me convient à merveille.
Moi l’autre: - Comme la Winnie de Beckett ?
Moi l’un : - Exactement ce que je me dis à chaque aube où je me connecte : « Encore une journée divine ! »
Moi l’autre : - C’est ta façon virtuelle de te rassurer ?
Moi l’un : - Absolument pas : je ne considère pas du tout Internet comme une réalité virtuelle, ou disons que, sur le 1% de temps compacté que je lui consacre, j’en tire 99% de réalité réelle, que je ne trouverai jamais à la télévision…
Moi l’autre : - Et dans les livres ?
Moi l’un : - Là tu me cherches, mais tu me trouves illico mesures en main : je dirai 100% de présence réelle pour les livres que je lis vraiment, ou pour ce que j’en écris, y compris sur Internet…
Moi l’autre : - Okay, mettons que cela tienne debout en ce qui te concerne, mais Aklain Finkielkraut affirme quelque chose qui relève du jugement de valeur général…
Moi l’un : - Ne fais pas la bête : tu te doutes bien que le philosophe ne vise aucunement l’outil Internet ni son utilisation constructive, mais son contenu réel global où la masse de déchets en croissance exponentielle appelle en effet la comparaison avec la poubelle.
Moi l’autre : - N’est-ce pas à un catastrophisme élitaire que tu cèdes ?
Moi l’un : - Pour le catastrophisme, sûrement pas. Il nous reste 1% où travailler et nous épanouir : c’est à peu près la dimension du jardin perso de chacun. Quant au caractère élitaire du travail au jardin : c’est l’évidence même.
Moi l’autre : - Et ça ne te gêne pas quelque part d’être élitaire ?
Moi l’un : - Certainement pas. Mais pour en revenir à notre statistique, ceci encore : que le 99% des déchets d’Internet correspond probablement, en termes d’objets bons à jeter, aux chiffres de l’industrie audiovisuelle, télévision publique comprise, des productions de l’écrit et de la société de consommation dans son ensemble.
Moi l’autre : On serait donc confinés, selon toi, dans ton minable 1 % ?
Moi l’un : - Minable en quoi ? Ah mais justement, mon jardin de curé m’appelle ! Et là, cher Candide, y a rien à jeter…


Celui qu’on oublie le long de la route sans faire exprès / Celle qui est naturellement effacée / Ceux qui n’aiment pas être vus même nus / Celui qui est toujours au jardin sauf les jours de retombées radioactives / Celle qui n’apparaît pas dans la liste des rescapés et se sent d’autant plus libre / Ceux qui sont si fâchés avec les chiffres que leurs bons comptes ne leur valent même pas d’amis / Celui qui s’exprime par sa note de frais / Celle qui donne toujours un peu trop (se dit-elle en se le pardonnant somme toute) aux mendiants / Ceux qui n’ont pas d’existence bancaire reconnue / Celui qui suscite des jalousies à proportion de son désintéressement à peu près total je dis bien à peu près / Celle qui n’est jamais invitée chez les De Vargasl à cause de son fils disparu la même année que leur chien Bijou / Ceux qui ne se sont jamais départis de la mentalité bas-de-laine de leur mère-grand Agathe la Bonne / Celui qui aime que les choses soient claires et préfère donc les tulipes blanches et le IVe Concert Brandebourgeois de Jean Séb Bach / Celle qui se dit qu’elle compte pour beurre ici-bas et se console à l’idée que le Très-Haut lui réserve un Bonus / Ceux qui ont compris qu’ils n’étaient rien de plus qu’eux-mêmes dans le métro matinal de Tôkyo / Celui qui essaie de se situer en tant que poète belge en traversant le quartier de Kanda (au centre de Tôkyo) où voisinent environ deux mille bouquineries / Celle qui a plusieurs dépucelages à son actif sans savoir exactement combien / Ceux qui n’ont jamais misé sur le don vocal de leur neveu Paul Anka (chanteur de charme à l’époque) qui en a été secrètement affecté / Celui qui est plutôt Sénèque le matin et plutôt Joubert le soir / Celle qui divague sur son divan de Diva / Ceux qui ricanent de Mademoiselle Lepoil militant au Conseil de paroisse en faveur de la reconnaissance de l’âme des hamsters femelles / Celui qui invoque les Pères de l’Eglise pour faire passer son message punk à la base / Celle qui use de sa muse pour emballer les jeunes nigauds qu’elle convoite / Ceux qui ont des voix de pasteurs noirs qui font bêler les brebis blanches / Celui qui n’a jamais compté les cadavres que son père et lui ont repêchés dans le fleuve / Celle qui n’a plus de créneau dans son Agenda pour caser un moment genre Où en suis-je Edwige ? / Ceux qui sont devenus meilleurs artisans à l’atelier Carton-plié de la prison des Fleurettes / Celui qui reste fidèle à ses erreurs de jeunesse avec un peu plus de métier faut reconnaître / Celle qui fait commerce de ce qui brille et ne récolte pas or pour autant / Ceux qui ont gardé le goût des vieilles Américaines fleurant bon le cuir et le chewing-gum dans lesquelles ils emmènent les veuves de leurs meilleurs amis, etc.




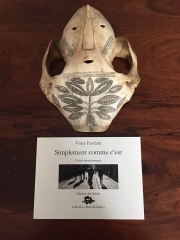
… C’est lorsque tu m’as quitté que j’ai commencé à lire les journaux économiques japonais dans les rues désertes du quartier des affaires, et le soir je ne manquais pas un film animalier, tu t’es toujours gaussée de mon peu de savoir en matière éthologique, aussi prenais-je des notes en me documentant sur la vie du chien ou du singe domestique, mais tu ne passais jamais dans la rue où je me tenais quand tu te rendais à la Bourse, et j’en viens à croire que mon peu de savoir en quoi que ce fût t’aurait suffi, après ma première panne, à te faire préférer la compagnie de ceux que tu appelais tes seules amours…
Image: Philip Seelen
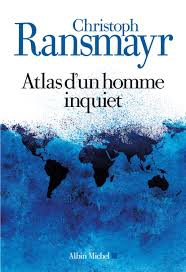

Lecture intégrale du dernier livre, extra-ordinaire, de Christophe Ransmayr. D'autres commentaires suivront...
RANSMAYR Christoph. Atlas d’un homme inquiet. Traduit de l’allemand par Bernard Kreiss. Albin Michel, 458p.
Au bout du monde
- Que les histoires se racontent.
- Sur un bateau à destination de Rapa Nui, l'île de Pâques.
- Navigation mouvementée. Le Pacifique pas du tout calme.
- Tout de suite l’univers physique est très présent.
- Un homme « effroyablement maigre » parle au Voyageur.
- Evoque le peuple de Rapa Nui, qui a peuplé les îles de milliers de statues de pierre.
- Les habitants étaient sûrs d’être seuls au monde et ne se rappellent pas leur origine.
- Parle un mélange d’anglais, d’espagnol et d’une langue inconnue. L’île est assimilée, à sa découverte, au séjour d’un dieu.
- Lequel, Tout Puissant, se nomme Maké-Maké…
- Son père est anglais et sa mère Rapa Nui.
- Manger lui est très pénible.
- Les statues s’appellent moaïs.
- Des figures tutélaires d’un culte oublié, qui sont devenues symboles de puissance.
- L’homme très maigre estime que la faim a été le destin de ce peuple.
- Dont les habitants ont épuisé les richesses naturelles et ont fini par s’entre-dévorer. Avant d’être exploités par les Péruviens dans des mines de guano.
- La quête de la faim est assimilée, dit-il, à une quête du corps astral. Texto.
- Le Voyageur se concentre ensuite sur la présence des sternes fuligineuses, dont l’homme très maigre dit que ce sont des oiseaux sacrés.
- Ils portent des noms étonnants : le puffin de la nativité, le fou masqué ou le pétrel de castro.
- La présence des oiseaux sera récurrente dans ce livre.
- Le Voyageur-poète y apparaît comme un témoin sensible. « J’étais là, telle chose m’advint ».
- Mélange de récit de voyage et d’évocation poétique mais sans fioritures.
 Chant de territoire.
Chant de territoire.
- Le Voyageur se retrouve sur la muraille de Chine enneigée.
- Où il avise la silhouette d’un type s’approchant.
- Un Mr Fox de Swansea, ornithologue, qui a vécu avec Hong Kong avec sa femme chinoise et répertorie des chants de territoire des merles.
- Classe les chants en fonction des sections de la muraille, chaque territoire ayant sa modulation.
- Le chant d’une grive marque l’au revoir des deux hommes.
- Une atmosphère étrange et belle se dégage de cette rencontre. La merveille est partout, très ordinaire en somme et prodigue en histoires.
- Herzfeld
- Chaque récit commence par « Je vis »…
- « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant »…
- Cette fois on est dans l’état fédéral. Brésilien de Minas Gerais.
- On enterre le Senhor Herzfeld.
- Dont le Voyageur a fait la connaissance deux jours plus tôt.
- Le fils d’un fabricant d’aiguilles à coudre du Brandebourg, exilé à la montée du nazisme.
- Herzfeld a commencé à lui raconter sa vie.
- Puis est mort la nuit suivante.
- L’évocation de la mise en bière du Senhor Herzfeld, et son enterrement, forment le reste de l’histoire.
Cueilleurs d’étoiles
- Le récit commence par la chute d’un serveur et de son plateau chargé de bouteilles sur une terrasse jouxtant un café des hauts de San Diego.
- Le serveur se retrouve par terre alors que tous alentour scrutent le ciel.
- Il a buté sur le câble d’alimentation d’un télescope électronique.
- Tous scrutent la Comète.
- Dont le passage coïncide, ce soir-là, avec une éclipse de lune.
- Et le serveur, aidé de quelques clients, ramasse les éclats de verre qui sont comme des débris d’étoiles.
- Cela pourrait être kitsch, mais non.
 Le pont céleste.
Le pont céleste.
- On voit des cônes de pierre noire sur lesquels déferlent des dunes.
- Le Voyageur se trouve quelque part au Maroc, dans un lieu dominé par des tumulus mortuaires d’une civilisation disparue.
- Là encore, le lien entre un lieu fortement chargé, et le passage des humains, est exprimé avec un mélange de précision et de poésie très singulier.
Mort à Séville.
- Le dimanche des Rameaux, dans les arènes de Séville, se déroule un dernier combat entre un cavalier porteur de lance et un taureau.
- La suite des figures est marquée par l’hésitation du taureau et la blessure du cheval, puis du public jaillit la demande de grâce, d’une voix unique.
- L’affrontement est évoqué avec une sorte de solennité, sans un trait de jugement de la part du Voyageur.
- C’est très plastique et assez terrifiant.
- Et cela finit comme ça doit finir.
- Sans que rien n’en soit dit.
 Fantômes.
Fantômes.
- On passe ensuite en Islande, où le Voyageur croit voir des fantômes.
- Se trouve là en compagnie d’un photographe, familier des légendes islandaises,nourries par les proscrits relégués dans cet arrière-pays.
- Lui raconte celle, saisissante, du bandit à qui le bourreau a coupé une jambe pour l’empêcher de se sauver, et qui a appris a courir en faisant « laroue ». Une roue humaine qui terrifie les passants quand elle leur fonce dessus…
- Où il est question de la peur du noir et des « diables de poussière ».
- Extinction d’une ville.
- Le Voyageur se retrouve au sud de Sparte.
- Il a été jeté de sa moto par il ne sait quoi.
- Puis remarque, dans la nuit, que les lumières de la ville de Kalamata sont éteintes.
- Ensuite il rejoint un café en terrasse où il découvre, à la télé, qu’un séisme vient d’avoir lieu dans la région.
- Qui a provoqué sa chute et l’extinction de la ville.
- Cela encore raconté sans le moindre pathos. J’étais là, telle chose m’advint.
- Mais rien non plus de froidement objectif là-dedans.
À la lisière des terres sauvages.
- Dans un asile psy autrichien, une jeune femme s’apprête à faire du feu avec du papier et des copeaux invisibles.
- On voit la scène, très développée ensuite.
- Sous le regard d’une gardienne dans une cage de verre.
- La jeune femme entend une voix qui lui dit : « Tu ne doit pas tetuer »…
 Tentative d’envol.
Tentative d’envol.
- Au sud de la Nouvelle Zélande, en terre maorie, le Voyageur observe un jeune albatros royal en train d’essayer de s’envoler.
- L’occasion d’une longue et épique digression sur la vie des albatros, telle que la lui évoque un ancien chauffeur d’autocar devenu ornithologue après la mort accidentelle de sa femme.
- Formidable récit ponctué de nouvelles diverses en provenance du monde des humains.
- Le Paon.
- ÀNew Delhi, son chauffeur de taxi lui évoque l’imminente pendaison du meurtrier d’Indira Gandhi.
- Une certaine psychose règne, liée àl’attentat qui a provoqué le massacre de milliers de sikhs.
- Atmosphère de pogrom.
- Le Voyageur veut se rendre au Rajasthan et à Jaïpur.
- « Et c’est alors que je vis le paon ».
- Uneapparition qui rappelle celle du paon de Fellini, dans Amarcord…
L’attentat.
- Le Voyageur se retrouve à Katmandou, dont les frondaisons des arbres sur le boulevard central, sont occupées par des milliers de renards volants.
- Plusieurs membres de la famille viennent d’être tués, et le nouveau roi se trouve probablement dans la limousine d’un convoi.
- Au moment de l’attentat auquel assiste le Voyageur, une nuée de renards volants obscurcit le ciel.
- Où le Voyageur croit voir un écho significatif aux événements en cours…
 Attaque aérienne.
Attaque aérienne.
- On se trouve maintenant sur les hautes terres boliviennes.
- Où le Voyageur chemine avec des amis, un biologiste bavarois et sa compagne italienne.
- Quand surgissent des chasseurs qui volent en rase-motte au-dessus d’eux, la jeune femme leur lance en espagnol : No pasaran.
- Il faut préciser qu’un nouveau dictateur s’est installé en Bolivie.
- Mais le pilote a vu le geste de défi de la jeune femme et fait demi-tour et canarde le trio.
- Se non è vero… io ci credo purtoppo.
- Plage sauvage.
- Un vieux type au crâne rasé, sur une plage brésilienne, semble rendre un culte privé à une femme dont il tient la photographie près de lui.
- Et soudain son parasol s’envole.
- Le Voyageur va pour l’aider, mais un jeune homme sort de la forêt et secourt le vieux.
- Sur quoi le voyageur lance « Amen ! Amen ! » à l’océan.
- Tout cela toujours étrange et vibrant de présence.
-
- Homme au bord de la rivière
- Un type repose en maillot de bain au bord de la Traun, rivière de haute-Autriche.
- Quelques enfants veillent sur son demi-sommeil, claquant des mains pour tuer les taons qui lui tournent autour.
- Les taons morts sont recueillis dans des sachets de feuilles.
- Lorsque le type se réveille, il compte les taons et distribue des piécettes à ses gardiens du sommeil.
- Etrange et belle scène d’été.
 Le souverain des héros.
Le souverain des héros.
- Au sommet de l’île d’Ios, dans les Cyclades, le Voyageur découvre les stèles blanches du tombeau d’Homère (92-97) et médite à propos de ce monument au « plus grand poète de l’humanité ».
- Il y voit un monument « à la mémoire d’un chœur de conteurs disparus »,tout en évoquant merveilleusement ce lieu que je me rappelle comme de ce jour-là après la baignade…
- Un chemin de croix.
- Sur la route de Santa Fe, à bord d’une Cadillac bordeaux qu’il a louée, le Voyageur croise une procession entourant un porteur de croix, dont les pèlerins lechassent bientôt à coups de pierre.
- Peuaprès il rencontre un deputy sheriffqui lui explique que ces penitentes procèdent parfois à de véritables crucifixions, parfois fatales au crucifié volontaire,mais absolument illégales…
- D’outre-tombe.
- À Mexico, le Voyageur observe une petite accordéoniste jouant sur le trottoirdans un entourage de squelettes et de têtes de mort et de cercueils en chocolat marquant la fête du Jour des Morts.
- Le Voyageur se rappelle alors une jeune Indienne sur une fresque, visiblementdestinée à un sacrifice rituel à l’ancienne cruelle façon. (p.104)
- Chacunde ces récits se constitue en unité, cristallisé par le regard du Voyageur etplus encore par son art de l’évocation, à la fois réaliste et magique.
- Onpense à Werner Herzog, en moins morbide, ou à Sebald, en plus profond.
Déplacement de sépultures
- Sur l’Île de Robinson Crusoë, quatre mois après un tsunami.
- Un homme s’affaire à mettre de l’ordre dans les tombes dévastées par l’eau.
- LeVoyageur se trouve là sur les traces d’Alexandre Selkirk, le boucanier donts’est inspiré Daniel Defoe.
- Unrécit qui suggère physiquement la mêlée des vivants et des morts.
- L’alertedonnée par une petite fille a permis de limiter le nombre de morts en ceslieux.
 Prise accidentelle
Prise accidentelle
- Suit le récit du sauvetage, par un pêcheur de homards furibond, du bateau à bordduquel le Voyageur se trouvait.
- Le pêcheur maudit le ciel à cause de sa pêche calamiteuse : Un seul homarddans 59 casiers.
- Maisen arrivant au port, de rage, il remet le homard unique à l’eau…
- Dans les profondeurs
- Avecd’autres whale watchers, le Voyageur observe une baleine « timide »qui a l’air de rêver au-dessous de lui, son aile reposant sur son baleineau…
- Ensuiteil éprouve une vraie terreur lorsque la baleine s’approche de lui. On pense àMoby Dick, au fil d’une évocation de ces immensités marines…
La reine de la jungle
- Il voit un veau mort dans une clairièred’herbe entourée de jungle.
- Lachose se passe dans l’Etat fédéral brésilien de Sao Paulo.
- Le proprio est un Allemand émigré qui a importé des vaches du Simmenthal.
- La forêt vierge perçucomme une entité vivante que l’Allemand a combattu pendant des années.
- Récit de ses tribulations.
- Et soudaine apparitiond’un anaconda de sept ou huit mètres traversant lentement la route.
- Telle étant la reinede la jungle.
- Dont un train routierlui fonçant dessus aura probablement brisé les vertèbres, quoique le serpentcontinue d’avancer…
La transmission
- Histoire du batelier Sang, sur le Mékong, dont le filsconduit depuis trois jours le bateau sur lequel se trouve le Voyageur.
- Quand il y a un danger, son père lui pose la main surl’épaule, sans un conseil de plus.
- Le fils connaît chaque remous du fleuve par son nomancien.
- L’histoire de Sang recoupe celle des bombardements sur leLao, dont l’intensité à dépassé ceux de l’Europe à la fin de la guerre.
L’Adieu
- Sur un banc de laplace du marché d’un bourg autrichien, un vieil homme, prof retraité et veuf,reste là avec une amie et fait parfois semblant de dormir.
- Cette fois pourtant,il peine à se réveille, jusqu’au moment où l’on constate qu’il ne fait plussemblant du tout.
- À la morgue, une larmeversée par le Voyageur nous fait comprendre qu’il vient de perdre son père.
Dans l’espace cosmique
- Le Voyageur seretrouve couché dans un canot à fond plat, conduit par un Maori dans une sortede labyrinthe à ciel ouvert.
- Puis le canot s’échouesur un matelas spongieux formé d’insectes morts.
- On retrouve là lessensations à la fois physiques et et quasi métaphysiques évoquées par Coloaneou Sepulveda au contact de la nature sauvage.
Drive au Pôle Nord
Récit d’une tout autre tonalité, dont un joueur de golf de l’Illinois est le sujet.
- Natif de Riga, il aémigré aux States après la déportation de son père par les Soviétiques.
- Débarqué au pôle nordà bord d’un brise-glace atomique, il va tirer dix coups sous le regard interditdu Voyageur, dix balles de golf dans la neige, à proximité du drapeaurusse…
Retour au bercail
- Le long d’une rivière canadienne, en Ontario, le Voyageur assiste à la remontée problématique dessaumons qui vont se heurter à l’obstacle d’une cascade asséchée.
- Désignant la« saloperie da cascade », un pêcheur n’en fait pas moins lacueillette de quelques saumons survivants…
Courants contraires
- Au Cambodge, leVoyageur assiste au feu d’artifice sur le Mékong, à l’occasion de la fête del’eau à Phnom Penh, avant d’évoquer les effets de la mousson sur les crues descours d’eau et des lacs.
- Cette évocationrecoupe celle des massacres imputables aux Khmers rouges.
- Très remarquable récit là encore.
 Le travail des anges
Le travail des anges
- Le Voyageur se retrouve à Trebic, près de l’égliseSaint Martin et nonloin du cimetière juif dont s’occupe le vieux Pavlik, ancieninstituteur non juif.
- Il est làé comme ungardien de mémoire, car il est question de désaffecter ce cimetière où reposentplus de 11.’’’ Juifs.
- Il est visiblementmarqué par la réflexion selonlaquelle les anges du Tout Puissant ont regardépasser les trains de déportés vers les camps d’extermination sans broncher.
Dans la forêt de colonnes
- Devant la citerne géante de Yerebatan, en la basilique souterraine de Justinien, au milieu de laforêt des colonnes, le Voyageur observe le curieux manège d’un visiteur quis’immerge après avoir jeté une pièce dans l’eau, qu’il entreprend ensuite deretourner.
- Scène étrange en celieu, comme beaucoup d’autres scènes de ce livre en d’autres lieux…
La beauté des ténèbres
- Le Voyageur se décritlui-même en train de scruter, avec ses instruments d’astronomie, la galaxiespirale de la Chevelure de Bérénice, qui a mis quelque 44 millions d’annéespour arriver du fond de l’espace à cet observatoire pseudo de Haute-Autriche.
- La séquence est assezvertigineuse, finalement traversée par le cri d’une chouette hulotte rappelant que le ciel communique avec la terre…
Tombé du ciel nocturne
- À Jaipur cette fois,du toit en terrasse de l’hôtel dit Le Palais des Vents, le Voyageur assiste àl’envol de milliers de cerfs-volants à l’occasion de la fin de l’hiver.
- Le récit de la chuted’une roussette, blessée par l’armature aiguisée d’un cerf-volant, corse lerécit de manière significative, comme l’épisode des renards volants…
Le pianiste
- Il y a du conte trèsplastique, à la japonaise, dans cet épisode faisant intervenir un très petitpianiste, assis comme un enfant à un grand piano, tandis que l’air extérieur vibre au chant des cigales.
- Le reste se ressentplus qu’il ne se décrit, comme souvent au fil de ces pages subtiles, à la foisréalistes et irréelles.
La chance et l’océan calme
- Le Voyageur, dans unquartier populaire de Valparaiso, observe un type qui lui semble un vendeur debillets de loteries au vu du collier de tickets qu’il porte autour du cou.
- Or ces billets ne sont pas à vendre mais représentent la collection des billets non gagnants rassemblés par le type en question.
- Tout cela sur f

ond de réalité chilienne non détaillée au demeurant…
Les règles du paradis
- Suit le plus long récit du livre, de presque vingt pages, évoquant la saga fameuse des révoltés du Bounty, alors que le Voyageur se trouve sur l’île perdue de Pitcairn où lesmutins ont fini par débarquer et crever après moult tribulations.
- L’on en apprend plus sur l’aventure de Fletcher Christian et de ceux qui l’ont assisté, puis le
Voyageur interrogecertains des descendants des forbans et se balade le long des falaises à-pic del’île.
- Il y a là-dedans un mélange de souffle épique et de sauvagerie où les fantasmes paradisiaques à la Rousseau en prennent un rude coup.
Tout cela très fort,toujours inattendu et intéressant, d’une expression limpide et comme nimbéed’étrangeté ou de mystère.
Loin est ici àmi-parcours de ce livre sans pareil.
La face cachée du salut
- L’apparition d’ungilet de sauvetage rouge, au bord d’un champ d’épaves de l’Océan indien,prélude à l’évocation du drame qui a coûté la vie à l’équipage d’un cotredisparu. Dont l’épave seule, intacte, réapparaît ensuite. Geste rituel d’uneHindoue versant de l’eau du Gange dans l’eau où reposent les noyés.
Le non-mort.
- Ensuite on se retrouvesur la Place Rouge, à Moscou, où sept couples de jeunes mariés attendent de sepointer dans le mausolée de Lénine.
- Diversesconsidérations devant la dépouille irréelle du révolutionnaire devenu dictateur.
Visiteurs au parlement.
- Après la visite à lamomie russe, le Voyageur observe un vieux type, pieds nus, dans la file descurieux se pressant à l’entrée du Reichstag de Berlin.
- Les pieds nus de l’original intriguent unepetite fille et mettent en évidence, sans peser, l’aspect étrange voire absurde de cetteprocession.
 Nu dans l’ombre
Nu dans l’ombre
- De nombreux récits durecueil ont une connotation politique. Sans discours à ce propos.
- Ici, c’est un hommenu, dans la cours d’une prison psychiatrique, dans la Grèce des colonels.
- Le cri du type déchireet signifie, sans besoin d’autre commentaire.
- Cependant la scène estminutieusement détaillée, avec quelque chose de très oppressant.
Un requin dans le désert
- Sur une route côtièrede la mer Rouge, le Voyageur remarque un arbre couvert de petits fanions, luirappelant les drapeaux de prière tibétains. Mais la comparaison s’arrête là carces chiffons n’ont rien de sacré.
- Puis on se retrouve aumarché aux poissons d’Al Hudaydah, et ensuite sur les lieux d’un accident detriporteur dont le conducteur débite le requin qu’il transportait.
 Sang
Sang
- Le Voyageur se remémore son enfance en Autriche, après le massacre, par la police, d’un garçon sauvage du lieu.
- Ivre, le lascar avait profané un monument aux morts de la guerre, et les anciens combattants l’ont dénoncé.
- Le Voyageur étaitalors enfant de chœur, et il évoque le drame à la manière d’un Thomas Bernharddans ses récits de faits divers.
- Les traces de sangdans l’église ont marqué la mémoire du narrateur.
Arche de lumière
- Le Voyageur seretrouve à Sydney où il observe l’ascension de l’arche gigantesque du HarbourBridge, par un type dont il croit qu’il va se suicider.
- Puis la ville estfrappée par une panne d’électricité géante.
- Il croit voir« la phase terminale d’un chemin de vie ».
- Mais c’est comme une erreur d’optique, ou comme une façon d’accommoder la vision, fréquente chez CR.
Seconde naissance
- À bord d’un brise-glace russe à l’arrêt sur labanquise, un pilote d’hélico convie ingénieurs et matelots à fêter sa secondenaissance après le crash de son appareil.
- Cela se passe vingtans après le récit de la découverte de la Terre François-Joseph, qu’il aévoquée dans Les effrois de la glace etdes ténèbres.
- Très belle évocationd’une ourse polaire et de ses petits (p.274)
Le dieu de glace.
- Le Voyageur évoque ledésarroi d’un petit garçon qui voit fondre la tête d’un bonhomme de neigeconservé dans un congélateur.
- La scène se passedevant un manoir du comté de Cork.
- Le père et le fils finissentpar éclater de rire à la vision de la tête fondue.
- On n’en saisit pasmoins l’importance magique de cette têtede neige…
Le prêcheur.
- Se la jouant Jésus et les marchands du temple, un prêcheur invective les petits commerçants ukrainiens et caucasiens dont les cahutes envahissent la pelouse du grand stadedu Dixième anniversaire, construit en mémoire du soulèvement de Varsovie.
- La scène est assez emblématique, typique de la Pologne de la fin des années 80.
- Je me rappelle une manifestation patriotique monstre dans le même stade, pendant les années de plomb.
Un photographe.
- Un cantonnier en train de creuser une fouille, devant une maison bleu pâle de la ville dominicaine dePuerto Plata, est prié par une dame de la prendre en photo avec deux types.
- Une pancarte vientd’être posée devant la maison, annonçant l’ouverture d’un cabinetd’hypnotiseur.
- Le cantinier, aprèsavoir tenu l’appareil de photo en ses mains, se dit que peut-être sa vie auraitpu être tout autre…
- Là encore, la banalitéd’une scène se charge d’étrangeté et de sens plus profond.
Pacifico, Atlantico.
- Le Voyageur se retrouve à 3400 mètres d’altitude, juste au-dessous du cratère de l’Irazu, levolcan le plus dangereux du Costa Rica.
- Il se trouve là dansl’espoir de voir l’oiseau quetzal, mais le brouillard est au rendez-vous.
- Il est aussi question du pèlerinage à la Vierge noire, la Negrita.
Love in vain.
- Dans une clairière de la mangrove, sur la côte est de Sumatra, le Voyageur surprend une scène un peusurréaliste de karaoké sans public, dont le chanteur (aveugle) interprète untube des Rolling Stones,
- Comme à chaque fois, ce n’est jamais lepittoresque qui est recherché par le Voyageur, mais l’étrangeté, le mystère, lamagie d’une situation où nature et culture ne cessent de s’interpénétrer.(p.300)
La menace
- En Malaisie, le Voyageur est confronté à la chasse aux trafiquants de drogue,menacés de mort.
- Raconteun contrôle à la douane, où son bus est vidé de ses occupants et immobilisélonguement.
- Une jeune femme est contrôlée plus sévèrement que les autres.
- Puis elleregagne sa place dans le bus. Mais personne ne vient s'asseoir près d'elle...
Présumé coupable
- Puis on se trouve en Afrique du Sud.
- Le buss'est arrêté auprès d'une pancarte proclamant : Hang em !
- Il estquestion d'un flic blanc, soupçonné de meurtre. Mais rien n'est sûr.
- Des conversations contradictoires suggèrent le climat du moment, plus à cran que jamais...
 Dimanche blanc
Dimanche blanc
- Où il est question de la prochaine communion d'une petite fille.
- Que son père accompagne dans un magasin de chaussures, sans cesser de critique cette dépense, et cette fête, non sans charrier la vendeuse de mufle manière .
- La grossièreté du type me rappelle tout à fait certaine Autriche. Le con.
- Et comme elle raison, la petite fille, de refuser de porter les godasses !
La pêcheuse à la ligne
- Une autrepetite fille, à Katmandou, avec une canne à pêche.
- Elle setrouve là au milieu des bûchers, sur lesquels crament des cadavres.
- Elle pêche, à l'aimant, des bijoux tombés des bûchers.
Le vase chinois
- À Santiago duChili, dans un jardin retiré, le Voyageur tombe sur une vase chinois genreMing, de trois mètres de haut.
- L'ambiance est à la préparation d'une garden-party.
- À un momentdonné, un employé du personnel de service déplace le vase, qui semble nepeser rien.
- L'objet doit êtrede papier.
- Le détailchange tout de ce qu'on perçoit de la séquence...

- Au bord du lac de Kunming, au nord-ouest de Pékin, des calligraphes recopient des poèmes Tang sur de grandes pierres, se servant d'eau en guise d'encre. De sorteque le soleil fait s'évaporer tout ce qui s'écrit.
- Merveilleuse évocation là encore, sans rien de kitsch...
Pèlerins
- À l'extrême -sud du Sri Lanka, sept ans après le tsunami qui a fait 7000 morts,Sameera le conducteur de tuk tuk raconte son histoire.
- Evoque lesort précaire des humains sur cette terre.
- Le vieil ermite, et ce lieu édénique où l'homme brille par son absence... (P.336-347)
Consolation des affligés
- Aux portes de l'hospice psychiatrique de Steinhof (cf. Thomas Bernhard), quelques dévots psalmodient.
- - Rappelle le passé, de très sinistre mémoire, du plus grand asile d'aliénés dumonde, qui comptait 4800 lits médicalisés à sa grande époque.
- Et comment les nazis déportèrent ou liquidèrent les individus jugés"indignes de vivre".
Le ténor
- Le Voyageur se retrouve dans un hôtel de Mourmansk, "les yeux braqués sur le chaos blanc".
- Décrit la décrépitude du lieu, aux eaux complètement polluées par ledémantèlement des sous-marins nucléaires, notamment.
- Sur cet arrière-fond apocalyptique, suit une émission de télé consacrée à unconcours de chant.
- Oùs'illustre un ténor anglais amateur, interprète glorieux de Puccini...
Homme sans soleil
- Dans un pub du comté de Cork, desouvriers se racontent l'histoire d'un tailleur de pierre qui a juré de cesserde boire.
- lest d'ailleurs là. L'entrepreneur allemand qui les emploie a juré de le virers'il arrivait une fois de plus en retard.
- Il va donc se préparer au réveil du lendemain, sans se rendre compte du faitqu'il a une nuit d'avance.
- Unehistoire dingue qui rend très bien certain climat de folie arrosée àl'irlandaise...
Ralenti
- Sur la côte pacifique du Costa Rica, un paresseux tombe d'un arbre et s'écrase au pied d'une femme en train de repasser une chemise blanche.
- La femme éclate de rire et le petit chien qu'il y a là montre son vif mécontentement à l'animal griffu, qui se traîne lamentablement au sol, cherchant l'ombre de la forêt...
-
Le chasseur de varan
- À Java Timur, tout un attroupement de gens se fait au lieu d’un accident, autour d’un conducteur de mobylette couché au sol.
- Unefillette hurle et l’on voit un varan ficelé sur le véhicule, lui aussi blessé.
- Puisun homme en pagne soulève la fillette au-dessus du sol, comme le font ensuiteplusieurs spectateurs, et la fillette cesse de hurler et rit comme une folle.
 Avis de tempête.
Avis de tempête.
- Le Voyageur se rappelle avoir vu deux bras gracile d’une femme étendre du linge,tandis qu’un orage s’approchait de Roitham en Haute-Autriche.
- Unorage qui arrache le toit de la plus grande demeure du village, dont le contenu du grenier s’envole et retombe dans la cour.
- Ily a là des drapeaux nazis et un grand portrait d’Adolf Hitler en chevalierteutonique.
- Comme le retour du refoulé…
Une fin du monde
- Dans une flambée apocalyptique s’effondrent la Bank ou China et toute une série d’établissements bancaires, cramant sur la mer de Chine à Hong Kong.
- Ce ne sont évidemment que des maquettes de bois qui flambent sur l’eau.
- Magnifique évocation,une fois de plus, d’une fête populaire local, ici à la gloire du ciel Tin Han,déesse de la mer de Chine orientale.
- Le Voyageur a participé à une rencontre de poètes et écrivains occidentaux et chinois.
- Ce qu’il en tire n’a rien de convenu au demeurant…
Le chien de berger
- On est maintenant en Lycie, dans le Taurus occidental.
- Le Voyageur se rappelle la guerre de Troie.
- Un chien le conduit aulieu d’une coulée de terre, d’où émerge un sarcophage.
- Là encore les vestiges du lointain passésuscitent une ré-actualisation étonnante.
À l’ombre de l’homme-oiseau.
- Retour à l’île dePâques, où le Voyageur chemine jusqu’à la baie d’Anakena.
- Là que ce serait établie la première colonie humaine.
- Il approche d’uneferme où pourrit une charogne de cheval.
- Surgit ensuite untroupeau de bovins hurlant de faim.
- Il va pour les abreuver et rencontre une femme, avant de développer un récit épique relatif àun ancien rite divin.
- Fabuleuse plongée là encore. (p.400-411)
Scènes de chasse
- Où il s’agit, en premier lieu, du jeu cruel d’unchat avec un oiseau.
- Cela se passe au bord du Parana, dans un poste d’essence dont le patron est soupçonné de trafic decoke.
- Les deux histoires, dujeu du chat et de la disparition du trafiquant, se mêlent en contraste.
- Et l’épisode finit parle défilé de colonnes de fourmis à côté de l’oiseau mort.
Le scribe
- Trois hommes et trois femmes se trouvent engagés dans une expédition à travers le Tibet oriental,déclaré zone dangereuse en ces jours précis ; mais ils sont déjà en route.
- Les témoins éventuelsde la répression policière chinoise contre les moines tibétains ne sont pas lesbienvenus ( !)
- Ils vont découvrir desinscriptions, sur des pierres, datant de siècles.
- Puis ils découvrent untrès jeune scribe, dont on comprend que lui aussi écrit depuis des siècles… Transgression
Transgression
- Une jeune nageuse évolue dans une piscine bleue, au milieu d’un jardin nocturne de Bali.
- Cela se passe à Nyepi,lors d’une fête exigeant l’obscurité totale.
- Et là, des nuées depapillons son attirés par la lumière de la piscine…
- Les papillons menacésde noyade se réfugient sur le dos de la jeune fille.
- Il est question despierres du ciel tombées d’un certain volcan.
- Les images se mêlentune fois de plus…
Silence
- Sur la côte est de SriLanka, un troupeau d’éléphants. C’est le soir de Noël.
- Le troupeau n’est que l’avant-garde d’une immense colonne de 200 éléphants sauvages, fuyant la guerrecivile entre forces gouvernementales et tigres tamouls
- Là encore se combinentl’observation d’un premier plan et la situation politique en crise du moment,sans le moindre commentaire au demeurant.
Fillette sous l’orage d’hiver
- Au bord de l’Inn, une fillette de six ou sept ans cherche la main de son frère aîné, mais celui-ci reste distant.
- Il est question d’un père qu’on doit aller chercher à la taverne.
- Le grand frère joues on rôle.
- À un moment donné, la fillette, dans la nuit, fait l’expérience de l’épouvante.
- La trace de la nuit entre danger et lieux de protection prendra, avec le temps, une dimension poétique particulière aux yeux du Voyageur.
- Dans l’ouest de l’Himalaya, à 4000 mètres d’altitudes, le Voyageur voit trois moines quimarmonnent de concert dans une grotte.
- De très jeunes moines.
- Qu’il découvre aprèsdes heures de marche difficile, jusqu’au lac de Phoksundo, près du village de Ringnmo.
- Après un premier arrêtau village, son compagnon le persuade, malgré leur fatigue, de monter jusqu’à àune grotte où ils découvrent les trois jeunes moines.
- Qui leur offrent du thé salé au beurre de yak.
- La nuit tombe au pied des 6000, et, dans unesorte de sérénité, le Voyageur note encore ceci : « Je me sentais à l’abri comme en ces temps révolus où l’on me portait au lit soir après soir : par une fente de la porte qu’on laissait entrouverte à cause de ma peur du noir, jevoyais un rai de lumière et j’entendais chuchoter dans la pièce d’à côté lesadultes qui me protégeaient. Lorsqu’une étincelle sauta de la cendre blanche comme neige et s’éteignit en vol dans l’obscurité froide de la grotte, je m’endormis. À présent j’étais arrivé. ( P.455)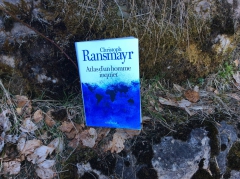 (Première lecture de ce livre sublime achevé au soir du 18 avril 2015, alors que Lady L. volait vers les States)
(Première lecture de ce livre sublime achevé au soir du 18 avril 2015, alors que Lady L. volait vers les States)
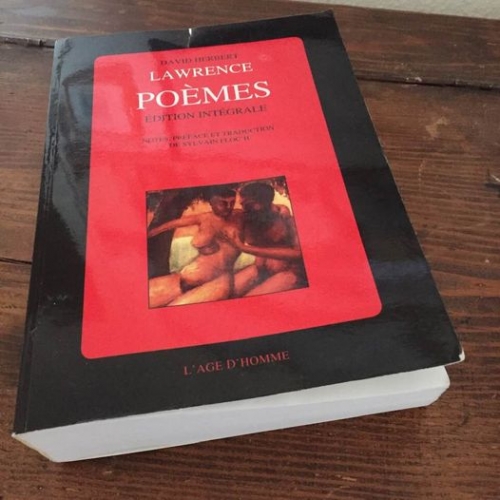
 Elle porte son duffle-coat bleu roi comme un petit nain. Lorsque je me pointe dans le compartiment d’à côté, elle se déplace et vient s'asseoir en face de moi. Je n’ai pas envie de faire attention à elle, mais elle m’y oblige: elle n’a personne ni nulle part où aller. Elle est adorable sans être jolie ni belle. En principe elle allait à Vienne dans la Drôme, mais à la gare où je descends elle descend aussi. Je remarque qu’elle n’a aucun bagage. Ensuite elle me suit partout, jusque chez moi où je lui dis que je n’ai qu’un lit, mais ça lui va. Nous dormons sans nous déshabiller, sans nous caresser, sans dormir peut-être mais dans les bras l'un de l'autre. Le matin je lui dis que j’ai du boulot au journal. Le soir quand je reviens l’oiseau s’est envolé.
Elle porte son duffle-coat bleu roi comme un petit nain. Lorsque je me pointe dans le compartiment d’à côté, elle se déplace et vient s'asseoir en face de moi. Je n’ai pas envie de faire attention à elle, mais elle m’y oblige: elle n’a personne ni nulle part où aller. Elle est adorable sans être jolie ni belle. En principe elle allait à Vienne dans la Drôme, mais à la gare où je descends elle descend aussi. Je remarque qu’elle n’a aucun bagage. Ensuite elle me suit partout, jusque chez moi où je lui dis que je n’ai qu’un lit, mais ça lui va. Nous dormons sans nous déshabiller, sans nous caresser, sans dormir peut-être mais dans les bras l'un de l'autre. Le matin je lui dis que j’ai du boulot au journal. Le soir quand je reviens l’oiseau s’est envolé.
Image: Lucian Freud

Celui qui se filme en train de se filmer / Celle qui parle à la Nation devant sa webcam / Ceux dont les minutes de silence ont fait des trous dans la Toile / Celui qui a un succès monstre dans son numéro de jodleur en jockstrap / Celle qui poste une séquence de vidéosurveillance de la Banque du Saint-Esprit captant une tentative d’agression au distributeur de dinars / Ceux qui laissent éclater leur créativité tous azimuts / Celui qui performe en toge de procurateur romain à l’époque du roi Hérode et de son gang dans les territoires occupés / Celle qui a mis en lignes diverses approches par zoom de sa fameuse tourte aux carottes / Ceux qui de Youtube ne se disent pas vraiment croyants mais juste pratiquants /

Celui qui ne souffre pas de n’être pas connecté vu qu’il n’est qu’un blaireau dans son terrier avec ses réserves pour l’hiver / Celle qui se dit de la nouvelle Eglise en Réseau / Ceux qui pensent sur Twitter, communiquent par Facebook et se lâchent sur Youtube / Celui qui a scandalisé ses collègues dames du Bureau de Objets Trouvés par la mise en ligne qu’il a faite des images de sacs à main «non réclamés par les pétasses» vu que ce langage est indigne d’un fonctionnaire municipal membre qui plus est du Groupe de Réflexion / Celle qui recycle les premiers clips de la grande époque d’Alice Dona / Ceux qui ne vont plus se perdre dans les bois depuis qu’ils sont connectés /

Celui qui ne voit plus personne vu que tout le monde est sur son écran / Celle qui espère être remarquée par un produc tombant sur quelque scène osée qu’elle a filmée dans son living mauve / Ceux qui ont filmé la dernière biture d’Arno le Belge dont ils ont fait un must cartonnant / Celui qui a imaginé une suite à la série Deschiens avec sa famille et les divers animaux / Celle qui entrevoit un nouvel avenir à la prostitution ancillaire / Ceux qui ont bien entendu la mise en garde du télé-philosophe Alain Finkielkraut relative à la poubellisation du concept sur Internet mais n’en pensent pas moins qu’il faut vivre avec son temps comme le disait Kant lors d’une de ses promenades dans la zone proche du Neckar que traverse aujourd’hui la nouvelle Autobahn fierté des Allemands / Celui qui s’est fait connaître pour ses imitations de Ben Laden et du rut du renne canadien / Celle qui surprend Marceline sa chambrière en train de mater des scènes de copulation basse sur Webcamworld dans la chambre du petit / Ceux qui ne se doutent pas de ce qui se passe dans la chambre des jumelles la nuit / Celui qui invite les 66.000 internautes connectés à son adresse Skype de s’agenouiller avec lui et de chanter de concert Il est né le divin enfant – pardon aux Juifs et aux Musulmans mais moi j’assume / Celle qui estime que le cybersexe n’est qu’une fiction de plus avec un peu moins de plaisir et de draps à changer ça c’est sûr / Ceux qui passeront un bon Noël en famille y compris leur million d’amis de Facebook et plus si affinités, etc.



 Thomas Wolfe, terrassé le 15 septenbre 1938 par la tuberculose cérébrale, aurait eu 120 ans cet automne... Le géant de la littérature américaine reste assez méconnu en dépit d'une oeuvre monuentale.
Thomas Wolfe, terrassé le 15 septenbre 1938 par la tuberculose cérébrale, aurait eu 120 ans cet automne... Le géant de la littérature américaine reste assez méconnu en dépit d'une oeuvre monuentale.
Pour ceux qui ont accompli, déjà, la grande traversée des quelque six cents pages de L’Ange exilé, inaugurant en 1982 la réédition des œuvres de l’écrivain dans la première traduction française qu’on puisse dire recevable, la seule mention du nom de Thomas Wolfe (à ne pas confondre évidemment avec Tom Wolfe !) est évocatrice d’une légende fabuleuse et, pour ce qui concerne les œuvre, de grands espaces romanesques peuplés de personnages inoubliables.
Thomas Wolfe incarne la tentative inégalée de restituer, dans un maelström de mots et d’images, l’inépuisable profusion du vivant. Tout dire ! Folle ambition de l’adolescence transportée par sa passion généreuse…
Or il y a de l’éternel adolescent chez ce grand diable d’à peu près deux mètres, né avec le siècle et fauché par la sale mort à l’âge de 38 ans, après qu’il eut arraché des millions de mots de ses entrailles, constituant la matière de quatre immenses romans, de nombreuses nouvelles et de pièces de théâtre, notamment. Là-dessus, à ses élans juvéniles à jamais inassouvis, Thomas Wolfe alliait des dons d’observation tout à fait hors du commun et une profonde expérience du cœur humain, ayant vécu précocement toutes les contradictions et les souffrances de l’individu accompli.

Il y a la légende de Thomas Wolfe. Celle du jeune provincial d’Asheville (Caroline du Nord) quittant l’univers confiné de sa ville natale pour débarquer dans la galaxie fascinante de New York, décrite avec un lyrisme sans égal. La légende de l’écrivain solitaire travaillant debout à longueur de nuit dans de gros registres posés sur un réfrigérateur, faute de bureau à sa taille, tout en se cravachant à la caféine. Et celle du forcené des errances nocturnes dans la ville immense, dont nous retrouvons des échos bouleversants dans les nouvelles de De la mort au matin. Ou celle, aussi, de sa rencontre providentielle avec l’éditeur Maxwell Perkins, qui eut le double mérite de parier pour son génie et de l’aider à transformer ses manuscrits torrentiels et désordonnés en ouvrages publiables.
Mais l’essentiel de la légende de Thomas Wolfe, c’est évidemment dans son œuvre que nous le découvrons, transposée et magnifiée sous la forme d’une autobiographie incessamment recommencée. Est-ce à dire que l’écrivain s’est borné à se scruter le nombril et à raconter sa vie ? Tout au contraire : car nul n’est plus ouvert à toutes les palpitations du monde que ce « récepteur » ultrasensible, lors même que les faits et toute la geste humaine se parent, sous sa plume, d’une aura mythique.
À la mythologie, Le temps et le fleuve emprunte les titres des huit sections qui le composent, sans pour autant que les noms cités d’Oreste, de Faust, de Télémaque ou d’Antée, notamment, correspondent très strictement au récit et à ses péripéties. Plutôt, il s’agit d’indications poétiques qui signalent peut-être, en outre, l’influence de Joyce sur l’auteur. Avec celui-là, comme le précise Camille Laurent, traducteur, Thomas Wolfe partage la conviction que « ce qui est fascinant, c’est le quotidien, et l’extraordinaire, ce qu’on a sous les yeux ».
Ce qui tisse ainsi les huit cents pages du deuxième livre de l’écrivain américain, qu’on pourrait dire une autofiction épique, c’est l’expérience quotidienne qui fut la sienne entre 1920 et 1925, ponctuée par son arrivée à Harvard, la rencontre déterminante d’Aline Bernstein et un voyage en Europe.
Cela précisé, l’autobiographie se fait poème et roman dès les premières pages du livre, avec la scène des adieux du protagoniste à sa mère, et la prodigieuse évocation de son voyage en train.
Eugène Gant, double romanesque de Thomas Wolfe, et qui était déjà le héros de L’Ange exilé, quitte donc Altamont (Asheville en réalité) pour Harvard, non sans faire étape auprès de son père en train de mourir du cancer. Or, tout le livre sera marqué, conjointement, par le thème joycien de la quête du père et par la recherche d’une identité personnelle et nationale à la fois – car ce voyage au bout de soi-même, à travers les circonstances de la vie, les passions et les vices, les émerveillements et les désillusions, engage de surcroît la destinée de tout un peuple.
Qui sommes-nous, Américains ? se demande aussi bien Thomas Wolfe. Et la question ressaisira toute l’énergie de l’écrivain, persuadé de cela que l’œuvre à faire participe d’une aventure propre au Nouveau-Monde.
Peu connu des lecteurs de langue française, et d’abord parce qu’il fut exécrablement traduit, Thomas Wolfe demeure également, aux Etats-Unis, le grand oublié de la littérature contemporaine. Evoquez son nom dans les universités ou les milieux intellectuels américains et vous verrez quelle petite moue supérieure on opposera à votre enthousiasme.
C’est qu’il est assurément problématique, pour ceux qui accoutument de disséquer les textes, de se faire à ce titan romantique et fort indiscipliné dans ses constructions, dont les élans ne vont pas toujours sans emphase ou répétitions. Au demeurant, seul l’aveuglément ou la méconnaissance peuvent expliquer le terme de « logorrhée » dont on a parfois taxé son style, d’une fermeté et d’un éclat où nous voyons surtout, pour notre part, l’expression de la meilleure vitalité, au temps où le rêve américain faisait encore rêver…
Editions L’Age d’Homme, Le temps et le fleuve, 582p. L'Ange exilé a été réédité, également à L'Age d'Homme, où l'intégralité de l'oeuvre devrait paraître.
Une suite poétique en triptyque fondateur
On croyait avoir tout lu de W.G. Sebald, disparu prématurément en 2001, à l’âge de 57 ans, enfin disons l’essentiel, à savoir Les émigrants, Les anneaux de Saturne, Vertiges et Austerlitz, et de fait, en dépit de leurs grandes qualités respectives, l’essai intitulé De la destruction, traitant du châtiment infligé aux Allemands par le feu du ciel des Alliés, et la suite de digressions critiques réunies dans Séjours à la campagne, relevaient un peu des marges de l’œuvre, mais qui aurait pu s’attendre, à part les germanophones avertis, à ce qui nous arrive aujourd’hui en traduction par la grâce de Sibylle Muller et Patrick Charbonneau ?
Or ce livre est LA première source de l’oeuvre et LE premier grand arpentage du monde et du temps de W.G. Sebald, comment dire ? C’est à la fois un paysage à multiples replis et déplis et la traversée de trois vies qui s’y logent et y bougent (la vie du peintre Grünewald, la vie du naturaliste voyageur Georg Wilhelm Steller, et la vie de W.G. Sebald lui-même), et c’est autre chose encore flottant entre les deux infinis de Pascal, plaçant le lecteur dans la position du personnage tout pensif d’un tableau fameux de Caspar David Friedrich.
Il y a beaucoup de très fine peinture, à la fois naïve et savante comme les maîtres anciens savaient la faire sous de doux glacis, et beaucoup de romantisme aussi, paradoxalement, dans ce livre dont la tristesse irradie une lumière que connaissent les lecteurs de Sebald, mais ici à un état de concentration rare.
La poésie de Sebald est narrative, et ce sont trois récits qui se donnent ici en triptyque sous trois titres qui chantent aussi bien. Comme la neige sur les Alpes est celui de la somnambule pérégrination à genoux ou à cheval de Grünewald, dont il est question ici comme chez aucun historien de l’art…Et que j’aille tout au bout de la mer nous emmène au bout de la terre en compagnie d’un luthérien allemand sans dieu, la bouche asséchée par le sel des planètes ; enfin la sombre merveille intitulé La nuit fait voile nous plonge au cœur des ténèbres de l’Allemagne où fut conçu W.G. au moment où Dresde s’effondrait sous le tonnerre des Justes…
Cela n’a rien à voir mais j’ai retrouvé, en lisant D’après nature, le mélange de sapience et de saveur, de miel et d’épices, de pollen et de tabac, de silence et de bruit du temps que j’ai goûté en découvrant un jour Le sceau égyptien de Mandelstam, par exemple. Surtout, je me suis retrouvé, sans les documents photographiques, dont on n’a pas besoin ici tant le texte est déjà saturé d’images, dans l’univers à la fois enveloppant et perdu de Sebald. Ce ne sont ici que de premières notes. Je vais parler et reparler de ce livre d’une sombre beauté et d’une lancinante musique pensée…
 W.G. Sebald. D’après nature. Poème élémentaire. Traduit de l’allemand par Sibylle Muller et Patrick Charbonneau. Portrait de W.G. Sebald: Horst Tappe.
W.G. Sebald. D’après nature. Poème élémentaire. Traduit de l’allemand par Sibylle Muller et Patrick Charbonneau. Portrait de W.G. Sebald: Horst Tappe.

(En mémoire de Gemma S.)
Qui fait que la vie soit comme ça ?
Qui peut vouloir cela ?
Quel début de grand mal au cœur ?
Quel massacre initial ?
Combien d’enfants sacrifiés
pour la beauté du chant ?
Quel délire animal ?
Quel Dieu pervers l’aura conçu,
ce monde tout déchu?
Ou quel démon tordu ?
Et faut-il donc tolérer ça:
qu’une folle l’inscrive ?
en mots de sanglante salive ?
Que fait donc la police ?
Qui parle par cette bouche louche ?
Qui réclame justice
en se parant des rhétoriques
d’une langue de fiel
transmuée en musique ?
Qui fait ainsi la nique au ciel ?
Quelle cinglée ose dire
que savoir aimer c'est mourir,
et conclure que belle est la vie ?
Peinture: Joseph Czapski


William Cliff en son Immense existence
On embarque d’abord sur le tram de Nantes en se rappelant celui de la Nouvelle Orleans se démantibulant entre les stations Désir et Cimetière, mais à Nantes « les gens fument les gens absorbent du café/les gens boivent les gens mangent beaucoup de viande/ils mangent la chair des bêtes qu’ils ont tuées », et c’est parti pour un tour de manège dans la vie de tous tous les jours, avec au ciel les oiseaux « qui chantent à Nantes /à gorge triomphante l’Existence Immense… »
Immense est l’amour, immense l’angoisse du poète qui vague et divague de ville en ville, revenant sur les traces de tel amour, rue des Feuillantines, attendant un bateau du Destin dans un fjord du nord ou se rappelant un souvenir de Vienne « dans une autre vie quand j’avais la beauté dans le corps et la bêtise en tête / la seule chose qui me reste c’est la marche /pour mesurer l’espace où le temps est passé. »
Ainsi marche-t-on de nuit en nuit et par les années, de Porto Rico à Venise (« restons un peu ici pour oublier la vie réelle »…) ou de Pétersbourg « en fin de soirée » aux escaliers de telle gare que dévalent les jeunes ouvriers belges qui « pour soulager leur jeune corps très affamé » mordent « les bonbons comme on mord dans un corps »…
En passant par Atlanta William Cliff a noté sur un bout de mémoire : « avec la maladie il a trouvé la vie / avec la souffrance il a trouvé la grandeur / avec le voyage il a trouvé la folie / du pauvre genre humain affamé de bonheur », mais déjà il est ailleurs, à Bénarès où la peur de la nuit se dissipe « parce que la nuit / tout le monde n’est plus qu’une ombre », déjà le rattrapent ses souvenirs de Namur « où il a tant souffert », et pourtant si le temps fout le camp lui « reste la marche / pour mesurer l’espace où le temps est passé »
C’est une âme assoiffée d’âme que William Cliff, un corps brûlant de se brûler au corps à jamais fuyant de l’introuvable, un frère de Villon et de Genet, comme celui-ci resté l’enfant de chœur des ronciers et le voilà qui chante Mélancolie, sur un dessin de Frédéric Pajak :
et que le ciel béant me tombait sur la tête
et que la mer autour murmurait pour venir
lentement m’enfermer dans sa marée pourrie
quand avec ma culotte infecte et ridicule
je montrais mes genoux cagneux et que j’étais
un insecte perdu dans l’humeur infinie
des adultes mauvais qui crachaient leurs blasphèmes
alors je m’arrêtais un instant sur la grève
et je portais ma main sur ma figure pour
ne plus voir l’horreur d’être né sur cette terre
et d’attendre toujours que se lève le jour…
Sombre et mélancolique , âpre et limpide à la fois, déployée comme un récit de vie aux tristes bonheurs et aux cinglants malheurs transfigurés par un verbe dur et doux, doublement relié à l’intime et au cosmos : telle est la poésie de William Cliff en son Immense existence…
William Cliff. Immense existence. Gallimard, 130p. Dessin de Frédéric Pajak.

Le mot DANSE m’apparaît ce matin, et tous les mots se mettent à danser avec l’enfant, petite, toute nue et belle dans un long foulard de soie flottant autour d’elle, là-bas sur le haut gazon de la maison de vacances comme suspendue au-dessus des mélèzes, dans l’air frais et bleuté des glaciers, toute seule à danser pour la première fois comme elle a vu, l’autre soir à la télé, l’immatérielle Isadora dans un film d’un autre temps, qui dansait et dansait en ne cessant de danser et danser.
Je serais Isadora et je danserais et danserais, semblaient alors dire tous les gestes et les mouvements de l’enfant à sa danse, seule là-bas sur le haut gazon et sans voir qu’elle était vue, sans s’en soucier nullement d’ailleurs, tout à sa danse, gracieuse et rieuse, tout à son geste et à son mouvement de danser et danser.
Or ce geste et ce mouvement, je le revis à présent les yeux fermés, ce geste et ce mouvement de cette première danse de l’enfant sont l’émanation même de la geste en mouvement de l’enfance et tout commence à tournoyer, dans le geste et le mouvement du temps, et me revient toute la grâce de cette après-midi dans l’absolue fraîcheur de l’été sous les glaciers dont les eaux tombées du ciel semblent se répandre sur les épaules des prairies suspendues, me revient toute l’émouvante beauté de cette enfant qui danse quasi nue et trouve, invente, se plie et se déplie dans la lumière intemporelle de cette après-midi d’innocence – et le soir, pour la première fois, le soir la petite dans son cahier de mots, la petite écrira le mot DANSE.
Mais à cet instant-là, tandis qu’elle dansait et dansait sur la pelouse, toute grâce et presque nue, l’homme et la femme, plus que nus ceux-là, la regardaient et dansaient et dansaient sans être vus, dansaient en houle et en foule de gestes et de mouvements, et le soir le père guiderait la main de l’enfant pour écrire le mot DANSE qui contient la chose, et la mère, peut-être, contenait depuis ce jour un nouvel enfant dont le père conduirait, peut-être, un jour, la main pour écrire le mot CHANT, un jour elles seraient deux enfants à danser et la mère et le père revivraient, tant d’années après, cette danse infinie de la geste d’enfance.



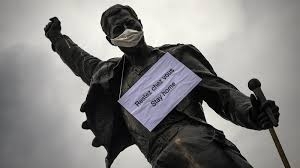

À Montagnola, ce 15 août 2002. - A l’instant, sortant du musée Hermann Hesse et me retrouvant à la terrasse jouxtant l’arrêt de la poste, ma bonne amie m’apprend, sur mon portable, que maman a été victime ce matin d’une hémorragie cérébrale. Elle est tombée en se lavant et ma soeur l’a trouvée gisant sur le carrelage vers midi, avant d’appeler l’ambulance. Elle est depuis lors dans un coma que les médecins disent irréversible, et ses heures semblent comptées. J’annule aussitôt mon voyage en Bretagne et je rentre. Le sommelier doit se demander quel chagrin d’amour me fait ainsi chialer sur mes trois décis de Merlot.
°°°
Ma petite mère qui regarde, me suis-je dis tout de suite, du côté de son amoureux dont elle est séparée depuis presque vingt ans. Ma petite maman de samedi dernier dans sa robe bleue et avec ses cheveux coupés courts, comme jamais elle avait osé, et qui lui allaient si bien. Ma petite innocente qui va rejoindre son innocent...
De la solitude. – Tu me dis que tu es seule, mais tu n’es pas seule à te sentir seule: nous sommes légion à nous sentir seuls et c’est une première grâce que de pouvoir le dire à quelqu’un qui l’entende, mais écoute-moi seulement, ne te désole pas du sentiment d’être seule à n’être pas entendue alors que toute l’humanité te dit ce matin qu’elle se sent seule sans toi…
Je me souviens...
(Noté dans le train du retour)
Je me souviens d’elle dans la cuisine de la maison, auprès de l’ancien petit poêle à bois, tandis que je regardais les photos du Livre des desserts du Dr Oetker.
Je me souviens d’elle en bottes de caoutchouc, maniant une batte de bois, dans la buée de la chambre à lessive.
Je me souviens de ses photos de jeune fille en tresses.
Je me souviens d’avoir été méchant avec elle, une fois, vers ma quinzième année.
Je me souviens de sa façon de nous appeler à table.
Je me souviens de son assez insupportable entrain du matin, quand elle ouvrait les volets en les faisant claquer.
Je me souviens de ses angoisses lorsque sa fille cadette ou son fils aîné furent accidentés dans le quartier. Son «Mon Dieu!» au téléphone.
Je me souviens de sa façon de dire «pendant la guerre».
Je me souviens quand elle nous lisait Papelucho, la série des Amadou ou Londubec et Poutillon.
Je me souviens de l’avoir surprise toute nue, une fois, en entrant par inadvertance dans la chambre à coucher des parents: je me souviens de sa forêt...
Je me souviens de nos dimanches matin dans leur lit.
Je me souviens de sa façon de nous seriner l’importance de l’économie.
Je me souviens de sa façon de critiquer l’avarice de Grossvater, tout en prônant l’économie.
Je me souviens du chalet de Grindelwald.
Je me souviens de la maison de pierre de Scajano.
Je me souviens de nos baignades à Rivaz.
Je me souviens de nos pique-niques en forêt.
Je me souviens du grand baquet de bois, pour les grands, et du petit baquet de fer, pour les petits.
Je me souviens de la lampe de chevet que lui avait offert, sur ses patientes économies (une pièce de cent sous après l’autre), un ouvrier de chez Schindler, où elle était comptable et qui l’avait à la bonne.
Je me souviens de son explication rapport aux «pattes» qu’elle suspendait à la lessive: ...
Je me souviens de sa discrétion (timidité) et de son indiscrétion (naïveté)
Je me souviens de sa lettre à Kaspar Villiger, ministre des finances.
Je me souviens de ses bas opaques.
Je me souviens de ses larmes.
Je me souviens du cahier jaune qu’elle a rédigé à mon intention après la mort de papa.
Je me souviens de sa façon de me recommander de ne pas trop travailler.
Je me souviens de sa façon de faire les comptes.
Je me souviens de sa façon de préparer les «paie» de nos filles.
Je me souviens de ses récents trous de mémoire.
Je me souviens de ses chèques Reka.
Je me souviens de sa querelle, à propos de la facture de l’entretien d’une pierre tombale de sa belle-mère que sa belle-soeur ne voulait pas l’aider à régler.
Je me souviens de ses rapports délicats (voire indélicats) avec sa belle-fille Ruth et avec son beau-fils Ramon.
Je me souviens des petits repas de nos dernières années, au Populaire ou à Sauvabelin, où elle me recommandait toujours de ne pas «faire de folies».
De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais…
Au CHUV, ce 16 août. - Seul au chevet de maman qui me fait un peu la même drôle de tête que le pauvre Edouard la veille de sa mort, mais plus paisible à vrai dire, lâchant de temps à autre un râle, mais sans signe visible d’aucune souffrance. Ai pris quelques photos. Essayé de prier, mais pas bien réussi je crois. Pense beaucoup à tout ce que nous avons vécu. Très reconnaissant dans l’ensemble. Regrette un peu de ne pouvoir lui parler, comme à papa le dernier jour, mais sa fin sera paisible comme elle le souhaitait.
Un jeune médecin très doux vient de passer. Me dit que ma mère va probablement s’éteindre comme une flamme déclinante. Pourrait faire des poses respiratoires, puis cesser de respirer tout à fait. En tout cas formel: aucun espoir de rémission.
L’humour noir de la situation: se dire qu’elle dort pour toujours, mais plus pour longtemps...
Au CHUV, ce 17 août, 6h. du matin. - Passé la nuit à l’hôpital. La vaillante continue de respirer. Très belle journée d’été en perspective, comme elle les aimait. Lui proposerais bien d’aller se balader au bord du lac ou par les forêts, mais plus jamais. L’air paisible au demeurant. La survie semble devenir «question de jours», mais en moi nulle impatience. Lui ai dit que ça avait été bien d’être son fils et leur fils. Lui reproche un peu d’être là et pas là, mais elle ne bronche pas.
Ma mère ne lira pas mon prochain livre, mais c’est pour elle que je le fais. Des choses qu’on ne réalise pas vraiment: sa mère sur son lit de mort.
Au CHUV, le 18 août. - Encore une journée divine. Maman repose sur le dos, la bouche grande ouverte, soufflant plus fort et de manière plus saccadée qu’hier. Me dis que le corps est plus et moins que le corps, mais où est la frontière ? Plus que le corps en cela qu’il déborde de ses limites apparentes, et moins que le corps en cela qu’il ne fera pas ce que n’imagine pas notre esprit.

Pascal disait que l’homme du futur aurait le choix entre la foi et le chaos. Or, on en est actuellement au simulacre de foi, qui ajoute au chaos.
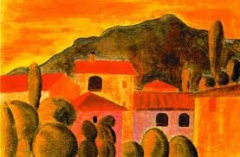
À La Désirade, ce 20 août. - Réveillé ce matin par sa présence. Grande tristesse et flot d’images. Pensé à elle et à tout un monde bon et régulier qu’elle représente à mes yeux. Puis la vision du Matin me rappelle quelle saleté peut être l’humanité. Deux adolescentes ont été assassinées en Angleterre, qui provoquent l’hystérie de la presse à scandale. De cela justement qu’elle avait assez, me disait-elle souvent : de cette saleté du monde.
(15h.-17h.) Toujours à son chevet. Ma sœur Liselotte me dit, non sans humeur, que c’est la première fois que notre mère ne fait pas «vite», selon son expression : «vite» que j’aille en commissions et «vite» que je fasse le frichti.
Diversion. - Autre moment comique pendant que j’attendais dans le couloir: dans une cellule de verre, un jeune médecin neurologue s’entretient avec un vieil oiseau déplumé. «Répétez, Monsieur Duflon: Je prépare mes affaires pour aller me baigner à la piscine. Répétez». Mais le vieux ne répète rien du tout, se contenant de marmonner sans discontinuer. Or le médecin ne désarme pas, mais après trois ou quatre vaines tentative, le voilà qui s’impatiente: «Répétez, Monseiur Duflon: le docteur est un imbécile. Répétez». Mais là encore, la proposition semble tomber à plat. Quant à moi, je suis soulagé à l’idée que maman ait échappé au labyrinthe de l’égarement mental…
Au CHUV, le 23 août. - «Il faut vous attendre à ce que ça se prolonge», me dit-on l’air compatissant. Ainsi la formule «elle risque de mourir» devient «elle risque de vivre». Mais je me sens ces jours comme hors du temps, ou dans un temps déplié come une carte du ciel, où nous sommes si petits.
Celui qui a peur de la nuit / Celle qui rêve qu’elle s’endort enfin / Ceux qui aiment le noir astral, etc.
À La Désirade, ce dimanche 25 août. - Ma sœur m’appelle pour me dire que l’infirmière de garde du CHUV lui a annoncé que maman allait nous quitter. À 13h. Liselotte, qui a eu le temps de la rejoindre à son chevet, m’apprend la mort de maman. Annette, notre sœur aînée, et elle étaient présentes. Je reste seul avec mes larmes.
J’ai toujours été attiré par la tristesse. Non seulement j’ai le don des larmes, mais j’en ai le goût.
De l’attention. – Si le monde, la vie, les gens – si tout le tremblement te semble parfois absurde, c’est que tu n’as pas bien regardé le monde, et la vie dans le monde, et que tu n’as pas assez aimé les gens dans ta vie, alors laisse-toi retourner comme un gant et regarde, maintenant, regarde cela simplement qui te regarde dans le monde, la vie et les gens…
À La Désirade, ce 26 août. - Mon travail pour le journal m’a occupé et distrait depuis la mort de maman, mais ce soir le chagrin, le tout gros chagrin m’a assailli sur l’autoroute, au point que je ne voyais plus où j’allais.
°°°
Passé cet après-midi à la chapelle no 10 du Centre funéraire de Montoie, où maman reposait derrière une vitrine. Elle avait, dans son cercueil, un air et une posture que je ne lui ai jamais vus, de très digne noble duègne espagnole peinte par Goya, mélange de dignité et de sérénité, la peau lisse comme de la pierre et les traits du visage bien détendus, les cheveux bien coiffés, les mains jointes d’une manière un peu forcée. C’est donc une troisième dernière image que je conserverai d’elle, après la petite dame en bleu du divan aux cheveux coupés courts qui lui allaient si bien, et la mourante sur son lit d’hôpital aux airs tour à tour paisibles et tourmentés.

Questions. - Où est-elle maintenant ? Est-elle tout entière disparue ou survit-elle d’une manière ou de l’autre ? Sera-t-elle réduite à cette poignée de cendres que nous allons déposer en terre à côté de la poignée de cendres de son cher et tendre, ou ce qu’on appelle leur âme poursuit-elle quelque part une existence différente, à part leur existence survivant en nous ?
De rien et de tout.- En réalité je ne sais rien de la réalité, ni où elle commence ni si elle avance ou recule, pousse comme un arbre ou gesticule du matin au soir comme je le fais – ce que je sais c’est juste que tu es là, qu’ils sont là et que je suis là, à écouter cette voix de rien du tout mais qui nous parle, je crois…
(Ces pages sont extraites de Chemins de traverse, Lectures du monde 2000-2005, paru en avril 2012 chez Olivier Morattel.)
Images: La mère, de Lucian Freud. Hermann Hesse au chat. Aquarelles de Hesse et JLK.
 En (re)lisant Le scorpion...
En (re)lisant Le scorpion...
C’est un écrivain souvent mal compris que Paul Bowles, paré d'une légende plus ou moins glamour et qui relève au contraire d'une littérature de la surexactitude implacable, comme l'illustrent les nouvelles réunies dans Le scorpion, dont la lecture procure un voluptueux effroi. On croirait y redécouvrir le monde avec les yeux d’un animal ou de quelque primitif. Tout y est comme déplacé par rapport à nos représentations mentales ou morales ; ou plus précisément, tout y est décentré, et ce changement de point de vue nous permet soudain de concevoir, avec un double frisson physique et psychique, l’extrême minceur de la cloison séparant l’état de nature de la civilisation, et le caractère tout relatif de nos convictions les plus profondes. Le sentiment est familier à tout voyageur un tant soit peu attentif, mais en l’occurrence il s’impose au lecteur avec l’intensité trouble de la fascination communiquée, ressortissant à la position même de l’écrivain, qui m’évoque tantôt un oiseau de proie et tantôt un serpent, avec une capacité de se glisser dans chaque peau comme cet esprit migrateur qu’il décrit dans La vallée circulaire.
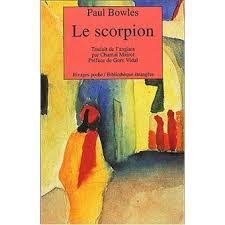
Il y avait de cette objectivité cristalline de vieux lézard altier chez Somerset Maugham, ce même quelque chose de romain et d’impérial (j’entends: de l’empire) qu’on retrouve aussi chez Gore Vidal, et cette même distance qui les sépare tous trois du christianisme. De fait, Bowles paraît complètement étranger à la morale et à la sentimentalité du monde chrétien. C’est un hyper sensitif endurci, avec ce regard implacable de l’enfant qui observe, yeux grands ouverts les paroissiens en train de prier, ou de l’entomologiste, ou plutôt de la mouche scrutant le monde de son oeil à facettes. Cela étant l’observation de Bowles n’est pas innocente. Ce qui l’arrête (et l’excite et le stimule), ces sont les chocs entre nature et culture, ou bien entre modes de vie hétérogènes, entre civilisations opposées, entre sexes, entre divers ages du même sexe.
Nous nous croyons le centre du monde, mais il suffit de parcourir celui-ci pour que nous soit infligé le plus cinglant démenti. Nous croyons avoir conquis la nature, jusqu’au moment où nous tombons entre les mains du présumé bon sauvage, comme il en va du linguiste candide d’En un pays lointain, qui fait figure de symbole. Ce professeur de linguistique, passionné par les variations de langues du Maghreb, et qui fait collection de jolies petites boîtes en pis de chamelle, bon connaisseur par conséquent de ces régions, néglige cependant, lorsqu’il s’en va, seul et de nuit, négocier auprès des redoutables Reguibat, de tenir compte de tout ce qu’il sait d’eux. Civilisé et pacifique, il imagine qu’il va pouvoir “observer” les pillards de plus près. Bon sujet de thèse, n’est-il pas ? Mais voici qu’il touche terre: qu’on l’assaille dès qu’il a mis le pied dans le ravin des nomades, lui coupe aussitôt la langue et le sangle bientôt dans une armure faite de boîtes de conserves, pour en user désormais comme d’un fou. Et le fait est que, finalement, le prof deviendra bel et bien foldingue. Une scène est prodigieuse, dans la nouvelle: lorsque ce malheureux entièrement assujetti, privé de langage alors que c'était sa raison d'être, rencontre un compatriote au cours d'une escale et l'entend parler anglais sans pouvoir lui faire comprendre qui il est ni ce qu'il est de quelque façon que ce soit. On a rarement mieux suggéré l'horreur de vivre en état d'absolue dépendance.
Une fois encore, au demeurant, la préoccupation de Paul Bowles n’a rien de moral. Simplement il observe. Connaisseur des lieux et des gens, il pratique l’understatement comme personne. Ainsi que le relève Gore Vidal, qui le tient pour l’un des plus grands écrivains américains de l’époque en formes courtes, Bowles “parvient à produire ses effets les plus magistraux quand il concentre entièrement son attention sur la surface des choses”. Enfin c’est un poète aux pouvoirs d’évocation saisissants, capable de suggérer tout un monde foisonnant et sauvage tout en restant cristallin, net et tranchant, dur et transparent comme le diamant.
Paul Bowles. Le scorpion (nouvelles). Rivages poche.
A lire aussi: L'écho et Un thé sur la montagne. Rivages poche.




La nouvelle série télévisée romande intitulée Cellule de crise en impose par sa performance technique label suisse. Mais à l’apparence toute lisse, voire froide de ce feuilleton aux situations souvent « téléphonées », heureusement humanisé par l’aura de quelques interprètes, s’oppose la constante et vibrante émotion de The Virtues, merveille du genre à découvrir sur ARTE.
Je me demande souvent ce qui distingue l’art de la fabrication, et j’en reviens toujours à cette conclusion qui vaut pour tous les domaines de l’expression humaine et dans toutes les cultures, qu’un mot dégagé de sa connotation théologique cristallise: la grâce.
La grâce distingue distingue le beau du joli, la grâce distingue le bon du sympa, la grâce distingue le vrai du vraisemblable, la grâce distingue enfin le juste du faux.
Tout cela est évidemment relatif, comme il en va de la distinction du bien et du mal aux yeux du binoclard batave Baruch Spinoza, mais c’est le plus bel exercice, au clavier de l’enfance de tous les âges, que de distinguer les touches noires des blanches, la gradation du do du dessous au do du dessus en passant par l’escalier de la gamme avant de plaquer des accords parfaits selon la technique ou d’esquisser une première mélodie sous l’effet imprévisible de la grâce.
Ce qui distingue l’art de la technique relève de la grâce. Il n’y a pas d’art sans technique, mais l’apparition de la grâce ou sa perception ne relève d’aucune technique, pas plus que ce qu’on appelle l’intuition ou ce qu’on appelle l’inspiration.
Cependant ce discours reste trop abstrait et général. Manque d’exemples et ensuite de nuances. Manque d’objets. Voyons donc ce qu’on a de plus récent, en magasin, aux rayons voisins de la fabrication et de l’art…
Un genre souvent sous-estimé parfois à tort…
Vous, je ne sais pas, mais pour ma part, me prenant peut-être trop au sérieux en tant que «pur littéraire» n’appréciant que le «grand cinéma », je me suis longtemps fait des séries télévisée une idée globalement négative à l’époque des Dallas, Dynasty et autres Urgences.
J’avais tort, et c’est un « grand » du cinéma, du nom de David Lynch, qui me l’a fait découvrir le premier en prouvant qu’on peut faire un film relevant de l’art touché par la grâce, tel Mulholland drive, et ne pas démériter avec une série du genre de Twin peaks.
Paradoxalement, ce n’est pas à la télé, que je ne regarde plus depuis une vingtaine d’années, voire plus (sauf quand je m’embête seul dans les hôtels ou les motels), que j’ai révisé mon jugement en visionnant, depuis quelques années, plus de cent cinquante séries de toutes espèces, mais sur mes divers écrans d’ordinateurs et en ne cessant de prendre des notes, comme il en irait de films d’auteurs ou de livres.
Un excellent conseiller, en la personne de Michael Frei, tenancier de la boutique vidéo lausannoise Karloff (hélas disparue depuis lors) m’a permis d’aller vite au meilleur du genre dont 99% de la production équivaut à de la daube molle selon mes critères.
Cela a commencé avec la mémorable série de docu-fiction intitulée The Wire (Sur écoute) signée David Simon et Ed Burns détaillant en 60 épisodes et sur 5 saisons les multiples aspects de la vie d’une grande ville américain (Baltimore), avec un mélange d’empathie humaine et de perspicacité documentaire qu’on retrouve dans la série des mêmes auteurs intitulé Treme parlant des séquelles de l’ouragan Katrina à La Nouvelle Orléans.
Même si l’on oublie à peu près tout d’une série après l’avoir vue, ce qui nous arrive aussi d’innombrables romans lus, je dois dire que ma connaissance du monde et des gens, des milieux sociaux variés et des sentiments éprouvés par mes semblables s’est pas mal enrichie à la vision de séries aussi différentes les unes des autres que Breaking bad (un chimiste bon père qui réussit un peu trop dans la fabrication de la drogue), de Borgen (une premières ministre danoise et ses tribulations personnelle), de Suits (le micmac des cabinets d’avocats à New York), d’Occupied (récit dystopique d’une invasion de la Norvège par les Russes), de Black Mirror (satire carabinée du monde numérique), de Designated survivor (deux séries américaine et coréenne sur le même thème du remplacement d’un Président victime d’un attentat terroriste par un suppléant improbable), ou plus récemment des mini-séries de premier ordre telles Big Little lies (la maltraitance des femmes) ou The Virtues, pas loin en densité émotionnelle et esthétique d’un chef-d’œuvre de cinéma ou de littérature à la Ken Loach ou à la William Trevor.
Il fut un temps où il eût été inimaginable que la critique littéraire «sérieuse» se penchât sur le contenu des romans dits «de gare» et autres sous-genres du policier et de la science fiction, ou que les spécialistes de cinéphilie accordassent la moindre attention aux feuilletons télévisés.
Or il en va tout autrement aujourd’hui, où le journalisme culturel, plus souvent complaisant qu’à son tour, adapte ses critères à ce qui «cartonne» alors même que la qualité se noie dans la quantité ; mais tout ne va pas pour autant dans le seul sens de la massification et de la facilité, car les techniques se sont affinées et les individualités réellement créatrices – souvent aussi rassemblées en collectifs dans la production des séries – continuent ici et là de nous surprendre, avec des îlots de grâce dans l’océan standardisé.
Une machine rutilante, mais encore ?

Techniquement parlant, la nouvelle série suisse romande intitulée Cellule de crise, à voir ces jours sur la RTS et via Internet, est un objet rutilant qui en jette autant que le jet d’eau de Genève, d’ailleurs omniprésent, sur fond d’âpres reliefs yéménites filmés (il me semble) en Espagne, comme certains westerns. De flamboyantes images extérieures (vues du ciel comprises à drones que veux-tu, comme il en va des séries hollywoodiennes ou bollywoodiennes) en intérieurs clinquants, la Geneva international est là autant que Jedda la saoudite ou Sanaa la yéménite, sans oublier le camp de réfugiés aussi propre sur lui que les stalags de la Liste de Schindler. Cela pour le décor.
Quant au scénario et à sa thématique, combinant la géopolitique et le feuilleton sentimental, il développe un véritable catalogue de «sujets porteurs» qui vont de l’attentat terroriste initial (une peluche explosive tuant le président d’une agence humanitaire en posture de se faire un selfie sympa avec une petite fille) à l’amour lesbien, de la prise d’otages à l’adultère inter-ethnique, de la gabegie politique au Moyen-Orient aux trahisons personnelles pour cause d’arrivisme, de la corruption des pouvoirs (le boss pourri du football mondial) à l’abjection des nuls qu’incarne, tiens, un journaliste relevant de la caricature.
Dans cette mixture de violence géopolitique et de sentimentalité de romance, les thèmes intéressants du projet (notamment la face sombre de l’humanitaire, les jeux de pouvoir multiples et ce que Georges Haldas le Genevois appelait le «meurtre sous les géraniums » se diluent hélas, d’un épisode à l’autre, dans un schématisme politique simpliste, et, pour ce qui concerne les personnages principaux, a priori intéressants et bénéficiant d’interprètes de premier ordre, dans la psychologie la plus superficielle.
Sans une once d’humour et avec des raccourcis narratifs peu crédibles (notamment dans l’imbroglio mélodramatique lié au « terrible secret » du personnage assez tordu qu’incarne André Dussollier, remarquable au demeurant, ou les retrouvailles du clone de Sepp Blatter interprété par Jean-François Balmer et de sa fille cachée au grand cœur humanitaire, campée avec non moins d’intensité par Isabelle Caillat), la mini-série de Jacob Berger (réalisateur) et de ses co-scénaristes François Legrand et Philippe Safir pèche donc, à mes yeux, par manque de sérieux (ou de courage, s’agissant de l’image édulcorée de l’Arabie saoudite) et plus encore de fibre sensible et d’émotion.
Entre douleur pure et beauté du pardon

La découverte, en même temps que celle de Cellule de crise, des quatre épisodes de la mini-série anglaise The Vertues, m’a fait l’effet opposé de celle-là même si le canevas dramatique de départ relève aussi, d’une certaine façon, d’un schéma déjà-vu (l’enfance souillée), notamment dans Mystic river de Clint Eastwood, Philomena de Stephen Frears ou L’Enfance volée de Markus Imhof.
Pour l’essentiel, cependant, comme il en va de tout drame humain ressaisi en profondeur, l’histoire de Joseph, protagoniste de The Virtues merveilleusement interprété par Stephen Graham, ne ressemble à rien tout en revêtant un caractère universel. Le réalisateur Shane Meadows, déjà connu pour This is England, a transcrit dans cette série sa propre douleur longtemps inavouée, restituée ici avec autant de réalisme que de poésie.
Ladite histoire a commencé bien avant que, bouleversé, Jo prenne congé de son petit garçon et de la femme que son alcoolisme maladif a éloigné d’elle, en route pour l’Australie avec le beau-père de remplacement de son fiston: quand, à peu près au même âge que celui-ci, il s’est fait violer par un camarade plus âgé dans l’institution où ses aïeux l’ont casé après la mort accidentelle de ses parents. Fuyant son abuseur et l’internat en question, il s’est réfugié chez une parente de Liverpool et, trente ans durant, sa famille irlandaise le croyant mort depuis longtemps, il n’a cessé de se fuir lui-même sans révéler à quiconque son douloureux secret.

Après le départ de son ex et de son fils, une nuit de biture alcoolique aussi follement joyeuse que désespérée le fait décider de tout plaquer et de regagner l’Irlande du nord où il va retrouver sa sœur mariée à un brave type dont la sœur déjantée, au prénom de Deonna, a vécu elle aussi sa galère en fille-mère de quinze ans dont le gosse lui a été arraché.
Bref: de quoi faire pleurer dans les chaumières ? Bien plus, car, sur fond de mélancolie lancinante (paysages d’une triste beauté à se pendre, et musique de P.J. Harvey à l’avenant), les quatre épisodes, portés par des acteurs d’une formidable vitalité, aussi drôles qu’émouvants, nous arrachent aux conventions stéréotypées des feuilletons pour nous confronter à la vérité vraie de la vie.

Point d’orgue de The Virtues, dont les personnages les plus avariés (le violeur de Jo retrouvé sur son lit de vieux pirate mourant sous un crucifix, et la mère bigote de Deonna) défient toute compassion: c’est pourtant un mouvement final de pardon, dénué de toute suavité convenue, qui en oriente les dernières séquences, rappelant cette grande instance clémente des pièces historiques de Shakespeare, évoqué par Peter Brook dans son éloge du Big Will intitulé La qualité du pardon…
Peter Brook, La qualité du pardon, traduit de l’anglais par Jean-Claude Carrière. Seuil, 2014.

À propos d'un recueil de Dialogues inoubliés assortis d'une anthologie sélective, aux bons soins de Gilberte Favre, amie et fille en esprit du poète.
Maurice Chappaz me dit un jour (ou plus précisément un soir d'hiver, dans son arche hors du temps de l'Abbaye du Châble. en janvier 2007) que l'inattention constituait, à ses yeux, l'un des grands péchés de notre époque.
Cette sentence doit -elle figurer au nombre des paroles inoubliables du poète, gravée sur la plus vénérable ardoise ? Peut-être pas, mais je la constate inoubliée, elle fait partie de ce que je me rappelle de Chappaz, de sa présence, de sa voix, de son écoute et de ses réponses à mes questions, de son regard sur le monde et de ce qu'il en disait en son grand âge de témoin d'un siècle chaotique; et je suis content, ce dimanche de décembre 2016, de retrouver cette même voix et ce même regard - cette même attention aimante non moins qu'intransigeante dans les Dialogues inoubliés de Gilberte Favre, manifestant elle aussi autant d'attention que d'affection et d'admiration fervente pour Maurice Chappaz.
Dans sa préface à l'ouvrage qu'il se dit heureux de publier l'éditeur Michel Moret souligne les qualités partagées par Gilberte Favre et ses amis aînés Corinna Bille et Maurice Chappaz, à l'enseigne d'une manière d'être commune: "Une même qualité de sensibilité, une même innocence, un même étonnement, un même rapport à l'enfance."

Or cette profonde connivence ne fait pas pour autant, des Dialogues inoubliés de Gilberte Favre et de Maurice Chappaz, un échange privé dont le lecteur serait le témoin extérieur voire exclu, tant ils s'inscrivent dans notre vie à tous et sont filtrés aussi, par la parole de l'écrivain et le truchement de ses livres.
"Lire Chappaz, dit encore très justement Michel Moret, c'est découvrir un univers où les mots du poète sont réparateurs et privilégient la beauté ".
Francis Ponge disait quelque part que le poète est au monde pour réparer les mots dans son atelier, et cette attention au langage juste et bon se retrouve dans les réponses de Maurice Chappaz sur les thèmes distribués dans ce livre: de l'engagement de l'écrivain, de l'éveil et de la marche inspiratrice, de l'angoisse existentielle et de l'écriture, du voyage et des femmes aimées Corinna et Michène notamment.

Terrien catholique, à la fois ancré dans une tradition séculaire de descendant de paysans médiévaux ou même antiques (Jacques Chessex m'a parlé de lui comme de "notre Theocrite"), Maurice Chappaz n'a jamais cotisé pour aucun parti politique, et pourtant il s'est fait haïr dans son canton pour son combat têtu de défenseur de l'environnement avant l'heure, et plus précisément avec le pamphlet poème intitulé Les maquereaux des cimes blanches où il s'en prenait aux promoteurs bradant le Valais et aux affairistes de tout poil. Et de rappeler à sa jeune amie émule que "le citoyen ne se sépare pas du poète " et que "La marginalité juste et profonde ne se sépare pas d'une insertion".

Cette insertion est à la fois celle d'un aventurier bohème propriétaire terrien moins paradoxal que ne pourraient le croire les philistins de l'établissement ou de la révolution à la petite semaine. L'étonnante correspondance de Maurice Chappaz et Corinne Bille, publiée cette année chez Zoé , illustre magnifiquement, à cet égard, le double aspect non conformiste de la chevalerie poétique vécue par le couple et ses amis en leur jeunesse et la prise en charge plus prosaïque d'une famille et d'un patrimoine défendu avec une rigueur, voire une âpreté qui pouvait faire passer Chappaz pour un rapiat.
Gilberte Favre parle quant à elle de la bonté de l'homme et cite telle attitude généreuse envers un malheureux de sa connaissance, ou de sa présence amicale aux moments difficiles qu'elle a vécus elle-même - mais c'est au-dessus de ces contingences, ou plus exactement au cœur de l'existence cernée de mystère, face aux verrous et dans la pleine conscience du mal qui court, qu'elle rassemble enfin la parole du poète en fines gerbes dans son anthologie subjective reflétant son propre besoin de lumière et d'attention aux sources: minutes heureuses et citations pour la route:
Sur la poésie
"La poésie est le présent divin / par d'autres nommé amour / son corps est comme le miel des abeilles.
(Verdures de la nuit. Mermod, 1945. Fata Morgana, 2004 )
Sur l'amour
"Je n'ai absolument pas su ce que c'était que l'amour ni en étant aimé ni en aimant".
(La pipe qui prie & fume. Conférence, 2007)
Sur la condition humaine
"Nous portons en nous l'agonie de la nature et notre propre exode".
(Testament du Haut-Rhône. Rencontre, 1953. Fata Morgana, 2003.)
Sur le monde
"Un certain Occident durera moins qu'un conifère".
(L'océan. Empreintes, 1993)
Sur l'écriture
"La vie c'est l'écriture de l'écriture et l'écriture c'est la vie de la vie".
(Le livre de C. Empreintes, 1986, Fata Morgana, 2004)
Sur la sagesse
"Quel est donc parmi les savants / celui qui enseignera la tendresse ?"
(Le Valais au gosier de grive. Portes de France, 1960. Fata Morgana, 2008)
Sur la mort
"Sans la mort je n'aurais rien compris".
(Livre de C. Empreintes, 1986. Fata Morgana, 2007)
Gilberte Favre. Dialogues inoubliés. Editions de L’Aire, 98p. 2016.
Corinna Bille et Maurice Chappaz. Jours fastes, Correspondance 1942-1979. Editions Zoé, 1200p. 2016.


Une visite à Dominique de Roux, en 1972.
Comment situer Dominique de Roux, écrivain dans la trentaine, essayiste, polémiste et éditeur dirigeant actuellement les éditions de l’Herne, sur la scène littéraire française ? Imaginons-le du côté des moutons noirs de bonne famille, l’air à la fois très détaché de ce bas monde et cependant préoccupé d’y croiser le fer avec élégance, plein d’une morgue teintée d’ironie, tantôt amical et tantôt éclatant en foucades contre ce qu’il appelle les « ténèbres de l’imbécillité ».
Auteur de talent, il brille particulièrement dans l’essai (La mort de L.F. Céline, L’écriture de Charles de Gaulle, Gombrowicz) et dans la chronique fragmentaire regroupant des éléments de toutes sortes, d’ordre historique, politique, philosophique, poétique, au encore procédant de plus fugaces règlements de comptes à la parisienne. Ses formules sont fulgurantes, ses jugements sans appel, et sa langue, déliée ici, voire somptueuse, se décharne là jusqu’à l’os, pour s’improviser ensuite couperet ou main caressante, selon l’objet considéré. L’ouverture de la chasse, dans le genre vif, contenait ainsi de nombreuses réflexions sur le monde actuel et sur quelques artistes ou écrivains (Gombrowicz, Pound et Brancusi, notamment), l’auteur lâchant d’emblée quelques flèches empoisonnées aux enthousiastes des « Ides de mai » de l’an 68. Poursuivant la même démarche légère et nerveuse, son dernier livre, intitulé Immédiatement, est une manière de provocation à l’intelligence.
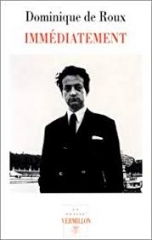
Dans son appartement du VIIe arrondissement, à une portée de mousquet du ministère des Armées, Dominique de Roux me reçoit très cordialement. La pièce où nous prenons place est tapissée de livres. On reconnaît le buste du poète Ezra Pound et le portrait dédicacé de Witold Gombrowicz. Grand seigneur, le maître de céans m’annonce que le temps de converser n'excédera pas une petite heure, après quoi il s’envolera vers l’Afrique...
« Voyez-vous, me dit-il alors, j’ai le sentiment que nous vivons dans un monde terriblement encombré, et c’est à lutter contre ce gavage d’oies que je travaille. L’oppression du capital est aussi grande que celle des pays de l’Est. Là-bas, au moins, c’est Goliath. On le voit. Mais ici, que faire ? Tout semble égal, et l’on perd peu à peu ses forces… »
- Cependant, vous publiez Immédiatement…
- Parce qu’il faut réagir, bien sûr ! Notez qu’avec ce livre, j’ai tenté de prendre une certaine distance par rapport à moi-même afin de penser ma situation dans la vie et dans l’idée, en contempteur. A cet égard, il me semble très important de développer, aujourd’hui, l’insolence et la polémique, bref : l’écriture de lutte.

« Identifier « le signe des temps » dont nous parlait, avec son exaltation politico-théologique, le pape Jean XXIII, et qui s’ouvre, subtilement, sur la profonde misère mentale d’une époque aliénée, anéantie par l’oubli de la vérité de l’être », c’est, aussi, à quoi s’ingénie Dominique de Roux dans son petit livre frondeur. Pour lui, il s’agit d’échapper à la « médiocrité apocalyptique » de ce temps et de rejoindre certains esprits demeurés libres, entre autres Gombrowicz à Vence à la fin de sa vie, ou Pierre Jean Jouve parvenu au « temps des vents inutiles ». Entre la jeunesse, dont le premier a prévu, après Kant, l’explosion (le fossé se creusant entre l’âge adulte selon la nature et l’âge adulte selon la culture), et l’état de maturité, Dominique de Roux s’attache à « dénominer le monde comme dans les rêves et les fulgurations », rejoignant à sa manière ceux qui ont choisi d’écrire – disent-ils – pour ne pas mourir.
- Les porteurs de chapeaux règnent, n’est-ce pas ? Chacun a son petit masque, que lui a collé la société, et chacun joue sa comédie là-dessous. L’horrible, alors, c’est le moment où les fils adolescents essaient d’imiter leurs pères…
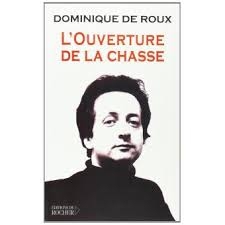
A ce propos, Dominique de Roux écrivait dans L’Ouverture de la chasse : « Les étudiants auraient dû innover. Les étudiants n’auraient pas dû confondre la France avec leur langage, ni écouter les claquettes des pauvres idiots, intellectuels bourgeois aux slogans dévastés, heureux qu’on les remarque, dans leur parodiques clameurs : Butor, Claude Roy ou maurice Clavel suivis de l’habituel congrès des signataires. C’était à qui coifferait le gros bonnet pour venir faire la pige aux bonzes des syndicats jaunes… »
Et de poursuivre ici :
- Il n’y a malheureusement, aujourd’hui, mon cher, que des oies et des âmes d’oies sur un capitole de fumier sec. Pour nous, ce qu’il nous reste, c’est d’incarner les « fils » aux yeux des générations montantes. »
Pour bien comprendre ces mots, il faut revenir au Gombrowicz de Dominique de Roux, peut-être son meilleur livre, et à sa recherche passionnée d’une jeunesse nue, non encore flagornée par les vieux moralistes ou par les vieux politicards : « Retrouver la réalité, aller vers le réel, l’élémentaire, vers la mort prévue de l’homme et vers l’homme secret qui vit encore, vers sa réapparition dans la forme nouvelle, dans l’éternelle jeunesse de l’antiforme éternelle ». Pour Dominique de Roux, c’est dans l’œuvre de l’exilé polonais qu’il fallait chercher les vrais insurgés « riches de leurs yeux tranquilles », les vrais fils soustraits à la stérilisation de leurs pères : « Quand l’absurde et la médiocrité apocalyptiques se paient du bon temps et prolifèrent dans la basse opulence d’une dégobillante Nouvelle Société Mondiale de la Technique, laquelle enfante à son tour ces masses surcrétinisées, cabotines, rendues à la mélasse des fondues originaires, tous les espoirs convergent vers le point lumineux des jouvenceaux primitifs de Gombrowicz ».
Mais au fait, nous n’avons pas encore hissé les couleurs : Dominique de Roux est-il de gauche ou de droite ? Sans doute les chiens de garde du troupeau n’auront-ils pas attendu le premier mot de l’intéressé pour lui coller les étiquettes de « réac », voir de « fasciste ». Et lui-même en aura rajouté par provocation : « Moi, Dominique de Roux, déjà pendu à Nuremberg ». Et d’ajouter : « Tout le monde aujourd’hui se sent débordé sur sa gauche à chaque instant. C’est une surenchère minable de tous les instants. On ne peut plus parler, on fait du bruit. Les couvercles de pianos ont remplacé les pianos ».
- Et la droite ?
- Des débris ! Des vieillards agitant des épouvantails et de jeunes flics. Je crois que l’engagement dans la réalité est aujourd’hui trop profond pour se laisser délimiter par les critères de « gauche » ou de « droite ». D’autant que celle-ci ne sera jamais forte que des abdications de celle-là. Pour ma part, je crois mille fois plus important de sauvegarder à tout prix ma liberté intérieure.
Dans sa conversation, autant que dans ses écrits, Dominique de Roux parle beaucoup des écrivains contemporains. Peu de respect chez lui pour les « pontes », dont il stigmatise la fuite en avant, à commencer par Sartre. Tandis que Malraux, selon lui, n’a pas la force de rester seul, et que Montherlant ne nous concerne plus, Genet portant son masque de maudit en espérant que les Palestiniens pourront en faire quelque chose…
- Et Céline ?
- Ah, Céline, c’était le nautonnier de Dante. Il avait déjà fait la traversée, lui. Mais maintenant il s’est éloigné de nous. Comme Bernanos, il a coulé avec son vaisseau…
- Et vous, pourquoi écrivez-vous ?
- Comme je tente de l’expliquer dans Immédiatement, il s’agit d’apprendre à vivre quotidiennement la tragédie profonde de sa propre disparition. Il faut pouvoir s’inventer pour soi-même une psychanalyse de soi-même. L’écriture est alors valable parce qu’elle s’installe dans son propre mensonge, se disant qu’elle est tout alors qu’elle n’est rien.
Cet entretien, partiellement retranscrit, a eu lieu à Paris en 1972 et a été publié dans La Feuille d'Avis de Lausanne, devenue 24 Heures. L’Ouverture de la chasse et Immédiatement ont paru aux éditions L’Age d’Homme et chez Christian Bourgois.

À propos de Lola, une femme allemande, de Rainer Werner Fassbinder.
Pour la comédienne et chanteuse Barbara Sukowa, magnifique interprète de Lola, ce film tourné en 1981, mal perçu à sa sortie, ne pouvait être compris qu'au moins dix ans plus tard, et sans doute a-t-elle raison, plus encore pour nous qui le (re)découvrons trente ans plus tard comme une espèce de classique hollywoodien dans la manière de Douglas Sirk - figure majeure des références de RWF - qu'on aurait pu, aussi bien, tourner la semaine dernière en Bavière. De fait, et comme il en va du Mariage de Maria Braun ou de L'Année des treize lunes, ce qui stupéfie aujourd'hui est le mélange de classicisme et de totale liberté formelle du film, dont le "collage" rompt complètement avec toute forme de naturalisme sans jamais pécher par "littérature" ou par abstraction cérébrale.  Ce qui apparaît mieux aujourd'hui, en outre, comme on a pu le constater du néo-réalisme italien sur la distance, c'est que la métaphore historique et sociale est d'autant plus lisible et pertinente, à l'heure qu'il est, que l'attente "didactique" d'un certain public cinéphile cède le pas à une approche plus libre et plus aiguë aussi, à proportion de l'aplatissement croissant du discours sur la réalité. En regardant Lola, une femme allemande, il m'a semblé retrouver l'esprit de fable limpide et radical de La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, qui installe la réflexion sur la corruption en plein bordel, quitte à détendre l'atmosphère. Or le plus étonnant est que, loin de flatter le cynisme ambiant genre "tout est pourri, rien à foutre", Fassbinder, comme Dürrenmatt, parvient à maintenir intacte la vérité des sentiments (la scène du retournement de situation, lorsque l'urbaniste Bohm craque devant Lola qu'il prétendait acheter) tout en maintenant ceux-ci en plein mensonge social.
Ce qui apparaît mieux aujourd'hui, en outre, comme on a pu le constater du néo-réalisme italien sur la distance, c'est que la métaphore historique et sociale est d'autant plus lisible et pertinente, à l'heure qu'il est, que l'attente "didactique" d'un certain public cinéphile cède le pas à une approche plus libre et plus aiguë aussi, à proportion de l'aplatissement croissant du discours sur la réalité. En regardant Lola, une femme allemande, il m'a semblé retrouver l'esprit de fable limpide et radical de La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, qui installe la réflexion sur la corruption en plein bordel, quitte à détendre l'atmosphère. Or le plus étonnant est que, loin de flatter le cynisme ambiant genre "tout est pourri, rien à foutre", Fassbinder, comme Dürrenmatt, parvient à maintenir intacte la vérité des sentiments (la scène du retournement de situation, lorsque l'urbaniste Bohm craque devant Lola qu'il prétendait acheter) tout en maintenant ceux-ci en plein mensonge social. Barbara Sukowa, pénétrante dans son commentaire, relève la grande tendresse manifestée par RWF à l'égard de ses personnages, à commencer par les femmes. Loin de se moquer de la plus grotesque en apparence - la secrétaire servile de Bohm -, il nous la fait aimer autant que la gouvernante, mère de Lola dont le conjoint est mort à Stalingrad et qui voit sa fille se prostituer sans la juger, comme si la fatalité historique de l'époque passait toute morale. Et Sukowa de rappeler que les Allemands des années 50, en plein élan de reconstruction, restaient mentalement déchirés par leur besoin d'oublier et par la conscience lancinante d'une responsabilité criminelle collective qui les empêchait de faire leurs deuils privés.
Barbara Sukowa, pénétrante dans son commentaire, relève la grande tendresse manifestée par RWF à l'égard de ses personnages, à commencer par les femmes. Loin de se moquer de la plus grotesque en apparence - la secrétaire servile de Bohm -, il nous la fait aimer autant que la gouvernante, mère de Lola dont le conjoint est mort à Stalingrad et qui voit sa fille se prostituer sans la juger, comme si la fatalité historique de l'époque passait toute morale. Et Sukowa de rappeler que les Allemands des années 50, en plein élan de reconstruction, restaient mentalement déchirés par leur besoin d'oublier et par la conscience lancinante d'une responsabilité criminelle collective qui les empêchait de faire leurs deuils privés.
Lola la pute est à la fois une petite fille blessée. Sa corruption n'empêche pas sa réelle et sincère candeur, quand elle chante agenouillée à l'église avec celui qu'elle veut séduire. Mariée à l'urbaniste en chef de la reconstruction, tout en restant la maîtresse de l'entrepreneur Schukert, ne lui pose pas un problème de conscience "dans les circonstances présentes", et le miracle est que le personnage reste signifiant et vrai du double point de vue de l'histoire allemande et d'une intrigue amoureuse à prendre avec un grain de sel...
À relever enfin: l'exceptionnelle distribution, kaléidosopique, des couleurs du film, et ses plans systématiquement rapportés en contre-plongée, ainsi que le relève la cheffe op Caroline Champetier dans un commentaire très éclairant.