
Si nous en croyons l’auteur culte par excellence qu’incarne - avec plus de lucidité lancinante et teigneuse que notre trop consensuel Joël Dicker - le redoutable Bret Easton Ellis à l’ironie aussi mordante que celle de Michel Houellebecq, la gouvernance actuelle des Etats-Unis d’Amérique incomberait moins à son président tweeter Donald Trump qu’au clan des Kardashian, Kim et les siennes.

Or il faut prêter attention, je crois, aux propos jugés à tort provocateurs du plus fameux enfant terrible de la littérature nord-américaine de ces trente dernières années dont la traduction française du recueil de nouvelles intitulé The Informers portait le titre quasi programmatique et non moins fondé en réalité réelle de Zombies ; et comment ne pas prendre au sérieux ce connaisseur avéré d’une société dont il est à la fois le produit typé et l’acide observateur, s’agissant de cette autre émanation médiatico-numérique que figure le clan Kardashian, concrétisation en 3D d’un feuilleton glamour mondialisé aux personnages de fées botoxées à griffes de sorcières semblant issues des séries hollywoodiennes des années précédentes, de Dallas en Dynasty.
Bret Easton Ellis est un garçon plus sérieux que ne le prétendent ses détracteurs médiatiques ou académiques et les brigades de tribades qui l’ont flingué à la parution d’American Psycho (et bien avant et plus encore après), réellement sérieux comme il le relève lui-même - et je propose désormais de prêter autant sinon plus d’attention aux considérations d’un auteur sur lui-même et ses œuvres, vu que la critique est en voie d’effondrement, et particulièrement aux States, en attendant le temps prochain où la présentation des livres dignes d’êtres lus se fera prioritairement, voire exclusivement par ceux qui le sont écrits.
Mais que veut dire Bret le maudit, stigmatisé pour sexisme et perversité sadique, en affirmant que le clan female Kardashian dirige aujourd’hui son pays, plus que les ponte républicains ou démocrates, et plus que le Président lui-même ?

Je le prends, pour ma part, comme une vraie vision d’écrivain, qui pourrait s’étendre à toute la galaxie «occidentale» dominée par la «culture» américaine, selon les même codes désormais intégrés par les clients du Grand Marché mondial.
Le jeune Bret a été très maltraité par son imbécile de père, de même qu’Anton Pavlovitch Tchekhov a été fouetté tous les jours, dès sa cinquième année, par son père farci de bigoterie, et ce n’est pas perdu pour la Littérature, me dis-je en regardant attentivement, sur YOUTUBE, un webdoc consacré au télévangiste John Filpatrick en train de parler «en langue», comme les prophètes de l’Ancien Testament, avant de vociférer son éloge du Président qui pourrait s’étendre, cela va sans dire, au clan female des Kardashian.
(...)
Le prochain livre de Bret Easton Ellis, sous le titre de White, est à paraître ces prochains jours en traduction française sur papier, mais je l’ai déjà sous les yeux en version anglaise numérique, commandée d’un CLIC sur Amazon Deutschland et récupérée sur mon application KINDLE, qui me permet d’apprécier à sa juste valeur le premier tir de barrage de la presse vertueuse criant au misogyne raciste et crypto fasciste par sa façon de taxer les démocrates américains de fachos - le serpent se mordant la queue une fois de plus.

Or je suis frappé, une fois de plus, et jusque dans sa bonne mauvaise foi (en laquelle je vois plutôt une grinçante bonne foi d’enfant blessé à la Houellebecq ) par l’honnêteté fielleuse de l’affreux Bret, en somme proche de celle d’un Richard Millet ou de l’amer Michel déjà cité.
Tout de suite, dans l’espèce de confession morcelée que représente White, le mot de peur apparaît, qui englobe l’enfance de l’écrivain, le quartier du Los Angeles de ses jeunes années ou plane l’ombre sanglante de Charles Manson, et l’atmosphère des films gore dont il raffole comme par exorcisme homéopathique, et j’en viens aussitôt à me demander à voix haute, auprès de la sage Lady L., si les Kardashian ne sont pas aussi dangereux que la clique de Manson, à quoi ma compagne répond que les Kardashian sévissent toujours, au contraire du satanique Charlie.
Je ne dirai pas que Bret m’est aussi cher et proche que mon ami Anton Pavlovitch, mais je ne jouerai pas celui-ci contre celui-là , pas plus que je ne préfère le paradis de Dante au Purgatoire ou même à l’Enfer.
Bret Easton Ellis, sur le même rang que Michel Houellebecq , est une sorte d’ange messager des enfers de l’agréable à l’américaine, comme Houellebecq s’est fait le témoin d’une certaine dissociété européenne, et cela aussi fait partie de la Putain de Littérature avec une grande aile.
Dominique de Roux, dans Immédiatement: « Avoir l’intelligence de la peur ».
***
Enfin comment caractériser, en vue générale, le clan female Kardashian ? Il me semble, comme un Jeff Koons a été le produit d’une mutation interne du marché de l’art contemporain, que le clan female représente un pur produit structuré des médias et de l’INTERNET boosté par les réseaux sociaux, dont la gouvernance virtuelle serait une manière d’État numérique dans l’Etat, où la nation zombie reconnaîtrait l’Eve future en voie de clonage.

Cependant un ange passe et j’en note aussitôt ce qu’il me souffle de son enfance : «Un de ces étés-là, lorsqu’on m’emmena dans la maison sur la colline, j’avais déjà appris à lire. En me promenant avec mon jeune père (qui portait sa canne comme un sabre, la poignée effilée dans la poche de son pardessus) dans les rues de la ville où nous passions l’hiver, et en suivant cette canne qui tout à coup se pointait sur les enseignes des antiquaires ou des pâtisseries, j’avais rapidement perçu le rapport, la loi de gravitation qui relie entre elles les lettres».
Et tant qu’à invoquer les anges, invoquons alors la présence d’un autre auteur paradoxalement très présent au firmament des âmes vives, en la personne de Walter Benjamin.
Tout entretien sur les anges paraît une lubie futile en ces temps de plat utilitarisme où la futilité massive, précisément, fausse tous les critères. Il est vrai que l'ange paraît s'éloigner de ce monde, comme l'avait conclu Walter Benjamin au terme de sa traversée des enfers du XXe siècle, mais la figure même de ce penseur étrange, épars, à la fois incarné et désincarné et prenant beaucoup sur lui de l'égarement du monde, laisse à son lecteur d'aujourd'hui le sentiment diffus et lancinant qu'un ange a passé.
WB appelait de ses vœux cet Angelus novus dont l'effigie, signée Paul Klee ne l'a jamais quitté, mais son propre angélisme, sans rien d'angélique au sens commun ou stupidement californien, est ailleurs: dans la fuite, et la perte, et la douleur liée à celles-ci, et le surcroît de présence réelle que cela lui donne à nos yeux en dépit de son constat désespéré.

Si la discussion sur le sexe des anges, une fois encore, paraît vaine, la question du désir reste très riche de sens et de sensations à leur évocation puisqu'ils en sont l'incarnation désincarnée mais hyper-consciente, où cohabitent l'innocence candide d'avant le sang et le sperme, et la mélancolie de l'âge.
L'ange en pardessus gris muraille Columbo, dans Les ailes du désir de Wim Wenders, figure bien cette incarnation désincarnée, qui traverse les scènes de crime avec l'air pensif de celui que la découverte du coupable ne fera jamais triompher.
Je revois aussi Bruno Ganz, dans le taxi du même film, murmurant à son compagnon de mission sur terre: « C'est extraordinaire de n'être qu'un esprit et de témoigner pour l'éternité de tout ce qui a trait à la spiritualité de chaque mortel. Mais parfois moi je me sens fatigué de n'être qu'un esprit, j'aimerais que ce survol éternel se termine enfin. J'aimerais sentir en moi un poids. Sentir que cette densité abolit l'illimité, me rattache au monde terrestre.
J'aimerais à chaque pas, à chaque coup de vent, pourvoir dire: « et maintenant », et « maintenant », « et maintenant », au lieu de dire « depuis toujours » ou « à jamais ». S'asseoir à une table ou des personnes jouent aux cartes, pour être salué d'un simple geste amical. Lorsqu'il nous arrive parfois de prendre part nous ne faisons que simuler. Dans ce combat en pleine nuit, on a fait semblant, on a simulé une luxation de la hanche, comme on feint d'attraper le poisson avec eux, comme on feint de s'asseoir à la table où ils sont assis, de boire ou de manger en leur compagnie, quand on fait rôtir les agneaux; quand on sert du vin dans les tente du désert, enfin on simule »...
À l'angélisme béat, voire inepte, voire obscène (du style «nos petits anges» des mères américaines gavées de sucre poétique) de l'imagerie sulpicienne, s'oppose évidemment le fracas du monde, de corridas en crucifixions, dont la peinture de Francis Bacon tire sa dramaturgie sanglante et féerique à la fois.
Or Bacon, à l’opposé véhément d’un Jeff Koons, relève lui aussi, je crois, de cette angéologie poétique, en sa face sombre, qui a succédé à l'angéologie dogmatique voire militaire des Docteurs ès théologie et autres visionnaires mystiques tels Jacob Boehme ou Angelus Silesius.
Francis Bacon entre en peinture avec une crucifixion blasphématoire (une espèce de spectre blanc de volaille clouée, datant de 1933) qui prélude à son émancipation d'avec son mentor-amant de l'époque, le peintre Roy de Maistre rallié de plus en plus au catholicisme traditionnel. Par la suite, l'ange de la mort ne cessera de danser autour de la chaise électrique sur laquelle Bacon assied ses modèles, souvent très beaux selon le canon conventionnel, pour en tirer des figures déformées voire monstrueuses sur fond d'explosion de couleurs extatiques.

Or, le même ange de la mort patrouille aux horizons du Voyage au bout de la nuit de Céline, scellant la même beauté noire et le même caractère électrisant de la prose célinienne. Mais ces messages extrêmes n'ont pas, pour autant, à nous détourner des anges de Rabelais, dont les chœurs nous ramènent incessamment à ce qu'on pourrait dire l'état chantant de l'angéologie poétique...



 Par le singulier morcellement de sa forme, indicatif autant d'un éclatement du discours que de l'interférence concertée de "rubriques" hétérogènes dont l'agencement même et la combinatoire assument une fonction critique, le Journal de Max Frisch investit un espace littéraire (car il faut souligner d'emblée l'aspect très élaboré de l'ouvrage dont toute spontanéité, toute effusion sentimentale ou tout abandon au flux du jour le jour sont absents) que nous pourrions situer aux antipodes du journal intime à la manière introspective et (plus ou moins) rien-que-pour-soi d'Amiel.
Par le singulier morcellement de sa forme, indicatif autant d'un éclatement du discours que de l'interférence concertée de "rubriques" hétérogènes dont l'agencement même et la combinatoire assument une fonction critique, le Journal de Max Frisch investit un espace littéraire (car il faut souligner d'emblée l'aspect très élaboré de l'ouvrage dont toute spontanéité, toute effusion sentimentale ou tout abandon au flux du jour le jour sont absents) que nous pourrions situer aux antipodes du journal intime à la manière introspective et (plus ou moins) rien-que-pour-soi d'Amiel.  Un anti-personnage
Un anti-personnage  Cette méfiance, à l'égard de l'empire du JE, sera discutée plus loin à propos de Miller, de Gombrowicz et des frères Goncourt, où sera mise en lumière l'alternative de "l'hypertrophie de l'égocentrisme" et de "l'hypertrophie du politique". A ces deux extrêmes, Max Frisch échappe également. Tout l'intérêt de son Journal tient alors, précisément, au dosage subtil des éléments qui lui sont incorporés, ressortissant aux deux sphères, dont l'ensemble constitue un "carnet de bord" permettant au lecteur de suivre un cheminement - et peut-être aura-t-il la curiosité, ensuite, de remonter au précédent Journal 1946-1949 -, un parcours évolutif inscrit dans le temps le renvoyant à des faits liés à la biographie de l'écrivain, au train du monde ou au travail, en coulisses, sur l'oeuvre en train de se faire.
Cette méfiance, à l'égard de l'empire du JE, sera discutée plus loin à propos de Miller, de Gombrowicz et des frères Goncourt, où sera mise en lumière l'alternative de "l'hypertrophie de l'égocentrisme" et de "l'hypertrophie du politique". A ces deux extrêmes, Max Frisch échappe également. Tout l'intérêt de son Journal tient alors, précisément, au dosage subtil des éléments qui lui sont incorporés, ressortissant aux deux sphères, dont l'ensemble constitue un "carnet de bord" permettant au lecteur de suivre un cheminement - et peut-être aura-t-il la curiosité, ensuite, de remonter au précédent Journal 1946-1949 -, un parcours évolutif inscrit dans le temps le renvoyant à des faits liés à la biographie de l'écrivain, au train du monde ou au travail, en coulisses, sur l'oeuvre en train de se faire.  Au reste, on aura tôt fait de le comprendre aussi: le contenu explicite de ces questions-réponses importe moins que l'effet second implicite qu'elles sont appelées à produire. Un langage est là, en train de se former. Une pensée affleure. Sans doute l'auteur s'ingénie-t-il à tourner ses questions de certaine façon, de sorte à faire "accoucher" l'hypothétique lecteur, mais la maïeutique ainsi fondée est une arme à double tranchant, et les esprits mal embouchés se feront un malin plaisir, aussi bien, de retourner les questions du "maître" aux limites de la tautologie ou de l'aporie. Cependant l'ombre du grand Wittgenstein n'aura fait que passer: des questionnaires paradoxaux, roboratifs ou se mordant la queue, voisinent avec d'autres qui touchent à l'avenir de l'espèce, aux raisons que nous avons de (sur)vivre, au mariage, à l'amitié, à la mère patrie, au trafic d'armes, à la propriété privée ou à la mort, au discours ou au discours sur le discours, entre autres considérations plus attendues du moraliste citoyen achoppant à l'une des obsessions du XXe siècle: la politique.
Au reste, on aura tôt fait de le comprendre aussi: le contenu explicite de ces questions-réponses importe moins que l'effet second implicite qu'elles sont appelées à produire. Un langage est là, en train de se former. Une pensée affleure. Sans doute l'auteur s'ingénie-t-il à tourner ses questions de certaine façon, de sorte à faire "accoucher" l'hypothétique lecteur, mais la maïeutique ainsi fondée est une arme à double tranchant, et les esprits mal embouchés se feront un malin plaisir, aussi bien, de retourner les questions du "maître" aux limites de la tautologie ou de l'aporie. Cependant l'ombre du grand Wittgenstein n'aura fait que passer: des questionnaires paradoxaux, roboratifs ou se mordant la queue, voisinent avec d'autres qui touchent à l'avenir de l'espèce, aux raisons que nous avons de (sur)vivre, au mariage, à l'amitié, à la mère patrie, au trafic d'armes, à la propriété privée ou à la mort, au discours ou au discours sur le discours, entre autres considérations plus attendues du moraliste citoyen achoppant à l'une des obsessions du XXe siècle: la politique. L'écrivain surtout...
L'écrivain surtout... 








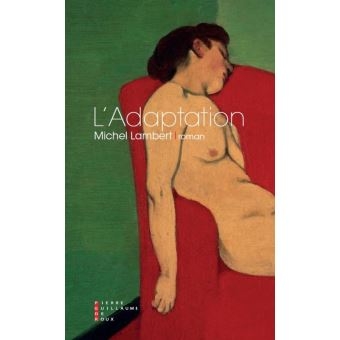


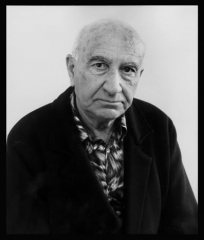



 Déambulant à sa propre rencontre par vaux et collines, le cueilleur de tessons remonte, de ruisseaux en rivières, le fleuve des rêveurs itinérants. Pour nous rejoindre au pays des lacs et des âmes où nous attendent les enfants d’Anker et Walser le vagabond, après moult rencontres et observations. Leçon de choses au fil des mots…
Déambulant à sa propre rencontre par vaux et collines, le cueilleur de tessons remonte, de ruisseaux en rivières, le fleuve des rêveurs itinérants. Pour nous rejoindre au pays des lacs et des âmes où nous attendent les enfants d’Anker et Walser le vagabond, après moult rencontres et observations. Leçon de choses au fil des mots… 





 Retour amont
Retour amont






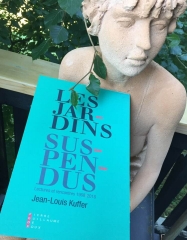


 Presque octogénaire, l’auteur du Petit ami toucha le public, au-delà des seuls cercles littéraires, par sa verve caustique et sa liberté d’esprit, la sincérité sans mélange avec laquelle il parlait de sa vie, et l’alternance de rosserie et d’émotion qui marquait ses propos sur ses pairs les écrivains (de Valéry à Gide, et de Verlaine à Jules Romains) ou sur les animaux, qu’il préférait ordinairement à ceux-là... .
Presque octogénaire, l’auteur du Petit ami toucha le public, au-delà des seuls cercles littéraires, par sa verve caustique et sa liberté d’esprit, la sincérité sans mélange avec laquelle il parlait de sa vie, et l’alternance de rosserie et d’émotion qui marquait ses propos sur ses pairs les écrivains (de Valéry à Gide, et de Verlaine à Jules Romains) ou sur les animaux, qu’il préférait ordinairement à ceux-là... .  Car c’est essentiellement une mesure que la phrase de Léautaud, correspondant à une civilisation. Plus proche de Voltaire que des surréalistes ses contemporains, de Chamfort que de Camus, ou de Molière que des petits marquis de la « modernité », Léautaud n’en constituepas moins un idéal toujours actuel de clarté et de naturel, de spontanéité (réelle ou feinte) et d’indépendance d’esprit, qui combine les vertus analytiques de la langue française et sa grâce nonchalante, sa précision, sa netteté, son tranchant et ses nuances aussi, sa flexibilité, enfin son génie intact.
Car c’est essentiellement une mesure que la phrase de Léautaud, correspondant à une civilisation. Plus proche de Voltaire que des surréalistes ses contemporains, de Chamfort que de Camus, ou de Molière que des petits marquis de la « modernité », Léautaud n’en constituepas moins un idéal toujours actuel de clarté et de naturel, de spontanéité (réelle ou feinte) et d’indépendance d’esprit, qui combine les vertus analytiques de la langue française et sa grâce nonchalante, sa précision, sa netteté, son tranchant et ses nuances aussi, sa flexibilité, enfin son génie intact.  Pour ne prendre qu’un exemple, relevons l’intérêt tout particulier des observations quotidiennes de Léautaud durant l’Occupation et au lendemain de la guerre : il y a là une mine de notations qui nous permettent de sentir beaucoup mieux le climat de la France moyenne de l’époque; lui-même professant un certain antisémitisme très partagé alors. En outre, maigre sa fréquente monotonie et son absence totale de perspectives métaphysiques, le Journal de Léautaud est un miroir que l’auteur nous tend, où nous ne cessons d’apprendre à nous mieux connaître. Jusque-là, ce monument n’était disponible que dans sa première édition du Mercure de France, en vingt volumes. Beaucoup plus pratique évidemment : celle que voici, en trois tomes sur papier bible assortis d’un volume d’index.
Pour ne prendre qu’un exemple, relevons l’intérêt tout particulier des observations quotidiennes de Léautaud durant l’Occupation et au lendemain de la guerre : il y a là une mine de notations qui nous permettent de sentir beaucoup mieux le climat de la France moyenne de l’époque; lui-même professant un certain antisémitisme très partagé alors. En outre, maigre sa fréquente monotonie et son absence totale de perspectives métaphysiques, le Journal de Léautaud est un miroir que l’auteur nous tend, où nous ne cessons d’apprendre à nous mieux connaître. Jusque-là, ce monument n’était disponible que dans sa première édition du Mercure de France, en vingt volumes. Beaucoup plus pratique évidemment : celle que voici, en trois tomes sur papier bible assortis d’un volume d’index. À découvrir
À découvrir Alceste et Pierrot
Alceste et Pierrot



