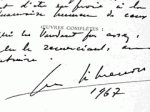Rencontre de Marina Vlady
Marina Vlady n’a pas froid aux yeux. C’est entendu: elle les a si beaux qu’on pourrait imaginer qu’elle nous la joue au charme ou, forte de sa triple carrière brillantissime de star de l’écran, de comédienne et d’auteur à succès, qu’elle se croit tout permis, jusqu’à «détourner» les personnages d’un classique russe.
Et pourtant non: le risque qu’elle a pris en donnant une suite, avec Ma Cerisaie, à la fameuse pièce de Tchekhov, n’a rien d’abusif. C’est une belle idée romanesque, et pleinement justifiée dans le cas d’une artiste pétrie de culture russe, dont les aïeux ressemblaient beaucoup aux figures de la pièce.

Dans son appartement des abords du Champ de Mars, entre bons gros chiens et sémillants canaris, tableaux partout et photos de scène (le trio Poliakoff jouant Les Trois soeurs, fait unique dans les annales théâtrales...), Marina Vlady évoque la genèse de son livre avec autant de simplicité que de naturel.
«Il y a une dizaine d’années, déjà, que je désirais raconter les tribulations incroyables qu’ont vécues ma grand-mère et ma mère, dont les destinées personnelles recoupaient les grands bouleversements de l’Histoire. Je ne savais pourtant comment m’y prendre, jusqu’au jour où, interprétant à Paris le rôle de Lioubov dans La Cerisaie mise en scène par Georges Wilson, je me suis soudain interrogée sur ce qui aurait pu arriver aux personnages de la pièce après la fin de celle-ci, en 1896, dans le tumulte révolutionaire. La Cerisaie se passe dans le même milieu que celui de mes grands-parents, de la petite noblesse terrienne cultivée et démocrate, dont les rejetons se révoltèrent souvent au nom du peuple opprimé. C’est ainsi que j’ai nourri le personnage d’Ania, fille de Lioubov, de ce que je savais du caractère et de la vie de ma grand-mère maternelle. Le mari de celle-ci, le général Evgueni Envald, militaire de carrière très ouvert aux idées nouvelles et fou de théâtre, apparaît dans le roman sous son vrai nom puisque c’est une figure de l’histoire russe. De la même façon, l’éducation de ma mère, Militza, s’est effectivement faite, dès sa huitième année, à l’Institut Smolny de Saint-Pétersbourg, réservé aux familles nobles et vidé de ses élèves en 1917 pour cause de révolution...»

Le défi d’un tel roman était, évidemment, de fondre en unité les destinées réelles et imaginaires, dans une fresque crédible. Sans encombrer son ouvrage, très documenté, de trop de données historiques, Marina Vlady a su mettre en rapport le détail et l’ensemble, portant l’accent sur certains événements moins connus (la traumatisante guerre russo-japonaise) et laissant les protagonistes historiques (Lénine, notament) dans l’arrière-plan, au profit des héros du roman, à commencer par les femmes. Telle Ania, «fille» à la fois de Tchekhov et de la romancière, qui «s’est détachée du mouvement le plus radical dès qu’elle a eu compris que le terrorisme ôtait la vie aux innocents plus souvent qu’aux tyrans»... Une phrase qui prend aujourd’hui un relief particulier, puisque l’attentat du World Trade Center devait survenir une heure après notre recontre avec Marina Vlady.
«Les femmes jouent un rôle de premier plan dans ce roman, parce que je tenais à rendre hommage à ces femmes si libres et courageuses qu’ont été ma mère et ma grand-mère. L’amour de la liberté et de la justice, autant que de l’art, a beaucoup compté pour elles et a marqué ma propre éducation. Quant à mon père, Vladimir Poliakoff, chanteur d’opéra, ingénieur en aéronautique et sculpteur chez Bourdelle, c’était un véritable personnage de roman. Pour ce qui touche aux personnages de Tchekhov, tels Lopakhine, auquel je crois avoir rendu justice alors qu’on le noircit trop souvent, ou Trofimov, je me suis efforcée de leur donner une destinée conforme à tout ce qui en est dit dans La cerisaie.»

Roman traversé par le souffle de la passion, Ma cerisaie doit beaucoup, aussi, au dire de Marina Vlady, aux douze années d’années et de tourment qu’elle a passées en Russie, de 1968 à 1980, auprès du grand poète, comédien et chanteur Vladimir Vissotski, devenu son mari et qui lui inspira, post mortem, son premier livre, Vladimir ou le vol arrêté. C’est à ses côtés que cette femme très engagée à gauche, qui militait il y a quelques temps encore pour les sans-papiers, a senti le souffle froid de la révolution trahie.
«Ils l’ont tué», constate Marina Vlady en évoquant l’homme de sa vie, tombé amoureux d’elle avant qu’il ne la rencontre et qui lui annonça crânement qu’elle serait sa femme dès leur première rencontre.
Bien loin de sa Russie de coeur, Marina Vlady parle avec beaucoup de tristesse de ce qu’est devenu le pays de ses aïeux. «La chaleur humaine que j’y ai trouvée dans les circonstances les plus dures n’existe plus. Il n’y en a plus que pour la chasse au fric...»
Mais la Russie revit, le lecteur l’aura compris, dans Ma cerisaie.
Marina Vlady, Ma Cerisaie. Fayard, 346pp.

 Les cygnes de Silvaplana. Découpage de LK.
Les cygnes de Silvaplana. Découpage de LK.





 Entre Balzac et les Russes
Entre Balzac et les Russes