Notes de l'isba (6)
Mort de Dimitri. - Il est six heures du matin et je pense à Dimitri. J’imagine son corps gisant là-bas, Dieu sait où. Je pense à tout ce qu’il a été et à tout ce qui fut. Je pense à tout ce qu’il nous a apporté. Ma pensée entière est remplie par la présence de son absence. Je pressens que j’aurai beaucoup à écrire et à dire (à me dire) sur lui. Cette mort si brutale, si violente est plus à mes yeux que l’expression d’une aveugle fatalité : elle figure à mes yeux une conclusion qui, sous couvert d’absurde, comme celle d’Albert Camus, ressemble en somme à Dimitri. Dès que j’ai appris l’horrible nouvelle, j’ai pensé que cette mort avait la force d’un paraphe final. Je n’en parlerai à personne en ces termes, mais j’ai pensé aussitôt à cette fin comme un élément ressortissant au mystère de cette personne. En attendant, j’ai repris mon exemplaire de Personne déplacée dans lequel je vais remplir les blancs de nos souvenirs. Je me rappelle à l’instant nos premières rencontres au Métropole, vers 1970. Son ironie sympathique envers le petit gauchiste plus ou moins repenti déjà fou de lecture. Ses sarcasmes et son attention assez affectueuse, son intérêt à me voir me passionner pour Charles-Albert Cingria, découvrir sans son conseil le Croate Miroslav Krleza et le Serbe Bulatovic (je ne discernai alors aucune discrimination de sa part entre auteurs serbes, croates, bosniaques ou macédoniens), avant Pétersbourg de Biély, premier chef-d’œuvre publié à L’Age d’Homme.
 De nos fins dernières. - Etait-ce après la mort de sa mère ou après la mort de son père ? Je ne saurais le dire. Toutefois on était près d’une mort proche. Dimitri m’a dit alors qu’il venait de lire, avec saisissement, la Méditation devant le corps de Marie Dimitrievna, de Dostoïevski. Et tout aussitôt je me suis mis à la recherche de cet écrit qui m’a ramené à la question de toujours sur les fins de ce monde, le sens de notre vie et les formes de notre éventuelle survie.
De nos fins dernières. - Etait-ce après la mort de sa mère ou après la mort de son père ? Je ne saurais le dire. Toutefois on était près d’une mort proche. Dimitri m’a dit alors qu’il venait de lire, avec saisissement, la Méditation devant le corps de Marie Dimitrievna, de Dostoïevski. Et tout aussitôt je me suis mis à la recherche de cet écrit qui m’a ramené à la question de toujours sur les fins de ce monde, le sens de notre vie et les formes de notre éventuelle survie.
Dimitri est mort mardi dernier et je ne sais si j’aurai l’occasion de me recueillir devant sa dépouille, sans doute exposée selon l’usage orthodoxe, mais je n’ai pas besoin de me trouver physiquement devant lui pour me poser à l’instant cette question : aux fins de quoi tout ça, et quel sens si ça ne se transforme pas en vie éternelle, comme je sens un peu mieux chaque jour que, tout se trouvant raclé, selon l’expression de Ramuz à la fin de Vie de Samuel Belet, qui rappelle aussi le bilan de L’Education sentimentale, quelque chose reste cependant, peut-être, peut-être ouvert à la transfiguration par l’intercession du Christ, synthèse des synthèses de toute l’humanité en nous à en croire Dostoïevski.

 Rozanov ne m’a jamais quitté. Sa conception de l’intimité et de la voix modulées par l’écriture recoupe la mienne et ne cesse de la revivifier en dépit de nombreuses idées ou positions qui lui sont propres et que je ne partage aucunement, comme il en allait de mes relations avec Dimitri. La somme rozanovienne que représente Feuilles tombées, publiée à L’Age d’Homme en 1984, me suit partout et je sais à l’instant qu’à l’ouvrir je trouverai ce que j’y cherche comme à l’état de murmure à moi seul destiné, et c’est exactement cela, page 398 : « Remercie chaque instant de ton existence et éternise-le »…
Rozanov ne m’a jamais quitté. Sa conception de l’intimité et de la voix modulées par l’écriture recoupe la mienne et ne cesse de la revivifier en dépit de nombreuses idées ou positions qui lui sont propres et que je ne partage aucunement, comme il en allait de mes relations avec Dimitri. La somme rozanovienne que représente Feuilles tombées, publiée à L’Age d’Homme en 1984, me suit partout et je sais à l’instant qu’à l’ouvrir je trouverai ce que j’y cherche comme à l’état de murmure à moi seul destiné, et c’est exactement cela, page 398 : « Remercie chaque instant de ton existence et éternise-le »…
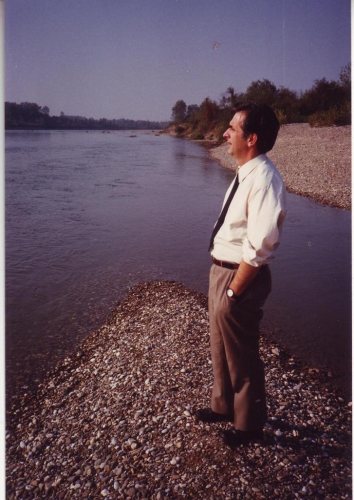

 J'écris ces mots dans une espèce de baraque décatie, au bord du ciel mais d’aspect tout semblable à celles de Buchenwald ou du Goulag, je ne suis qu’un doux rêveur à la Illia Illitch Oblomov et n’ai jamais souffert en ma vie de privilégié que de sentiments sentimentaux, cependant je recueille ce vestige de lumière éternelle que représente à mes yeux ce bout de pain de rien du tout - et de tout ça je remercie Dieu qui n’existe pas sauf à l’instant d’être reconnu dans ce morceau de pain sec dont l’image sera mon icône de ce matin, mon mandala et mon tapis de prière...
J'écris ces mots dans une espèce de baraque décatie, au bord du ciel mais d’aspect tout semblable à celles de Buchenwald ou du Goulag, je ne suis qu’un doux rêveur à la Illia Illitch Oblomov et n’ai jamais souffert en ma vie de privilégié que de sentiments sentimentaux, cependant je recueille ce vestige de lumière éternelle que représente à mes yeux ce bout de pain de rien du tout - et de tout ça je remercie Dieu qui n’existe pas sauf à l’instant d’être reconnu dans ce morceau de pain sec dont l’image sera mon icône de ce matin, mon mandala et mon tapis de prière... La bonne mesure. – La lecture de Gustave Thibon me fait du bien, comme le pain ou l’eau claire. Pas besoin de plus, ou s’il y a plus, car il y a forcément plus et d’un peut tout, je me connais, la base de cette présence paisible et lucide, sensible, aimante, me reste un port d’attache depuis ma vingtaine lointaine, et qu’on le dise réac ou catho souverainiste m’est bien égal à moi le huguenot de moins en moins croyant mais de plus en plus chrétien au sens évangélique paléo d’avant Rome et les sectes, estimant que Thibon Gustave le philosophe paysan n’est pas plus de droite ou de gauche que le pain et l’eau claire.
La bonne mesure. – La lecture de Gustave Thibon me fait du bien, comme le pain ou l’eau claire. Pas besoin de plus, ou s’il y a plus, car il y a forcément plus et d’un peut tout, je me connais, la base de cette présence paisible et lucide, sensible, aimante, me reste un port d’attache depuis ma vingtaine lointaine, et qu’on le dise réac ou catho souverainiste m’est bien égal à moi le huguenot de moins en moins croyant mais de plus en plus chrétien au sens évangélique paléo d’avant Rome et les sectes, estimant que Thibon Gustave le philosophe paysan n’est pas plus de droite ou de gauche que le pain et l’eau claire. Celui qu’elle disait « ton Monsieur Sénèque » était, à ses yeux, un penseur réellement fréquentable, qui ne mettait pas de majuscules à ses pensées ni d’italiques à ses sentiments, un sage franc du collier, lucide et prudent, mais pas éteignoir pour autant, pour ainsi dire un type bien…
Celui qu’elle disait « ton Monsieur Sénèque » était, à ses yeux, un penseur réellement fréquentable, qui ne mettait pas de majuscules à ses pensées ni d’italiques à ses sentiments, un sage franc du collier, lucide et prudent, mais pas éteignoir pour autant, pour ainsi dire un type bien… 
 (Cette liste a été établie au fil de la lecture alternée des 60 épisodes des 5 saisons de la série The Wire/Sur écoute et du dernier livre de Max Dorra intitulé Lutte des rêves et interprétation des classes paru à L'Olivier)
(Cette liste a été établie au fil de la lecture alternée des 60 épisodes des 5 saisons de la série The Wire/Sur écoute et du dernier livre de Max Dorra intitulé Lutte des rêves et interprétation des classes paru à L'Olivier) 

 La nature qui nous entoure ici reste le lieu de tous les carnages, pas un instant je ne l’oublie, pas plus que l’instinct prédateur de l’homme et sa passion morbide, mais la nature ne dore pas la pilule, la nature reste ce qu’elle a toujours été dans son indifférence absolue et son étrangeté splendide qui me font retrouver ici, dans cette espèce de cabanon au bord du ciel, l’humilité sereine de l’homme des bois selon Thoreau ou l’équanimité de Pascal entre ses deux infinis, entre le cendrier et l’étoile – et voici le fermier du dessus se pointer pour m’annoncer qu’il a dû couper l’eau que j’ai captée à sa fontaine vu que « ça manque » ces jours…
La nature qui nous entoure ici reste le lieu de tous les carnages, pas un instant je ne l’oublie, pas plus que l’instinct prédateur de l’homme et sa passion morbide, mais la nature ne dore pas la pilule, la nature reste ce qu’elle a toujours été dans son indifférence absolue et son étrangeté splendide qui me font retrouver ici, dans cette espèce de cabanon au bord du ciel, l’humilité sereine de l’homme des bois selon Thoreau ou l’équanimité de Pascal entre ses deux infinis, entre le cendrier et l’étoile – et voici le fermier du dessus se pointer pour m’annoncer qu’il a dû couper l’eau que j’ai captée à sa fontaine vu que « ça manque » ces jours… Idiots utiles. – Il faut (re)lire La Vie est ailleurs de Milan Kundera pour mieux réévaluer, aujourd’hui, les mécanismes de la fascination exercée, sur les intellectuels, par le Pouvoir, à côté de cette autre observation fondamentale sur le fait que de doux poètes, tels un Eluard ou un Aragon, en soient arrivés à louer les mérites d’un Staline.
Idiots utiles. – Il faut (re)lire La Vie est ailleurs de Milan Kundera pour mieux réévaluer, aujourd’hui, les mécanismes de la fascination exercée, sur les intellectuels, par le Pouvoir, à côté de cette autre observation fondamentale sur le fait que de doux poètes, tels un Eluard ou un Aragon, en soient arrivés à louer les mérites d’un Staline. Sauveteurs. - Contre le romantisme et son mensonge récurrent, notamment en littérature, tel que René Girard l’a isolé (au sens pour ainsi dire scientifique, comme il en irait d’un virus ou d’une bactérie) et décrit par le détail dans Mensonge romantique et vérité romanesque, contre cette flatterie « jeuniste » qui exalte la rébellion pour la rébellion ou la nouveauté pour la nouveauté, la notion de bon génie de la Cité m’a toujours été chère, au dam de mon propre romantisme, que je retrouve avec reconnaissance chez les écrivains ou les penseurs que Léon Daudet, par opposition aux Incendiaires, appelait les Sauveteurs.
Sauveteurs. - Contre le romantisme et son mensonge récurrent, notamment en littérature, tel que René Girard l’a isolé (au sens pour ainsi dire scientifique, comme il en irait d’un virus ou d’une bactérie) et décrit par le détail dans Mensonge romantique et vérité romanesque, contre cette flatterie « jeuniste » qui exalte la rébellion pour la rébellion ou la nouveauté pour la nouveauté, la notion de bon génie de la Cité m’a toujours été chère, au dam de mon propre romantisme, que je retrouve avec reconnaissance chez les écrivains ou les penseurs que Léon Daudet, par opposition aux Incendiaires, appelait les Sauveteurs. 
 De la peinture-peinture. – C’est en repassant par les bases physiques de la figuration qu’on pourra retrouver, je crois, la liberté d’une peinture-peinture dépassant la tautologie réaliste. Thierry Vernet y est parvenu parfois, comme dans la toile bleue qu’il a brossée après sa visite à notre Impasse des Philosophes, en 1986, évoquant le paysage qui se découvre de la route de Villars Sainte-Croix, côté Jura, mais le transit du réalisme à l’abstraction est particulièrement lisible et visible, par étapes, dans l’évolution de Ferdinand Hodler. Nous ne sommes plus dans cette continuité, les gonds de l’histoire de la peinture ont été arrachés, mais chacun peut se reconstituer une histoire et une géographie artistiques à sa guise, à l’écart des discours convenus en la matière, en suivant le cours réel du Temps de la peinture dont la chronologie n’est qu’un aspect, souvent trompeur. De là mon sentiment qu’un Simone Martini ou un Uccello, un Caravage ou un Signorelli sont nos contemporains au même titre qu’un Bacon, un Morandi ou un De Staël…
De la peinture-peinture. – C’est en repassant par les bases physiques de la figuration qu’on pourra retrouver, je crois, la liberté d’une peinture-peinture dépassant la tautologie réaliste. Thierry Vernet y est parvenu parfois, comme dans la toile bleue qu’il a brossée après sa visite à notre Impasse des Philosophes, en 1986, évoquant le paysage qui se découvre de la route de Villars Sainte-Croix, côté Jura, mais le transit du réalisme à l’abstraction est particulièrement lisible et visible, par étapes, dans l’évolution de Ferdinand Hodler. Nous ne sommes plus dans cette continuité, les gonds de l’histoire de la peinture ont été arrachés, mais chacun peut se reconstituer une histoire et une géographie artistiques à sa guise, à l’écart des discours convenus en la matière, en suivant le cours réel du Temps de la peinture dont la chronologie n’est qu’un aspect, souvent trompeur. De là mon sentiment qu’un Simone Martini ou un Uccello, un Caravage ou un Signorelli sont nos contemporains au même titre qu’un Bacon, un Morandi ou un De Staël… Notes de l'isba (2)
Notes de l'isba (2)

 De là mon attachement aux peintres un peu dingos genre Adolf Wölfli (1864-1930), grand obsédé à trompettes de papier dont les mots ne peuvent rien nous dire quoique le cherchant en discours véhéments rappelant ceux de l’autre Adolf timbré, alors que ses images nous atteignent et nous traversent et nous hantent comme des visions d’enfance quand le Méchant rôde autour de la maison et que c’est si bon. De même l’écriture très matinale, au nid, est-elle une bonne voie ouverte aux « forces intérieures » dont parle Ludwig Hohl, cet autre toqué.
De là mon attachement aux peintres un peu dingos genre Adolf Wölfli (1864-1930), grand obsédé à trompettes de papier dont les mots ne peuvent rien nous dire quoique le cherchant en discours véhéments rappelant ceux de l’autre Adolf timbré, alors que ses images nous atteignent et nous traversent et nous hantent comme des visions d’enfance quand le Méchant rôde autour de la maison et que c’est si bon. De même l’écriture très matinale, au nid, est-elle une bonne voie ouverte aux « forces intérieures » dont parle Ludwig Hohl, cet autre toqué.
 Le moindre trait, j’entends : la moindre amorce de ligne, et les hachures, les réseaux et les résilles, les griffures et les morsures – les traits tirés de Louis Soutter (1871-1942) me touchent indiciblement, comme personne en gravure sauf peut-être Rembrandt dans ses moments de plus libre abandon, ou Goya bien entendu (je veux dire le Goya vraiment déchaîné), ou Soutine qui ne dessine que par la couleur – mais tout Soutter et jusqu’aux doigts, Soutter qui se met à dessiner de la main gauche quand la droite est trop habile, Soutter Louis de Morges à Ballaigues et sans commencement ni fin, Soutter en sa présence exacerbée par la douleur transfusée en foudre de beauté…
Le moindre trait, j’entends : la moindre amorce de ligne, et les hachures, les réseaux et les résilles, les griffures et les morsures – les traits tirés de Louis Soutter (1871-1942) me touchent indiciblement, comme personne en gravure sauf peut-être Rembrandt dans ses moments de plus libre abandon, ou Goya bien entendu (je veux dire le Goya vraiment déchaîné), ou Soutine qui ne dessine que par la couleur – mais tout Soutter et jusqu’aux doigts, Soutter qui se met à dessiner de la main gauche quand la droite est trop habile, Soutter Louis de Morges à Ballaigues et sans commencement ni fin, Soutter en sa présence exacerbée par la douleur transfusée en foudre de beauté…










