
À propos de l'expo qui s'ouvre ces jours au Grand Palais, à Paris, et d'un petit livre d'une pénétrante justesse sensible de Maryline Desbiolles.
Félix Vallotton (né à Lausanne en 1865 et mort à Paris en 1925) fut sûrement l’un des artistes du début du XXe siècle les plus originaux issus de notre pays, même s’il réalisa l’essentiel de son œuvre en France – dont il prit la nationalité en 1909 -, autant comme peintre que pour ses travaux de graveur extrêmement prisés, ses écrits critiques et ses ouvrages littéraires, dont le roman La vie meurtrière est aussi à redécouvrir. Comme celle de Ferdinand Hodler, son quasi contemporain, l’œuvre très dense de Vallotton (son catalogue raisonné compte plus de 1700 titres) a déjà fait l’objet d’une redécouverte (via Paris, Zurich et Martigny), où les aspects les plus novateurs de sa peinture furent mis en exergue, notamment avec ses paysages proches des nordiques Munch et Nolde, de Cuno Amiet ou de Hodler précisément.
 Arrivé à Paris à dix-sept ans, le jeune Lausannois se mêla bientôt à la vie artistique et littéraire parisienne, proche notamment des Nabis (terme signifiant « prophètes ») qui s’éloignaient de la représentation « fidèle » pour intensifier la couleur en aplats et privilégier la ligne et la synthèse des formes dans une transposition radicale de la nature. Surnommé le « Nabi étranger », Vallotton fut ainsi proche de Vuillard et de Maurice Denis, le théoricien du groupe. Pour autant, l’œuvre de Vallotton ne se borne pas à une «manière» d’école, se développant sans cesse et comme par à-coups, avec autant de « pannes » que d’avancées.
Arrivé à Paris à dix-sept ans, le jeune Lausannois se mêla bientôt à la vie artistique et littéraire parisienne, proche notamment des Nabis (terme signifiant « prophètes ») qui s’éloignaient de la représentation « fidèle » pour intensifier la couleur en aplats et privilégier la ligne et la synthèse des formes dans une transposition radicale de la nature. Surnommé le « Nabi étranger », Vallotton fut ainsi proche de Vuillard et de Maurice Denis, le théoricien du groupe. Pour autant, l’œuvre de Vallotton ne se borne pas à une «manière» d’école, se développant sans cesse et comme par à-coups, avec autant de « pannes » que d’avancées.
On connaît évidemment l’implication du graveur dans son époque, illustrateur des mœurs intimes ou publiques, aux accents souvent incisifs, voire polémiques, mais on retrouve surtout, ici, le grand coloriste et l’inventeur d’espaces nouveaux. Au tournant du siècle, Les Blés (1900) marquent une stylisation radicale du paysage, mais l’art de Vallotton n’exclut ni la foison ni le lyrisme, ni non plus les sombres échos de ses dépressions et de la Grande Guerre, au lendemain de laquelle il peint l’expressionniste Paysage soleil couchant de 1919, sombre merveille. De la guerre même, où l’engagement volontaire lui a été refusé, il laisse en outre une évocation quasi abstraite de Verdun (1917) qui frise l’abstraction tout en suggérant la déshumanisation par de furieuses diagonales opposées où ne s’animent que feux et flammes. Si les nus de Félix Vallotton semblent parfois « plombés » par une sorte de crispation puritaine, et si ses natures mortes et autres intérieurs s’ « éteignent » parfois en dépit de la tension qui les habite c’est dans ses paysage que le peintre paraît donner sa pleine mesure libérée, même endiablée.
 Quelle fulgurance et quelle liberté, quelle poésie douce et dure à la fois, glaciale et brûlante que celle de Vallotton ! Vallotton est aussi suisse et fou qu’un Hodler, en plus ornemental parfois (même s’il y a aussi de l’ornement de circonstance chez Hodler) mais aussi débridé dans ses visions, et notamment dans ses crépuscules incendiaires et ses à-plats véhéments.
Quelle fulgurance et quelle liberté, quelle poésie douce et dure à la fois, glaciale et brûlante que celle de Vallotton ! Vallotton est aussi suisse et fou qu’un Hodler, en plus ornemental parfois (même s’il y a aussi de l’ornement de circonstance chez Hodler) mais aussi débridé dans ses visions, et notamment dans ses crépuscules incendiaires et ses à-plats véhéments.
Vallotton avait treize ans de plus que Ramuz. Il laisse 500 peintures et une masse de gravures illustrant, avec une virulence expressionniste plus germanique ou nippone que française, la chronique d’une époque. Proche à certains égards d’un Munch, notamment face au désir, mais moins libre et sensuel, moins tragique aussi, que celui-là, du moins en apparence: plus coincé, plus glacé. La ligne plus importante chez lui que les couleurs. Un sourire pincé à la Jules Renard, surtout dans ses gravures. On l’a dit peintre de la raison, mais c’est un jugement par trop français, car la folie couve là-dessous...
Paris, Grand Palais, du 3 octobre 2013 au 24 janvier 2014.
Maryline Desbiolles. Vallotton est inadmissible. Seuil, coll.Fiction & Cie, 48p.


 Note de l'isba (39)
Note de l'isba (39) Ensuite j'ai commencé de lire, hier soir, Où le sang nous appelle de Chloé Delaume et Daniel Schneidermann, étonnant récit à deux voix alternées et singulier dialogue d'une femme un peu monstrueuse et d'un quinqua mal remis de s'être fait larguer, tous deux figures notables des médias mais se révélant tous deux immédiatement troublants de vérité dans ce double récit où les blessures d'enfance, surtout chez Chloé, comptent pour l'essentiel.
Ensuite j'ai commencé de lire, hier soir, Où le sang nous appelle de Chloé Delaume et Daniel Schneidermann, étonnant récit à deux voix alternées et singulier dialogue d'une femme un peu monstrueuse et d'un quinqua mal remis de s'être fait larguer, tous deux figures notables des médias mais se révélant tous deux immédiatement troublants de vérité dans ce double récit où les blessures d'enfance, surtout chez Chloé, comptent pour l'essentiel. L'exorcisme des mots. - Faut-il avoir vu sa mère assassinée pour comprendre les mots d' À Suspicious River ou de Chloé Delaume ? Faut-il avoir vécu ce que Leila, la protagoniste offensée et humiliée du premier roman de Laura Kasischke, et la petite Nina, alias Nathalie Abdallah, devenue Chloé Delaume en littérature, ont enduré en leur enfance respective, fiction pour la première et réalité pour la seconde, en assistant au meurtre de leur mère par leur oncle ou leur père ? Evidemment pas, pas plus que l'état de parricide est requis pour lire Les Frères Karamazov...
L'exorcisme des mots. - Faut-il avoir vu sa mère assassinée pour comprendre les mots d' À Suspicious River ou de Chloé Delaume ? Faut-il avoir vécu ce que Leila, la protagoniste offensée et humiliée du premier roman de Laura Kasischke, et la petite Nina, alias Nathalie Abdallah, devenue Chloé Delaume en littérature, ont enduré en leur enfance respective, fiction pour la première et réalité pour la seconde, en assistant au meurtre de leur mère par leur oncle ou leur père ? Evidemment pas, pas plus que l'état de parricide est requis pour lire Les Frères Karamazov...  Cela paraît niais de le rappeler, mais notre époque de haut narcissisme et de basse curiosité, où le fait divers sordide est élevé au rang de littérature, y contraint. Ainsi La belle lurette d'Henri Calet, qui évoque les désarrois ordinaires d'un enfant parigot en milieu popu, en dit peut-être autant, dans un tout autre registre émotionnel, social ou psychologique, que les fictions de Laura Kasischke ou les autofictions de Chloé Delaume, s'agissant d'exorciser des blessures d'enfance qui ne se "pèsent" pas...
Cela paraît niais de le rappeler, mais notre époque de haut narcissisme et de basse curiosité, où le fait divers sordide est élevé au rang de littérature, y contraint. Ainsi La belle lurette d'Henri Calet, qui évoque les désarrois ordinaires d'un enfant parigot en milieu popu, en dit peut-être autant, dans un tout autre registre émotionnel, social ou psychologique, que les fictions de Laura Kasischke ou les autofictions de Chloé Delaume, s'agissant d'exorciser des blessures d'enfance qui ne se "pèsent" pas... 


 Né en 1864, Adolf Wölfli vécut à Berne - ville dont on retrouve souvent, dans ses oeuvres picturales, la représentation correspondant à des images déposées en lui en son jeune âge, qui ressurgiront quarante ans plus tard -, jusqu'à l'âge de huit ans. Ivrogne et délinquant, son père succombe au delirium en 1875. Sa mère, elle était probablement morte deux ans auparavant.
Né en 1864, Adolf Wölfli vécut à Berne - ville dont on retrouve souvent, dans ses oeuvres picturales, la représentation correspondant à des images déposées en lui en son jeune âge, qui ressurgiront quarante ans plus tard -, jusqu'à l'âge de huit ans. Ivrogne et délinquant, son père succombe au delirium en 1875. Sa mère, elle était probablement morte deux ans auparavant.  C'est en 1899 que les rapports citent, pour la première fois, les dessins d'Adolf Wölfli. Dès cette période, il s'affaire inlassablement à la compositions scripturale, picturale et musicale d'une gigantesque journal apparaissant tantôt comme une saga autobiographique merveilleusement fantaisiste (il ne faut pas minimiser les qualités poétiques de ses écrits en dépit de leurs limites évidentes du point de vue du sens) et tantôt comme une projection cosmogonique de visionnaire délirant.
C'est en 1899 que les rapports citent, pour la première fois, les dessins d'Adolf Wölfli. Dès cette période, il s'affaire inlassablement à la compositions scripturale, picturale et musicale d'une gigantesque journal apparaissant tantôt comme une saga autobiographique merveilleusement fantaisiste (il ne faut pas minimiser les qualités poétiques de ses écrits en dépit de leurs limites évidentes du point de vue du sens) et tantôt comme une projection cosmogonique de visionnaire délirant.  L'accent porté, par Gomez de La Serna, sur l'universalité de l'expérience artistique, limite à l'évidence toute récupération de l'"aliéné artiste" au tire du génie ordinaire, et de même se gardera-t-on on d'exalter les impasse sou les apories de son expression artistique. Si les peintures de Wölfli sont aussi "lisibles", certes, que celles d'artistes "normaux", il n'en va pas du tout de même de ses textes, mêlant à tout moment l'intelligible et le délire, la même confusion marquant les partitions musicales qu'il exécutait à la trompette de papier...
L'accent porté, par Gomez de La Serna, sur l'universalité de l'expérience artistique, limite à l'évidence toute récupération de l'"aliéné artiste" au tire du génie ordinaire, et de même se gardera-t-on on d'exalter les impasse sou les apories de son expression artistique. Si les peintures de Wölfli sont aussi "lisibles", certes, que celles d'artistes "normaux", il n'en va pas du tout de même de ses textes, mêlant à tout moment l'intelligible et le délire, la même confusion marquant les partitions musicales qu'il exécutait à la trompette de papier...


 (Cette liste dédiée aux fats et autres vaniteux a été établie parallèlement à la lecture du dernier essai de Pierre Bergounioux, intitulé Le style comme expérience (L'Olivier, 2013) et d'Un été avec Montaigne d'Antoine Compagon le bien-nommé (éditions des Equateurs /France Inter, 2013)
(Cette liste dédiée aux fats et autres vaniteux a été établie parallèlement à la lecture du dernier essai de Pierre Bergounioux, intitulé Le style comme expérience (L'Olivier, 2013) et d'Un été avec Montaigne d'Antoine Compagon le bien-nommé (éditions des Equateurs /France Inter, 2013) 

 À propos d'un souvenir d'Otto Frei...
À propos d'un souvenir d'Otto Frei...



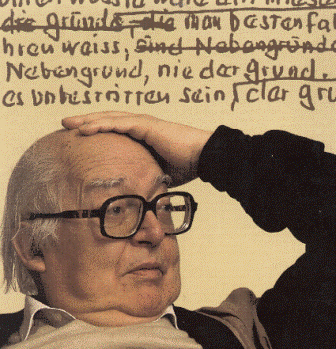
 l est vrai que l'auteur se garde bien d'évoquer la formidable machine sociale dont le monstre n'est que l'émanation. En l'occurrence, Dürrenmatt se livre à une analyse qui pourrait à la rigueur convenir à une dictateur de type ordinaire, et encore. Ce qu'il ne semble pas voir, en revanche, c'est l'essence particulière du régime dont il se borne à caricaturer les satrapes. Or, réduire la figure de Staline aux dimensions d'un tyranneau fascistoïde ne revient-il pas à justifier ce qu'un Soljenitsyne appelle "l'hypocrisie de l'Occident" ? Et le compère Hitler aurait-il l'air aussi gaillard, traité selon le même procédé ?
l est vrai que l'auteur se garde bien d'évoquer la formidable machine sociale dont le monstre n'est que l'émanation. En l'occurrence, Dürrenmatt se livre à une analyse qui pourrait à la rigueur convenir à une dictateur de type ordinaire, et encore. Ce qu'il ne semble pas voir, en revanche, c'est l'essence particulière du régime dont il se borne à caricaturer les satrapes. Or, réduire la figure de Staline aux dimensions d'un tyranneau fascistoïde ne revient-il pas à justifier ce qu'un Soljenitsyne appelle "l'hypocrisie de l'Occident" ? Et le compère Hitler aurait-il l'air aussi gaillard, traité selon le même procédé ? 

 Le personnage dominant du roman, figure théâtrale par excellence au verbe dévastateur, n'apparaît cependant qu'en seconde partie, avec
Le personnage dominant du roman, figure théâtrale par excellence au verbe dévastateur, n'apparaît cependant qu'en seconde partie, avec 

 (Cette liste a été établie en marge de la lecture de
(Cette liste a été établie en marge de la lecture de 

 Déçu par ses compatriotes qui, après les affres de la guerre, n'ont cessé de réarmer; déçu par l'Allemagne qu'il vitupère en bloc dans son pamphlet le plus corrosif, Allemagne, Allemagne par-dessus tout ! ou qu'il caricature par le détail, n'épargnant ni le bourgeois-type, épinglé sous les traits de M. Wendriner, aux sains principes et à la panse gonflée de bière Pilsen, ni les visées de la petite-bourgeoisie ("Le destin de l'Allemand: être debout devant un guichet; l'idéal de l'Allemand: être assis à un guichet), déçu enfin, et définitivement, par la montée du nazisme. Exilé en Suède, désespéré et sans ressources, il mettra fin à ses jours en 1935.
Déçu par ses compatriotes qui, après les affres de la guerre, n'ont cessé de réarmer; déçu par l'Allemagne qu'il vitupère en bloc dans son pamphlet le plus corrosif, Allemagne, Allemagne par-dessus tout ! ou qu'il caricature par le détail, n'épargnant ni le bourgeois-type, épinglé sous les traits de M. Wendriner, aux sains principes et à la panse gonflée de bière Pilsen, ni les visées de la petite-bourgeoisie ("Le destin de l'Allemand: être debout devant un guichet; l'idéal de l'Allemand: être assis à un guichet), déçu enfin, et définitivement, par la montée du nazisme. Exilé en Suède, désespéré et sans ressources, il mettra fin à ses jours en 1935. ui aussi polémiste, Kraus l'est cependant tout autrement que Tucholsky, sa lutte se situant d'abord et avant tout au niveau de la langue et du verbe, avec lesquels il entretient une relation de poète pour ainsi dire organique.
ui aussi polémiste, Kraus l'est cependant tout autrement que Tucholsky, sa lutte se situant d'abord et avant tout au niveau de la langue et du verbe, avec lesquels il entretient une relation de poète pour ainsi dire organique.


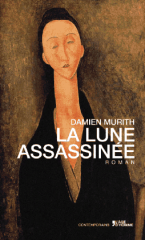 Damien Murith. La Lune assassinée. L'Age d'Homme, 109p. En librairie ces prochains jours.
Damien Murith. La Lune assassinée. L'Age d'Homme, 109p. En librairie ces prochains jours. 
 Seize ans, donc, après avoir quitté le Japon pour la dernière fois, Amélie Nothomb accepte d'y retourner, à l'invite d'une réalisatrice de télé française, pour un reportage sur les lieux de son enfance. Le bref séjour, fin mars-début avril 2012, sera aussi l'occasion de revoir son "fiancé" de la vingtaine, éconduit en des circonstances qu'elle relate dans
Seize ans, donc, après avoir quitté le Japon pour la dernière fois, Amélie Nothomb accepte d'y retourner, à l'invite d'une réalisatrice de télé française, pour un reportage sur les lieux de son enfance. Le bref séjour, fin mars-début avril 2012, sera aussi l'occasion de revoir son "fiancé" de la vingtaine, éconduit en des circonstances qu'elle relate dans 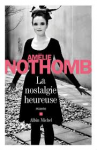 Amélie Nothomb.
Amélie Nothomb. 
