
Entretien avec Marthe Keller, invitée d'honneur des 47es Journées de Soleure. Une grande dame, toute de classe et de simplicité, enfin reconnue par les siens...
Pour le grand public du petit écran, le nom de Marthe Keller évoque aussitôt la série « culte » de La Demoiselle d’Avignon. Pour beaucoup d’amateurs de cinéma, celle qui fut l’épouse de Philippe de Broca (dont elle a un fils, le peintre Alexandre de Broca) et la partenaire de son ami Al Pacino dans l’émouvant Bobby Deerfield de Sydney Pollack, irradia aussi de sa présence Fedora de Billy Wilder et Marathon Man de John Schlesinger.
Cependant, la carrière cosmopolite de cette comédienne de théâtre et de cinéma, aussi à l’aise en allemand et en anglais qu’en français, est parfois sous-estimée dans notre pays, notamment en Suisse allemande. Plus de nonante films de télévision (où figurent deux de ses préférés, Le lien et La ruelle au clair de lune) et de cinéma, une carrière théâtrale de haut niveau et une mise en scène du Don Giovanni de Mozart qui a fait date, émaillent la trajectoire de cette artiste exemplaire. Rencontre à Soleure, où sont présentés onze de ses films.
- Qu’est-ce pour vous que la Suisse ?
- Tout. La Suisse est tout pour moi. Tout à l’heure, je suis arrivée à la gare de Soleure que je connais à peine, il pleuvait, et je me suis dit : voilà, je suis à la maison. Je suis partie toute jeune de la Suisse parce que je m’y sentais à l’étroit. Tout était trop petit pour moi. Ce n’est pas que j’avais la grosse tête, mais j’avais besoin d’indépendance et de m’affranchir. Or plus je vieillis et plus, avec la distance et l’absence, je me sens accrochée à ces racines. Si j’ai réussi un petit peu dans ma vie professionnelle, c’est grâce à la Suisse. À cause de l’amour de mes parents et de leur honnêteté. À cause de l’équilibre qu’ils m’ont aidée à préserver. Si je ne suis pas hystérique et que j’ai gardé le respect du travail bien fait sans me prendre trop au sérieux, c’est à cause d’eux et de la Suisse.
- Qu’est-ce qui vous « tient ensemble » dans vos multiples activités et forme l’unité de votre personne ?
- Ce qui est essentiel pour moi, c’est l’indépendance et la question. La question m’intéresse plus que la réponse. Les résultats ne m’intéressent pas : c’est la mort. Le trajet m'intéresse. On a besoin du public, mais je n'aime pas ce qui entoure ce métier, le côté superficiel et débile du « people ». Lorsqu’on me pose des questions « people », je me dis que la vie d’un dentiste ou d’une femme de ménage mériteraient autant d’attention que celle d’un acteur, mais bon : nous faisons un métier public et c’est le jeu. Et si le bavardage médiatique ne m’intéresse pas, ce qui m’intéresse c’est le travail. J’adore le travail, et de plus en plus souvent avec les jeunes. J’ai beaucoup aimé, ainsi, travailler avec les apprentis réalisateurs de l’ECAL, à Lausanne. J’ai tourné avec des gens extraordinaires comme Billy Wilder, Sydney Pollack ou plus récemment Clint Eastwood, avec des acteurs comme Marlon Brando, Dustin Hofman, Al Pacino, entre tant d’autres, je les admire et ils m’ont fait rêver, mais la peur de l’inconnu vient d’ailleurs et je suis plutôt groupie de tout ce que je ne connais pas : les gens qui font quelque chose de bien pour le monde, des savants, des médecins, me fascinent plus que les grands du cinéma, qui font en somme leur boulot.
- Quand avez-vous commencé de rêver au théâtre ou au cinéma ?
- Je n’ai jamais rêvé à cette carrière. J’ai rêvé d’être danseuse, mon rêve s’est brisé vers seize dix-sept ans après un accident de ski, mais je ne m’en plains pas aujourd’hui : ça fait une danseuse au chômage de moins ! J’étais trop timide pour imaginer que je ferais jamais du théâtre et du cinéma ! D’ailleurs, comédienne boursière à Munich pour trois ans, puis à Heidelberg, j’ai essuyé pas mal de refus avant de me risquer à Berlin en 1966 où j’ai enfin démarré et joué tous les classiques au théâtre avant de rallier Paris en 1968, où j’ai rencontré Philippe de Broca.
 - Quels films, des onze qui sont présentés à Soleure vous sont les plus chers, et pourquoi ?
- Quels films, des onze qui sont présentés à Soleure vous sont les plus chers, et pourquoi ?
- Certains films que j’aime particulièrement, comme La ruelle au clair de lune de Molinaro, avec Michel Piccoli, ou Le lien, ne sont pas là, mais je comprends le choix du festival qui mise aussi sur les succès américains. Le Lien, téléfilm de Denis Malleval, est mon film préféré, mais j’aime bien aussi Elle court elle court la banlieue, de Gérard Pirès, qui reste très actuel et que le public de Soleure reverra. Je suis aussi contente qu’il y ait Les yeux noirs, de Mikhalkov, qui n’est pas parfait mais contient de jolies choses, ou encore Per le antiche scale de Bolognini avec Marcello Mastroianni.
- Y a-t-il des rôles, dans votre carrière de comédienne, qui vous aient particulièrement marquée ?
- Je me nourris de tout, même si c’est un petit rôle . Les grands chocs, pour moi, ont été plutôt théâtraux. C’est par exemple Jeanne d’Arc que j’ai interprétée dans quinze productions durant trente ans et que j’ai mûri. Sinon, j’ai toujours appris quelque chose.
- Cela vous gêne-t-il d’être identifiée, par beaucoup, comme la demoiselle d’Avignon ?
- Au début j’étais très heureuse. Après, comme j’ai fait tellement de choses plus dures et consistantes, ça commençait de ronronner et de m'agacer. Plus tard, j’ai revu ça à cause de mes petites-filles et je me suis dit que ça faisait en somme rêver sans vulgarité. Et puis c’était bien ficelé avec la magie du feuilleton qui vous donne envie de rester scotché. Enfin vous n’allez pas le croire mais ce matin encore, à Paris, le chauffeur de taxi m’a reconnue quarante ans après…
- Qu’avez-vous eu à cœur de transmettre à votre fils ?
- Mon fils Alexandre est ma fierté ! Ce que je constate, dans ses choix, c’est que je lui ai transis mon goût de l’indépendance et de l’honnêteté dans son travail. L’artiste Alexandre de Broca mène sa barque avec beaucoup d’intelligence et de talent. Il pratique la gentillesse et l’intégrité et se trouve toujours prêt à partir. Ses deux filles Charlotte et Joséphine, une petite violoniste et sa sœur, semblent elles aussi sur la bonne voie. Ma petite Charlotte, qui a neuf ans et à qui j’interdis de prononcer un gros mot comme « grand-mère », m’a écrit « Nina, est-ce que tu peux venir m’écouter à l’auditorium du Conservatoire du IXe avec toute ma troupe ? », devant 600 personnes. Elle a joué Bach
- et la grand-mère en a pleuré...
Avez-vous le sentiment d’avoir été reconnue en Suisse ?
- Cela a été le sujet de toute une polémique ! Pour Bâle, j’ai commencé à exister, dans les médias, avec ma Légion d’Honneur en janvier dernier. Cela m’a valu de faire la Une après des années d'inexistence, mais il ne faut pas le dire : ne l’écrivez pas ! Les Romands m’ont toujours acceptée, mais les Bâlois ont vu d’un mauvais œil que je parte à l’étranger ou en Suisse romande. Par ailleurs, la première proposition qui m’a été faite de tourner en Suisse l’a été passée la soixantaine, dans le film Fragile de Laurent Nègre, en 2005. Merveilleuse expérience d’ailleurs ! Alors que l’équipe était sans moyens, elle m’a loué une suite royale à l’Hôtel du Rhône grâce à une amitié entre hockeyeurs, et une Rolls offerte par un garagiste admirateur qui voulait juste une photo dédicacée. Nous avons beaucoup ri et restons complices : c’est ce que j’aime en Suisse, même si cette débrouillardise n’est pas « typiquement suisse ». Et puis j’ai aimé le film, sa qualité humaine, sa tendresse et les questions qu’il pose sur les relations entre deux frères et sœur confrontés à la mère atteinte d’Alzheimer. Ce mélange de bonne nature et de travail sérieux. Ensuite j’ai resserré mes liens avec le Festival de Zurich qui m’a offert la présidence du jury. Et là je me suis dit qu’il y avait en Suisse de formidables talents qu’on ignore alors même qu’on découvre des films philippins à Paris… Depuis lors, je travaille sur des scénarios, j’ai donné mes « secrets » à l’ECAL de Lausanne, où j’ai aussi rencontré Lionel Baier dont j’adore le travail personnel. Par ailleurs. Ce que fait la Fondation Rolex est extraordinaire, et c’est pour aider : pas du tout bling-bling ! Et le festival musical de Verbier, auquel j’assiste depuis le début, est aussi formidable !
- Vous avez passé à la mise en scène d’opéra avec Don Giovanni. Quelle place la musique tient-elle dans votre vie ? Et Pensez-vous remettre ça ?
- Vous êtes Italien d’origine, à prononcer Don Giovanni comme ça ?
- Non, mais j’aime l’Italie et me réclame volontiers de mon arrière-grand-père maternel, un curé piémontais qui a connu bibliquement la mère de ma grand-mère, chassée de son village du Haut-Valais alors que lui restait crânement sur sa chaire…
- Ah je vous envie, ça c’est swing ! Quant à la musique, elle m’habite depuis ma jeunesse de danseuse. Mon oreille a été éduquée quand je faisais partie du corps de ballet, jusqu’à mon accident, car nous n’entendions pas que Tchaïkovski mais aussi Britten, Prokofiev et bien d’autres. Un jour, Seizi Ozawa m’a choisie pour remplacer Meryl Streep dans Jeanne d’Arc au bûcher, de Claudel et Honegger, et c’est ainsi que je suis revenue à la musique. Plus tard, j’ai participé à des concerts-lectures au Carnegie Hall. Cependant je n'ai pas actuellement de rêve d’opéra. En revanche, je reprendrais demain le Dialogue des Carmélites si on me le demandait. Il n’y a rien qui ne soit plus loin de moi que la religion catholique au sens strict, ou la Révolution française. Mais en travaillant sur le Dialogue, j’ai découvert une correspondance de Gertrud Von Lefort avec Edith Stein, juive devenue carmélite et morte en camp de concentration. Or Gertrud von Lefort a écrit La dernière sur l’échafaud avant Poulenc et Bernanos, et rajouté en 1933 le rôle de Blanche. Je n’ai pas ajouté l’étoile jaune à ma mise en scène, mais celle-ci a été une grande expérience partagée. À mes choristes carmélites que je considérais comme autant de rôles-titres, j’ai dit que j’espérais que nous sortions de cette aventure plus riche et meilleurs. Pendant les répétitions, il y avait une vraie grâce, alors que les répétitions de Don Giovanni au Metropoliotan Opera étaient terribles, chacun craignant pour son job, etc. Bref, avec Cassandre, Jeanne d’Arc et les Dialogues, on ne quitte pas le spirituel même si je ne vais pas à l’église tous les dimanches.
- Y a-t-il un film que vous mettiez au-dessus de tous ?
- Quand passent les cigognes, de Mikhaïl Kalatozov. Sans être religieux, ce film contient tout…
- Le cap de la soixantaine est parfois redoutable dans le monde actuel, et notamment au cinéma. Comment l’avez-vous vécu ?
- Bien mieux que le cap de la quarantaine ou de la cinquantaine ! En fait, je vois les propositions affluer ces derniers temps. Comme je ne suis pas trop botoxée, les réalisateurs apprécient peut-être mon naturel…Je viens de finir le tournage d’Au galop de Louis-Do de Lencqeusaing. Je viens aussi de signer avec un grand réalisateur anglais pour le rôle principal de son prochain film – c’est génial mais encore top secret. Et un film français avec Gérard Depardieu va suivre, entre autres.
- Lira-ton un jour les mémoires de Marthe Keller, et tenez vous un journal intime comme toute jeune fille bien ?
- Ah non, quelle horreur ! On me le demande toutes les semaines, mais non ! Hier, cependant à l’ambassade suisse de Paris, j’ai lu L’Analphabète d’Agota Kristof dont vient d’être tiré un CD pour les éditions Zoé. L’une de mes dernières lectures a été Aucun d'entre nous ne reviendra de Charlotte Delbo, la douleur absolue. Et je travaille beaucoup, depuis trois ans, autour d’Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva et Rilke…
- Comment va votre Amérique ?
- C’est assez terrible, comme partout. Mais c’est pire en France où on fait la gueule. Les Américains, c’est évidemment l’argent et l’argent, mais ils s'accrochent avec toute leur naïveté et leur courage aussi, et puis ils font quand même la fête. Les Français font la gueule et ils aiment un peu trop les scandales. Quant à moi, je ne pourrais pas vivre à Zurich ou à Bâle, mais là je vais passer un mois à Verbier et j’y suis déjà comme chez moi…
Journées de Soleure, jusqu’au 26 janvier. Programme des films avec Marthe Keller : www.journeesdesoleure.ch

 Patria Grande à la Grange de Dorigny, Lausanne, du 26 au 29 janvier et à l'Usine à Gaz, Nyon, le 2 février www.dominiqueziegler.com
Patria Grande à la Grange de Dorigny, Lausanne, du 26 au 29 janvier et à l'Usine à Gaz, Nyon, le 2 février www.dominiqueziegler.com
 Aux dernières nouvelles, j’ai constaté qu’Alina Reyes avait fermé son site, après avoir fermé son blog depuis un certain temps déjà. A-t-elle eu raison ? Sans doute, en ce qui la concerne, et son livre l’illustre évidemment. Mais a-t-elle raison de réduire ceux qui pratiquent la blogosphère à des rats morts ? Je ne le crois pas. D’ailleurs les accents qui se veulent prophétiques, dans le genre catastrophiste, de Forêt profonde, sont à mes yeux la partie la plus faible du livre, et qui vieillira vite n’était-ce que par ses lourdeurs d’écriture, alors que le souffle de l’Eros, le souffle de la vie et le souffle de l’amour en traversent mainte pages superbes et qu’on relira demain.
Aux dernières nouvelles, j’ai constaté qu’Alina Reyes avait fermé son site, après avoir fermé son blog depuis un certain temps déjà. A-t-elle eu raison ? Sans doute, en ce qui la concerne, et son livre l’illustre évidemment. Mais a-t-elle raison de réduire ceux qui pratiquent la blogosphère à des rats morts ? Je ne le crois pas. D’ailleurs les accents qui se veulent prophétiques, dans le genre catastrophiste, de Forêt profonde, sont à mes yeux la partie la plus faible du livre, et qui vieillira vite n’était-ce que par ses lourdeurs d’écriture, alors que le souffle de l’Eros, le souffle de la vie et le souffle de l’amour en traversent mainte pages superbes et qu’on relira demain.
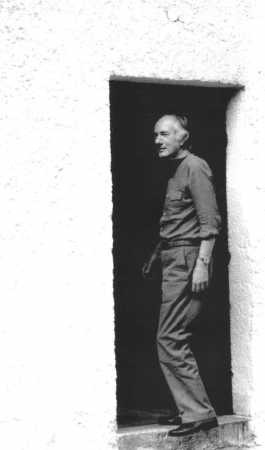

 - Quels films, des onze qui sont présentés à Soleure vous sont les plus chers, et pourquoi ?
- Quels films, des onze qui sont présentés à Soleure vous sont les plus chers, et pourquoi ?





 Quand Anne Wiazemsky raconte « son » Godard…
Quand Anne Wiazemsky raconte « son » Godard…
 Un paresseux fécond
Un paresseux fécond

 Robert Walser avant-gardiste? Pas du tout au sens d'un chef d'école ou d'un concepteur de manifestes. Et pourtant, qui aura mieux que lui subverti tous les clichés et nettoyé, à sa façon, la langue en la «travaillant» au creux de ses arcanes auriculaires - Peter Utz dégageant mieux que personne son talent d'«écouteur» du bruit du temps.
Robert Walser avant-gardiste? Pas du tout au sens d'un chef d'école ou d'un concepteur de manifestes. Et pourtant, qui aura mieux que lui subverti tous les clichés et nettoyé, à sa façon, la langue en la «travaillant» au creux de ses arcanes auriculaires - Peter Utz dégageant mieux que personne son talent d'«écouteur» du bruit du temps.

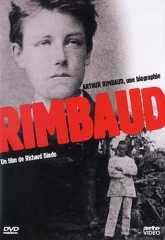





 Après avoir signé La déconfite gigantale du sérieux, entre dix autres titres, Arno Bertina, 37 ans, consacre un peu moins de 500 pages « gigantalement » ludiques, voire délirantes, à celui qu’on a qualifié tantôt de « génie » et d’« extraterrestre », conjuguant « grâce absolue et « magie ». Or ce délire n’est en rien une « déconfite » du vrai sérieux. Pas seulement parce que l’auteur, qui semble tout connaître des moindres « coups » du Maître, parle merveilleusement du tennis, mais parce que son roman va bien au-delà de la célébration sportive ou de la curiosité pipole : du côté de l’humain, du dépassement de soi et des retombées de la réussite, ou de l’échec que le seul terme de « mononucléose » suffirait à évoquer, etre autres envolées philosophiques, artistico-physiologiques ou éthylo-poétiques.
Après avoir signé La déconfite gigantale du sérieux, entre dix autres titres, Arno Bertina, 37 ans, consacre un peu moins de 500 pages « gigantalement » ludiques, voire délirantes, à celui qu’on a qualifié tantôt de « génie » et d’« extraterrestre », conjuguant « grâce absolue et « magie ». Or ce délire n’est en rien une « déconfite » du vrai sérieux. Pas seulement parce que l’auteur, qui semble tout connaître des moindres « coups » du Maître, parle merveilleusement du tennis, mais parce que son roman va bien au-delà de la célébration sportive ou de la curiosité pipole : du côté de l’humain, du dépassement de soi et des retombées de la réussite, ou de l’échec que le seul terme de « mononucléose » suffirait à évoquer, etre autres envolées philosophiques, artistico-physiologiques ou éthylo-poétiques. 


 …L’idée que le geste de faire pût se faire à deux n’avait pas effleuré, cela va sans dire, la pensée créatrice de Basil pour lequel Dante et Béatrice, Pétrarque et Laure ou Cervantès et sa flopée de personnage ne travaillent pas dans le même rayon - chacun son job. Mais Jula n’est pas moins essentielle que le surnommé Nuage dans la story genre épopée urbaine dont on ne voit pas trop où elle conduira si ce n’est qu’elle m’est un prétexte comme un autre de revoir Basil au café des Abattoirs ou au Buffet de la Gare sous le Cervin mandarine, selon les jours ; et c’est là que nous parlons et reparlons de cette idée éventée visant à l’évacuation de la notion d’Auteur, comme on a renvoyé les personnages de romans aux vestiaires et la notion même de story, avant de replonger dans les avatars de téléfilms et de romans-feuilletons. Tout ça, Tonio, on se l’est dit et répété, pour soulager la vanité chiffonnée des auteurs sans entrailles et des cuistres facultards. Tout ça complètement obsolète et à réviser à l’acéré. Vieilles nippes pseudo-modernistes. Après Bourdieu les bourdieusards et c’est de la même paroisse aigre que celle des bigotes de l’Abbé Brel. Je n’en ferai pas, le Kid, une théorie de plus, mais la notion d’Auteur est une aussi belle fiction que la fiction des personnages se pressant dans sa salle d’attente pour le casting. Tu connais ma vanité totale, Kiddy, qui serait de ne plus signer aucun texte. On y reviendra à l’orgueil suprême du griot homérique parlant comme personne et pour tout le monde – ce qu’attendant tu me cites trois lignes du petit Marcel, trois de l’affreux Ferdine, trois autres de l’ourse noire ou de sainte Flannery et je te signe le certificat d’identification, nulle difficulté en cela, n’est-ce pas, mais pour prouver quoi ? Or ce que j’aime dans votre volée de freluquets est votre dédain croissant des références et des étiquettes, qui vous campe plus nus devant la Chose, plus désarmés peut-être mais peut-être plus vrais, parfois, j’sais pas, y m'semble, je crois…
…L’idée que le geste de faire pût se faire à deux n’avait pas effleuré, cela va sans dire, la pensée créatrice de Basil pour lequel Dante et Béatrice, Pétrarque et Laure ou Cervantès et sa flopée de personnage ne travaillent pas dans le même rayon - chacun son job. Mais Jula n’est pas moins essentielle que le surnommé Nuage dans la story genre épopée urbaine dont on ne voit pas trop où elle conduira si ce n’est qu’elle m’est un prétexte comme un autre de revoir Basil au café des Abattoirs ou au Buffet de la Gare sous le Cervin mandarine, selon les jours ; et c’est là que nous parlons et reparlons de cette idée éventée visant à l’évacuation de la notion d’Auteur, comme on a renvoyé les personnages de romans aux vestiaires et la notion même de story, avant de replonger dans les avatars de téléfilms et de romans-feuilletons. Tout ça, Tonio, on se l’est dit et répété, pour soulager la vanité chiffonnée des auteurs sans entrailles et des cuistres facultards. Tout ça complètement obsolète et à réviser à l’acéré. Vieilles nippes pseudo-modernistes. Après Bourdieu les bourdieusards et c’est de la même paroisse aigre que celle des bigotes de l’Abbé Brel. Je n’en ferai pas, le Kid, une théorie de plus, mais la notion d’Auteur est une aussi belle fiction que la fiction des personnages se pressant dans sa salle d’attente pour le casting. Tu connais ma vanité totale, Kiddy, qui serait de ne plus signer aucun texte. On y reviendra à l’orgueil suprême du griot homérique parlant comme personne et pour tout le monde – ce qu’attendant tu me cites trois lignes du petit Marcel, trois de l’affreux Ferdine, trois autres de l’ourse noire ou de sainte Flannery et je te signe le certificat d’identification, nulle difficulté en cela, n’est-ce pas, mais pour prouver quoi ? Or ce que j’aime dans votre volée de freluquets est votre dédain croissant des références et des étiquettes, qui vous campe plus nus devant la Chose, plus désarmés peut-être mais peut-être plus vrais, parfois, j’sais pas, y m'semble, je crois…  …Entretemps, après Vanda, j’avais aussi découvert Trona. Un youngster à l’air rilax m’avait fait ce cadeau de me révéler Trona dans son premier roman, après Le cul de Judas du bel Antonio. Les musiciens servent à ça aussi : à te fiche le blues avec un Andante dont tu ne te rappelles plus le nom de l’auteur sauf que tu sens qu’il a vu un peu plus de pays que les autres, celui-là. J’te passe quand tu veux la mort de Didon de Purcell, compère Quentin, ou je te fredonne la Sonate posthume de Schubert ou n’importe quel blues de Lightnin’Hopkins. Et voir la vérité de Trona, autant qu’exprimer l’atroce vérité de Vanda titubant entre seringues et cageots dans le labyrinthe à l’infernal tintamarre, se replonger en Angola guerrier dans la foulée de Lobo Antunes puis suivre ce Don Juan carabiné - le meilleur coup de Benfica selon les femelles de là-bas -, dans les cercles infernaux des malades de Monsieur le psychiatre frotté de lettres, fraternel autant qu’un Carver ou qu’un Tchekhov; et revenir alors à l’inoubliable dépotoir de la Salle 6 de ce dernier – tout ça va nous exonérer, comme après une virée aux pays de Flannery ou de l’affreuse Patty, des salamalecs devant le Génie de l’Auteur ou des arguties méticuleuses visant à nous prouver que rien ne tient que la textualité du texte en son contexte textuel – tout cela ne découlant finalement que de la même chronique immensément amère et tonique, car tout se mêle, que tous ils se mêlent et s’entremêlent à renfort de vocables dans le flux des proses, et l’homme n’en finit pas de tomber…
…Entretemps, après Vanda, j’avais aussi découvert Trona. Un youngster à l’air rilax m’avait fait ce cadeau de me révéler Trona dans son premier roman, après Le cul de Judas du bel Antonio. Les musiciens servent à ça aussi : à te fiche le blues avec un Andante dont tu ne te rappelles plus le nom de l’auteur sauf que tu sens qu’il a vu un peu plus de pays que les autres, celui-là. J’te passe quand tu veux la mort de Didon de Purcell, compère Quentin, ou je te fredonne la Sonate posthume de Schubert ou n’importe quel blues de Lightnin’Hopkins. Et voir la vérité de Trona, autant qu’exprimer l’atroce vérité de Vanda titubant entre seringues et cageots dans le labyrinthe à l’infernal tintamarre, se replonger en Angola guerrier dans la foulée de Lobo Antunes puis suivre ce Don Juan carabiné - le meilleur coup de Benfica selon les femelles de là-bas -, dans les cercles infernaux des malades de Monsieur le psychiatre frotté de lettres, fraternel autant qu’un Carver ou qu’un Tchekhov; et revenir alors à l’inoubliable dépotoir de la Salle 6 de ce dernier – tout ça va nous exonérer, comme après une virée aux pays de Flannery ou de l’affreuse Patty, des salamalecs devant le Génie de l’Auteur ou des arguties méticuleuses visant à nous prouver que rien ne tient que la textualité du texte en son contexte textuel – tout cela ne découlant finalement que de la même chronique immensément amère et tonique, car tout se mêle, que tous ils se mêlent et s’entremêlent à renfort de vocables dans le flux des proses, et l’homme n’en finit pas de tomber…
 Celle qui préfère ceux qui de presque rien font de petits quelque chose / Ceux qui s’approchent à tâtons de la source de lumière légèrement réchauffante / Celui qui évite les bavards sectaires / Celle qui ne sait rien que par la peau / Ceux qui se parlent à demi-mots et à double-sens / Celui que les explications claires dépriment toujours un peu / Celle qui ne se fie qu’aux ardents / Ceux qui ont tout refroidi / Celui qui endure la méchanceté des lascars / Celle qui devine le pourquoi de la méchanceté des lascars à l’endroit des infirmes / Ceux qui se paient sur l’innocence des candides / Celui qui efface ses traces afin d’être mieux suivi /
Celle qui préfère ceux qui de presque rien font de petits quelque chose / Ceux qui s’approchent à tâtons de la source de lumière légèrement réchauffante / Celui qui évite les bavards sectaires / Celle qui ne sait rien que par la peau / Ceux qui se parlent à demi-mots et à double-sens / Celui que les explications claires dépriment toujours un peu / Celle qui ne se fie qu’aux ardents / Ceux qui ont tout refroidi / Celui qui endure la méchanceté des lascars / Celle qui devine le pourquoi de la méchanceté des lascars à l’endroit des infirmes / Ceux qui se paient sur l’innocence des candides / Celui qui efface ses traces afin d’être mieux suivi /  Celle qui se désole de voir tant de garçons renoncer à la Conquête / Ceux qui ont fait le tour de la Question et ne feront donc plus que se la poser / Celui qui s’en met une pour en finir avec cette année soûlante / Celle qui écoute ce qui parle en elle dans une langue qu’elle apprend à mesure / Ceux qui se racontent l’histoire de la rousse qui a jeté son enfant au dévaloir et qu’on a retrouvé vivant et qui a fait une jolie carrière de trader alors qu’elle en chie dans la banlieue de Lisbonne / Celui qu’une malédiction semble poursuivre mais ce n’est qu’une impression / Celle qui voit son taudis fracassé par les promoteurs qui ne respectent rien / Ceux qui se trouvaient bien dans l’immeuble pourri aux squatters amateurs de slam / Celui qui chantonne au milieu des gravats / Celle qui répand de la joie sans le savoir ni le vouloir encore moins / Ceux qui se contentent de ce qu’ils ont sans la moindre envie sauf la secousse qu’on sait ou une tuée le samedi / Celui qui a une tempête dans la tête qu’il affronte avec la détermination de Prospéro sublimant la rage de Caliban et déployant la grâce d’Ariel et de Miranda / Celle qui calme les éléments en élevant simplement la voix juste ce qu’il faut / Ceux qui s’opiniâtrent à l’Ouvroir, etc.
Celle qui se désole de voir tant de garçons renoncer à la Conquête / Ceux qui ont fait le tour de la Question et ne feront donc plus que se la poser / Celui qui s’en met une pour en finir avec cette année soûlante / Celle qui écoute ce qui parle en elle dans une langue qu’elle apprend à mesure / Ceux qui se racontent l’histoire de la rousse qui a jeté son enfant au dévaloir et qu’on a retrouvé vivant et qui a fait une jolie carrière de trader alors qu’elle en chie dans la banlieue de Lisbonne / Celui qu’une malédiction semble poursuivre mais ce n’est qu’une impression / Celle qui voit son taudis fracassé par les promoteurs qui ne respectent rien / Ceux qui se trouvaient bien dans l’immeuble pourri aux squatters amateurs de slam / Celui qui chantonne au milieu des gravats / Celle qui répand de la joie sans le savoir ni le vouloir encore moins / Ceux qui se contentent de ce qu’ils ont sans la moindre envie sauf la secousse qu’on sait ou une tuée le samedi / Celui qui a une tempête dans la tête qu’il affronte avec la détermination de Prospéro sublimant la rage de Caliban et déployant la grâce d’Ariel et de Miranda / Celle qui calme les éléments en élevant simplement la voix juste ce qu’il faut / Ceux qui s’opiniâtrent à l’Ouvroir, etc.