
Anne-Lise Thurler est décédée ce matin, laissant une œuvre vibrante d’humanité.
C’est une figure attachante de la littérature romande qui s’est éteinte aujourd'hui en la personne d’Anne-Lise Thurler, romancière et nouvelliste dont le dernier récit, paru en avril 2007 chez Zoé sous le titre de La fille au balcon, restera comme l’un de ses ouvrages les plus aboutis, les plus frémissants de sensibilité et les plus ouverts à la compréhension de l’autre.
Il y est question, après la mort de la mère de la narratrice, de l’effort que celle-ci s’impose afin de retrouver, malgré des années d’incompréhension et de maltraitance, celle dont elle s’était déjà rapprochée durant les dernières années de sa vie. Avec une lucidité claire nuancée de tendresse blessée, Anne-Lise Thurler aura donné, dans ce dernier livre paru, le meilleur d’un talent toujours nourri par la vie, qui s’est déployé dans le roman (Le crocodile ne dévore pas le pangolin et Lou du fleuve) et les nouvelles (Scènes de la mort ordinaire et L’enfance en miettes). Attentive aux misères du monde, elle avait également composé, avec Selajdin Doli, réfugié kosovar, un récit-témoignage à deux voix évoquant les tribulations des Albanais du Kosovo, intitulé Aube noire sur la plaine des merles, adapté au théâtre par Isabelle Bonillo et présenté au fil d’une longue tournée en Suisse romande.
Terrassée par la maladie avant la cinquantaine (elle était née en 1960 à Fribourg et vivait au Mont-sur-Lausanne avec ses deux jeunes enfants), Anne-Lise Thurler laisse, à ceux qui l’ont connue, le souvenir d’un belle personne rayonnante et généreuse.
-
-
Le courage de Boualem Sansal

Le village de l’Allemand, entre Shoah et Djihad
La lecture du Village de l’Allemand, nouveau roman de l’écrivain algérien Boualem Sansal, est immédiatement prenante. Aussitôt on plonge dans un drame aux multiples occurrences personnelles et autres ramifications historico-politiques, dont le Mal du XXe siècle et de celui qui a si dangereusement commencé, entre Shoah et Djihad, tisse la trame de sang et de destruction, d’ignominie et de honte.
Cela commence, en octobre 1996, par le journal du jeune Malrich (prénom condensant Malek et Ulrich), dont le langage signale un beur de banlieue plutôt atypique, puisque son père est d’origine allemande, et qui commence d’écrire six mois après le suicide de son grand frère Rachel (condensé de Rachid et Helmut), brillant sujet, comme on dit, mais sombré dans le désespoir on ne sait pourquoi.
On le comprend mieux après que Com’Dad, le commissaire de quartier de la « zone urbaine sensible de première catégorie » où survivote Malrich, remet à celui-ci les quatre cahiers chiffonnés constituant le journal de Rachel, ledit Com’Dad lançant au plus ou moins voyou : « Faut lire, ça te mettra du plomb dans la tête. Ton frère était un type bien ». Et de fait, ces cahiers vont changer la vie de Malrich, comme la vie de Rachel a changé, au lendemain d’un massacre, en 1994, qui a coûté la vie à ses parents, là-bas dans un douar du bout du monde du nom d’Aïn Deb, quand il découvrit qui fut en réalité son père déclaré « martyr », l’ancien SS Hans Schiller…
On sait le grand talent de Boualem Sansal, auteur de l’admirable Serment des Barbares, et son courage intellectuel, qui lui a dicté l’an dernier la lettre ouverte de colère et d'espoir au pouvoir et au peuple algérien intitulée Poste restante : Alger. On se rappelle l’amitié qui le liait à Rachid Mimouni, autre romancier intègre qui mourut désespéré en Europe et dont le corps rapatrié dans son pays fut déterré par les islamistes pour être dépecé et livré aux chiens de la nuit. Je me souviens qu’à ma dernière rencontre de Mimouni je lui souhaitai d’être protégé par Allah. Or c’est le même Allah que j’invoque en lisant ce nouveau livre, inspiré par une histoire vraie, où alternent les voix des deux frères, celle de Rachel relayant elle-même les voix de tous les témoins de l’horreur, Primo Levi en tête et transmettant à celle de Malrich une nouvelle conscience et l’espoir que la honte puisse être dépassée par le « geste d’amour » de son sacrifice…
Boualem Sansal. Le village de l'Allemand, ou le journal des frères Schiller. Gallimard, 263p. -
Pierrot le fou le reste

La Compagnie Un air de rien revisite Pierrot le fou de Godard en évitant le recyclage complaisant. A voir à Vidy.
Quel sens cela peut-il bien avoir, plus de quarante ans après le choc artistique qu'a constitué la sortie de Pierrot le fou (en 1965), de revisiter au théâtre l'un des films «cultes» de Jean-Luc Godard, alors même que celui-ci dénonce aujourd'hui le manque de créativité des nouvelles générations? Comment échapper au réchauffé, voire à la resucée débile, étant entendu que ce qui survit du film tient essentiellement au cinéma, plus exactement: à la géniale «musique de plans» de Godard? Après Bonnie and Clyde ou Sailor and Lula, cette énième cavale des amants libertaires ne se réduirait-elle pas à un recyclage opportuniste?
Telles sont les questions que se seront posées d'aucuns avant d'assister au Pierrot le fou de la Compagnie Un air de rien, dans une mise en scène très inventive de Sandra Gaudin et une (belle et efficace) scénographie de Sylvie Kleiber, assistée par Joan Ayrton pour l'horizon pictural, avec une équipe de trentenaires fringants pour complices, dont sept comédiens pétants de talentueuse santé.
Qu'est-ce que Pierrot le fou à l'origine? En gros, pour citer un bout du scénario de Godard, c'est l'histoire de Ferdinand et Marianne qui «sautent dans l'eau en riant. Ils ne réussissent pas à sauver les valises mais s'en foutent, et s'éloignent en se tenant par la taille. Le long de la plage déserte, éclairée par le soleil couchant, la mer efface la trace de leurs pas.» C'est donc une histoire d'amants sur la plage du monde, ici et maintenant, dont on va suivre les traces de pas avant que la mer ne les efface, à moins que ça ne finisse à la mitraillette, comme dans les polars à quatre sous, et qu'il en reste du rouge, assorti à la robe de la dame...
Au théâtre, maintenant, c'est tout de suite la question du langage qui est posée par une petite fille au ballon à Pierrot vautré dans sa baignoire et lisant sa propre histoire pour lâcher justement ce mot de «langage»: «Ah mais, m'sieur, le langage, c'est quoi?»
Eh bien, voici ce que c'est: c'est du piapia de pub gorillé, ce sont les formules de la persuasion clandestine et de la philosophie à La petite semaine de Suzette postmoderne, c'est du patchwork de clichés émaillant tous les discours de tous les pouvoirs et de tous les affects du monde qui nous entoure autant en 2008 qu'en 1965, y compris les images pastichant la téloche ou les journaux gratuits.
C'est plus précisément la road story de Marianne et Ferdinand préludant à celle des Valseuses de Blier ou de Tueurs nés de Stone, mais avec les moyens du théâtre. Donc c'est redécoupé pour la scène, avec un montage de plans ad hoc, un dialogue recousu pile-poil «sur la bête». Et «la bête» vivante sur scène: sept comédiens en chair et en os pour dire la vie vite au moyen d'un éventail d'expressions touchant à toutes les formes, via le chant et la danse, la citation légendaire (le couple en Dauphine), le clin d'oeil au burlesque américain ou à la bande dessinée anarchisante, notamment.
Les acteurs réunis en l'occurrence sont tous épatants, à commencer par Diane Müller et Christian Scheidt (Marianne et Ferdinand), bien entourés par Hélène Cattin avec ses jolis nénés à l'air de femme superactuelle, Jean-Paul Favre qui chante et danse avec la grâce d'un éléphanteau de revue, Shin Iglesias «dégageant» elle aussi un max, Magali Tosato jouant Magali Tosato comme dans un film de Godard, et Nicolas Rossier en Godard à cigare pour l'envoi final.
Surtout, avec musiques et lumières (Pascal Noël, Ben Merlin et Guitos Fournier), costumes (Marie-Christine Meunier) et objets plus ou moins automobiles combinés dans l'ensemble du montage, sans temps morts ni trous d'espace, le ton du spectacle, en crescendo, «sonne» juste, ludique, intelligent et rigolo, le pied léger. Rien d'un «jeunisme» de pacotille dans cette réalisation chaleureusement accueillie, mais comme un air de jeunesse tonifiant...
Lausanne, Théâtre de Vidy, jusqu’au 3 février. www.theatrevidy.chCet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 17 janvier 2008.
-
Une musique fraternelle

Sur La visite de la fanfare d’Eran Kolirin
On s’attend d’abord à une satire ou, du moins, à un film jouant sur l’ironie, en découvrant les premières séquences de La visite de la fanfare de l’Israélien Eran Kolirin, dès l’arrivée des ploucs de la fanfare de la police d’Alexandrie dans ce trou perdu d’Israël où ils sont censés représenter l’honneur de l’harmonie égyptienne. Hélas, un malentendu les fait débarquer dans le bled de Bet Hatkiva au lieu de Patah Tikva où ils étaient attendus, et plus moyen de se tirer de là avant le bus du lendemain. Or on s’amuse de voir paniquer leur cérémonieux directeur (Sasson Gabai), imbu de sa tâche comme s’il en allait d’un enjeu national, et le premier passage en revue des membres de cette clique perdue, dont l’élément le moins contrôlable est le beau jeune Khaled aux yeux bleus cherchant la gueuse et traînant la patte en murmurant My funny Valentine de Chet Baker, ne manque pas de sel.
Bientôt, cependant, dès l’apparition de Dina (la merveilleuse Ronit Elkabetz), tenancière du bistrot de la vague bourgade où ils ont échoué, et qui les accueille pour la nuit, la cocasserie insolite de l’épisode va céder le pas à une émotion croissante, liée à l’atmosphère générale du récit et aux relations se nouant entre les personnages. Pour la soirée, Dina s’est réservé les deux fleurons masculins du groupe (le directeur coincé à souhait mais bel homme, et le jeune Khaled), tandis que leurs collègues subissent l’humeur mitigée d’une famille qui les reçoit de moins bonne grâce. Entre un dancing pour patineurs à roulettes et une boîte plus branchée, un jardin public et un bord de mer, les protagonistes vont frayer plus ou moins et parfois communiquer, tantôt par la musique (ce beau moment où Egyptiens et Israéliens se mettent à chanter Summertime) et tantôt par le geste (la séduction d’un laideron par un garçon timide qu’instruit Khaled nettement plus à la coule), ou par la confidence personnelle qui marque l’échange le plus émouvant du film, entre Dina et le chef tombant le masque et révélant son passé douloureux avant de se révéler, lui aussi, un adepte de Chet Baker...
 On pense un peu aux films de l’Est des années 60-70 (je ne sais pourquoi le souvenir de L’As de pique de Forman m’est soudain revenu), mais également aux situations décalées d'un Kaurismäki, au fil de cette mise en scène jouant sur d’étonnants ralentis et des plans quasi picturaux, où le jeune réalisateur excelle à rendre un climat dont l’étrangeté va de pair avec un sentiment croissant de fraternité. C’est très beau, très tendre, très touchant, très délicat. Ce premier ouvrage d’Eran Kolirim a été sacré meilleur film israélien de l’an dernier. On en sort tout ému.
On pense un peu aux films de l’Est des années 60-70 (je ne sais pourquoi le souvenir de L’As de pique de Forman m’est soudain revenu), mais également aux situations décalées d'un Kaurismäki, au fil de cette mise en scène jouant sur d’étonnants ralentis et des plans quasi picturaux, où le jeune réalisateur excelle à rendre un climat dont l’étrangeté va de pair avec un sentiment croissant de fraternité. C’est très beau, très tendre, très touchant, très délicat. Ce premier ouvrage d’Eran Kolirim a été sacré meilleur film israélien de l’an dernier. On en sort tout ému. -
Ceux qui se ressourcent
Celui qui se remet à la cure de phosphate / Celle qui brûle ses toxines en courant dans les escaliers / Ceux qui vont d'un bon pas sur leurs prothèses nickelées / Celle qu'insupportent les romans qui ne finissent pas bien / Ceux que leur pessimisme fait péter le feu / Celui qui se la pète aux amphètes /Celle qui acquiert avec confiance le package Poids (sauge, verveine, citronnelle, chiendent, feuilles de bigaradier) drainant, reminéralisant et détoxiquant/Ceux qui sourient sans discontinuer aux séances d’aquagym/Celui qui estime qu’un pot de gelée royale vaut le prix d’un Evangile relié plein cuir/Celle qui découvre enfin la pressothérapie après deux divorces épuisants quoique rémunérateurs/Ceux qui parlent russe dans le jacuzzi/Celui qui a appris à distinguer le bigaradier coupe-faim de l’oranger ordinaire traité aux produits chimiques/Celle qui va se fumer une pipe de tabac hollandais sur la terrasse enneigée après que son amie Rosemonde lui a clairement fait des remarques sur son surpoids et ses humeurs de sanglier/Ceux qui se repassent la vidéo de l’exécution de Saddam en attendant l’heure de leur traitement botulique/Celui qui lit Eschyle dans l’Espace Détente du centre thermal/Celle qui remarque que ce qui manque au centre est une enceinte de barbelés et des miradors pour surveiller ceux qui refusent de se relaxer/Ceux qui ne sont pas loin de penser que le watsu est la grande conquête de la nouvelle culture japonaise/Celui qui se fait expliquer l’origine du shiatsu par le Japonais aux long cheveux qui lui a emprunté Le Tapin (c’est ainsi qu’il appelle le journal Le Matin)/Celle qui explique à la petite amie du Japonais aux longs cheveux que la raclette ne se déguste pas avec de la bière sans alcool/Ceux qui passent des heures dans la salle de repos panoramique à s’efforcer de ne penser à rien sans y parvenir nom de Dieu/Celui qui se demande comment son chien Fellow réagirait à la cure de relaxation Reiki plusieurs fois millénaire/Celle qui recommande la massage à la pierre volcanique aux Hollandais qui lui ont révélé les vertus du massage pédimaniluve/Ceux qui estiment que les employés des Sources ne devraient pas faire usage des fraiseuses Honda pour le déneigement des abords des bassins en plein air à cause des gaz polluants et d’une nuisance phonique pas possible/Celui qui se paie une teinture de sourcils pour se donner plus de chances auprès du jeune Chilien Pablo Escudo dont il apprécie les interprétations au pianola/Celle qui pète les plombs dans le hammam/Ceux qui déclarent que la cure de détente totale Nirvana à 75 francs les 30 minutes ne vaut pas la caresse orgiaque des buses d’eau…
Peinture: Leonor Fini
-
L'énigme de CELA
Carnets de 2007 (fragments)
De la musique. - Il m’est difficile, de parler de musique, autant que des livres qui me sont les plus chers, comme si cela relevait d’une part trop intime, à la limite de l’indicible. Je peux parler de littérature et de peinture sans aucune difficulté, je peux parler de blues ou de rock, qui ne me touchent guère en profondeur (même si je peux réécouter un blues cent fois de suite), mais il en va tout autrement de la musique, que je ne puis qu’évoquer en relation avec telle ou époque de ma vie, Bach pour la maison de notre enfance, Puccini dans ma trappe artiste des escaliers du Marché, Mahler au Grand Chemin ou à La Malmeneur, Arvo Pärt dans ma trappe viennoise ou Schubert à La Désirade, entre cent autres, de Fauré à Purcell…
Insomnie I. – CELA m’empêche de dormir et c’est bien: je reconnais CELA pour mon bien, CELA ne se dit pas, qui advient lorsque je me retourne ou me déporte. CELA est mon indicible et ma justification non volontaire.
Angoisse. – Je me dis qu’elle n’est pas de moi et précisément: elle est en moi le plus que moi qui me taraude, m’interroge et me porte à faire éclater ce moi trop étriqué et trop personnel. Par elle je renoue avec le fonds impersonnel qui procède de la personne mystérieuse. CELA est ma zone sacrée.Blanchot. – Longtemps je me suis couché sans le lire, mais ces nuits de bonne heure j’ouvre L’Amitié comme un recours secret. Je ne désire en parler à personne. Leur culte m’a fait me tenir à distance tout en le lisant en douce de loin en loin, lui en son moi nombreux, son silence clair, tellement doucement éclairant.
Mondanité. – Tenue de ville exigée. Dressing code. L’endroit où il faut être. Toutes ces formules d’un théâtre nul me remontent à la gorge en lisant Comment parler des livres qu’on n’a pas lus? Cela même que je fuis avec Walser et Bartleby à travers les taillis et le long des arêtes.
Grimace. – Le fantasme est grimace, qui n’est même pas un masque. Celui-ci serait pudeur ou protection, allusion à autre chose, même pulsion pure, tandis que le fantasme est sans histoire, j’entends le fantasme sexuel multimédiatique qui ne raconte rien mais branle la multitude.
Bartleby. – L’esquive de celui qui refuse de jouer ne me suffit pas. Je serai l’ennemi de l’intérieur. Je sonderai la bauge et m’en ferai le témoin. Ils croient m’avoir mais je leur souris au nez: je réponds à leur parole vide par mon silence songeur. Je mimerai leur vulgarité et leur platitude. Je vis tous les jours ce grand écart entre la substance et l’insignifiance.
Du non intérieur. – La Daena, de l’angéologie iranienne, est le modèle céleste à la ressemblance duquel j’ai été créé et le témoin qui m’accompagne et me juge en chacun de mes gestes. Au moment ultime je la verrai s’approcher de moi, transfigurée selon la conduite de ma vie en une créature encore plus belle ou en démon grimaçant. Ma Daena n’attend chaque jour qu’un petit non qui soit pour elle une pensée belle. Elle attend ta conversion matinale, me dis-je en lui souriant, puis je l’oublie en attendant demain qui m’attend, mais je garde en moi ce petit non que j’oppose à tout moment à ce qui risque d’enlaidir ma Daena…
Insomnie II. – CELA est à la fois le butoir et l’échappée. Tout vise à l’esquiver ou à l’acclimater dans la société du non-être, mais CELA me tient présent. Telle étant la formule: rester présent.
CELA. - Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, mais plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir: que CELA monte.
-
Un verbe de vibrant cristal
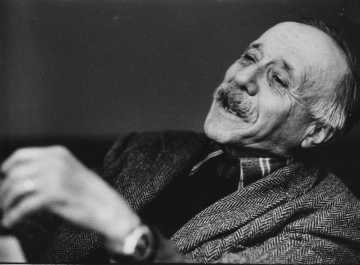
Poésie de Maurice Chappaz
« C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons », écrivait Charles-Albert Cingria en 1953, une année avant sa mort, au jeune poète valaisan Maurice Chappaz qui venait de lui envoyer son Testament du Haut-Rhône. « Enfin, voilà une façon d’écrire qui fait exception et une fameuse dans la décevante production de l’époque – aussi bien en France que chez nous », ajoutait Cingria : « Vous êtes le seul à ne pas être déprimant».
Ce double accent porté, par un immense poète méconnu du grand public qui n’a jamais écrit un seul vers, sur la pureté cristalline et le caractère tonifiant de l’écriture de Maurice Chappaz, pour un texte de haute qualité poétique mais ne ressemblant à rien de ce qu’on attend dans le genre – ni poème versifié, ni prose poétique non plus - vaut aujourd’hui encore et pour toute l’œuvre de Maurice Chappaz, de son premier texte publié, Un homme qui vivait couché sur un banc, à ses derniers écrits de nonagénaire encore vif d’esprit et de plume. Toute l’œuvre de Maurice Chappaz, qu’on pourrait situer dans un Valais «tibétain » et un temps qui serait à la fois celui des Géorgiques de Virgile et des géniales improvisations de Rimbaud, est aussi bien du même cristal, qu’elle se module en vers libres ou qu’elle se décline en chroniques, en récits épiques ou lyriques, et jusque dans son formidable Evangile selon Judas, paru en 2001 chez Gallimard et passé quasiment inaperçu de la critique française.
De la découpe de cette écriture, de son ton et de sa musique, il faut donner immédiatement quelques exemples. Et du tout début pour commencer, avec ce qu’on pourrait dire l’entrée en lice du jeune poète, dans son premier texte publié en 1939 sous le titre d’ Un homme qui vivait couché sur un banc, d’ailleurs dédié à Cingria : « Il est temps d’entrer dans ce monde, d’allumer une cigarette et de tirer sur la fumée, sur le feuillage tremblant et bleu de l’air maintenant. Il s’agit de s’infuser ce qui est, et cet air du matin on le boit. » Tout de suite nous frappe le tour physique de la phrase de Chappaz, son recours à des éléments très concerts et sa transmutation simultanée en début de légende dorée. A l’école des poètes ou des chroniqueurs antiques, mais aussi des Riches Heures médiévales et du vélocipédiste Charles-Albert, Maurice Chappaz se présente d’emblée en troubadour anarchisant, passant par là comme le poète de Ramuz et notant cela simplement qui se trouve à sa vue : « Il y a des granges, des entrepôts, le char des paysans et les camions chargés de vivres qui démarrent dans les goudrons, tout un bazar d’étoffes, de charges de légumes, d’enfants des rues et les rudes travailleurs manuels ; la vie du peuple magnifique avec ses odeurs, sa peinture – odeur de foin, peinture de fruits ». Simple comme bonjour et telle sera la crâne représentation initiale du travail du poète : « Moi je m’étends sur un banc pour toute la journée. Rien faire, absolument rien faire ». Cela sonne, au seuil de la Deuxième Guerre mondiale et venant de la part d’un jeune fils d’avocat en vue, notable du Valais qui aimerait le voir se lancer dans le Droit et ne pas trop musarder, comme une déclaration d’indépendance et une prise de parole apparemment coupée des grandes préoccupations du monde. Pourtant, on verra par la suite que, loin de se cantonner dans une tour d’ivoire de littérateur, Maurice Chappaz jouera bel et bien son rôle dans la communauté, mais toujours en poète, voire en visionnaire.
 L’attention au monde
L’attention au monde
Un élément me semble fondamental dès l’entrée en poésie de Maurice Chappaz, et c’est son attention au détail des moindres choses, qu’il va saisir et « enluminer » par le truchement des mots et des images. Il le répétera d’ailleurs soixante ans plus tard dans son dernier opuscule, paru en 2007, au titre joyeusement provocant (Hors de l’Eglise pas de salut) par les temps qui courent : «le péché capital, le seul péché est le manque d’attention. Le temps présent se précipite telle une chute d’eau. Hâte-toi de puiser ! C’est-à-dire : sois attentif. » Or l’attention n’est pas que la consommation de la « chose vue » mais sa consumation et sa transmutation, qui fait que le spectacle le plus banal devient un fragment de tableau. Comme un livre d’image s’ouvre d’ailleurs Testament du Haut-Rhône, premier chef-d’œuvre: « Je loge à quelques lieues seulement de la forêt, au bout d’une prairie où les eaux s’évadent. Par les fenêtres ouvertes de ma demeure de bois (qui me porte et toute une famille d’enfants déguenillés, en train maintenant de dormir), on entend les clochettes d’un troupeau de chèvres qui se déplace sur les pentes ainsi qu’une eau courante ou un nuage de feuilles sèches ».
Ou encore, revenant un peu plus loin « à la lisière d’une ville assez vaste » où il avoue passer « pour connaître des femmes », l’errant lyrique poursuit son début de chronique légendaire : « Une angoisse agréable me poussait à travers des parcs et d’anciens quartiers pour surprendre les échanges secrets de la foule dans lesquels, comme une once d’or, je pesais ma propre luxure et le deuil de mon enfance. Je fréquentais les jardins de lilas et l’extrémité d’une banlieue où s’amalgamaient quantité de boutiques et de cafés pareils aux boulettes d’ossements que rejette l’estomac des hiboux. » Or, ces clochettes des chèvres semblables, sur la montagne de l’aube qui pourrait être d’une aquarelle chinoise, à « une eau courante ou à un nuage de feuilles sèches », et ces boutiques et autres cafés « pareils aux boulettes d’ossements » déféqués par des oiseaux de nuit, sont du Chappaz le plus pur, comme le sont ces vers de Tendres campagnes à la dévotion de la femme aimée :
« Mon désir d’elle
la fait ressembler à une carafe d’eau glacée
qui circule en plein midi
à la terrasse d’un café.
Mon désir d’elle la pose sur la table
telle une cathédrale claire et fragile,
le litre et le verre.
Mais mes lèvres balbutient de soif
et cette transparence est pour mon esprit
une nuit au milieu du jour.»
 Un franciscain nomade
Un franciscain nomade
Pour marquer sa double rupture radicale d’avec son milieu de riches bourgeois et la vie de flambeur qu’il a menée jusque-là, le jeune Francesco Bernardone se met à poil sur la place d’Assise, en 1206, avant d’endosser la tenue du Poverello, et la même mue vestimentaire symbolique, au début d’Un Homme qui vivait couché sur un banc, scelle l’entrée du jeune homme de 23 ans dans ce que son ami Georges Haldas appellera plus tard « l’état de poésie ». Celui-ci n’aura rien d’académique ni moins encore de statique : ce sera une façon de vivre autant qu’une instance fondatrice de l’écriture.
La vocation et le rôle du poète sont assez précisément définis par Chappaz dans ses premiers livres. Un homme qui vivait couché sur un banc évoque d’emblée la vie nouvelle d’un quidam qui se défait de « son habit fort civil » avec quelques jurons bien sentis (des « damned », des « christo », des « morbleu »…), pour revêtir le costume le plus simple. «Il libéra ses souliers d’une secousse et un instant il fut tout nu (rudement étrange, bonnes gens, Cicérons !) et un instant après chaussé d’espadrilles, vêtu d’un pantalon de toile bleue, d’un chandail et d’une vieille casquette, c’est-à-dire comme Jacques et comme Pierrot, ses amis». Et d’ajouter sur le même ton de romantisme bohème : « Mais par-dessus tout, ce qui est vraiment beau, ce qui est extra, comme disent les enfants et les poètes, c’est la liberté ». Plus tard, après « sept années de tourmente », Testament du Haut-Rhône donnera de la poésie et du poète une définition plus grave et déjà prophétique puisque « les poètes seront en fait des devins. » Rien là pour autant d’occulte, mais le « voyant » de Rimbaud reste proche, qui s’oppose aux « assis » de la société conformiste : « Nous explorons les gouffres légers de l’enfance, décelant comme la chouette des Ecritures les ordres sacrés aujourd’hui pareils à des débris fanés. (…) Ceux que leurs propres cités rejettent, ceux-là seul auront le pouvoir d’écrire et de tester pour le monde défunt. J’en salue les héritiers : des ouvriers d’usine, des bergers, des semeurs de seigle, des petits marchands d’abricots et de raisons ; notre histoire sera faite par eux et non plus par les avocats ».
S’il y a du marginal errant en Chappaz, qui s’est heurté violemment à la volonté du père pour obéir à sa vocation, lui-même connaîtra cependant les responsabilités d’une charge de famille après son mariage avec S. Corinna Bille, en 1947, avec laquelle il aura trois enfants, et ne pourra donc passer sa vie « à ne rien faire, absolument rien faire ». L’expérience de la guerre, sa participation (de 1955 à 1958) à la construction du barrage de la Grande-Dixence, et le travail sur les domaines vignerons de la famille, constitueront, avec maintes virées proches et moult grands voyages autour du monde, autant d’expériences formatrices ou lucratives qui distinguent nettement son mode de vie de celui d’un homme de lettres, d’un professeur ou d’un journaliste, même si le poète écrivit lui aussi de nombreux articles et autres chroniques pour assurer la matérielle, tôt engagé en outre dans la défense de l’environnement naturel et culturel. Mais là encore, le combat de Maurice Chappaz s’inscrit dans l’ensemble d’une vision du monde marqué au sceau de la poésie. En dépit de son titre provocateur, le pamphlet qui a valu au poète haines privées et injures publiques, Les maquereaux des cimes blanches, est un poème autant qu’une attaque frontale des affairistes immobiliers et autres marchands du temple valaisan.
« J’ai assisté à la fin des visages », écrit le poète furieux, rappelant les « visages sortis et imprimés dans les torrents de montagne », auxquels a succédé « l’effacement par la graisse ». Et d’assener : « Les plus importants de mes compatriotes portent ce masque de bandit propret. De bandit de bureau qui culotte l’illégalité ». Friedrich Dürrenmatt reprochait à la poésie romande de cultiver la « rose bleue » de l’esthétisme. On voit que Maurice Chappaz échappe à cette accusation. Au reste, il ne s’agit pas pour lui de s’opposer au progrès au nom du « bon vieux temps ». Bien plus : c’est une « fuite en avant » qu’il dénonce, dont nous voyons aujourd’hui les conséquences et l’extension mondiale.
 Danses d’amour et de mort
Danses d’amour et de mort
L’œuvre de Maurice Chappaz, dans sa double nature lyrique et prophétique, ne saurait être séparée de la tradition biblique et de la foi catholique, comme l’a fort bien illustré Christophe Carraud dans le premier essai substantiel consacré, en France, à l’écrivain valaisan. Cela ne fait pas pour autant de Chappaz un «poète catholique » comme on peut le dire d’un Claudel, au sens d’un auteur à «message». La théologie de Chappaz passe par la poésie et rejoint les chants et les sagesses du monde, de l’Orient arabe aux poètes T’ang, sans diluer ses dogmes pour autant. On pense en outre à la Vita nova de Dante et à l’Amour courtois des troubadours provençaux en lisant Tendres campagnes, où la Dame est à la fois désirée et sublimée par le chant.
Cela étant, loin des tourments de conscience de l’âme romande, à dominante protestante, le catholicisme de Maurice Chappaz et plus encore sa poésie sont tissés de sensualité et de saveur. La langue poétique de Chappaz, jusque dans l’ Evangile selon Judas, est une fête. « La femme dans l’ombre où elle est nue /est comme le lourd printemps frais », écrit-il dans Verdures de la nuit, premier recueil marquant (daté 1938-1941) qui célèbre précisément La merveille de la femme et commence par cette invocation. « O juillet qui fleurit dans les artères /je désire toutes les choses /dans la rouge mémoire de mon sang/ bougent les limons et les chairs vivaces »…
Or à la merveille est consubstantiellement liée la « miette d’ombre » symbole de corruption ou de mort, et toute danse de joie se poursuit dans la transe des danses de morts, comme dans la peinture médiévale et ses « grotesques » auxquels nous renvoient le recueil A rire et à mourir.
« Quelle est cette idée de faire une œuvre avec de l’encre ! Personne n’écrit ainsi. Le chant vient du sang, sur les montagnes du cœur il coule et il arrose le monde. Il fait germer les pays, c’est lui qui procrée. Il envoie les pensées devenir des arbres, des oiseaux, saumons ou truites dans l’eau (comme dans les cascades spirituelles que tu essaies de remonter). Chaque signe a besoin d’une goutelette de sang pour être manifeste. »
La poésie de Maurice Chappaz n’a pas d’âge ni ne s’est altérée d’année en année, dans son chant autant que dans ses récits à multiples ramifications. La meilleure preuve en est la prose étincelante d’invention de l’ Evangile selon Judas, publié par l’octogénaire, ou sa nouvelle approche des contes africains réunis dans Orphées noirs, l’année de ses nonante ans ! Bref, Chappaz est un poète savoureux et lumineux, profond et tonique jusque dans ses lettres à Gustave Roud, son ami et correspondant de longue date, ou dans Le livre de C. en mémoire de Corinna Bille, son Journal de l’année 1984 ou ces textes inspirés que sont L’Océan, magnifique évocation d’un grand voyage passant par New York (qu’il appelle « Nouillorque » !), Le garçon qui croyait au Paradis ou La mort s’est posée comme un oiseau.
Dès le Testament du Haut-Rhône, la conscience d’une perte irrémédiable a marqué l’œuvre de Maurice Chappaz de son sceau, relançant ses mises en garde et ses colères. Mais la vie est bonne jusque dans l’évidence de notre fin : La mort est devant moi…
« La mort est devant moi
comme un morceau de pain d’épice,
la vie m’a tournoyé dans le gosier
comme le vin d’un calice.
L’une par l’autre j’ai cherché à les expliquer.
J’ai trempé le pain dans le vin,
je me suis assis,
j’ai fumé,
J’étais sauvage avec les femmes,
avec les mains, avec l’esprit.
J’ai tâché de travailler à des œuvres qui respirent.
Maintenant je cherche un parfum
dans la nuit. »
Bien enracinée dans sa terre d’origine et faisant écho aux préoccupations de notre temps, jusqu’à la ruade polémique, l’œuvre de Chappaz nous transporte à la fois autour du monde et hors du temps, ou plus exactement au cœur de ce noyau temporel que figure l’instant « éternisé » de la poésie. Ernst Jünger écrivait que celui qui touche au cœur de la réalité en atteint tous les points de la circonférence, et c’est exactement la vertu de la poésie à la fois engagée et dégagée de Maurice Chappaz, capable à tout coup, à partir du plus simple objet de tous les jours regardé avec attention, d’atteindre l’essentiel.
Mourir c’est écrire, écrit enfin Maurice Chappaz… pour ne pas mourir :
« Qui est-ce qui passe ici si tard ? Entre un genévrier et le saule tremblant sur le Haut-Rhône en 203o…
Je suis parti au pays de la mémoire.
L’écriture est une crevasse dans un glacier qui devrait être le ciel bleu. « Je suis seul comme Franz Kafka », dit Kafka. « Je vivrai plus longtemps que vous », répond Lorca aux miliciens qui l’agenouillent de force devant les fusils.
Au revoir mes amis de l’azur, compagnons de la Marjolaine ! Les cloches de mon église ont sonné toutes seules. Je reviens sans que vous le sachiez et je l’ignore aussi ».
Pour Lire Maurice Chappaz (choix succinct)
Un Homme qui vivait couché sur un banc, [Revue Suisse romande], 1939. Castella, Albeuve, 1988.
Verdures de la Nuit, Mermod, Lausanne, 1945. Castella, Albeuve, 1988.
Testament du Haut Rhône, Rencontre, Lausanne, 1953 et 1966. Fata Morgana, 2003.
Portrait des Valaisans en légende et en vérité, L’Aire, 1983.
Les Maquereaux des cimes blanches, Galland, Vevey, 1976. Zoé, Genève, 1984, 1994.
Maurice Chappaz, pages choisies. L’Age d’Homme, Poche Suisse, 1988
Le Garçon qui croyait au paradis, L’Aire, 1995.
La Mort s’est posée comme un oiseau, Empreintes, Lausanne, 1993.
Evangile selon Judas. Gallimard, 2001.
Maurice Chappaz, par Christophe Carraud. Seghers, 2005.
Ce texte a paru dans la revue ProLitteris.

