
Le Nouveau film de Ken Loach: It's a free World
On se trouve, dans le dernier film de Ken Loach, sarcastiquement intitulé It's a free World, pris au piège de cette prétendue liberté dans une espèce de frénétique course du rat – plus exactement de la ratte, laquelle se débat comme une belle diablesse dans le cercle infernal du nouveau marché aux esclaves des migrants plus ou moins clandestins de l’Europe de l’Est et de partout qui débarquent en Angleterre. Angie après s’être fait virer d’une agence de recrutement pour ne s’être pas soumise à la règle machiste de ses supérieurs, se retrouve sur le carreau et lance alors, avec sa colocataire Rose, une agence indépendante de placement assortie d’une cafétéria. Malgré les mises en garde réitérées d’un de ses copains-collègues, Angie développe bel et bien un début de réseau sans se rendre compte qu’elle empiète sur le terrain de négriers sans scrupules beaucoup plus puissants qu’elle. Comme elle-même, toujours un peu « borderline » depuis qu’elle doit assumer la charge de son fils Jamie (le père de celui-ci a décroché depuis longtemps et passe son temps devant la télé) avec l’aide de ses parents dépassés par les événements, recourt à des procédés de plus en plus proches de l’illégalité, Angie va se trouver acculée à une situation dont elle se sortira de la façon la plus abjecte, dénonçant un groupe de clandestins au Service de l’immigration, pour caser à leur place une quarantaine d'autres malheureux qu’elle rançonne pour ainsi dire, avant que tout ne se retourne contre elle.
Si le scénario du film (primé à Venise) est solidement construit, qui nous confronte à une imbrication de situations aussi scandaleuses que réelles, avec de brusques aperçus de détresses personnelles insoutenables, It's a free World, dans sa violence amère, a quelque chose de frustrant pour d'aucuns dans la mesure où Ken Loach se contente, de manière frontale, de montrer les choses telles qu’elles sont, sans béquilles critiques ni trace d’évolution rassurante chez la protagoniste, puisque Angie, à la toute fin du film, se retrouve quasiment à la case départ, à recruter de nouveaux Ukrainiens à Kiev…
Ceux qui ont besoin d’une « morale » ou d'un espoir lui reprocheront ce parti pris, que je trouve pour ma part d’une honnêteté conséquente. Le portrait d’Angie, dont la rage de s’en sortir va de pair avec une espèce de santé sensuelle et sauvage, est remarquable (et magnifiquement servi par Kierston Wareing, tout à fait saisissante en sa beauté sexy et râpeuse à la fois, l’énergie véhémente et l’ambiguïté dérangeante de son personnage), autant que celui de Rose (Juliet Ellis, incarnant une femme plus lucide et sensible à la fois que son amie), et le rôle central de ces deux femmes ajoute à la critique implicite du film, signifiant en somme que cette liberté de merde est aussi merdique pour les uns que pour les autres dès lors qu’on obéit aux mêmes codes que ceux du système qui aboutit à ce merdier… A nous, en effet, de remplir les vides de ce film plein d’humanité mais qui se refuse aux faux-fuyants politiquement corrects ou aux conclusions lénifiantes….
-
-
Un chant arraché à la douleur
Dans son deuxième livre, Demeure le corps, Philippe Rahmy module un admirable «chant d’exécration».
L’impression d’entendre un chant inouï monter d’un charnier, ou celle de recueillir les paroles exhalées par un supplicié, l’horrible sentiment d’impuissance qu’on peut éprouver devant un malade crucifié sur son lit de douleurs nous saisissent à la lecture de Demeure le corps de Philippe Rahmy, dont il faut rappeler brièvement qu’il souffre, depuis son enfance, de la maladie dite des os de verre. Un premier livre intitulé Mouvement par la fin; un portrait de la douleur, avait paru en 2005, couronné par le Prix des Charmettes. Et voici qu’une «seule et longue phrase» qui «regarde le soleil» nous cingle, tantôt comme un fouet de mots, et tantôt nous amène au bord des larmes douces de l’enfance, par exemple en lisant à la suite «la douleur n’apprend rien, rien, le refuge qu’elle offrait vient de s’effondrer; lorsque les cris cessent et que la bouche dévastée, puante d’entrailles, se vide à longs traits, j’entends hurler la voix que j’appelle mon âme», ou bien «le corps est l’orifice naturel du malheur», ou, sous l’effet d’une espèce de grâce éperdue, «ma mère s’est assise entre les deux fenêtres, elle me tend une tasse de thé au jasmin; j’embrasse ses mains et l’odeur de la pluie», ou bien «une mouche vient boire au bord des yeux; on dirait une âme se lavant du péché», ou encore «la douleur, légère barque d’os, me conduit tout à coup; je perçois à nouveau mon rapport au langage; le corps, soudain rajeuni, vulnérable au regard, se tient debout dans les fougères».
Peu de livres, en si peu de mots, savent dire avec tant de violence et de douceur, de rage et de délicatesse, de précision nue et crue (où l’on hurle tantôt parce qu’on en chie, et tantôt se branle pour arracher un peu de lait de feu au roncier de son corps) et de lyrisme déchirant la totalité complexe de la souffrance physique et spirituelle, dont coule aussi de source cette sainte phrase où le martyr jamais doloriste se dit «porté par une pitié silencieuse pour tout ce qui existe»…
Ce livre se donne le sous-titre de Chant d’exécration, mais c’est surtout un chant d’amour et de manque innocent que Demeure le corps, d’une «honnêteté absolue» et revendiquée pour telle, d’une écriture soumise à une tenue, modulée dans un style, un rythme et une musicalité sans faille.
 Philippe Rahmy, Demeure le corps. Editions Cheyne, 60p.
Philippe Rahmy, Demeure le corps. Editions Cheyne, 60p.Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 10 octobre 2007.
-
Fellini le mendigot
A propos de Roberto Begnini et du chien d’Umberto D. « L’huile d’olive n’est pas morte !», s’exclamait l’énerguménal Roberto Begnini après la disparition de Federico Fellini, et de fait il y avait de cette saveur ambrée, de cette fluidité d’essence féminine bonne pour la salade et de cette délicatesse odorante et raffinée par les années, chez Fellini (la personne au fin parler malicieux, plus que le personnages déjà presque trop fellinien), qu’on peut rapporter à l’huile d’olive ou au regard du silure ou au pelage du chaton ou à l’agate de l’œil de hibou dans la nuit romaine. J’aime ce délire généreux du populo italien qui se coule dans les films du Maestro en sottovoce, et je ne sais pourquoi cette prodigalité pauvre me rappelle le petit chien d’Umberto D. , bouleversant mendigot du vieil homme dont la misère est comme un clin d’œil à fleur de larmes, tel Fellini faisant la manche aux portes de l’Etat et des Riches qu’il roulait en ne cessant de se plaindre - au bord du fou rire…
JLK: le chien d'Umberto D.
-
Le sel des jours
Carnets de 2007 (extraits)
La vision la plus émouvante de ma journée est celle de ma bonne amie endormie, lorsque je viens la rejoindre tard le soir. J’y vois à la fois une petite fille et une vieille gisante, elle a tous les âges et figure la plénitude de ma vie, ni plus ni moins, dont je n’ose penser à ce qu'elle serait sans elle… Il y a des semaines et des mois que je suis au bord de m’attaquer à son portrait, mais je ne me sens pas encore tout à fait prêt : je sans qu’il faut encore que je me purifie avant de m’y mettre vraiment. (Janvier 2007)
 Il y a chez Maurice Chappaz, qui se retrouve de part en part de l’œuvre en dépit de la dispersion de celle-ci, de la variété de ses formes et de ses tonalités, de ses différences aussi de tension ou de niveau, une qualité cristalline de l’écriture, doublée d’une fraîcheur et d’une originalité de l’image qui en scellent le génie que je dirai simultanément antique et de ce matin même. Comme l’écrivait Charles-Albert Cingria à propos du Testament du Haut-Rhône: «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons».
Il y a chez Maurice Chappaz, qui se retrouve de part en part de l’œuvre en dépit de la dispersion de celle-ci, de la variété de ses formes et de ses tonalités, de ses différences aussi de tension ou de niveau, une qualité cristalline de l’écriture, doublée d’une fraîcheur et d’une originalité de l’image qui en scellent le génie que je dirai simultanément antique et de ce matin même. Comme l’écrivait Charles-Albert Cingria à propos du Testament du Haut-Rhône: «C’est du pur cristal qu’enfin nous respirons».
Rêvé cette nuit que c’était la guerre. L’horreur physique tenait au fait que nous avions à traverser des souterrains très étroits où nous risquions à tout moment de rester coincés, comme souvent dans ce genre de rêves qui doivent venir de loin, je présume: de l’angoisse physique du nouveau-né ?Après le moment de noir qui m’accable chaque matin, je reviens à la vie en buvant mon café à la fenêtre d’où je vois le monde émerger lui aussi du noir en beauté; et ce mot me sauve alors: ce mot de beauté.
Sa qualité de porosité fait de Shakespeare l’écrivain des écrivains, plus encore que Baudelaire qui a pourtant tout senti lui aussi. Mais à la porosité s’allie l’effort de transmutation sans lequel la porosité ne serait qu’une disposition spongieuse et passive. La poésie est un acte.
On voit de plus en plus de gens, au cinéma mais aussi chez les écrivains, comme dans les médias, penser en termes de « coups » en oubliant l’œuvre à faire qui se développerait dans la durée et selon sa propre cohérence. Il s’agit avant tout d’être remarqué et d’occuper le devant de la scène, en cherchant le sujet « porteur » qui s’inscrit dans le trend du moment.
 Il y a quelque chose de proustien dans Autour de ma mère, le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique intime, personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. «Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire», murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une «idéale dernière note» à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui «se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir».
Il y a quelque chose de proustien dans Autour de ma mère, le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique intime, personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. «Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire», murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une «idéale dernière note» à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui «se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir».«Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un.» Or tel est le ton de ce livre, qui est d’amour mais souvent âpre, difficile, arraché à la complication des relations hommes-femmes comme Au nord du capitaine, roman précédent de l’auteur, disait la complication des relations nord-sud; et l’âge venant, c’est l’enfance aussi qui remonte et toutes les années passées auprès de cette mère qui y retombe, tout le doux et le triste de la vie, la guerre entre les parents, la paix jamais établie…
Ce qui compte c'est de situer ce bouquin, mec, donc de prendre conscience qu’ Ulysse de Joyce est un remake de L’Odyssée d’Homère (pas le film, le texte d’Homère), qu’il se rattache plus ou moins au mouvement du flux de conscience et se passe à Dublin. Ouais, mec, Ulysse ça se passe à Dublin, c’est vachement chiant, j’veux dire, mais à Dublin tu bois une bière super. Bon mais maintenant on parle de Finnegans’wake. T’sais mec, Butor a écrit que Finnegan’s wake c’était du whisky, je l’ai pas lu mais c’est vachement bien vu, j’veux dire c’est super comme jugement littéraire… (Lire à la façon de Pierre Bayard).
Si tu veux savoir ce que pense Monsieur, vise Madame, me disait je ne sais plus qui, et de même ai-je toujours été attentif, sans le laisser forcément paraître, aux réactions de ma bonne amie par rapport aux gens que nous approchions, qu’il s’agisse de mes anciens amis, de collègues ou de relations courantes, avec l’impression de disposer d’une espèce de radar décelant et fixant ce que moi-même j’avais décelé sans forcément le fixer, plus enclin qu’elle à me leurrer, en tout cas en ce qui concerne mes propres amis, car il m’est arrivée de montrer la même lucidité acérée à l’endroit des siens, que je supportais comme elle supportait les miens. Ce qui est sûr est que nos deux appareils de détection sont assez redoutables dans leur exercice combiné, et que les faiseurs, les truqueurs, les mesquins, les faux-culs n’ont pas trop de chance avec nous deux. Ainsi ne nous arrive-t-il plus jamais de nous égarer ou de nous attarder dans une compagnie de raseurs ou de frimeurs, très vite d’accord pour repérer la sortie de secours dès que l’ennui menace en tel ou tel lieu…
 Ma première pensée de ce matin a été consacrée à Georges Haldas, auquel j’ai décidé de consacrer la prochaine ouverture du Passe-Muraille. Il y aura dix ans cette année que j’ai cassé cette relation, choqué par son rejet du Viol de l’ange, qu’il disait un livre sale. Comme il m’a fait à la même époque un mot aimable, et donc hypocrite, pour l’envoi de je ne sais plus quel nouveau livre de lui, je lui ai renvoyé celui-ci en lui écrivant qu’il pouvait aussi bien m’oublier. Et c’est ainsi que je n’ai plus rien lu de lui. Je lui ai rendu poliment hommage lorsqu’il a reçu le Prix Rod, mais c’est tout. Notre longue amitié ne s’en remettra probablement pas, mais ses livres existent, le vieil homme est dans sa nonantième année et tout à coup j’ai envie de revenir, non pas à l’homme mais à ses livres. La dernière fois que j’ai ouvert un de ses livres, dans une librairie, je suis tombé sur cette page où il traitait la philosophe Jeanne Hersch d’« amazone pisseuse». J’ai eu moi-même un conflit carabiné avec Jeanne Hersch, après un abus de pouvoir caractérisé de sa part, mais traiter cette dame d’«amazone pisseuse» m’a semblé indigne de la part d’un l’écrivain prônant, par ailleurs, l’Attention à l’Autre à grand renfort de majuscules.
Ma première pensée de ce matin a été consacrée à Georges Haldas, auquel j’ai décidé de consacrer la prochaine ouverture du Passe-Muraille. Il y aura dix ans cette année que j’ai cassé cette relation, choqué par son rejet du Viol de l’ange, qu’il disait un livre sale. Comme il m’a fait à la même époque un mot aimable, et donc hypocrite, pour l’envoi de je ne sais plus quel nouveau livre de lui, je lui ai renvoyé celui-ci en lui écrivant qu’il pouvait aussi bien m’oublier. Et c’est ainsi que je n’ai plus rien lu de lui. Je lui ai rendu poliment hommage lorsqu’il a reçu le Prix Rod, mais c’est tout. Notre longue amitié ne s’en remettra probablement pas, mais ses livres existent, le vieil homme est dans sa nonantième année et tout à coup j’ai envie de revenir, non pas à l’homme mais à ses livres. La dernière fois que j’ai ouvert un de ses livres, dans une librairie, je suis tombé sur cette page où il traitait la philosophe Jeanne Hersch d’« amazone pisseuse». J’ai eu moi-même un conflit carabiné avec Jeanne Hersch, après un abus de pouvoir caractérisé de sa part, mais traiter cette dame d’«amazone pisseuse» m’a semblé indigne de la part d’un l’écrivain prônant, par ailleurs, l’Attention à l’Autre à grand renfort de majuscules.
Mais le temps passe, il nous crible, nous serons bientôt tous morts tandis que les livres continueront de témoigner de ce qui nous dépasse, et j’ai envie à l’instant de retrouver l’âme de Georges Haldas, ses petits matins, ses balades en Grèce, ses lectures de Cavafy ou de Saba, ses lectures de l’Evangile, ses coups de gueule, ses chroniques merveilleuses du père (Boulevard des Philosophes) et de la mère (Chronique de la rue Saint-Ours), nos rencontre Chez Saïd où nos engueulades parfois chez Dimitri – tout ce qui fait le sel de la vie, et tout ce qu’il a cristallisé dans ses livres sans pareils.
Un jour j’ai reçu de la part de Jacques Chessex, après que j’eus publié un grand papier élogieux sur Georges Haldas, une carte postale m’apostrophant pour me reprocher de dire du bien de ce «cuistre christique» écrivant comme un balai, et quelques années après le même Chessex célébrait Haldas à la remise du prix Rod. Petite foire aux vanités de la littérature, à laquelle survivent les livres. Lorsque nous étions amis, Jacques Chessex m’a dit un soir sa réelle affection pour Haldas, malgré leurs différends de toute sorte, de même que Chappaz m’a dit la sienne, qui avait rompuz avec Haldas depuis leur jeunesse. Le premier jour que nous nous sommes rencontrés à Genève, en 1973, Georges Haldas a dit au petit crevé que j’étais alors: «Méfiez-vous des écrivains, il y a un diable en chacun de nous».
A l’instant, le regard perdu sur les crêtes enneigées des montagnes qui de cela se foutent comme du dernier fossile, je ressens le besoin de dire ma reconnaissance à Georges Haldas, et de ce pas j’irai tout à l’heure faire l’acquisition des derniers livres qu’il ne m’a pas envoyés. (17 février 2007)Peinture JLK: Creste senesi, 2007, huile sur toile
-
Le mentir créateur

Cendrars à l’oral.
Est-ce quand il mentait le plus que Cendrars était le plus vrai ? Ce serait trop facile de l’affirmer, surtout en un temps de grand déballage où l’on se figure que le vrai se réduit aux « révélations » avérées par les faits. Si Sauser devint une légende poétique dès le choix de son pseudonyme, c’est tout au long de sa vie, en écho à l’épopée de son œuvre, qu’il n’a cessé de développer les enluminures de ses Riches Heures, jusque dans les journaux l’interrogeant ou les micros se tendant vers sa gueule de pirate.
Ainsi que l’explique Claude Leroy, éditeur des nouvelles Œuvres complètes (« Tout autour d’aujourd’hui » en 15 volumes, chez Denoël), c’est après la Deuxième Guerre mondiale que le personnage de Cendrars se hausse au niveau d’une véritable légende vivante, jouant son personnage jusqu’à se parodier lui-même. Du mitan des années 1920 où il voit l’avenir de l’homme blanc en Amérique du sud, au lancement du premier spoutnik où sa carcasse le torture méchamment, voici, après les fameux entretiens avec Michel Manoll, une trentaine d’interviews ou de portraits plus ou moins fouillés, dont quelques vrais bijoux signés Parinaud, Labro (son premier papier !) ou Lapouge, notamment. Presque que du mentir vrai !
Rencontres avec Blaise Cendrars (1925-1959), textes établis par Claude Leroy. Editions Non Lieu, 302p. -
Beauvoir l’éclaireuse

ANNIVERSAIRE Simone de Beauvoir aurait eu cent ans aujourd’hui.
Le nom de Simone de Beauvoir, plus de vingt ans après sa mort (en 1986) reste l’un des plus connus, voire des plus adulés de la scène intellectuelle et littéraire française du XXe siècle. Plus qu’aucune femme écrivain de l’époque, le Castor (ainsi surnommée par un condisciple jouant sur le nom anglais de Beaver) fit figure, aux côtés de Jean-Paul Sartre, de véritable « icône », selon l’expression au goût du jour. De la bohème de Saint Germain-des-Prés aux manifestations de mai 68, en passant par la guerre d’Algérie et les luttes pour la dépénalisation de l’avortement, l’ancienne prof de philo fut concrètement engagée, par ses écrits et dans la rue, avec une intensité jamais démentie. Ainsi que l’explique Danièle Sallenave au début de la monumentale déconstruction critique qu’elle vient de publier sous le titre de Castor de guerre, « l’œuvre entière de Simone de Beauvoir, romans compris, porte ce sceau guerrier, jusque dans son style, la coupe de ses phrases, leur rythme, jusque dans la présence d’une voix qui ne laisse jamais le lecteur en repos ».
L’activisme politique de Simone de Beauvoir, ses voyages autour du monde, la caution qu’elle donne (avec Sartre) par sa présence et ses écrits aux causes révolutionnaires qu’elle estime justes et bonnes, face aux puissances de l’oppression et de l’injustice, de Cuba à la Chine de Mao, lui ont attiré les critiques les plus virulentes, parfois justifiées. Dans La lune et le caudillo, ainsi, Jeannine Verdès-Leroux a stigmatisé la complaisance aveugle du couple français, littéralement ébloui par Castro. De la même façon, l’obsession anti-bourgeoise de ces grands esprits fascinés par le « réel » et le peuple, leur haine anti-capitaliste et leur vindicte anti-américaine les auront-elles poussés à prendre des positions proches de celles des « idiots utiles » cher à Lénine. Du moins seront-ils restés conséquents (Sartre refusera le Nobel après avoir manifesté sa solidarité au terroriste Andreas Baader) et l’évolution de Simone de Beauvoir en imposera par l’approfondissement de son regard sur le « phénomène humain » qu’elle scrute à l’observation nette et honnête de sa propre vie.
Or il ne faut pas oublier l’œuvre. L’estime et la reconnaissance qu’elle suscite toujours découlent surtout du Deuxième sexe, ouvrage fondateur du féminisme publié en 1949, qui s’arracha à plus de vingt mille exemplaires dès la première semaine, fut traduit en plus de trente langues et valut à l’auteur la mise à l’index du Vatican. Pour rappeler le « ton » de l’époque, on peut relever que François Mauriac écrivit à l’un des collaborateurs des Temps modernes : « J’ai tout appris sur le vagin de votre patronne »... De la droite conservatrice à la gauche stalinienne, le livre déchaîna les passions. Cet ancrage dans l’atmosphère politiquement très polarisée des années doit être rappelé pour mieux évaluer la détermination frondeuse de la brillante agrégée en rupture de conformité, qui s’affirme dès L’Invitée, premier roman à la touche très personnelle paru en 1943. Avec Les mandarins (prix Goncourt 1956), autre roman qui pose la question de l’engagement et de ses pièges, et Les mémoire d’une fille rangée (1958) rapidement hissé au rang de best-seller, Simone de Beauvoir donne ses meilleurs livres avant la trilogie de ses mémoires dont Une mort trop douce, évoquant la fin de sa mère avec une remarquable noblesse.
C’est à la genèse et au développement de ces mémoires que Danièle Sallenave s’attache dans Castor de guerre en « dialoguant » sans discontinuer avec son impérieuse aînée, quitte à poursuivre la « dispute » pied à pied. Il en ressort, comme à la lecture de La cérémonie des adieux ou de la correspondance extrêmement vivante, parfois aussi captivante et drôle (le cynisme en plus) que celle de George Sand, du Castor avec Nelson Algren ou Claude Lanzmann (deux passions durables de l’amoureuse), un portrait nuancé qui rompt avec la figure caricaturale de la cheftaine à souliers plats ou de la patronnesse à chignon serré : une intellectuelle en guerre à la lucidité tranchante, mais également une femme orgueilleuse non moins qu’attachante - un écrivain qui gagne à être parcouru dans ses marges où la liberté se nuance d’humour et de spontanéité sans rides…
Danièle Sallenave. Castor de Guerre, Gallimard,601p.
Jacques Deguy et Sylvie Le Bon de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Ecrire la liberté. Découvertes Gallimard, 126p.
Simone de Beauvoir, une femme entière. France 5, le 10 janvier, à 20h. 40, et sur Arte à 22h.35
La donneuse de leçons s’efface devant l’écrivain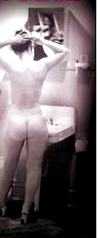 Qu’aurait pensé Simone de Beauvoir, en sa centième année, de la très large diffusion, advenue ces jours, d’une image intime la représentant toute nue, croquée de dos par un compère photographe de son amant américain Nelson Algren ? Se serait-elle réjouie de ce dernier pied de nez au conformisme de la bourgeoisie catholique dont elle était issue ? Y aurait-elle vu l’expression de sa liberté de mœurs ou se serait-elle indignée de ce que soit ainsi exploitée l’image de son corps ? Poser la question revient à s’interroger sur le culte voué à l’ « icône » du couple qu’elle formait avec Jean-Paul Sartre : deux grands intellectuels briseurs de tabous réduits eux-mêmes à un cliché pour touristes ou étudiants japonais. Or que magnifie ce cliché ? La bohème de Saint Germain-des-Prés ? L’emblème de deux esprits libres aux positions éthiques et politiques exemplaires ? Ou les deux derniers maîtres à penser d’une époque désormais sans « figures » ? Symboles bien discutables à vrai dire, tant le meilleur et le pire cohabitent dans l’« enseignement » de Sartre et du Castor.
Qu’aurait pensé Simone de Beauvoir, en sa centième année, de la très large diffusion, advenue ces jours, d’une image intime la représentant toute nue, croquée de dos par un compère photographe de son amant américain Nelson Algren ? Se serait-elle réjouie de ce dernier pied de nez au conformisme de la bourgeoisie catholique dont elle était issue ? Y aurait-elle vu l’expression de sa liberté de mœurs ou se serait-elle indignée de ce que soit ainsi exploitée l’image de son corps ? Poser la question revient à s’interroger sur le culte voué à l’ « icône » du couple qu’elle formait avec Jean-Paul Sartre : deux grands intellectuels briseurs de tabous réduits eux-mêmes à un cliché pour touristes ou étudiants japonais. Or que magnifie ce cliché ? La bohème de Saint Germain-des-Prés ? L’emblème de deux esprits libres aux positions éthiques et politiques exemplaires ? Ou les deux derniers maîtres à penser d’une époque désormais sans « figures » ? Symboles bien discutables à vrai dire, tant le meilleur et le pire cohabitent dans l’« enseignement » de Sartre et du Castor.Professeurs de liberté ? Mais quel usage en firent-ils en fermant les yeux sur les sinistres prisons de la dictature cubaine ou en célébrant la sanglante révolution culturelle maoïste ? « L’avenir m’a donné raison », ose écrire Simone de Beauvoir dans La Force des choses. Hélas pour elle, les victimes de « l’avenir » ont témoigné depuis lors, entre autres historiens non partisans. Pourtant l’admiratrice de BB (dont elle défendit la figure de femme libre…) n’est pas à jeter avec l’eau des bains de sang : reste l’œuvre. Un auteur qui écrivait « avec un fer à repasser », comme le prétendait Nathalie Sarraute ? Pas seulement : une femme heureusement contradictoire, une amoureuse à tempêtes, une fille à sa maman capable d’émotion devant Une mort trop douce, une vieille camarade touchante à la Cérémonie des adieux, une épistolière à la George Sand, une bête littéraire que nous osons préférer à la donneuse de leçons…
Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures du 9 janvier 2008.


