La Symphonie du Loup, de Marius Daniel Popescu (premières pages)

Il avait presque quarante ans, une bonne partie de ses cheveux étaient blancs, il nous a quittés deux jours après l’accident. Ces deux jours-là, il était dans le coma, à l’hôpital où ils l’ont opéré à la tête. Les chirurgiens qui l’ont opéré disaient qu’il avait des chances de s’en sortir. Ils lui ont découpé une partie du crâne. Ils avaient demandé à sa femme une signature pour l’intervention chirurgicale. Sa femme a signé qu’elle acceptait les risques de l’opération. Ils étaient mariés depuis deux ans. Ils habitaient dans une petite maison et avec eux il y avait sa fille à elle, de son premier mariage, sa mère à elle et il y avait encore sa grand-mère à elle. Il vivait avec ces quatre femmes dans la maison. La fille à elle avait dix-huit ans. La grand-mère à elle avait huitante ans. Il était ingénieur en génie civil. La mère à elle était sourde-muette. Elle avait presque soixante ans. Quand il est mort, il travaillait sur un chantier en province. C’était un chantier où il dirigeait la construction d’une fabrique de fromage. Ces temps-là, il rentrait à la maison seulement le samedi soir. Il repartait sur le chantier le lundi matin. Vers huit heures du matin. Le lundi matin, sa femme n’allait pas au travail. Sa femme était la gérante d’un magasin d’instruments de musique. Elle vendait des violons, des pianos, des flûtes et des batteries. Elle était plus jeune que lui. Elle avait douze ans de moins que lui. Il pratiquait le métier d’ingénieur depuis une dizaine d’années. C’était son deuxième métier. Son premier métier était celui de maître de sports. Il avait pratiqué l’athlétisme. Il avait fait des études de maître de sports. Quand tu es né, il enseignait le sport à des sourds-muets, dans une école spéciale. Il a appris la nouvelle de ta naissance par téléphone. Il n’y avait pas beaucoup de téléphones à l’époque. Il a appris la nouvelle de ta naissance vers neuf heures du soir et il a pris un taxi pour se rendre à l’hôpital. Tu aimais bien aller avec lui en taxi. Quand le taxi passait d’une portion de route couverte par de l’asphalte à une portion de route couverte par des pavés, tu aimais bien le changement de sons créé par le frottement des roues du taxi sur la couverture de la route. Le son des roues du taxi, sur les pavés, étaient comme une cavalerie à la charge. Tu aimais bien jouer au cavalier qui chargeait les ennemis. Il a donné un gros pourboire au chauffeur du taxi. Pendant tout le trajet, il a dit plusieurs fois au chauffeur qu’il venait d’être père. Il a quitté le taxi et il a parcouru en courant l’espace qui menait au service des nouveaux-nés et il a gravi les marches des escaliers trois par trois, jusqu’à la porte, et il a sonné. Le portier de la maternité est sorti pour lui dire qu’il ne pouvait pas te voir en dehors des heures de visite; le portier de la maternité pensait à un gros pourboire, et il lui a dit qu’il devait venir le lendemain matin, à partir de dix heures. Ton père a cassé la gueule du portier de la maternité. Il lui a donné deux coups de poing. Il a visé d’abord l’oeil droit du portier de la maternité puis, avec la deuxième coup il a visé la bouche. Deux coups de poing en pleine figure pour le portier de la maternité. Puis il est monté tout seul à l’étage. Il a commencé à ouvrir les portes des salles et il appelait ta mère par son prénom. Il a réveillé tout le monde. Il vous a vite trouvés. Les infirmières et les médecins n’ont pas pu l’empêcher de vous voir à dix heures du soir. Il savait que tu étais né prématurément. Tu es né à sept mois et, quand il est entré dans la pièce où tu étais avec ta mère, il t’a vu dans la couveuse et il a dit à l’infirmière «sortez-le!», et l’infirmière t’a sorti immédiatement et il t’a pris dans ses bras et il t’a embrassé et il a dit que tu avais un gros nez. Il a embrassé ta mère. Il te portait dans ses bras et il souriait dans la chambre d’hôpital. Tu n’as pas un gros nez. Tu as son nez à lui. Il n’est pas resté longtemps à la maternité. Il est resté à peu près un quart d’heure puis il est redescendu et il est sorti en passant à côté du portier de la maternité qui était en train de se faire soigner par deux infirmières. Il est allé chercher ses amis. Il a trouvé une dizaine de ses amis et il les a invités dans le meilleur restaurant de la ville. Il leur a offert à manger et à boire toute la nuit. Il a mangé et il a bu avec eux. Il leur a parlé de toi et de ton nez. Quand un vendeur de roses est entré dans le restaurant, il l’a appelé d’un signe de la main et il lui a acheté toutes les fleurs. Il est revenu tôt, le matin, à la maternité. Il est descendu du taxi avec les roses dans les bras. Le portier de le veille est venu lui ouvrir. Le portier de la veille avait les lèvres gonflées et bleues et il avait un oeil couvert par l’enflure de la joue. Le portier de la veille lui a ouvert la porte de la maternité, ton père est entré sans rien dire et le portier a refermé la porte et il est retourné dans sa petite cabine de portier. Ton père a donné toutes les roses à ta mère. Physiquement, tu lui ressembles. Autrement, tu ne ressembles à personne de la famille. Une fois, ta mère t’a dit que tu étais fils de Dieu; c’est parce qu’elle ne voulait pas d’enfant. Elle travaillait beaucoup et son travail la tenait loin de sa maison. Elle était expert comptable et elle était toujours en route. Elle vérifiait les comptes de plusieurs entreprises. Elle ne voulait pas avoir d’enfant. Quand elle était enceinte de toi, c’est ton père qui voulait l’enfant. Ta mère t’a dit qu’elle avait payé ton avortement. Chaque fois qu’elle allait à l’hôpital, pour avorter, il allait avec elle. Il l’accompagnait et, en chemin, il la persuadait, chaque fois, de rentrer à la maison. Il lui a fait rebrousser le chemin de l’avortement. Quatre fois, il a tout fait pour qu’elle n’avorte pas. La quatrième fois, quand elle voulait aller à l’hôpital, il lui a dit que c’était impossible. Il lui a dit que personne ne ferait cet avortement parce que c’était trop tard. Tu étais assez grand, dans le ventre de ta mère. Plus personne ne pouvait te toucher. C’est comme ça qu’elle t’a gardé. Ta mère et ton père s’aimaient beaucoup. Il t’ont beaucoup aimé, depuis le début. Cette histoire d’avortement, c’est une histoire de Dieu. C’est pour cela que ta mère a dit que tu étais fils de Dieu. Elle a voulu te dire que tu allais mourir par la volonté de Dieu et non par la volonté des hommes. Ton père lui avait transmis la volonté de Dieu. C’est comme ça qu’elle a interprété le désir de ton père de garder l’enfant. Maintenant, tu es là. Tu es là, avec moi. Nous parlons. Nous nous regardons. Nous avons beaucoup de souvenirs à nous raconter. Des fois, tu parles comme moi. Autrement, tu parles comme personne d’autre. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui parle comme toi. J’ai nonante-huit ans et, durant toute ma vie, je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui parle comme toi, tu comprends ? J’ai fait les deux guerres mondiales. J’ai été combattant pendant les deux guerres mondiales. Ton père aimait que je lui raconte des faits de guerre. Il était un guerrier, ton père. Un guerrier qui n’a jamais accepté cette histoire de parti unique. Dans les réunions de l’entreprise, il engueulait toujours quelqu’un, un membre du parti unique ou un lèche-cul du parti unique. Les lèches-culs du parti unique étaient des lèche-culs du parti unique parce qu’ils voulaient devenir des membres du parti unique. Ton père n’a léché le cul de personne. Ton père n’a jamais voulu entrer dans ce parti unique. Quand il est mort, je t’ai envoyé deux télégrammes. Avec le premier télégramme, je voulais te prévenir. Je voulais te préparer à la mauvaise nouvelle. Dans le deuxième télégramme, je te disais «papa est mort». Les services de la poste ont fait que c’est le deuxième télégramme qui est arrivé en premier. L’autre, où je te disais que ton père allait mal, est arrivé en dernier. Tu m’as dit que tu étais à la pêche, dans la rivière, avec la canne à pêche. Ta tante est venue au bord de la rivière et elle pleurait et elle t’a appelé en te disant que ton père était mort. Tu as sorti de l’eau le fil de ta canne à pêche, tu as pris dans ta main le hameçon, tu as enlevé le ver de terre accroché à l’ hameçon, tu as accroché
l’ hameçon à la canne à pêche et tu as commencé à marcher, dans l’eau, vers le bord de la rivière où ta tante pleurait et disait que ce qui t’arrivait était malheureux. Dans une de tes mains, tu as dit que tu que tu tenais le sac en plastique qui contenait les poissons pêchés. Tu avais pêché environ deux kilos de poisson. Tu marchais dans l’eau et tu tenais ta canne à pêche sur une de tes épaules et tu pensais à ton père et tu regardais l’eau de la rivière et ta tante qui t’attendait sur le bord de la rivière et tu regardais les peupliers qui poussaient sur le bord de la rivière où ta tante t’attendait et tu pensais à ta canne à pêche faite d’une tige de roseau. Il faisait chaud. Tu étais habillé d’un pantalon court et, dans une des poches de ce pantalon court, tu avais une boîte de cire dans laquelle tu gardais les vers de terre pour la pêche. Tu avais dans cette poche cette boîte métallique avec son couvercle troué afin que les vers de terre puissent respirer. Dans l’autre poche de ton pantalon court, tu avais une boîte en plastique, une boîte de médicaments et dans cette boîte tu gardais des hameçons de réserve. Tu avais plusieurs hameçons de réserve. Tu avais une ceinture en cuir à ce pantalon court et à ta ceinture était pendu, dans son fourreau, ton couteau de pêche. Ton couteau de pêche, fait d’une de mes baïonnettes de la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens bien du jour où je t’ai donné cette baïonnette. Tu t’approchais du bord de la rivière et tu voyais ta tante qui avait un tablier sur sa robe, et tu pensais qu’elle était en train de préparer le repas. Tu pensais à ton père. Tu l’avais vu deux mois en arrière. Il t’avait acheté un vélo. Un vélo de course pour ta réussite à l’examen. Deux mois auparavant, ton père et toi, vous avez fêté ton entrée au lycée. Tu voulais un vélo de course. Il t’avait acheté ce vélo de course. L’eau de la rivière était chaude et tu l’as quittée en montant sur le bord où ta tante pleurait et disait «c’était un brave homme, ton père.» Tu as pris le sac en plastique qui contenait les poissons et tu l’as donné à ta tante. Elle a pris le sac avec les poissons et vous êtes partis vers la maison, en suivant le chemin qui longeait le bord de la rivière. Vous avez marché sous les branches des saules et sous les branches des peupliers. Quand le bord de la rivière a rejoint la route, vous avez pris le chemin qui mène à la maison de ta tante et chaque fois que vous croisiez quelqu’un la tante lui annonçait la mauvaise nouvelle, elle s’arrêtait quelques secondes et elle disait «son père vient de mourir.» Tu regardais ta tante et les gens qui venaient d’apprendre que ton père était mort. Tu étais pieds nus. Jusqu’à la maison de la tante, vous avez rencontré plusieurs personnes qui habitaient la rue et qui connaissaient ton père et qui apprenaient que ton père venait de mourir. Tu ne parlais pas. Tu es entré dans la cour de la maison de la tante et tu as sorti la boîte avec les vers de terre, tu lui as enlevé le couvercle et tu as versé les vers de terre sur la terre des rosiers, à l’ombre, et tu as vu comme les vers de terre commencent à bouger et à chercher des trous dans la terre des rosiers et à disparaître dans ces trous qui les abritent de la chaleur. Tu as remis le couvercle de la boîte de cire et tu as remis dans ta poche cette boîte métallique. Tu as longé la maison de ton oncle, jusqu’à la terrasse, tu as posé par terre ta canne à pêche, tu as enlevé ton couteau de pêche de la ceinture, tu as mis ce couteau sur la table de la terrasse puis tu as sorti de tes poches la boîte avec les hameçons de réserve et la boîte métallique avec le couvercle troué et tu as mis ces deux boîtes sur le comptoir en bois installé contre la barrière qui sépare la terrasse de la basse-cour. Tu as dit à ta tante que tu allais chez ta grand-mère. La grand-mère habitait la même rue. Elle habitait deux cent mètres plus loin. Tu habitais avec ta grand-mère. Dans la même maison, ta grand-mère avait deux chambres et un grand hall et tu avais deux chambres à toi tout seul. Tu avais quatorze ans. Tu venais d’avoir quatorze ans. Tu as fait tout seul le chemin entre la maison de ton oncle et la maison de ta grand-mère. Tu pensais à la mort. La mort de ton papa n’était pas la mort. Tu te rendais compte que la mort de quelqu’un n’est pas ta mort. Tu comprenais que ton père ne te parlerait plus jamais et tu savais que cela ne signifiait pas que ton père te quitterait pour toujours. Tu es entré dans la cour de la maison où tu habitais avec ta grand-mère maternelle et tu a vu ta grand-mère t’accueillir depuis le seuil de sa cuisine d’été. Elle t’a dit «sois fort, tous on fini dans la terre, qu’on le veuille ou pas!». Elle t’a dit «il est mort jeune, ton père» et elle t’a demandé si tu voulais te laver. Elle a sorti de la cuisine un tabouret et une bassine en plastique et elle a placé la bassine sur le tabouret, devant la porte de sa cuisine, puis elle est allée prendre de l’eau à la fontaine de la maison, dans la cour. Elle a rempli d’eau une grande casserole et elle a mis cete casserole remplie d’eau sur un des feux allumés de la cuisinière, puis elle a apporté le savon et elle l’a posé sur le tabouret à côté de la bassine en plastique. Tu étais assis sur le seuil de la porte de la cuisine d’été et tu regardais les châtaigners de la cour et le cerisier. Tu ne pensais à rien. Tu regardais tes bras croisés sur tes genoux et tu regardais tes pieds nus et tu regardais les gens qui passaient dans la rue et que tu reconnaissais à travers les fentes de la palissade. Elle est venue avec de l’eau chaude et elle a versé dans la bassine plusieurs litres d’eau chaude, puis elle est venue avec de l’eau froide et elle a versé de l’eau froide par dessus l’eau chaude et elle a testé de ses mains le mélange d’eau chaude et d’eau froide, puis elle t’a dit «elle est bonne, tu peux commencer», et elle est partie dans la cuisine d’été. Ton père était une sorte de rebelle qui disait tout en face et à n’importe qui. Tu as pris le savon, et, debout, devant la bassine posée sur le tabouret, tu as mis une de tes mains dans l’eau, tu as pris de l’eau dans la paume de ta main, tu as mis l’eau sur tes bras, sur tes épaules, sur ton cou, sur ta poitrine, et tu savonnais chaque partie de ton corps. Tu ne voyais pas beaucoup ton père. Tu le voyais seulement quelques mois par année. Tu voyais l’eau sale couler depuis ton corps dans la bassine en plastique, tu frottais ta peau et tu voyais une couche de mousse grise se former à la surface de l’eau de la bassine et ta grand-mère te regardait depuis le seuil de sa cuisine d’été. Quand elle a vu que tu étais prêt, elle t’a apporté de l’eau froide pour te rincer et elle a versé de l’eau froide sur ton corps à l’aide d’un seau et tu prenais des filets d’eau froide dans les paumes de tes mains et tu laissais couler de l’eau froide sur tes bras et tes épaules et ta nuque, et c’est là que tu as pleuré pour la première fois. Pour la première fois de ta vie, à quatorze ans, tu as pleuré.
Ce texte constitue la première séquence de La Symphonie du Loup, parue aux éditions José Corti, 398p.
 La Symphonie du Loup
La Symphonie du Loup
Dès l’ouverture, limpide et poignante, de cette chronique polyphonique que constitue La Symphonie du loup, le lecteur est saisi par la puissance expressive et narrative de l’auteur, évoquant initialement la scène capitale de son adolescence, au jour où lui fut annoncée la mort accidentelle de son père. D’emblée aussi, la modulation vocale du récit, par le truchement de la voix du grand-père paternel, figure tutélaire faisant pendant à celle du père disparu, inscrit cette remémoration dans le flux et les rythmes d’une véritable épopée personnelle au temps du Parti unique. Dans cette Roumanie de la dictature du « socialisme réel » dont nous découvrons peu à peu le décor déglingué et la vie quotidienne, avec une frise de personnages hauts en couleurs dont la vitalité expansive colore et réchauffe un univers teinté d’absurde, Marius Daniel Popescu puise une substance romanesque effervescente, que son talent de romancier fixe en visions inoubliables, comme celle de tel cheval martyrisé. En contrepoint de ces rhapsodies « gitanes » proches parfois de la transe, se dessine le motif tout de douceur et de délicatesse de la vie présente de l’écrivain, où le fils éperdu se reconstruit dans son rôle de père attentionné et de « loup » pacifié.
Il y a comme une « chronique européenne » en raccourci dans ce grand récit alterné, profus et généreux, qui brasse plusieurs cultures et les expériences de plusieurs générations, finalement ressaisi dans l’unité d’une langue-geste originale.
 Marius Daniel Popescu
Marius Daniel Popescu
Marius Daniel Popescu, né à Craiova (Roumanie) en 1963, et établi à Lausanne depuis 1990, où il gagne sa vie en qualité de chauffeur de bus au Transports publics locaux, est à la fois écrivain, poète et prosateur. Il a commencé de composer et de publier de la poésie dans son pays d’origine, où parurent quatre recueils. Son premier ouvrage de poèmes en langue française, intitulé 4 x 4, poèmes tout-terrains et publié par les éditions Antipodes, à Lausanne, fut suivi en 2004 par Arrêts déplacés, chez le même éditeur, qui obtint le prix Rilke 2006. Proche du quotidien par sa poésie, dans une veine rappelant parfois le lyrisme urbain d’un Raymond Carver ou d’un Charles Bukowski, Marius Daniel Popescu a lancé dès 2004 un journal dont il est le rédacteur unique, à l’enseigne du Persil, marqué par la même démarche lyrique et critique visant à la sacralisation des choses de la vie et à la lutte contre l’uniformisation.Bien présent dans la vie littéraire romande, par le truchement d’animations diverses (dans les prisons ou les écoles), de collaborations à des revues ou à divers médias, Marius Daniel Popescu publie aujourd'hui La symphonie du loup, première grande prose polyphonique brassant des thèmes autobiographiques fortement enracinés dans son expérience roumaine, avec le constant contrepoint de sa vie actuelle. Marié à l’artiste lausannoise Marie-Josée Imsand, Marius Daniel Popescu est père de deux enfants.
Photo JLK


 La Symphonie du Loup
La Symphonie du Loup  Marius Daniel Popescu
Marius Daniel Popescu
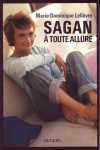 C’est un livre absolument goûteux, vivant et chaleureux, que Sagan à toute allure, approche biographique joyeusement désordonnée de Françoise Sagan par Marie-Dominique Lelièvre. S’y déploie un portrait kaléidoscopique remarquable de la femme-enfant propulsée au pinacle de la gloire littéraire dès son premier roman (Bonjour tristesse, en 1954), dont on peut rappeler qu'il fut adoubé par les plus éminents auteurs et critiques de l'époque (de Paulhan à Nadeau, ou d'Arland à Chardonne, Mauriac ou De Fallois). En outre, la traversée de l’œuvre, nourrie par une lecture pertinente, se mêle à une chronique très documentée de la vie de patachon menée par Sagan dont nous découvrons pas mal d’aspects du caractère (à dominante bon enfant désarmant) et de la vie, entre sauteries et retraites d’écriture, fêtes et déprimes ou défonces. Françoise Quoirez (née en 1935) y apparaît en garçonne craquante (quasiment un play-boy…) aussi douée que fragile, de mœurs très libres, incapable de vivre ou de dormir seule (elle a mis autant de belles dames dans son lit, dont Ava Gardner, que de beaux mecs, sans compter ses deux maris), buvant sec, claquant son fric au casino ou en boîte et plus encore à sniffer, sans que ce tourbillon d’inconduite ne laisse la moindre trace dans le style de la romancière, disciple bohème de Stendhal à l’art concis et fluide, d’une musicalité sans faille, cousine vieille France de Scott Fitzgerald avec sa fêlure à elle.
C’est un livre absolument goûteux, vivant et chaleureux, que Sagan à toute allure, approche biographique joyeusement désordonnée de Françoise Sagan par Marie-Dominique Lelièvre. S’y déploie un portrait kaléidoscopique remarquable de la femme-enfant propulsée au pinacle de la gloire littéraire dès son premier roman (Bonjour tristesse, en 1954), dont on peut rappeler qu'il fut adoubé par les plus éminents auteurs et critiques de l'époque (de Paulhan à Nadeau, ou d'Arland à Chardonne, Mauriac ou De Fallois). En outre, la traversée de l’œuvre, nourrie par une lecture pertinente, se mêle à une chronique très documentée de la vie de patachon menée par Sagan dont nous découvrons pas mal d’aspects du caractère (à dominante bon enfant désarmant) et de la vie, entre sauteries et retraites d’écriture, fêtes et déprimes ou défonces. Françoise Quoirez (née en 1935) y apparaît en garçonne craquante (quasiment un play-boy…) aussi douée que fragile, de mœurs très libres, incapable de vivre ou de dormir seule (elle a mis autant de belles dames dans son lit, dont Ava Gardner, que de beaux mecs, sans compter ses deux maris), buvant sec, claquant son fric au casino ou en boîte et plus encore à sniffer, sans que ce tourbillon d’inconduite ne laisse la moindre trace dans le style de la romancière, disciple bohème de Stendhal à l’art concis et fluide, d’une musicalité sans faille, cousine vieille France de Scott Fitzgerald avec sa fêlure à elle.