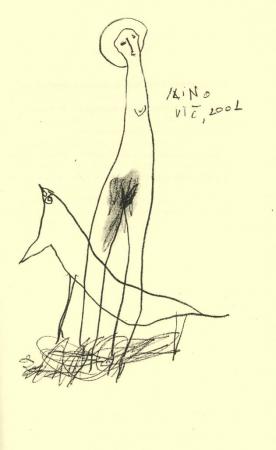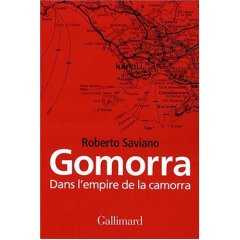
Une plongée saisissante dans les guerres à l’italienne
« Je suis né en terre de camorra, l’endroit d’Europe qui compte le plus de morts par assassinat, là où la violence est le plus liée aux affaires et où rien n’a de valeur s’il ne génère pas le pouvoir », écrit le jeune (né en 1979) journaliste d’investigation Roberto Saviano, dont l’ouvrage a fait l’objet d’un film à découvrir bientôt, et qui vit actuellement sous protection policière. Le contenu de Gomorra est en effet aussi explosif qu’instructif, qui nous révèle l’incroyable emprise, sur toute une société, des clans du crime organisé, à Naples et en Campanie, mais également bien au-delà. A la différence d’une enquête journalistique classique, ce récit témoigne d’une immersion biographique dans le milieu décrit avec une familiarité et une vivacité qui vont de pair avec le besoin du jeune observateur d’exorciser un mal à la fois local et mondial (maints points communs y apparaissant entre le Clan mafieux et l’Entreprise néolibérale), question de survie, « la seule chose qui permet de sentir qu’on est encore un homme digne de respirer ». Du fonctionnement du Système aux guerres implacables entre clans, des ateliers de contrefaçons de marques au commerce des armes et de la drogue, de l’exploitation des enfants (baby-dealers) à celle des femmes, en passant par les métastases du cancer à l’Est, l’aperçu, très incarné, brassant la langue, est saisissant.
Roberto Saviano. Gomorra ; dans l’empire de la camorra. Traduit de l’italien par Vincent Raynaud. Gallimard, 356p.
-
-
Jeux olympiques de dupes
COUAC Un amateur de sport prône l’abolition pure et simple
Olivier Villepreux n’y va pas par quatre chemin à la veille des Jeux de Pékin, relançant selon lui une parodie hypocrite de célébration, par la jeunesse du monde, de « l’amitié entre les peuples ». L’auteur de Feue la flamme n’est pas précisément un ronchon mal dans sa peau : fils d’un célèbre international de rugby, lui-même journaliste sportif à Libération, auteur d’un Larousse du rugby, on sent l’amoureux déçu dans le pamphlétaire de Feue la flamme, dont les 109 pages virulentes s’achèvent sur ces propos carabinés : « Les Jeux participent à la négation de la nature et au mépèris de l’espèce humaine »…
Si l’ouverture est franco-française, avec le rappel du débat pour l’élection présidentielle de 2007, entre un Nicolas Sarkozy « favorable aux Jeux » et une Ségolène Royal se tortillant un peu réclamant « des pressions sur la Chine » sans boycott pour autant, le botteur verbal en vient vite au fait que « la Chine est un pays liberticide, en pleine croissance, courtisée pour sa main-d’œuvre asservie et ses débouchés économiques », et que «les jeux Olympiques consacrent sa prise de pouvoir sur l’économie mondiale ». Or Olivier Villepreux ne s’en prend pas qu’aux éditions les plus controversées des J.O. de Berlin à Moscou : c’est l’institution dès ses débuts, frappée d’équivoque et d’hypocrisie, qu’il remet en cause avant d’en appeler à leur suppression.
Olivier Villepreux. Feue la flamme ; pour en finir avec les J.O. Gallimard, 109p.
-
Le mur dans les têtes

IMPASSE Un « nouvel historien » israélien critique les faucons.
Si son esprit de guerrier n’était pas actuellement en veilleuse, Ariel Sharon rugirait à la lecture des pages qui lui sont consacrées dans cette vaste fresque reconstituant, dès la naissance d’Israël, le 14 mai 1948, après un rappel des fondements du sionisme, et jusqu’à l’épilogue tout à fait contemporain, six décennies de relations entre Israël et le monde arabe. Sharon, qui récusa lui-même les « nouveaux historiens » dont fait partie Avi Shlaim (né en 1945 à Bagdad), est en effet présenté comme l’un des fauteurs principaux de l’ «unilatéralisme», ennemi juré de la paix qui, entre autres mesures violentes, engagea la construction de la « barrière de sécurité » aux allures de mur d’apartheid. Or l’idée dudit mur à toute une histoire, remontant initialement à un article datant de 1923 et signé par Zeev Jabotinsky (1880-1940), nationaliste juif et père spirituel de la droite israélienne, qui estimait la coexistence des Arabes et des Juifs de Palestine possible, à long terme, mais seulement « après l’édification d’une muraille imprenable ». Or il s’agissait d’une mesure de protection provisoire liée à une reconnaissance implicite de l’entité nationale palestinienne. Le mur, métaphore et réalité, court ainsi à travers cet ouvrage extrêmement bien documenté, cartes et références à l’appui, où le dilemme d’Israël (« il peut avoir la terre ou la paix. Pas les deux»…) ne sera résolu, selon l’auteur, que par la coexistence de deux Etats.
Avi Shalam. Le mur de fer ; Israël et le monde arabe. Traduit de l’anglais par Odile Demange. Buchet-Chastel, 757p.
-
Votre attention s'il vous plaît
Contre le nihilisme des non-lecteurs. Yann Apperry et Sylvie Germain en point de mire...
De noirs constats ont été établis ces derniers temps, relatifs à l’état de la littérature française, faisant échos à de non moins noirs constats, établis à l’étranger, relatifs au déclin de la culture française. Paris n’est plus le centre du monde littéraire : belle découverte, n’est-ce pas, mais encore ? De quoi parle-t-on: d’orgueil national ou de réalité ? Est-il vrai qu’il ne s’écrive plus rien d’intéressant en France et en français ? Et le déclin de la littérature n’est-il qu’une affaire française ? Pas un grand écrivain en France actuelle ? Et en Italie s’il vous plaît ? En Allemagne ? En Europe ? Aux Etats-Unis ? Et quelle sorte de grandeur ? Pour quelle sorte de société ?
L’année littéraire 2008 a commencé en beauté avec la parution de La route de Cormac McCarthy. Formidable écrivain sans doute, mais à la hauteur de Faulkner ? On aura relevé l’extraordinaire succès de librairie, aux Etats-Unis, de ce roman, dont le moins qu’on puisse dire pourtant est qu’il n’a rien de séduisant pour le grand public, travaillé par des questions relevant de la haute poésie métaphysique. Or suffit-il de remarquer qu’il a été littéralement « boosté » par la célèbre Oprah Winfrey, pour rabaisser sa qualité intrinsèque ? Et comment juger, rétrospectivement, de l’engouement pour Les Bienveillantes ? Littérairement nul ont conclu d’aucuns, souvent par simple réaction à la faveur populaire, et sans le lire. Or on s’extasie d’un côté, on élit un nouveau génie par semaine, puis on dégomme de l’autre, on consomme, on vomit - et comment équilibrer son jugement ?
Le monde est-il en voie de décomposition ou de recomposition ? La littérature, actuellement sans grande ambition trop souvent ni massive relève, va-t-elle disparaître ou rejaillir comme en d’autres temps ? Et d’ailleurs, regarde-t-on assez ce qui se passe ? Ne manque-t-on pas, terriblement, d’attention et de générosité ? Lisez-vous seulement, vous qui prétendez que plus rien n’est à découvrir ?
Nous recevons ces jours, nous autres lecteurs de métier, les premiers sacs de livres à paraître cet automne. Or voici que j’ai commencé, déjà, le nouveau roman de Yann Apperry, Terre sans maître. Très bonne impression immédiate : belle écriture, récit très plastique tenu et soutenu, thème sérieux: je ne vous dis que ça pour le moment de cette fable poético-politique qu’on situe illico dans le sillage de Buzzati ou d’Agota Kristof. Et voilà se pointer Sylvie Germain avec L’Inaperçu...Vous dites, bonnets de nuit que vous êtes, qu’il n’y a plus rien de rien à lire de ce qui s'écrit par les temps qui courent ? Allons allons, allez: lisez plutôt...
-
L'autre part de Calvin

HISTOIRE-FICTION Dans son premier roman, Nicolas Buri fait revivre le réformateur et son époque, de Rabelais au bûcher de Michel Servet, avec une belle maîtrise du montage «cinématographique», doublée d'une écriture en verve.
Au nom de Calvin est attaché, de nos jours, le cliché du rabat-joie par excellence. Même s'il y a du vrai dans cette image qui a lesté le protestantisme romand de son poids, Calvin ne se borne pas aux séquelles moralisantes du calvinisme perpétué par de graves pasteurs. N'oublions pas le grand dessein d'un esprit frondeur qui défia les pouvoirs au nom d'une réforme spirituelle et temporelle radicale, ni le formidable écrivain. Or le double mérite de Nicolas Buri, qui s'est toujours passionné pour les religions (dont il a étudié l'histoire, parallèlement à des études de droit) est d'incarner le personnage (c'est Calvin qui parle) et son époque sans trop simplifier, tout en développant un récit aussi elliptique qu'efficace, clair et vif, captivant de bout en bout, marqué surtout par un ton personnel et une espèce de gouaille (plutôt Grottes que Tranchées genevoises...) et ne se privant pas de mêler réalité historique et fiction.
Exemples: François Rabelais n'a pas vraiment «pété au nez» du jeune Calvin débarquant chez les «sorbonnicoles», mais sa présence récurrente n'est pas gratuite. Calvin n'a pas rencontré Luther «pour de vrai», mais l'épisode colle à la dramaturgie du récit, et le terrifiant inquisiteur Trithème Segarella, qui livre les parties «sacrées» des hérétiques aux dents de sa chienne Alicia, relève également de l'invention, illustrant du moins la violence de l'époque, comme la peste répandue par intention maligne (historique...) censée faire ici des papistes les inventeurs d'une arme de destruction massive à venir...
Autres licences de romancier: le traumatisme initial de Calvin «naissant» à 6 ans à la mort de sa mère aimée, l'aversion que lui inspire un père cupide dont il reniera le nom (Cauvain) devant son lit de mort, le génie et le courage précoces qu'il manifeste contre les puissants au nom d'un Dieu qu'il s'impatiente de mieux connaître et de servir au lieu de s'en servir, fondent autant de scènes d'une chronique animée, où le tragique et le burlesque se mêlent comme sur une bande dessinée d'époque, en bois gravé à rehauts de couleurs.
«J'ai toujours été passionné par le théâtre», explique Nicolas Buri, qui a lui-même une expérience de scénariste, notamment pour Jacob Berger et Claude Champion. C'est d'ailleurs au pied du mur des Réformateurs, aux Bastions, que l'idée initiale d'un film sur Calvin lui est venue avec le metteur en scène Dominic Noble.
D'une écriture puisant au vivier verbal de l'époque, où les traités des reliques et du scandale de Calvin lui-même, autant que Rabelais et la «parlure» populaire, font florès, Pierre de scandale réserve une part notable aux combats de «l'élu» prophétique contre les libertins genevois (Ami Perrin) et autres athées, tel Jacques Gruet dont le procès précède celui, d'une autre portée, de Michel Servet. Si Castellion, autre grand contradicteur de Calvin, n'est pas au casting, Nicolas Buri renvoie le lecteur aux ouvrages plus doctes que le sien, passionnant divertissement au demeurant.Nicolas Buri, Pierre de scandale. Editions d'autre part, 225p.
-
Petit dèje

Son plaisir est de les troubler quand ils se pointent avec l’énorme plateau.
Elle s’est rafraîchie avant de se recoucher, et le désordre de ses cheveux est une invite.
Alban connaît exactement ses préférences, mais le jeu consiste aussi à jouer de surprise. Avant-hier par exemple ce coquin lui a envoyé l’horrible Portugais fessu dont rien ne laissait supposer les qualités qu’il la força à reconnaître, jetée sur le fauteuil crapaud et prise à la hussarde. Or, même n’ayant rien à se faire pardonner, le facétieux concierge estima juste, le lendemain, de lui réserver les jumeaux lettons, qui font le croque-monsieur comme personne et sont par conséquent très demandés.
Ce qui la désole dans la vie est que le petit dèje ne puisse se prolonger tout le jour. D’un autre point de vue, elle se dit que c’est un bon commencement avant que de se mettre aux affaires.
-
Le temps suspendu d’une image



Une visite à Robert Doisneau
La première image de notre rencontre est celle de ce poulbot d’une dizaine d’années, dans cette banlieue de Montrouge, appuyé à un mur de brique brun sang-de-bœuf caillé et qui vendait de minuscules bouquets de jonquilles. Alors je me suis dit qu’on approchait...
Quelques pas au-delà, place Jules-Ferry, c’était tout un rassemblement de maraîchères, de fripiers et de fleuristes sous le petit soleil risquant un premier clin d’œil de printemps dans les branches dessinées à l’encre de Chine sur fond de ciel bleu-blanc-rose à la Dufy.
J’étais donc déjà dans son univers quand Robert Doisneau, l’imagier par excellence de l’âme de Paris, m’a fait entrer dans son atelier où il n’a pas tardé à me parler de ses balades avec Cendrars et Prévert ou de ses visites au vieil Utrillo et à Léautaud, l’Alceste de Fontenay-aux-Roses.
« La première photo que j’ai faite était d’un tas de pavés, me raconte-t-il en évoquant son apprentissage chez Estienne, et ce qui est rigolo c’est que ces derniers jours, vers le Théâtre-Français, j’ai retrouvé de ces pavés bien gros qui ne sont pas de la sorte qu’on lance sur les CRS mais d’une taille plus noble et qui accrochent si bien la lumière… »
Quand je l’interroge sur ce qui l’a poussé vers la photographie, Doisneau me répond que c’est à la fois la curiosité et la timidité: « On parle toujours du chasseur d’images, mais je crois qu’on est plutôt traqué par l’image qu’on a envie de faire, et que ça donne du culot. Même timide, on se fourre dans les situations les plus audacieuses, avec ce bizarre désir d’arrêter le temps, et cette espèce de panique qui vous prend à l’idée que tout va disparaître… »

-
Hitler en Amazonie

Cela se passe dans la jungle amazonienne, où un groupe de nazis vient de débusquer un vieil homme. Hitler en personne. “Pris vivant et au fin fond de l’enfer”. Sur quoi l’incroyable nouvelle est diffusée en code, mais aussitôt interceptée, déchiffrée et répercutée de services en services secrets. Stupéfaction. Perplexité. Que faire ?
Pour les chasseurs, c’est alors un long calvaire, durant lequel il s’agira de prendre le plus grand soin du “vieux salopard”. Transport sacré. “Comme l’Arche”. Mais ensuite, comment juger Hitler ? Comment empêcher que le monde ne se le réapproprie ? Et quelle peine lui infliger ? C’est ce que se demandent ces émigrants “hors de la vie”. Et l’un d’imaginer d’extrêmes tortures, l’autre de lâcher plutôt le vieillard en Israël, libre mais contraint d’y mendier son pain, un autre encore affirmant qu’Hitler ne mourra qu’à la mort du dernier Juif. Et c’est l’amorce du grand thème du livre, associant la destinée du “peuple du mot” à celle d’A.H. qui “lui aussi a fait sonner les mots plus fort que la vie” avec son éloquence sans pareille - et n’est-ce pas de la doctrine du peuple élu qu’Hitler a tiré son idée maîtresse ?
“Mon racisme ne fut qu’une parodie du vôtre, qu’une avide imitation. Mais qu’est-ce qu’un Reich de mille ans comparé à l’éternelle Sion ?” Ces derniers mots, Hitler les adresse à ses chasseurs lorsque ceux-ci, finalement, décident de le juger eux-mêmes en présence de l’Indien Teku, “visiteur de l’Eden” qui ne voit à vrai dire, en le vieux monstre, qu’un vénérable Ancien... Et le plaidoyer d’Hitler de se poursuivre, implacable, sans une once de mauvaise conscience. Contre le Dieu sanguinaire de l’Ancien testament. Contre “l’appel au sacrifice mielleux” du Christ. Contre le “rabbi Marx et sa clique”. Pour clamer enfin: “Par trois fois, le Juif nous a soumis au chantage de la transcendance. Par trois fois, son bacille de la perfection a empoisonné notre sang et notre matière grise”.
Mais déjà vrombissent les hélicoptères, du côté de la vie. Où se précipitent ces aventuriers minables, qui vont négocier les premières photos du revenant. Où les politiciens aux mains propres en appellent à la cour de Strasbourg. Où ce juriste allemand, dans son bureau feutré, se demande gravement si tout cela “fut vraiment important”...
(En lisant Le transport de A.H. de George Steiner) -
Simenon citoyen du monde

Jeune Rastignac belge las des mondanités parisiennes, Simenon se fait, de 1931 à 1935 et entre 1945 et 1946, reporter au long cours à la rencontre de l’«homme nu». Au scalpel de son regard s’ajoute le témoignage de ses photos.Si Georges Simenon parcourut le monde en tous sens, de la France profonde aux quatre coins de l’Europe, de l’Amérique à la Russie soviétique et de l’Afrique à Tahiti, il ne fut jamais un écrivain voyageur au sens où on l’entend de nos jours. C’est ce qui ressort clairement de la passionnante anthologie de reportages du jeune Simenon que Benoît Denis, directeur du Centre d’études Georges Simenon de Liège, a montée comme un grand film à thème, présentée et commentée avec autant de pertinence chaleureuse que d’objectivité lucide, dans la collection Voyager avec… dont chaque volume supplémentaire fait éclater les nouveaux clichés du voyage plus ou moins moutonnier.
Georges Simenon est un immense voyageur immobile, pourrait-on dire, à la fois curieux et lucide, impatient de voir les choses et les gens, aux antipodes du baroudeur romantique, convaincu que l’aventure n’a plus cours à l’ère des voyages organisés.
«J’ai horreur de l’observation», remarque-t-il même, non sans provocation, alors que rien ne lui échappe; mais plus que d’observation, c’est plutôt d’osmose qu’il faut parler à son propos: poreux comme personne, il sent les choses et les gens plus qu’il ne les détaille ou les «pense». Ce qui intéresse Simenon n’est pas la «merveille» du monde d’un poète à la Cendrars, ou le récit «épique» à la Kessel, ni non plus le reportage-témoignage documenté d’un Albert Londres. Dès son premier périple de six mois sur les canaux de France profonde, en 1928, qui fournira une mine d’observations au romancier futur, ce sont les gens ordinaires qu’il approchera au jour le jour.
Dès 1930, l’écrivain (indépendant mais déjà en vue) va financer des voyages de plus en plus importants en écoulant ses reportages entre quotidiens et magazines. Ses Escales nordiques (1931) paraîtront ainsi dans Le petit journal, que suivront, à un rythme effréné, L’heure du nègre (1932) et Europe 33, dans Voilà, Peuples qui ont faim (pays de l’Est et Russie soviétique), en 23 livraisons dans Le jour, ou encore Mare nostrum ou la Méditerranée en goélette (1934), dans Marianne, et L’Amérique en auto (1946), dans France-Soir. Ceci entre beaucoup d’autres séries de reportages, dont Benoît Denis caractérise utilement la «manière», le style (faussement naïf) et les obsessions récurrentes, de l’agonie d’un certain monde (d’une certaine France) à la recherche d’un humanisme universel, sans oublier son goût pour les bas-fonds, la vérité de la rue, le commerce de la femme…
Le Simenon voyageur est essentiellement romancier. La posture du reporter, privilégiant le détail et l’anecdote, exclut la pose de celui qui en sait plus. Sa découverte de l’Amérique des années pauvres ou de la calamiteuse vie quotidienne dans les pays de l’empire communiste n’est pas d’un idéologue mais d’un homme curieux de vérité, à qui «on ne la fait pas».
Sans poser au vertueux, souvent sarcastique, il montre le colonialisme en Afrique autant que la calamiteuse arriération du «nègre», la?morgue capitaliste en Amérique, la terreur latente et la famine en URSS.
Ne lui importent que les constats et les faits portant sur l’état de tel pays ou le sort de tel individu. La différence l’intéresse moins que la ressemblance et plus il va, plus il voit partout le même homme, qu’il appellera l’«homme nu». Celui-ci sera le personnage omniprésent de ses romans non-Maigret, qu’il commence d’ailleurs à publier au début des années 1930 en passant chez Gallimard.
Nourris de ses pérégrinations, ces «romans de l’homme» seront irradiés par une profonde empathie humaine, alors que ses reportages sont d’un témoin plus «objectif», critique voire polémique. Benoît Denis est le guide avisé de ce voyage «à travers Simenon», à vivre par tous les temps d’un été à crachin…
Georges Simenon, Les obsessions du voyageur. Textes choisis et commentés par Benoît Denis. La Quinzaine/Louis Vuitton, coll. Voyager avec…, 313p. -
Le Bateau-Livre torpillé
Défendre Frédéric Ferney, c'est défendre la littérature
Ainsi que nous l’apprend notre camarade blogueur Eric Poindron, à l’enseigne du Cabinet de curiosités (http://blog.france3.fr/cabinet-de-curiosites/), la meilleure émission littéraire de la télévision française disparaîtra des grilles de la prochaine rentrée. La nouvelle est à la fois triste et révoltante, comme il est triste et révoltant, depuis des années, de voir le sort de plus en plus minable réservé à la littérature et aux livres sur la chaîne publique de la Télévision romande; comme il est triste et révoltant de constater, depuis le début de cet admirable nouveau siècle, la disparition de plus de 40 libraires indépendantes en Suisse romande, victimes (notamment) du combat que se livrent deux grandes entreprise françaises sur notre territoire, à l’enseigne de la Fnac et de la chaîne Payot.
La décision frappant Le Bateau-Livre est-elle irrévocable ? Ce serait une abdication de plus au nom de saint Audimat, et une perte considérable pour les lecteurs. De fait, cette belle et sympathique émission, dont l’animateur a su instaurer un climat de confiance et d’attention aux livres et aux écrivains, avec des vraies discussions qui n’étaient pas pour autant des prises de tête, évitant le jargon et la cuistrerie, n’était pas suivie qu’en France, mais dans toute la francophonie, jusqu’aux derniers vallons de Suisse profonde où l’on dit que l’on lit. Inutile de préciser que le vallon de Villard, où se trouve La Désirade, était l’un des ports préalpins du Bateau-livre, où le nom de Frédéric Ferney sonnait comme celui d’un ami du livre et des auteurs. Les trois ânes de La Désirade, nommés respectivement Hemingway (dont la fin de L'Adieu aux armes évoque ces lieux), Nabokov (qui y chassa l'Argus azuré de son souple filet) et Nourissier (dont le chalet de Caux est tout voisin), seraient d'ailleurs ravis de voir se pointer notre jovial confrère en ces lieux. Bel entretien en perspective, au bord du ciel...Bref : Eric Poindron invite chacun des lecteurs de ce blog à déposer, dans son Cabinet de curiosités, un message de soutien au timonier maltraité du Bateau-Livre. Ne laissons pas faire : défendre la Bateau-livre, c’est défendre tous les passeurs de littérature. C’est défendre la littérature elle-même. Taxer Frédéric Ferney d’élitisme relève d’une vieille stupidité démagogique que les zélateurs paresseux de saint Audimat nous ressortent, alors même qu’ils s’agenouillent en troupeau docile devant l’élitisme absolu du Sport et de la Phynance. Aidons, si cela se peut encore, le Bateau-Livre à survivre ou revivre. Et toute reconnaissance soit manifestée à Frédéric Ferney. Ce qu'attendant, voici copie de sa lettre adressée au début de ce mois, à Nicolas Sarkozy, grand lecteur s'il en est...Paris, le 4 juin 2008
Monsieur le Président et cher Nicolas Sarkozy,
La direction de France-Télévisions vient de m’annoncer que « Le Bateau-Livre », l’émission littéraire que j’anime sur France 5 depuis février 1996, est supprimée de la grille de rentrée. Aucune explication ne m’a encore été donnée.
Si j’ose vous écrire, c’est que l’enjeu de cette décision dépasse mon cas personnel. C’est aussi par fidélité à la mémoire d’un ami commun : Jean-Michel Gaillard, qui a été pour moi jusqu’à sa mort un proche conseiller et qui a été aussi le vôtre.
Jean-Michel, qui a entre autres dirigé Antenne 2, était un homme courageux et lucide. Il pensait que le service public faisait fausse route en imitant les modèles de la télévision commerciale et en voulant rivaliser avec eux. Il aimait à citer cette prédiction : « Ils vendront jusqu’à la corde qui servira à les pendre » et s’amusait qu’elle soit si actuelle, étant de Karl Marx. Nous avions en tous cas la même conviction : si l’audience est un résultat, ce n’est pas un objectif. Pas le seul en tous cas, pas à n’importe quel prix. Pas plus que le succès d’un écrivain ne se limite au nombre de livres vendus, ni celui d’un chef d’état aux sondages qui lui sont favorables.
La culture qui, en France, forme un lien plus solide que la race ou la religion, est en crise. Le service public doit répondre à cette crise qui menace la démocratie. C’est pourquoi, moi qui n’ai pas voté pour vous, j’ai aimé votre discours radical sur la nécessaire redéfinition des missions du service public, lors de l’installation de la « Commission Copé ».
Avec Jean-Michel Gaillard, nous pensions qu’une émission littéraire ne doit pas être un numéro de cirque : il faut à la fois respecter les auteurs et plaire au public ; il faut informer et instruire, transmettre des plaisirs et des valeurs, sans exclure personne, notamment les plus jeunes. Je le pense toujours. Si la télévision s’adresse à tout le monde, pourquoi faudrait-il renoncer à cette exigence et abandonner les téléspectateurs les plus ardents parce qu’ils sont minoritaires? Mon ambition : faire découvrir de nouveaux auteurs en leur donnant la parole. Notre combat, car c’en est un : ne pas céder à la facilité du divertissement pur et du people. (Un écrivain ne se réduit pas à son personnage). Eviter la parodie et le style guignol qui prolifèrent. Donner l’envie de lire, car rien n’est plus utile à l’accomplissement de l’individu et du citoyen.
Certains m’accusent d’être trop élitaire. J’assume : « Elitaire pour tous ». Une valeur, ce n’est pas ce qui est ; c’est ce qui doit être. Cela signifie qu’on est prêt à se battre pour la défendre sans être sûr de gagner : seul le combat existe. La télévision publique est-elle encore le lieu de ce combat ? Y a-t-il encore une place pour la littérature à l’antenne ? Ou bien sommes-nous condamnés à ces émissions dites « culturelles » où le livre n’est qu’un prétexte et un alibi ? C’est la question qui est posée aujourd’hui et que je vous pose, Monsieur le Président.
Beaucoup de gens pensent que ce combat est désespéré. Peut-être. Ce n’est pas une raison pour ne pas le mener avec courage jusqu’au bout, à rebours de la mode du temps et sans céder à la dictature de l’audimat. Est-ce encore possible sur France-Télévisions ?
En espérant que j’aurai réussi à vous alerter sur une question qui encore une fois excède largement celle de mon avenir personnel, et en sachant que nous sommes à la veille de grands bouleversements, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect.
Frédéric Ferney
P.S. « Le Bateau-Livre » réunit environ 180 000 fidèles qui sont devant leur poste le dimanche matin à 8h45 ( ! ) sur France 5, sans compter les audiences du câble, de l’ADSL et de la TNT ( le jeudi soir) ni celles des rediffusions sur TV5. C’est aussi l’une des émissions les moins chères du PAF.
-
Ceux qui s’éloignent

Celui qui laisse dire / Celle qui sourit à son agresseur / Ceux qui préfèrent marcher en moyenne montagne / Celui qui défie toute indiscrétion / Celle que la vulgarité blesse sans qu’elle n’en dise rien / Ceux qui n’entrent pas dans le jeu des amuseurs médiatiques / Celui que l’opportunisme de ses collègues sous-chefs sidère / Celle qui ne s’étonne plus de rien / Ceux qui se réfugient dans la peinture sur porcelaine / Celui qui emmènera sa douce voir Cézanne à Aix-en-provence en juin prochain / Celle que son garçon en train de muer émeut sans qu’elle sache pourquoi / Ceux qui écoutent en même temps Désert de Varese sur Espace2 / Celui qui a besoin (dit-il) de s’exploser chaque matin sous sa douche / Celle qui ne fréquente plus le Club des Seniors depuis qu’elle a appris certaines choses / Ceux qui économisent pour l’achat d’un 4x4 / Celui qui en pince pour les postières motorisées du Périgord noir / Celle qui a résolu de flinguer son chien Patou avant de retourner l’arme contre elle-même / Ceux qui pensent qu’ils vont guérir les deux lesbiennes du service contentieux de la banque cantonale de M. / Celui qui pense que le sexe est une valeur en baisse après la retraite / Celle qui drague dans les couloirs de l’établissement médico-social L’étoile du matin / Ceux qui revivent quand ils entendent Bambino sur Nostalgie / Celui qui ne jure que par Honda / Celle qui prétend que le curé Clément Ledru est un émissaire de l’astéroïde Lupus III / Ceux qui se rappellent le concert en plein air de Dalida au Lavandou vers 1958,59 / Celui qui se flatte d’avoir un cousin qui s’entraîne au même club de remise en forme que le député social-démocrate Bernier / Celle qui fricote avec un gazier / Ceux qui disent en avoir plein le casque des médias / Celui qui se croit tous les jours dimanche (disent-ils) / Celle qui dit ne pouvoir sacquer la prof chargée du cours d’éducation sexuelle / Ceux qui ne croient plus vraiment en l’Avenir Radieux, etc.Dans le métro. Huile sur toile de Thierry Vernet.
-
Le secret de chair
L’Enlacement, admirable, de François Emmanuel
Après l’inoubliable polyphonie vocale de Regarde la mer, qui reste l’un des rares vrais bonheur de lecture de l’an dernier, François Emmanuel nous revient avec un petit roman non moins admirable de texture et de musicalité, certes plus intimiste et plus âpre, plus douloureux aussi et plus tendu, dont on se demande où il va basculer quand il se dénoue de façon à la fois déchirante et finalement apaisante, qui nous fait passer d’un lien surtendu à une relation relevant d’un amour qu’on pourrait dire d’au-delà de l’amour, délivré de l’angoisse crucifiante.
Est-ce la lumière du moment, dans cette salle du musée viennois du Belvédère, ou la seule vision de la grand toile à l’érotisme tourmenté de L’Enlacement d’Egon Schiele qui fait s’effondrer soudain cette femme gracieuse visitant le musée avec un ami de son mari – un écrivain en lequel elle a reconnu une âme proche -, lequel vient l’aider à se relever pour s’entendre dire « ah, c’est vous » au moment même où se noue entre eux un lien qu’il pressent vertigineux. Et de fait, Anna Carla Longhi n’aura de cesse de revoir l’écrivain dont les lectures publiques l’ont troublée, alors qu’elle vit pour la première fois l’accession à une forme de « temps éternel », avec la sensation d’être guidée. Or à l’instant même où le lecteur se prend à songer à Virginia Woolf, à laquelle la phrase limpide et liquide, ondoyante et mélodieuse, toute par vagues, de François Emmanuel, s’apparente à l’évidence, voici que la citation directe de La promenade au phare relance la narration. Sur quoi la médiation d’une voix et d’une écriture devient, comme dans la lecture mimétique de Paolo et Francesca, le lieu et le lien d’une rencontre très délicate, à la fois très fragile et très intense – parfois au fin bord de l’hystérie, dont on se demande bientôt à quoi elle rime quand, par une sorte de transfert où l’écrit de l’homme reçoit le secret de la femme blessée en sa fraîche jeunesse et le raconte, tout s’éclaire par-dessous, si l’on ose dire, libérant l’affreux secret et la pauvre honte, par delà le désir.
Quelle tempête indicible a soulevé la tempête suspendue de L’Enlacement aux draps à dents de scie et aux corps de naufragés, si tant est que ce soit la scène du tableau et pas ses seules couleurs ou les chairs barbelées, l’évidence exacerbée du sexe, ou « l’irruption de la lumière » en ce jour qu’elle dit plus tard « le jour de l’éblouissement " ?
Nulle réponse évidemment, au terme de ce livre modulé en grande douceur, petit livre aux grands espaces de silence et de présence, coulé dans une écriture comme il en est presque plus à entendre…
EMMANUEL François. L’Enlacement. Seuil, 88p.
-
Nivat de père en fille
PASSEURS Deux livres importants, Vivre en Russe et Bagdad, zone rouge, contribuent à surmonter les murs de l’incompréhension. Avec la même passion de communiquer.
Le père, fils de prof, a découvert la Russie en Auvergne à seize ans. La fille a suivi la «pente russe» de ses parents avant de se tracer une voie personnelle. Tous deux sont d’insatiables curieux. Rien du spécialiste confiné chez le père. Rien de l’agitation de surface chez la fille. Chacun, à sa façon, agit en passeur : Georges Nivat en explorateur de la langue, de la littérature, de la terre, des hommes et de l’âme russes ; Anne, en risque-tout du reportage dans les zones à haut risque, pour qu’on n’oublie pas les victimes de la folie des hommes en Tchétchénie, en Afghanistan ou en Irak. Chacun à son rythme, mais aussi profondément engagés l’un que l’autre, le père et la fille nous entraînent dans une quête de vérité et de sens lestée du même amour des gens et de la vie.
Vivre en Russe relève de la grande traversée où Georges Nivat raconte, plus personnellement que d’ordinaire, l’histoire de sa passion pour la Russie et les Russes, de l’époque de Pasternak (qu’il aima comme « une sorte de père) à celle de Poutine, qu’il juge moins sévèrement que beaucoup d’Occidentaux. Le « roman » commence dans un antre de relieur en chambre, à Clermont-Ferrand, où l’exilé Georges Nikitine, ancien combattant de l’armée blanche, lui fait entendre la musique de cette langue dont il s’émerveillera des ressources particulières dans une page d’anthologie. C’est que la langue est consubstantiellement liée à ce qu’on dit « l’âme russe », cliché sentimental pour beaucoup mais réalité néanmoins, complexe et souvent contradictoire, que le Nivat « philosophe » va éclairer en citant trois « caractères» signalé par son maître Pierre Pascal: « solidarité » d’abord, « indétermination » (à bas de fatalisme, paresse et résignation) dans un sens plus négatif et « tendance vers l’absolu ». Plus en profondeur, Nivat éclairera ensuite la notion-clef de « sobornost », grand concept russe désignant une sorte d’unanimisme spirituel, pour distinguer l’esprit russe de la mentalité occidental. Cependant, loin de toute simplification, c’est pour une Russie «européenne» que plaidera Nivat au fil de ces pages, en proposant du pays actuel un tableau foisonnant et nuancé.
De son premier séjour à Moscou où, dans une bohème artiste vivifiante mais toujours assombrie par le souvenir des camps, il fréquenta la famille de Pasternak avant d’être expulsé en août 1960, à la fin de l’URSS qu’il vécut comme un « bonheur personnel », Georges Nivat a «vécu» la Russie dans tous ses états. Traducteur et biographe de Soljenitsyne (dont il reste distant à certains égards), interlocuteur privilégié d’Alexandre Zinoviev (que son catastrophisme n’a jamais convaincu) et de Vassili Grossman, entre cent autres écrivains et jusqu’aux plus jeunes, Nivat fait éclater les catégories du commentaire littéraire ou esthétique en incluant la culture russe de la base au sommet, du détail « quotidien » aux grands courants sociaux ou spirituels, du cinéma d’Alexandre Sokourov aux accointances des Bienveillantes et de Vie et destin, de Nabokov à Volkoff. Son « être russe » procède alors d’une seconde patrie qui multiplie son « être français » dans une optique universaliste qui reste très centrée. Son inoubliable première traduction, avec Jacques Catteau, du Pétersbourg d’Andrei Biély, parue en 1967 à Lausanne, aux éditions L’Age d’Homme dont il fut l’un des sourciers majeurs, et Vivre en Russe, à la même enseigne, marquent deux dates d’un parcours et d’une œuvre de « lecteur du monde » souvent inaperçus en nos murs. Or l’un des mérites de Georges Nivat et d’avoir aidé à renverser les murs…
La « fille courage »
A Bagdad, des murs s’érigent aujourd’hui de manière démente, symboles d’une situation qu’Anne Nivat, mère d’un petit garçon que l’écrivain Olivier Rolin qualifie de « femme la plus gonflée que j’aie jamais connue », est allée observer en « zone rouge» durant deux séjours en 2007. Vivant chez l’habitant, voilée, impatiente d’aller partout, la journaliste se raconte en deuxième personne («tout t’intéresse ! »), non du tout pour se mettre en avant mais pour mieux « objectiver » sa situation dédoublée de femme « infiltrée » qui s’expose malgré sa peur et veut informer en dépit de l’indifférence ou du fatalisme. Il en résulte bien plus qu’un reportage : un relevé d’immersion grouillant de détails sur la vie au ralenti des Bagdadis, entre désespoir (ce jeune antiquaire survivant dans la poussière) et détermination (ce frère dominicain dont trente-six collègues ont été massacrés), sous une chape de peur et d’insécurité croissante. Collection de faits exacts et de témoignages précieux, le dernier livre d’Anne Nivat est à lire absolument lui aussi.
Georges Nivat. Vivre en Russe. L’Age d’Homme, 480p.
Anne Nivat, Bagdad zone rouge. Fayard, 279p.
Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 10 juin 2008
-
Un romancier d’avenir

Romain Gary à redécouvrir…
Ce serait l’histoire d’un homme fou de la vie et ne la supportant pas telle qu'elle est, qui aurait voulu ne mourir jamais et qui se suicida d’un coup de revolver. Ce serait l’histoire d’un homme venu de nulle part, dont l’enfance baigna dans la culture d’un peuple exterminé pendant qu’il combattait lui-même l’Ange des ténèbres, et qui vécut plusieurs vies en une pour en tirer des fables à n’en plus finir.
Tel était Romain Kacew, devenu Gary, puis Emile Ajar : Protée écrivain du XXe siècle réinventant des mythes dans une langue accessible à tous, intervenant à égale distance de la gauche et de la droite mais engagé dans l’absolu de son œuvre : interrogeant le mal dans l’homme, le sens de la vie et ce qu’elle deviendrait sans un grand changement en chacun. Naïf apparemment aux yeux des beaux esprits, jamais dupe des modes intellectuelles, Romain Gary poursuivait une méditation incarnée sur l’humanité du XXe siècle, avec la Shoah et les retombées de la guerre nucléaire pour horizon.
Son premier livre, Education européenne, illustrait la Résistance, à la fois polonaise et universelle, et une nouvelle culture à réiventer. Par la suite, à l’image d’un Hemingway européen, pas loin non plus d’un Malraux, ce grand vivant de la race des conquérants bâtit une œuvre pétrie de sang et d’émotion, à l’écart de ce qu’on a dit la modernité, dans la masse et l’énergie d’une saga picaresque. Hélas, ce dont les « élites » intellectuelle ne se sont pas assez avisées de son vivant, le blessant profondément, c’est que Romain Gary était aussi un visionnaire et, dans sa vie autant que dans son œuvre, un médium du drame vécu par l’homme du XXe siècle, entre nihilisme et convictions nouvelles.
La contradiction incarnée
Or voici que, 25 ans après le suicide de Romain Gary, de multiples signes témoignent de sa survie et plus encore : du regain de signification de son œuvre, autant que de celle d’Emile Ajar, son complément réduit, à l’époque, à une péripétie médiatique, alors qu’il représente un double essentiel, symbole vivant des contradictions vécues par l’écrivain, ainsi qu’en témoigne le génial Pseudo aussi mal compris du public que de la critique…
Pour redécouvrir Romain Gary et Emile Ajar, un très éclairant Cahier de L’Herne vient de paraître, rassemblant des études (notamment de Paul Audi, François Bondy, Nancy Huston ou Pierre-Emmanuel Dauzat), quantité de témoignages (l’affaire Ajar racontée par Michel Cournot) et nombre de textes de Gary lui-même et autres entretiens. Parallèlement paraissent les articles et essais de Gary, sous le beau titre de L’Affaire homme, et un recueil de nouvelles dont la première qu’il a publiée, sous le titre de L’orage.
Dans le dernier roman d’Emile Ajar, L’angoisse du roi Salomon, Romain Gary nous envoya l’un de ses messagers les plus tonifiants, merveilleux vieillard s’acharnant à compenser le mal commis au su et au vu d’un Dieu apparemment indifférent. Le thème du messianisme est en effet central chez Gary, impliquant ce qu’il disait « la fin de l’impossible » : non pas l’utopie mais l’avènement d’un homme plus humain. Or, s’il n’a pas survécu lui-même à ce vœu, son œuvre demeure, à lire et relire pour changer l’avenir…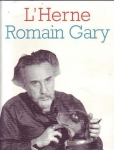

Romain Gary. Cahier de L’Herne, 362p.
L’orage, nouvelles, L’Herne, 215p.
L’affaire Homme, Folio, 354p.Sur Romain Gary:
Paul Audi, La fin de l’impossible. Bourgois, 120p.
Philosophe au langage accessible, Paul Audi rend ici un hommage très personnel à Romain Gary, en lequel il voit le garant créatif d’une nouvelle forme de liberté.Fabrice Larat, Un itinéraire européen. Georg, 187p.
Humaniste anti-nationaliste, Romain Gary impressionna Denis de Rougemont avec son Education européenne. Ce livre éclaire sa conception non conventionnelle d’une Europe des cultures. -
L’ogre
 Quand il nous attrape dans la forêt, nous surprend d’abord la rapidité de sa détente d’animal sauvage. Les contes le représentent souvent comme un grand empêtré, mais il en va de l’ogre comme du loup à l’instant de bondir sur sa proie.
Quand il nous attrape dans la forêt, nous surprend d’abord la rapidité de sa détente d’animal sauvage. Les contes le représentent souvent comme un grand empêtré, mais il en va de l’ogre comme du loup à l’instant de bondir sur sa proie.
Ensuite seulement vient la douceur, non moins surprenante, de sa pince, puis de sa paume et de son giron velu.
Nous étions ce matin une poignée de bambins dans le décolleté de sa chemise de forestier, où la sueur pleuvait; et d’emblée sa voix moelleuse a calmé nos tremblements de lapereaux. C’était amusant de l’entendre nous supplier de ne pas le chatouiller ainsi, même il alla jusqu’à glousser lorsque le plus hardi d’entre nous s’en vint à lui mordiller un téton; mais alors apparut la masure dans la clairière et nous parvint, enivrant, le fumet du pot-au-feu où tout à l’heure l’ogre nous jetterait tout vifs.
Nous qui n’avons jamais humé que l’odeur rance de la misère, nous croyons découvrir l’odeur du paradis lorsque l’ogre enfin nous dépose, dans sa cuisine où flotte le relent divin, sur la grasse planche où flamboient les couteaux. Cela non plus n’est pas assez connu des conteurs: que l’ogre, dans l’apprêt de ses viandes, soit un être d’une si prévenante délicatesse.
-
Apories sensibles du sens
Découverte de Cvetko Lainovic
« Son vide apparent est la vie pleine », écrit Vladimir Dimitrijevic à propos des aphorismes et de la quinzaine de très singuliers dessins qu’il a publiés de Cvetko Lainovic, sous un titre on ne peut plus explicite : Honte des mots. Les uns, autant que les autres, aphorismes et dessins, expriment en effet l’inexprimable et, pour le lecteur, suggèrent plus qu’il ne disent l’inouï, l’inconcevable, l’aporie tremblante, la vision les yeux fermés.
« Ainsi, il ne reste que le verbe, l’essentiel, la ligne. La blancheur de ses dessins est tumultueuse, mais seulement dans l’œil de celui qui regarde », écrit encore Dimitrijevic, « c’est ainsi que j’ai subi la première vision de son art. J’ai lu, non, je me suis approprié ces aphorismes verticaux comme des météorites qui chutent. Inattendus ! »
Par exemple : «Les mots viennent du ciel, et les idées d’une insuffisance de rire ». Ou ceci : « Les horreurs ont leurs racines dans les idées claires ». Ou encore : « Je suis convaincu que la ligne que je piétine ressent une douleur ». Ou encore : « Toute pensée a son mort ». Ou encore : « La beauté se sépare de la vérité au moment où tu deviens sûr de l’une des deux ». Ou encore : « Les animaux sont beaux car ils ne perçoivent pas le temps ». Ou encore : « La beauté prend exemple sur la disparition ». Ou encore : »Les mots protègent le ciel contre nous ». Ou encore : « L’art fait que les vides souffrent moins ». Ou encore : « La peinture a été créée selon le principe suivant : l’oubli irradie ». Ou encore : « L’art et la femme représentent l’exception à toute vérité ». Ou encore : « On supporte le mieux l’inexistence ».
Mais la citation sélective mutile, il faudrait tout citer, ou plutôt il faut avoir ce petit livre à tout moment à portée de main et le remplir de points d’exclamation ou d’interrogation. Traits verbaux ou picturaux fulgurent, qu’on a honte de commenter. « Et le même trait fulgurant comme lame passant sur la peau fait naître les hennissements de l’étalon, la solitude du monastère, Moïse, les natures mortes, les balais, les saints », quelque part entre un Matisse en transe et le graffiteur du Mur aux énigmes…
Cvetko Lainovic. Honte des mots. Aphorismes. Traduit du serbe par Dejan M. Babic. L’Age d’Homme, 62p.
Dessins de Cvetko Lainovic : L’écuyère; Le Christ; L’entrée à Jérusalem.
-
Bouillon de multiculture
La littérature suisse est un biotope quadrilingue foisonnant mais mal défendu. La revue ViceVersa propose un nouveau lien traversant et pose un début de constat. Pourrait mieux faire...
Le grand public sait désormais, avec le soutien d’un ministre militant (Pascal Couchepin) et de ses deux bras armés (Jean-Frédéric Jauslin et Nicolas Bideau) que le cinéma suisse existe et qu’il lui arrive d’être populaire et de qualité. L’évidence était vieille comme Tanner au moins, mais le marketing actuel consiste à dire et répéter les choses connues jusqu’elles soient reconnues.
Or qu’en est-il de la littérature suisse ? Que dit la littérature sur la réalité de ce pays ? Son regard est-il plus ou moins pertinent que celui de notre cinéma ? Est-il vrai que la nouvelle génération soit dépolitisée et que faut-il en déduire ? La production littéraire des quatre cultures a-t-elle une tonalité générale ou des caractères spécifiques ? Qui lit « nos » auteurs ? Lesquels sont traduits ? Comment sont-ils présentés dans les médias de leur aire linguistique et des autres régions ? Editeurs et auteurs se défendent-ils comme il en va des gens de cinéma ? Et la politique du livre en Suisse est-elle cohérente ?
A ces questions générales, c’est par des états-généraux de la littérature en Suisse qu’il faudrait répondre en rassemblant tous les intéressés. Or une telle concertation semble peu probable à vue de nez, et le relever nous ramène à ce qui est : une peau de chagrin à beaucoup d’égards, surtout du côté des passeurs.
Dire, comme on a dit que la Suisse n’existe pas, que la littérature suisse n’existe pas, est une imbécillité. Il y a beaucoup d’auteurs intéressants en Suisse, l’édition y reste un fleuron de notre culture, et l’état de la lecture dans notre pays est moins inquiétant qu’ailleurs. Le problème est plutôt affaire de visibilité et de transmission, dans la relation entre le livre et le public, sur fond de consommation de masse et de course à l’audimat. Du moins est-ce le constat qui se dégage des aperçus que propose la deuxième livraison de la revue d’échanges littéraires Viceversa littérature, proposant notamment un panorama de l’année littéraire 2007 et une enquête sur la critique littéraire dans les médias.
Dédaignée à la télévision (un peu moins au Tessin qu’en Suisse romande et alémanique), plutôt bien défendue en revanche sur nos chaînes de radio et même dans nos journaux, la production littéraire suisse pâtit d’un net déficit du point de vue de la traduction, notamment « intra muros ». De manière générale, les quatre régions linguistiques communiquent peu. A quelques « stars » près (une Agota Kristof, un Martin Suter), les meilleurs auteurs et les œuvres les plus marquantes mettent des années à être traduits ou reconnus entre Confédérés. Alors que les Journées de Soleure rassemblent la profession et le public, les journées littéraires de Soleure se bornent à des lectures ou les Romands occupent un strapontin. Quant à la fondation Pro Helvetia, qui subventionne plus qu’elle ne propose quoi que ce soit de globalement constructif, elle reflète assez l’atomisation actuelle de toutes les énergies. Pour pallier celle-ci, l’initiative de Viceversa littérature est certes louable, mais encore trop limitée à un public d’initiés. Du moins pourrait-on espérer qu’elle incite les auteurs (en leurs sociétés) et les éditeurs à se décider enfin à montrer qu’ils existent, quitte à faire du cinéma…Trois perles de multiculture Un garçon parfait, d’Alain Claude Sulzer. Traduit de l’allemand par Johannes Honigmann. Jacqueline Chambon, 241p.
Un garçon parfait, d’Alain Claude Sulzer. Traduit de l’allemand par Johannes Honigmann. Jacqueline Chambon, 241p.Tant par son climat que par sa thématique de l’amour à sens unique, ce très beau roman imprégné de mélancolie ne tarde à rappeler Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro ou La mort à Venise de Thomas Mann, dont la figure apparaît incidemment en l’occurrence. Ernest, le narrateur quinquagénaire dont le service impeccable, au Grand Hôtel de Giessbach, consiste à se rendre personnellement transparent, apparaît sous un autre jour au lecteur à la réception d’une lettre d’Amérique lui venant, après des années de silence, d’un jeune collègue qu’il a initié à la perfection tout en partageant des jeux nocturnes moins policés. S’il a vraiment aimé Jakob, celui-ci lui a prêté son corps comme à bien d’autres, en gigolo narcissique. Passons sur les détails, d’ailleurs traités sans forcer le trait. Mais l’émotion va crescendo. Dans une forme toute classique, un brin surannée, le romancier bâlois nous enchante cependant par la musique songeuse de son écriture, fort bien rendue en notre langue.
Szuzsanna Gahse. Livre de bord. Version bilingue. Traduit de l’allemand par Patricia Zurcher. Editions d’En Bas,
Les littératures suisses ont accueilli, ces dernières décennies, des auteurs remarquables émargeant à diverses cultures, liés aux migrations économiques ou au refuge politique. Szuszanna Hahse arrivée de Budapest (où elle est née en 1946) à Vienne, avec la vague des réfugiés de 1956, et transitant ensuite d’Autriche en Allemagne, puis en Suisse où elle a été nommée « observatrice de la ville de Zoug » en 1993, en est un exemple significatif, dont l’oeuvre germanophone (prose, poésie, essais, théâtre, traductions de grands auteurs hongrois) est aussi considérable et primée que méconnue en terre francophone. Les thèmes de la migration, du déracinement et des dérives d’une langue à l’autre sont traités, par cet esprit vif à la plume acérée, de façon très originale où les lieux investis, les paysages, les éléments, les gens animent une sorte de théâtre géographique étonnant, Dans un Livre de bord lucernois, une Petite topographie instable et un récit lausannois intitulé Pierre, plus surprenant encore, nous découvrons un regard décentré et révélateur sur notre univers proche, d’un apport substantiel.
 Remo Fasani. L’éternité d’un instant. Traduit de l’italien par Christian Viredaz. Préface de Philippe Jaccottet. Samizdat, 142p.
Remo Fasani. L’éternité d’un instant. Traduit de l’italien par Christian Viredaz. Préface de Philippe Jaccottet. Samizdat, 142p.Philippe Jaccottet n’est pas du genre à tempêter, et c’est pourtant d’une « négligence scandaleuse » qu’il parle à propos de la méconnaissance à peu près complète dont souffre l’œuvre poétique, selon lui majeure, du poète tessinois Remo Fasani, pourtant établi depuis une quarantaine d’années en Suisse romande, chargé de la chaire de langue et de littérature italienne à l’Université de Neuchâtel de 1962 à 1985; et Jaccottet de préciser, dans son amicale introduction à cette très dense et très limpide anthologie groupant chronologiquement, de 1944 à 199, un choix de poèmes tirés de cinq recueils, que Remo Fasani est un « poète de la grande solitude » manifestant une « attention presque religieuse » au monde, dont nous pourrions ajouter que les poèmes nous transportent à la fois hors du temps et au cœur du temps, avec quelque chose de la pureté cristalline des poètes-peintres chinois : « Une lumière de vin/brûle sur le fil des neiges / un frisson sur les roches est suspendu », et de fait, l’instant de ce Soir alpestre se dilate aux dimensions d’une éternité pressentie. La guerre est cependant présente en filigrane, un homme dans une nuit qui se nomme Fasani et se déclare à la fois « citoyen du monde » et « en exil », un homme essentiel pourrait-on dire qui nous parle d’une voix intime, proche et nimbée du silence d’un sourire de Bouddha, sereine et détachée apparemment, mais dont chaque mot est d’un cristal que le temps a taillé patiemment.