
En Lisant Les grand-mères de Doris Lessing
A La Désirade, ce dimanche 11 septembre. – C’est un livre qu’on lit en coup de vent et qui touche pourtant au cœur, je l’ai traversé en une heure avec le sentiment de « lire » une possibilité de bonheur liée à une folle liberté prise, folle et si naturelle à la fois, scandaleuse apparemment et si légitime, rare mais donnée ici comme une grâce.
De fait, Les grands-mères de Doris Lessing pourrait être dit le roman de la grâce heureuse, à la fois idéale et interdite, même s’il n’a rien de réellement transgressif. C’est l’histoire d’une amitié totale entre deux petites filles restées inséparables à l’âge d’être femmes. Elles forment un vrai couple sans être lesbiennes pour autant, comme leurs fils uniques s’aimeront sans êtres gays. Les deux amies à la vie à la mort sont Roz et Lil; leurs deux garçons, Tom et Ian.
Roz, forte nature très portée sur le théâtre, a fait fuir Harold qui se sentait si peu exister aux yeux de sa jeune femme, laquelle a refusé de le suivre dans la ville universitaire où il espèrait l’emmener, loin de Lil. Quant à celle-ci, elle n’a même pas à s’occuper de son conjoint, qui trouve satisfaction avec d’autres avant de se crasher dans un accident de voiture.
Sur ce rivage marin à l’éternel beau temps, aéré en permanence et où leurs maisons proches ont l’air d’être toujours ouvertes, les belles jeunes femmes voient grandir leurs garçons jusqu’à l’âge d’incarner de jeunes dieux, lesquels radieux éphèbes deviendront assez naturellement leurs amants, en parallèle parfait. C’est une possibilité de bonheur, nous souffle Doris Lessing en menant son roman comme une joviale mise en scène, laissant cependant toute liberté à ses personnages et à la vie. Surtout c’est une modulation sur le thème de l’amoureuse complicité, au sein d’une famille élargie qui se fait clan à l’approche des belles-filles, et c’est enfin une rêverie sur l’utopique jeunesse éternelle renvoyant non au désenchantement mais à l’acceptation malicieuse de la réalité pleine de si délicieux souvenirs.
Le roman commence et s’achève par un fracas, après la découverte par Mary, la femme de Tom, des lettres d’amour que celui-ci a adressées à Lil, sa maîtresse de vingt ans son aînée. Roz éclate de rire quand elle comprend que Mary a compris la nature des amours croisées qu’ont vécues les deux « grand-mères » et leurs fils, et le quatuor en restera un peu mélancolique à vrai dire, mais « c’est la vie », à laquelle les amants ont fait un beau pied-de-nez, et ma foi tant pis pour les jeunes épouses qui n’ont plus qu’à inventer leur propre liberté en fondant une petite entreprise en crâne tandem, au dam du clan…
Chère vieille Doris insolente et si jeune de cœur à 86 balais. Je me rappelle notre rencontre fortuite au jardin du Luxembourg, il y a presque vingt ans de ça, une heure avant notre rendez-vous chez son éditeur. L’ayant reconnue après qu’elle se fut assise sur mon banc, je lui avais souri dans le soleil, et, le regard vif, elle m’avait souri à son tour en constatant que je lisais « quite a good book », puisque le bouquin n’était autre que le sien… Ensuite elle avait éclaté de rire en me voyant arriver pour l’interviewer, et nous avions parlé de son livre et de la vie comme si nous nous connaissions depuis longtemps…
Doris Lessing. Les grand-mères. Flammarion 2005, 127p.
-
-
La peinture au corps
Sensualité et sublimation
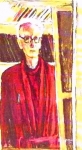

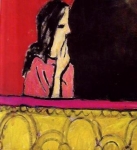
Lorsque Josef Czapski m’a dit un jour qu’il bandait pour la couleur, avec un de ces élans juvénils qui semblaient soulever tout à coup sa vielle carcasse d'octogénaire repliée comme celle d’un grand oiseau en cage, dans la mansarde à plafond bas de l’Institut polonais, à Maisons-Laffitte, je l’ai pris comme un saillie, c’est le cas de dire, sans me douter alors de ce que le rapport physique avec la peinture pouvait avoir effectivement de sensuel et d’excitant, notamment lorsqu’une forme émerge du chaos des couleurs, et surtout dans la pratique dionysiaque de celles-ci. De fait on n’imagine guère Monsieur Bonnard, debout devant sa toile en cravate, bandant pour la couleur, même si celle-ci est chez lui tous les jours à la fête. Mais Bonnard est un apollinien, comme Cézanne, sauf quand celui-ci caresse ses baigneuses et ses baigneurs.
A l’opposé, qu’on imagine le plus souvent ivres et virtuellement à poil dans le bordel de leur atelier : Soutine et Bacon, dont les couleurs sont autant de décharges nous touchant "directement au système nerveux", comme le notait justement Philippe Sollers à propos de Bacon.
C’est le côté sauvage de la peinture, qui ne se résume souvent qu’à une touche ou à une échappée de liberté folle, comme chez Véronèse ou Delacroix la mèche rebelle dépassant sur le côté…
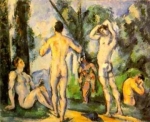
Peindre est un plaisir sans comparaison avec celui de l’écriture, mais ce n’est pas tant une affaire de bandaison que d’effusion dans le tourbillon des odeurs et des couleurs, de quoi surgit la forme.
Paul Gadenne montre, dans Baleine, combien la forme créée est belle, émouvante et paradoxale, et d’autant plus belle, en opposant une partie encore intacte de la dépouille, ailerons et gouvernail de la baleine morte, qu’elle nous apparaît au milieu du désordre de chairs retournant au chaos originel. J’avais vu cela en Grèce lorsque je lisais Kazantzakis, tombant soudain, dans l’anse sablonneuse d’une île déserte, sur un chien ensablé, squelette à tête encore pelucheuse et aux yeux de verre éteint.
Nietzsche a montré mieux que personne, je crois, et Berdiaev après lui, cette oscillation entre dionysiaque et apollinien, qui ne se réduit pas au dualisme entre physique et spirituel, loin de là, mais renvoie au corps sans limites de certains Chinois et de tous les vrais mystique qui « bandent » pour Dieu - les femmes autant sinon plus que les hommes, cela sans dire…Post Scriptum du 10 septembre, sur un balcon au bord du ciel de Neuchâtel. - Et ce soir nous imaginions, avec des amis, que le ciel qui s'étageait au-dessus du lac et des collines avait été peint par Corot. Après que j'eus rappelé à mes amis que Corot, sur son lit de mort, avait regretté de n'être jamais arrivé à peindre un ciel - ce peintre par excellence du ciel, l'ami Jean a alors observé que probablement où il était On le chargeait de temps à autre d'en peindre un vrai, comme celui de ce soir, un Corot divin...

Josef Czapski. Autoportrait, Café rouge et La femme au théâtre
Bonnard et Cézanne, ou l'accord parfait du dionysiaque et de l'apollinien
John Constable, Ciel.
-
L'île possible du présent
De Houellebecq en Dantzig
A La Désirade, ce mercredi 7 septembre. – Je reviens « à moi ». Après sept jours passés à la lecture de La possibilité d’une île, je reviens « à moi » ce qui signifie : à ma propre perception de la réalité. Je suis certes content d’avoir lu le livre de Michel Houellebecq à fond, parce qu’il le mérite, mais si j’estime ce livre important pour l’époque, et que je reconnais qu’il m’a captivé, j’éprouve à présent le besoin de revenir à ma façon naturelle d’aimer et, revenant « à moi », je reviens au vrai partage d’une passion que m’offre, si généreusement, le Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig dont j’ai relu ce matin les rubriques consacrées au mots Âme, Amour
 et Amers grincheux.
et Amers grincheux.
C’est un peu comme au jardin zoologique . On regarde un moment l’ornithorynque. Il est intéressant. Vraiment un drôle de cocktail, cet Arcimboldo animal, puis on retourne à l’otarie faisant la folle dans la cascade ou au lion pensif à plat ventre dans sa crinière de philosophe du XIXe finissant.
. On regarde un moment l’ornithorynque. Il est intéressant. Vraiment un drôle de cocktail, cet Arcimboldo animal, puis on retourne à l’otarie faisant la folle dans la cascade ou au lion pensif à plat ventre dans sa crinière de philosophe du XIXe finissant.
Houellebecq radote à propos de Nabokov, comme Nabokov a radoté à propos de Faulkner ou de Dostoïevski, mais c’est la loi du jardin zoologique : le lamantin ne saurait même concevoir l’oiseau de paradis, ni celui-ci se figurer la possibilité d’un gnou sur une île flottante, tandis que nous passons d’une cage à l’autre, Charles Dantzig et ses amis, en devisant tranquillement.
Voici ce que dit Dantzig du mot Âme dont les poètes font leur bonnet même en été : « Âme est un mot simple, dont on ne se méfie pas à cause de sa simplicité, au contraire des célèbres mots en « ismes » dont le monde se méfie à cause de ce tatouage à la cheville qui siffle : « Attention, notion ! »
Et ceci encore de si juste : « Âme révèle souvent l’orgueil insensé d’écrivains qui se proclament humbles, comme Villiers de l’Isle-Adam qui écrit : « Je n’écris que pour les personnes atteintes d’âme » (Fragments divers). Et cela encore : « Certains écrivains emploient ces mots comme les femmes qui vont au marché avec tous leurs bijoux ».
Ensuite Dantzig , à propos d’Amers et grincheux, multiplie les constats d’une fusillante pertinence. « La moitié de la gloire de Baudelaire vient, non de ses grands vers, mais de ce qu’il n’est jamais content. L’amertume plaît aux auteurs, en ce qu’elle réfute leur responsabilité, aux lecteurs en ce qu’elle justifie leurs rancoeurs. » Ensuite à Cioran qu’il appelle « l’amer en chef », il reproche d’employer la langue française « avec un vocabulaire d’étudiant en sociologie » qui abuse des points de suspension, ce qui fait de lui « un moraliste distendu ». Et de conclure : « Un moraliste devrait assumer sa posture de tueur méprisant : une phrase, une balle, on rengaine ». Ainsi s’exprime Charles Dantzig .
Et cela qu’on dirait du Vialatte : « Selon les grincheux, nous vivons en décadence. Comme si la décadence n’était pas là depuis le premier jour de la vie. Chassé du paradis, Adam errait en grommelant : « Tout fout le camp ». Avant c’était mieux. Après ce sera mieux. Pauvre présent ! pauvre présent toujours injurié, présent qui est nous, présent qui n’arrive jamais à se débarrasser du chewing-gum du passé, et devant qui on agite en permanence le papier brillant de l’avenir, pauvre présent, tu trouve les moyen d’admirer ceux qui t’injurient ! »
Sur Amour aussi notre compagnon de route excelle. Je ne cite pas tout mais ceci doit l’être : « L’amour est un espoir. De là sa nuance de bassesse. Seulement, c’est un espoir envers soi-même, de pouvoir être assez bien pour plaire, etc. De là sa nuance de hauteur. Une des conséquences positives de l’amour est la vanité. Tous les efforts qu’on fait pour attirer l’attention de l’autre et qui nous améliorent… » On voit qu’on est loin de la philosophie de Marc Levy.
Et cela : « Bien sûr, il n’y a que l’amour, et ce livre même n’est qu’un grand imprimé d’amour destiné à en créer, mais je crois qu’il ne faut pas trop le dire. Les forces de la haine en profiteraient pour enrôler dans leurs troupes les esprits irrités par l’air béat que, disent-elles, l’amour donne ».
On le constate dès qu’on entre dans Le passé, grand roman d’amour de l'Argentin Alan Pauls (Bourgois, 2005) dont j'ai entrepris la lecture cette nuit et qui vibre d'électricité passionnelle dès ses premiers chapitres rappelant Proust - et très vite il faut se faire à la béatitude des jeunes amants sous peine de retourner à la cage de l’amer Michel…
Quant à Dantzig il remet ça : « Les femmes deviennent amoureuses espérant introduire du romanesque dans leur vie. Ayant constaté que cela a surtout introduit des emmerdements, elles lisent des romans ». Et cela enfin : « L’amour est le seul sujet sur lequel on puisse écrire n’importe quoi, car l’amour est n’importe quoi. C’est une qualité ».
Charles Dantzig est à la fois l’un des gardiens du jardin zoologique et l’interprète de tous les animaux dont l’un de ses préférés est la Fontaine, il me semble. A propos d’Amour, encore, il relève que La Fontaine écrit que « son mari l’aimait d’amour folle ». Ce qui lui fait conclure : « C’est charmant, frais, pimpant, un air de flûte, reste des temps médiévaux qui croyaient aux fées. « Un jeune fol s’éprit d’amour folle… » Et c’est le début d’un conte". -
Désarrois d’un costume trois pièces
A propos de L’Homme interdit
Le sentiment que, sous les apparences d’une vie réglée et « gérée » dans ses moindres détails, certains individus dissimulent une totale incapacité à vivre, se trouve parfaitement illustré dans le premier roman de Catherine Lovey, dont le thème apparemment convenu au premier regard donne lieu à un développement ouvert à de multiples interrogations.
L’idée de confronter un homme d’affaires au-dessus de tout soupçon, véritable parangon du battant supérieur ne vivant que pour son job, à la subite disparition de son épouse, qui lui fait soudain découvrir tout un pan de sa vie auquel le temps lui manquait d’accorder la moindre attention (sa femme justement, ses enfants, tout ça…), pourrait relever du lieu commun d’époque, comme il en prolifère dans les romans actuels. L’inhumanité croissante du monde qu’on appelle néo-libéral, la fuite en avant de ces hommes-creux réduits à leur fonction sociale, déjà typés au début du XXe siècle par Dostoïevski ou Kafka, appelle évidemment la réaction et la critique, mais encore faut-il que celles-ci s’étoffent à proportion de la complexité humaine, étant entendu que le pur pantin social n’existe pas et ne présente aucun intérêt pour le romancier.
pan de sa vie auquel le temps lui manquait d’accorder la moindre attention (sa femme justement, ses enfants, tout ça…), pourrait relever du lieu commun d’époque, comme il en prolifère dans les romans actuels. L’inhumanité croissante du monde qu’on appelle néo-libéral, la fuite en avant de ces hommes-creux réduits à leur fonction sociale, déjà typés au début du XXe siècle par Dostoïevski ou Kafka, appelle évidemment la réaction et la critique, mais encore faut-il que celles-ci s’étoffent à proportion de la complexité humaine, étant entendu que le pur pantin social n’existe pas et ne présente aucun intérêt pour le romancier.
Or dès les premières pages de L’Homme interdit, le sieur Brown, grand flandrin probablement beau mec et entré dans les ordres sociaux en costume trois pièces, qui apprend par la police que sa femme a disparu à l’instant même où il va signer le contrat de sa vie, nous apparaît, à travers sa parole même (le récit reproduisant sa confession à un psy muet, six mois après les événements), comme un individu intéressant par ce que filtre sa voix, que sa solitude croissante (soupçon des flics, rejet de ses collègues, silence absolu du thérapeute) va pousser vers une sorte de lucidité panique, jusqu’aux confins de la folie – toutes chose perçues à fleur d’écriture, saisies et restituées avec une acuité rare.
Qui était sa femme ? Qui sont ses enfants ? Qu’est-ce que cette voisine à chats qui le juge ? Qu’inspecte cet inspecteur dans ses tiroirs et ses fichiers informatiques ? Qu’est-ce que ce monde où les femmes disparaissent et les enfants réclament de la neige ? Et qui diable est-il lui-même, qui parle dans le vide et se rappelle un jour que l’instabilité (cette saleté de flux et de reflux) de la mer l’a toujours déstabilisé ?
Telle sont les questions qu’il ne se posera jamais que par la bande, en « homme interdit » qu’on sent à la fois comme effaré et comme empêché, qui a entrevu un jour, l’espace d’un éclair, que la mort de sa femme pourrait le libérer « quelque part », mais vite il a pensé à autre chose, craignant une fois encore toute instabilité, toute fluidité lui rappelant il ne sait quelle angoisse d’enfance.
Monstre d’égoïsme ou vieil enfant cravaté, fou virtuel du genre à flinguer soudain ses gosses ou assassin de sa propre femme qui aurait gommé tout souvenir de son acte ? La romancière ne conclut pas, laissant le lecteur flotter dans la stupeur fascinée entretenue par le discours maniaquement précis, hyperlucide et souvent frotté d’un étrange humour, d’un homme de plus en plus perdu et finalement proche, humain, émouvant en son vertigineux désarroi.
Catherine Lovey. L’homme interdit. Zoé, 167p.
-
Une curée indigne
Houellebecq et la critique

Lecture de La possibilité d'une île (6)
A La Désirade, ce dimanche 4 septembre. - La méchanceté de la critique établie à l’encontre de La possibilité d’une île est à la fois sidérante et significative, comme s’il s’agissait de se débarrasser vite fait d’un écrivain qu’on craint de lire, les propos méprisants et même haineux trahissant de fait une lecture en surface ou de mauvaise foi. Il y a là une sorte de lynchage qui découle probablement, aussi, du marketing anticipé de ce livre, comme s’il fallait que les vertueux critiques opposent leurs saints principes à ce battage et montrent ainsi leur indépendance. Sous un titre hypocrite (Ni cet excès d’honneur ni cette indignité), car on a soigneusement choisi les termes les plus méprisants de nos confrères européens, Le Temps d'hier passait en revue une dizaine de chroniques où l’on voit bien que le parti pris, le jugement anticipé, la conclusion précédant lecture sont la règle. On parle d’antisémitisme et de misogynie, on taxe le pauvre auteur de « commère » ou de « cynique vulgaire », surtout : on ne dit rien du contenu réel du livre.
Il va de soi qu’on peut discuter les (apparentes) provocations du début du livre, où Daniel 1 l’humoriste « panique » aligne les énormités comme n’oserait le faire un Dieudonné shooté, de même qu’on peut se trouver en désaccord avec maintes observations et autres conclusions du même protagoniste, et notamment avec sa vision déterministe de la vie, mais discuter, ou même disputer, n’est pas vilipender.
C’est d’autant plus choquant qu’il s’agit d’un livre d’immersion lente et d’évolution, dont le personnage, d’abord agité et faraud à l’image de l’époque, devient de plus en plus pénétrant au fur et à mesure qu’il mesure, avec quel désarroi, l’effet du vieillissement sur lui-même.C’est là le grand thème du livre : le vieillissement du corps et, pourrait-on dire, du corps de l’espèce, le sentiment d’un type vieillissant d’être jeté (qu’exprimait déjà si fort un Buzzati dans sa Chasse aux vieux), la fatigue d’être et la tristesse de n’être plus aimé, car c’est aussi un roman d’une lancinante mélancolie sur le manque d’amour, qui ressort le plus fort dans le chapitre magnifique où Daniel 1 constate que la charmante Esther, type de la jeune fille libérée à l’enseigne de la movida espagnole, incarne une sorte de nouvelle espèce hédoniste qui ne désire que son désir et surtout pas l’attache de l’amour.
Je doute, pour ma part, que l’hédonisme d’Esther (lequel ravirait Michel Onfray, que vomit Daniel 1, et moi donc...) soit le fait d’une génération entière, comme le prétend Daniel 1. Il y a du moraliste puritain chez Houellebecq (puritain à l’envers si l’on veut mais puritain quand même) qui répugne aux nuances et aux détails individuels, même si ses personnages sont bien plus travaillés ici et diversifiés que dans Les particules. Mais là encore : le texte évolue. Il est imbécile de prétendre, comme La Stampa, que ce livre postule « le salut par l’entremise d’une secte adoratrice de la science et des extraterrestres », telle affirmation prouvant du moins que le livre n’a pas été lu. C’est ne pas voir la critique malicieuse des tenants et des aboutissants de la secte en question, avec le passage du premier gourou à son fils messianique, et cette superbe description de la petite entreprise du début devenant firme organisée nickel. Ce qu’on retient dans les gazettes, c’est que Michel le barjo a trempé dans un séminaire des raéliens et qu’il en est revenu fondu en mysticisme. C’est prouver une fois de plus qu’on n’a pas lu son livre...
Mais ma foi tant pis pour eux: ils ont manqué quelque chose. Un chef-d’œuvre ? Peut-être pas. Pas encore Les illusions perdues, mais un beau livre drôle et douloureux, surtout : honnête.
J’ai souvent été exaspéré par le vilain canard Houellebecq, qui m’a imposé l’interview la plus pénible jamais réalisée, dont la bande enregistrée est une suite de grommellements vagues et de propos vaseux. Les particules m’avaient pas mal déçu, de même que la forme genre feuilleton de Plateforme, alors que le contenu, le ton, l’immersion psychologique, les observations nouvelles de ce livre, sa vision dans le temps aussi, m’ont réconcilié avec ce drôle de bonhomme.Quant à La possibilité d’une île, c’est indéniablement le livre le plus accompli de Michel Houellebecq et le plus prometteur aussi, car le lascar n'a pas dit son dernier mot : c’est, passées une fois encore les cinquante premières pages un peu trop « couilles de Reiser », de la littérature sérieuse. Pas cuistre ou pédante du tout, mais sérieuse, captivante, amusante et sérieuse.