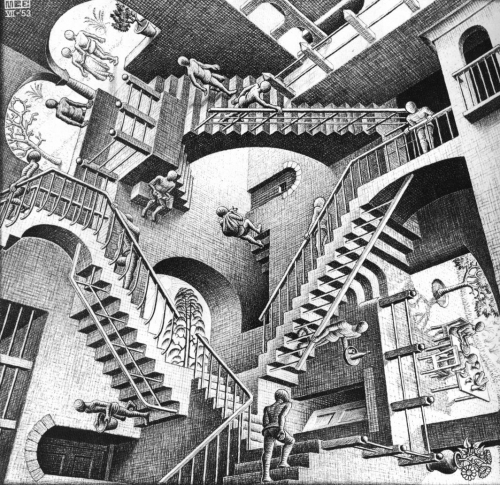
Pas une minute à perdre
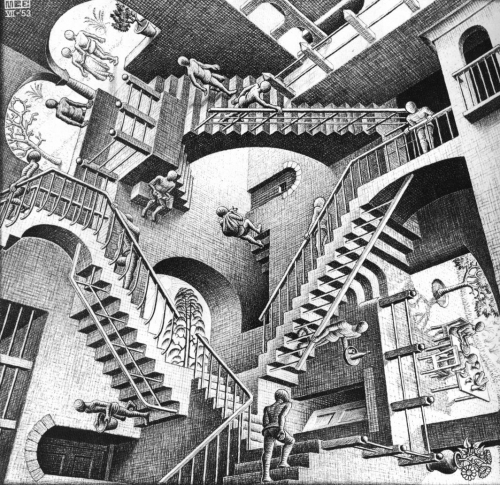
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
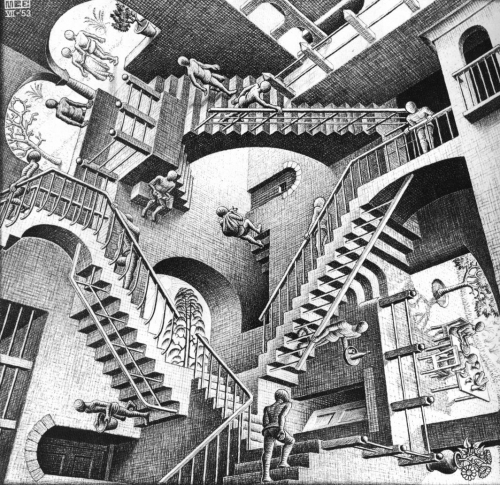
En (re)lisant Guido Ceronetti, prélude à une rencontre.
C’est à une sorte d’ardent travail alchimique que nous convie Guido Ceronetti dans La patience du brûlé, dont les 453 pages tassées m’évoquent ces fichiers « compactés » de l’informatique dont le déploiement peut nous ouvrir magiquement 4530 voire 45300 feuillets en bruissant éventail.
Une bévue éditoriale fait paraître cette première version française sous l’absurde appellation de Roman. Gisement précieux conviendrait mieux. Ou: Réserve d’explosifs Ou bien: huche à pain, ruche à miel, que sais-je encore : strates, palimpseste, graffiti par chemins et bouquins ?
En tout cas Notes de voyage, même si c’est de ça qu’il s’agit, ne rend pas du tout le son et le ton de cette formidable concrétion de minéralogie sensible et spirituelle dans le mille-feuilles de laquelle on surajoute à son tour ses propres annotations.
Pour ma part, ainsi, dès que je m’y suis plongé, j’en ai fait mon livre-mulet du moment. S’y sont accumulés notes et croquis, recettes, régimes, billets doux et tutti quanti. Une aquarelle d’un ami représentant l’herbe du diable, et le détail des propriétés de celle-ci, en orientent la vocation magique, confirmée sur un fax à l’enseigne de la firme Operator par la papatte du compère apprenti sorcier qui me rappelle que «le premier artiste est le chaman qui voit sur la paroi de la grotte l’animal dessiné par la nature et ne fait qu’en marquer le contour de son bout de bois calciné ». Patience du brûlé… De son bâton de pèlerin, Guido Ceronetti fait tour à tour une baguette de sourcier et un aiguillon ou une trique. Ses coups de sonde dans l’épaisseur du Grand Livre universel ne discontinuent de faire jaillir de fins geysers. A tout instant on est partout dans le temps et les lieux, au fil de fulgurantes mises en rapport. Qu’un quidam le prenne pour un «prêtre», genre dandy défroqué, ou peut-être pour un « frère », teigneux et courtois à la fois, lui fait remarquer qu’en effet il «sacrifie à l’aide du mot».
De son bâton de pèlerin, Guido Ceronetti fait tour à tour une baguette de sourcier et un aiguillon ou une trique. Ses coups de sonde dans l’épaisseur du Grand Livre universel ne discontinuent de faire jaillir de fins geysers. A tout instant on est partout dans le temps et les lieux, au fil de fulgurantes mises en rapport. Qu’un quidam le prenne pour un «prêtre», genre dandy défroqué, ou peut-être pour un « frère », teigneux et courtois à la fois, lui fait remarquer qu’en effet il «sacrifie à l’aide du mot».

Et de chamaniser en relevant les vocables ou les formules aux murailles de la Cité dévastée (sa passion pour toute inscription pariétale du genre CATHOLIQUES ET MUSULMANS UNIS DANS LA NUIT ou, de main masculine, ATTENTION ! ILS VEULENT A NOUVEAU NOUS IMPOSER LA CEINTURE DE CHASTETE !, ou encore l’eschatologique LES CLOUS NOIRS REGNERONT) en boutant à l’onomastique le feu du (non)sens ou en soufflant sur les braises de mille foyers épars dans le dépotoir. Bribes alternées des noms de rues et des lieux-dits, des visages et des paysages sans couleurs de l’infinie plaine urbaine, langage grappillés dans les livres de jadis ou de tout à l’heure, des tableaux, des journaux, des gens (le « geste antique » d’un marchand de beignets) ou du bâtiment qui va (« ce petit couvent aussi délicat qu’une main du Greco ») quand tout ne va pas…
Parce que rien ne va plus dans la « mosaïque latrinaire » de ce monde uniformisé dont l’hymne est le Helter Skelter de John Lennon. Venise et Florence ont succombé à la CIVILISATION DES TRIPES et donc à «l’infecte canaille des touristes indigènes transocéaniques».

Place de La Seigneurie, voici les «tambours africains amplifiés par le Japon, hurlement américanoïde de fille guillotinée». Voici ces « jeunes auxquels on a raclé tout germe de vie mentale », autant de « tas d’impureté visible et invisible » qui implorent un coup de « Balai Messianique »…
Il y a du Cingria catastrophiste et non moins puissamment ingénu, non moins follement attentif à la grâce infime de la beauté des premiers plans chez Ceronetti. Le même imprécateur criant raca sur l’arrogance humaine fauteuse de génocides animaux et sur le règne des pollueurs de toute nature, industriels ou chefs de bandes nationalistes devenues « essentiellement d’assassins », ainsi que l’illustrent les derniers feuilletons de la Chaîne Multimondiale (toutes guerres sans chevaux), le même contempteur des aquarelles d’Hitler « irrespirables d’opacité » et qui s’exclame dans la foulée que désormais « presque tout est aquarelle d’Hitler dans le monde nivelé et unifié », le même vidangeur de l’égout humain (« c’est encore homme, ce truc-là ?) est un poète infiniment regardant et délicat qui note par exemple ceci en voyant simplement cela : « Un moineau grand comme un petit escargot près du mur. Vol d’un pigeon. Une cloche »…

Car il aime follement la beauté, notre guide Guido (qui lit Virgile qui guidait Dante que nous lisons), et d’abord ce « geste extrême anti-mort de la Beauté italienne, sourire infini que nous avons oublié et tué », et c’est Giorgione et à saute-frontière c’est Goya, ou dans un autre livre (Le lorgnon mélancolique) c’étaient Grünewald ou la cathédrale de Strasbourg, et les oiseaux mystiques ou quel « regard ami » qui nous purifiera.
Dans l’immédiat, pour se libérer des « infâmes menottes du fini », le voyageur lance à la nettoyeuse des Bureaux Mondiaux : « Au lieu d’épousseter, femme, couvre ces bureaux de merde ». Et déjà le furet du bois joli s’est carapaté en se rappelant le temps où nous étions « croyants du Bois Magique ». Et de noter encore ceci comme une épiphanie : « Petit vase de fleurs fraîches, violettes, resté bien droit, celui d’à côté renversé – des quilles, la vie… »
Guido Ceronetti. La Patience du brûlé. Traduit de l’italien par Diane Ménard. Albin Michel, 1995. A lire aussi : Le silence du corps, prix du Meilleur livre étranger 1984, repris en Poche Folio. Ou encore : Une poignée d’apparences, Le lorgnon mélancolique, Ce n’est pas l’homme qui boit le thé mais le thé qui boit l’homme. Etc.










