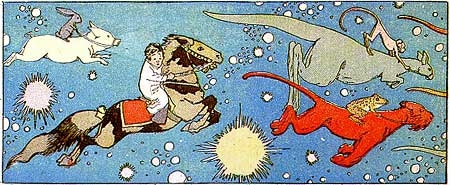Avec François Cheng, à propos de L'Eternité n'est pas de trop
"Sans le vrai deux il n'y a pas de vrai trois"
Il est certaines rencontres durant lesquelles les heures semblent se dilater ou se parer d’une sorte d’aura, et tel est le sentiment profond que j'aurai éprouvé en passant, l’autre jour, un après-midi de plénitude avec François Cheng, assis sur de mauvaises chaises dans une salle froide entourée de gens bruyants, mais comme hors du temps, ou plutôt au coeur du temps, dans sa palpitation mêlée de violence et de douceur, où l’ombre le dispute à la lumière.
De fait, le poids du monde et la légèreté de l’être marquent immédiatement, sans la moindre pose, la conversation de cet homme qu’on sent à la fois délicat à l’extrême et habité par une grande force intérieure, dont l’enfance fut marquée par les horreurs de la guerre et qui connut l’«enfer parisien», selon l’expression de Rilke, du dénuement et de la solitude, avant de faire un beau chemin de lettré et de poète, puis de romancier capable d’exprimer à la fois les nuances les plus subtiles de l’émotion et les pulsions parfois terrifiantes de la brute humaine.
«Ce qui m’occupe essentiellement dans L’éternité n’est pas de trop, c’est la passion. Et ce que je veux dire, c’est que la vraie passion relève de l’esprit. Elle est certes fondée sur les sens et les sentiments. Mais celui qui reste à ce niveau purement biologique tourne en rond et se dessèche. Quand la passion relève de l’esprit, c’est l’ouverture continuelle. Pourquoi ? Parce que la possibilité d’échange entre le masculin et le féminin est le plus grand don qui nous ait été offert par la Création. Tous les autres types de dialogues relèvent d’ailleurs de cette relation, y compris chez les mystiques qui dialoguent avec Dieu, ou chez les artistes qui dialoguent avec la nature. Un cynique pourrait nous dire que le rapport masculin-féminin n’est qu’une nécessité liée à la procréation, mais je crois que c’est faux. Parce que l’homme est devenu un être de langage, qui est un miracle de la création. Le rapport entre masculin et féminin offre alors un dialogue sans fin, fondé sur un désir toujours renouvelé et encore amplifié par l’inaccessibilité. Comme on ne peut jamais atteindre tout à fait l’autre, le dialogue est d’autant plus infini. L’homme et la femme sont deux êtres finis, mais qui s’engagent sans cesse dans la voie de l’infini.»
Sublimités éthérées que ces propos ? Au contraire: ce qui saisit à la lecture de L’éternité n’est pas de trop, c’est son ancrage physique dans le concret et le sensible, d’où rebondissent ses échappées vers les hauteurs. Disciple de Rilke, sur les traces duquel il est allé se recueillir quelque temps, dans un chalet-hôtel en face de Rarogne - Rilke qu’il affirme un «poète de l’être» comme il se définit lui-même -, François Cheng dit qu’il est devenu un «pèlerin de l’Occident».
Lorsque, boursier de dix-neuf ans et ne sachant pas un mot de français, il débarqua à Paris le premier jour de 1949, le jeune Cheng connaissait déjà parfaitement les littératures européennes. C’est cependant après des années de vraie «galère» que le futur traducteur chinois des plus grands poètes français contemporains, allait se faire connaître, dans les années 70, par deux ouvrages portant, respectivement, sur L’Ecriture poétique chinoise (Seuil, 1977) et sur Vide et plein, le langage pictural chinois (Seuil, 1979), précédant divers livres d’art de haute tenue, notamment consacrés à la peinture de Shitao. Or on relèvera, dans la foulée, que c’est bel et bien en «pèlerin de l’Occident» que François Cheng s’est fait passeur d’Extrême-Orient; et par exemple en remontant aux sources de la Renaissance italienne qu’il a redécouvert celles, bien antérieures, de la peinture chinoise.
«C’est en approchant la meilleure part d’une autre culture que vous découvrez votre propre meilleure part. D’où la nécessité de l’échange. Toute culture qui se replie sur elle-même se meurt. Vous connaissez bien vous-mêmes, en Suisse, ce danger. A ce propos, je me rappelle que Romain Rolland, dans Jean-Christophe, imaginait l’avenir de l’Europe des cultures à partir du modèle helvétique. Plus l’autre est riche, plus je m’enrichis moi-même, et plus je suis à même d’enrichir ensuite les autres.»

«Dans ce mouvement d’échange, poursuit François Cheng, je crois que la Chine peut amener quelque chose à l’Occident avec son intuition ternaire. L’Occident a privilégié la logique duelle, ce qui constitue sa grandeur. Cette séparation du sujet et de l’objet fut sa démarche originale. Cela étant, maintenant qu’on a conquis la matière et le monde entier, il est peut-être temps de valoriser la dimension ternaire. La Chine n’a peut-être pas assez privilégié le deux, qui représente le droit, le respect de l’autre, la démocratie et la liberté. Or sans le vrai deux, il n’y a pas de vrai trois. Ce qui est important à l’instant, dans notre conversation, ce n’est pas chacun de nous: c’est ce qui a pu avoir lieu, qui nous dépasse l’un et l’autre pour donner cette nouvelle expression de l’être - une rencontre et une conversation.»
Evoquant l’avenir de son pays, où il n’est revenu que dans les années 8o, après la tragédie sanglante de la Révolution culturelle, François Cheng refuse d’envisager la rencontre de la Chine et de l’Occident en termes de relation «duelle».
«Il faut que chacun dépasse les idées préconçues qu’il a de l’autre. Non, la Chine n’est pas le monde monolithique et fermé, voire agressif, que se figurent certains Occidentaux. Non, l’Occident n’est pas réductible au culte du profit. Certes, la Chine actuelle est gangrenée par la corruption, mais ce n’est pas toute la Chine. Comme à d’autres époques, le meilleur de la Chine a conscience de sa faiblesse et sait que c’est dans le dialogue avec l’Occident qu’elle peut se régénérer et lui apporter, aussi, quelque chose de sa propre richesse millénaire...»
Une passion qui survit au temps
L’époque est à l’obsessionnelle célébration de la jeune chair, dont les dialogues débiles du Loft illustrent, pour le pire, la pauvreté des échanges. Autant dire que le roman d’un amour empêché, qui devient passion sur le tard, et sans union charnelle consommée (quoique la fin reste ouverte), fait figure d’ouvrage à contre-courant.
Or ce qui saisit, à la lecture de L’éternité n’est pas de trop, c’est l’extraordinaire fraîcheur, et la plénitude sensuelle et spirituelle de cette histoire concentrant à la chinoise, à la fin de la dynastie Ming (XVIIe siècle), les deux passions contrariées de Roméo et Juliette et de Tristan et Yseut.
Trente ans après avoir échangé un regard amoureux avec la belle Lan-Ying, fille de riches bourgeois alors qu’il n’est lui-même qu’un pauvre musicien ambulant, Dao-sheng revient dans le bourg où, mariée contre son gré avec un seigneur local, Dame Ying dépérit. Sa qualité de médecin, acquise auprès des moines, permet à l’amoureux persistant d’approcher celle qui lui a été ravie (il a même été battu et a connu le bagne pour son audace), et de la guérir, au déplaisir ardent du seigneur jaloux, lequel mourra de rage mauvaise après avoir tenté d’étrangler sa femme redevenue trop belle à son goût.
Bien plus qu’un roman d’amour «sublimé», L’éternité n’est pas de trop est l’incarnation vivante - où les instances du mal sont aussi présentes que l’aspiration au dépassement -, d’une passion sublime, admirablement modulée, en un présent de l’indicatif qu’on dirait concentrer tous les temps verbaux, par l’écriture limpide et fruitée, énergique et poétique, d’un maître écrivain.
François Cheng. L’éternité n’est pas de trop. Albin Michel, 282p.
 Images: calligraphies et peinture de Fabienne Verdier.
Images: calligraphies et peinture de Fabienne Verdier.