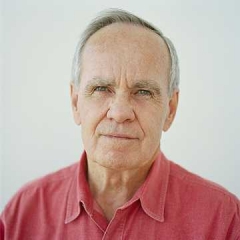
 Après La Route apocalyptique et autres romans d’une noirceur éblouissante, Cormac McCarthy nous entraîne au bout de la nuit du XXe siècle dans la foulée d’un solitaire pleurant l’amour de sa vie aux cheveux d’or...
Après La Route apocalyptique et autres romans d’une noirceur éblouissante, Cormac McCarthy nous entraîne au bout de la nuit du XXe siècle dans la foulée d’un solitaire pleurant l’amour de sa vie aux cheveux d’or...
Y a-t-il une vie après la mort, se demandent les présumés vivants qui traversent le désert encombré de ruines des lendemains de l’hiver nucléaire, dans La Route, mais la question que se pose Alicia est plutôt : y a-t-il une vie avant la mort ? Et le paradoxe est applaudi à grandes nageoires par le Kid Thalidomide faisant les cent pas autour de son lit de schizo géniale, nabot chauve qui l’assomme de ses visites fantasmagoriques, qu’elle repousse aussi fraîchement qu’il l’a tarabuste a n’en plus finir, mais « rien à foutre,bordel de merde », pour le dire comme cet affreux-jojo sorti des coulisses du théâtre de marionnettes du psychisme humanoïde, à devenir fou si cela vous a été caché jusque-là.
Or Alicia tient bon , même après sa mort constituant l’ouverture lyrique hivernale et comme auréolée par la magie de Noël: « Il avait un peu neigé dans la nuit et ses cheveux gelés étaient d’or et de cristal et ses yeux glacier durs comme de la pierre. Une de ses bottes jaunes avait glissé et se dressait dans la neige en dessous d’elle. Son manteau se dessinait saupoudré de neige la où elle l’avait abandonné et elle ne portait plus qu’une robe blanche et elle pendait parmi les arbres de l’hiver, poteaux nus et gris, la tête inclinée et les paumes légèrement ouvertes comme ces statues œcuméniques qui réclament par leur attitude qu’on prenne en compte leur histoire. Qu’on prenne en compte les fondations du monde qui puise son essence dans le chagrin de ses créatures".
De fait, Alicia, même défunte, reste infiniment présente dans le chagrin de son frère Bobby Western, protagoniste de ce premier élément d’un diptyque dont le second, Stella Maris, paraîtra cet automne...
Le mal au corps du monde et à l’âme…
Tous les livres de Cormac McCarthy, et les derniers comme en crescendo « pascalien », sont traversés par les ombres du Mal sous ses diverses formes, qui procède en somme de ce que les théologiens appellent le « péché originel », et que le romancier module à sa façon de puritain à l’américaine, dans la filiation des conteurs géniaux à la Nathanael Hawthorne ou Flannery O’Connor, mais également proche des métaphysiques naturelles du « philosophe dans les bois » Thoreau, de son mentor Waldo Emerson ou de leur émule Annie Dillard.
Par ailleurs, la vision « christique » de l’auteur d’Un enfant de Dieu s’est trouvée enrichie, ces dernières décennies, par une réflexion nourrie des inquiétudes contemporaines et des réponses de la science, ici des mathématiques et de la physique.
Plus précisément, les deux jumeaux protagonistes du Passager, Alicia et Bobby, sont les enfants représentatifs de ce qu’on pourrait dire le mal du siècle puisque leur père, en tant que physicien, a participé au projet Manhattan au côté de Robert Oppenheimer, père de la première bombe atomique.
Tout cela, cependant, n’est pas révélé de façon directe et linéaire, pas plus que le « roman noir » annoncé n’a d’intrigue ni de dénouement satisfaisants. À cet égard, les amateurs du genre seront probablement frustrés, alors que l’auteur « brasse » tout ailleurs.
Le premier épisode dramatique vécu par Bobby, plongeur spécialisé dans la récupération d’épaves englouties, confronté au mystère d’un avion sinistré dont un des passagers et la boîte noire ont disparu, devrait constituer un départ d’enquête, mais non : pas de suite à l’énigme. Et pas d’explication plausible non plus au fait qu’il soit poursuivi, 500 pages durant, par on ne sait trop quels « fédéraux » comme il y en a dans toutes les séries…
Très curieusement, alors, comme s’il rejoignait à sa façon un courant « postmoderne », Cormac McCarthy semble jouer, en partie tout au moins, avec les codes de la culture populaire – bande dessinées ou sous-produits de la télévision – dont le langage avarié fonde la jactance du Thalidomide Kid, multipliant les calembours débiles et les impasses de la communication sereine. Et pourtant, contre toute attente, les dialogues opposant Alicia et son « agent pathogène » sont d’autant plus déroutants qu’ils semblent gratuits sans l’être…
Un chant d’amour, d’amitié et de mélancolie
Le hasard a fait que, venant juste d’achever la lecture du Passager, aux pages d’une rare pureté, je suis tombé, via Netflix, sur le documentaire consacré à la tragédie de Waco, en 1983, marquée par la mort de plus de 80 personnes, dont une vingtaine d’enfants brûlés vifs. Tous « morts pour Dieu », prétendait un rescapé des disciples de David Corey, avatar autoproclamé d’un Christ narcissique et pervers à l’extrême, caricature d’une religiosité dévoyée à grande échelle.
Et c’était retrouver, dans sa trivialité, la réalité de cette Amérique dont Cormac Mc Carthy dit qu’elle n’est « pas pour le vieil homme », alors même que le vieil homme ne détourne pas le regard.
Ainsi sera-t-il question, au fil des multiples récits arborescents du Passager, des atrocités vécues au Vietnam par l’un des compères de Bobby Western - lequel le mitraille littéralement de questions -, ou, dans un bar de La Nouvelle Orléans où se trouve un mafieux de haut vol, des circonstances plus que probables de l’assassinat de JFK, que le même Bobby apprécie en connaisseur des armes, comme il l’est des techniques de plongée et de travail sous-marin, de la conduite des bolides de Formule 2 – il en a été un pilote éprouvé dans une vie antérieure – entre autres activités « manuelles » complétant son savoir en matière de physique quantique et de mathématiques très spéciales…
De la même façon, l’on découvrira, en la sœur adorée de Bobby, non seulement un génie des maths à la précocité monstrueuse, mais également une experte en matière de confection des violons et une sorte de mystique inspirée en ses observations sur « la vie ». Comme se le demanderont les amateurs de stéréotypes psychanalytiques et les moralistes à l’américaine, la question se posera de savoir si Western et sa frangine ont passé « réellement » la ligne rouge de l’interdit de l’inceste, alors que nous apprenons ce qu’il en est de bien pire : qu’ils se sont passionnés pour les mêmes livres, comble de l’amour n’est-ce pas ?
Or Le Passager est, pour l’essentiel, un livre d’amour, sans une scène chaude « explicite », cela va sans dire, pas plus qu’on n’y trouve la moindre violence ou l’ombre d’un de ces serial killers à capuches devenus les figures de polars conventionnels par excellence, jusqu’en Suisse romande dont la classe moyenne se délecte entre deux barbecues.
L’amour et la mort, l’amitié entre frères humains et le sens de ce que nous foutons sur cette putain de terre, comme se le sont demandé Einstein sur son vélo ou Cioran entre deux apéros, et Shakespeare ou Dostoïevski avant eux : voilà de quoi il retourne dans la première moitié de ce roman à la fin déchirante de mélancolie modulée par des pages sublimes de poésie « concrète », dans le paradis - cliché fondamental - d’Ibiza, après laquelle fin le film se rembobinera comme dans les séries « cultes », avec le récit d’Alicia, donc vingt ou trente ans avant, au lieudit Stella Maris, titre précisément du second volume du diptyque combien attendu…
Cormac McCarthy, Le Passager, Traduit de l’anglais (USA) par Serge Chauvin. Editions de l’Olivier, 536p.
-
-
Le spectre du mal
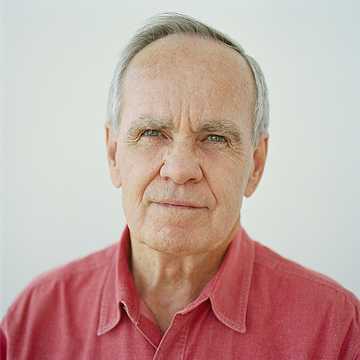
Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, de Cormac McCarthyCormac McCarthy est sans doute l’un des écrivains américains les plus importants de ce tournant de siècle, découvert dans notre langue avec L’obscurité du dehors et, d’une pureté terrifiante qu’on retrouve dans son dernier livre, Un enfant de Dieu, que suivirent six romans non moins marquants, de Suttree à la fameuse Trilogie des confins (De si jolis chevaux, Le Grand passage et Des villes dans la plaine), en passant par cette autre merveille que fut Méridien de sang, tous traduits à l’Olivier.
Il y a chez Cormac McCarthy un mélange de noirceur fataliste et de lancinante tendresse, pour ses personnages, qui évoque à la fois Faulkner (dont il a souvent la puissance d’évocation et le lyrisme sauvage) Nathanaël Hawthorne ou Flannery O’Connor, en plus ancré dans les ténèbres de la violence américaine contemporaine - parent alors, en plus profond dans sa perception du mal, d’un James Ellroy ou d’ un James Lee Burke, notamment.
Un sentiment dominant se dégage aussi bien de Non, ce ne pays n’est pas pour le vieil homme (dont le titre est emprunté à un poème de Yeats), et c’est celui que le mal gagne dans ce monde, et par des moyens qui défient de plus en plus la bonne volonté des honnêtes gens, ici représentée par le shérif Ed Tom Bell, dont la litanie lancinante des réflexions sur la perversité croissante du crime alterne avec le récit des faits abominables auxquels il est mêlé et dont il échappe assez miraculeusement, avant de jeter l’éponge avec le sentiment d'une défaite.
« Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait », remarque Bell au cours de ses méditations, et de fait, la drogue et l’argent de la drogue sont au cœur de ce thriller « théologique », dont le pouvoir d’attraction et de contamination fondent toutes les relations et jusqu’aux péripéties du roman, qu’on dirait précipitées dans une sorte d’entonnoir vertigineux à une seule issue, fatale pour la plupart des protagonistes, à commencer par le jeune Moss. Celui-ci, tenté de s’arracher à sa petite vie de brave garçon au moment où, par hasard, il découvre en pleine nature où il chassait, sur les lieux d’un massacre de trafiquants, une véritable fortune en dollars serrés dans une serviette, va payer de sa vie le geste de s’emparer, sans témoins, de cet argent semblant doté d’une espèce de rayonnement radioactif. De la même façon toutes les instances du crime, dans le roman, semblent liées entre elles par une espèce de lien obscur et de connivence fantomatique qui fait fi de tous les obstacles.
Commis aux basses œuvres de Satan, face au shérif Bell qui ne le rencontrera qu’à travers ses traces sanglantes, le personnage maléfique d’Anton Chigurh agit ainsi en parfait expert du crime, doublant son art démoniaque d’une véritable morale criminelle, si l’on ose dire.
Dans la foulée, on aura remarqué qu’il est dit que Chigurh ressemble à « n’importe qui », comme le protagoniste, fort compétent lui aussi, des Bienveillantes. Cependant, à la différence du roman de Jonathan Littell, celui de Cormac McCarthy module les degrés du mal et du bien par le truchement de toute une gamme de personnages se débattant dans les filets de la nécessité.
Si la violence semble faire partie de la destinée fatale de l’Amérique, comme l’illustre le retour de Bell dans son propre passé, avec l’ombre portée de deux guerres européennes et du Vietnam, d’où chacun est revenu avec son poids de péché, c’est finalement à l’avenir de l’humanité en tant que telle, dans un monde désacralisé et privé de tout référentiel, qu’achoppe ce roman implacable et proche de la désespérance, que pondèrent, en fin de parcours, les lueurs de l’amitié et de la tendresse indestructible scellant le couple formé par Bell et sa compagne Loretta. Marqué par une sorte de tristesse révoltée à la Bernanos, ce roman est à lire et relire pour tout ce qui y est écrit comme entre les lignes. D’une écriture à la fois tranchante et infiniment suggestive, tissé de dialogues denses aux résonances se prolongeant bien après la lecture, Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme est sans doute l’une des grandes choses à lire cette année.
Cormac McCarthy. Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme. Traduit de l’anglais par François Hirsch. Editions de l’Olivier, 292p. En lecture: The Road. Picador, 307p.
En lecture: The Road. Picador, 307p."The first great masterpiece of the globally warmed generation. Here is an American classic which, at a stroke, makes McCarthy a contender for the Nobel Prize for Literature". (Andrew O'Hagan, BBC)
A father and his young son walk alone through burned America, heading slowly for the coast. Nothing moves in the ravaged landscape save the ash on the wind. They have nothing but a pistol to defend themselves against the men who stalk the road, the clothes they are wearing, a car of scavenged food - and each other.
-
Prends garde à la douceur
 (Pensées en chemin, XVII)De l’obstacle initial. – Au commencement l’obscurité régnait en plein jour, cela du moins est sûr même si la frontière séparant le DEDANS du DEHORS restera longtemps imperceptible, enfin longtemps c’est façon de dire, mais regarde bien le mot : LONGTEMPS, et là-dedans combien d’heures de pleurs et de confusion BIENTÔT oubliées tandis que les sons des mots et les mots qui disent des choses apparient patience et transparence…De la prise. – La première sensation du tenir s’efface derrière la première satisfaction du retenir, et plus tard du contenir, et l’enfant très éveillé pourrait se demander ce qu’il en est du serpent ou de l’œuf, savoir : comment le serpent s’y prend pour tenir l’œuf, et ce que l’œuf ressentirait si l’enfant dormait en lui…De la traversée. – Comme inscrits sur un invisible mur, les mots eux-mêmes sont des murs que vous regardez, interdits, ici vous pourriez lire MUR et là MURMURE si vous saviez lire, mais vous en êtes encore à l’ouï-dire et ce n’est que par la voix de la liseuse ou du liseur (on dira plus tard lectrice ou lecteur, ou Mum & Dad dans la langue de Charles Lutwidge Dodgson, dit aussi Lewis Carroll ) que vous voyez bel et bien, sur le mur, le miroir dans l’eau duquel se perçoit le murmure d’Alice aux merveilles, et venue d’on ne sait où, mais pas tout à fait malgré vous, l’histoire vous fait passer le mur des mots…Peinture: Miro.
(Pensées en chemin, XVII)De l’obstacle initial. – Au commencement l’obscurité régnait en plein jour, cela du moins est sûr même si la frontière séparant le DEDANS du DEHORS restera longtemps imperceptible, enfin longtemps c’est façon de dire, mais regarde bien le mot : LONGTEMPS, et là-dedans combien d’heures de pleurs et de confusion BIENTÔT oubliées tandis que les sons des mots et les mots qui disent des choses apparient patience et transparence…De la prise. – La première sensation du tenir s’efface derrière la première satisfaction du retenir, et plus tard du contenir, et l’enfant très éveillé pourrait se demander ce qu’il en est du serpent ou de l’œuf, savoir : comment le serpent s’y prend pour tenir l’œuf, et ce que l’œuf ressentirait si l’enfant dormait en lui…De la traversée. – Comme inscrits sur un invisible mur, les mots eux-mêmes sont des murs que vous regardez, interdits, ici vous pourriez lire MUR et là MURMURE si vous saviez lire, mais vous en êtes encore à l’ouï-dire et ce n’est que par la voix de la liseuse ou du liseur (on dira plus tard lectrice ou lecteur, ou Mum & Dad dans la langue de Charles Lutwidge Dodgson, dit aussi Lewis Carroll ) que vous voyez bel et bien, sur le mur, le miroir dans l’eau duquel se perçoit le murmure d’Alice aux merveilles, et venue d’on ne sait où, mais pas tout à fait malgré vous, l’histoire vous fait passer le mur des mots…Peinture: Miro. -
Les coeurs flagadas
 Le cœur à la fin se fatigue,ne bat plus que d’un aile:un vieux ridé comme une figueau tabac d’à côté,une guitare qu’on abandonne,le regret d’un baiser perdu,ou le geste amorcéd’une maldonne survenue...Tu lui parlais de beaux lointains,et vous aurez rêvé:vous serez partis le matinvers les mondes ensoleillésde vos claires années;des mots inhabités de chairvous avez séparéles ombres et la lumière,et les enfants là-basdans l’insouciance radieuse,faisant les innocents,jouaient comme jouent les enfants...Les enfants l’aident à traverser:la vieille reste làUn peu lasse de n’avoir plusassez de force en ellepour se relever en rebellecontre tout ce qui clochedans le monde parfois si moche...Puis je m’en fiche, se dit-elle:je danse encore un peu,je lui souris même au-delàde notre doux trépas -et l’étoile là-haut clignotecomme un vieux qui radote...Dessin: Albrecht Dürer
Le cœur à la fin se fatigue,ne bat plus que d’un aile:un vieux ridé comme une figueau tabac d’à côté,une guitare qu’on abandonne,le regret d’un baiser perdu,ou le geste amorcéd’une maldonne survenue...Tu lui parlais de beaux lointains,et vous aurez rêvé:vous serez partis le matinvers les mondes ensoleillésde vos claires années;des mots inhabités de chairvous avez séparéles ombres et la lumière,et les enfants là-basdans l’insouciance radieuse,faisant les innocents,jouaient comme jouent les enfants...Les enfants l’aident à traverser:la vieille reste làUn peu lasse de n’avoir plusassez de force en ellepour se relever en rebellecontre tout ce qui clochedans le monde parfois si moche...Puis je m’en fiche, se dit-elle:je danse encore un peu,je lui souris même au-delàde notre doux trépas -et l’étoile là-haut clignotecomme un vieux qui radote...Dessin: Albrecht Dürer -
Ceux qui imposent leur narratif
 Celui qui dicte son récit à sa femme de ménage sibérienne / Celle qui infuse le discours quotidien du ministre de transition / Ceux qui ont rallié le récit national après les concessions du parti vert / Celui qui parle pour les gens d’en bas et même de tout en bas si ça se trouve / Celle qui en tant que juriste du parti affirme que le dire exprime le sentir des camarades qui n’osent même y penser / Ceux qui voient ce qu’il il y a d’historique dans ce qu’ils sont en train de vivre et que verbalise la journaliste hystérique / Celui qui prétend écrire l’histoire avec son sang après s’être égratigné dans la manif retransmise à la télé / Celle qui décrit son trauma générationnel au vieux psy en jeans troués / Ceux qui racontent la grande déprime des militants à leurs kids nés pendant ou juste après / Celui qui déconstruit le narratif du politologue en pointant son non-dit pulsionnel de représentant patent des mâles dominants blancs / Celle qui a souffert du patriarcat comme tu peux pas l’imaginer mon pauvre Jean-René / Ceux qui sans transition ont passé de l’état de mecs branchés à celui de fiotes larguées, etc.
Celui qui dicte son récit à sa femme de ménage sibérienne / Celle qui infuse le discours quotidien du ministre de transition / Ceux qui ont rallié le récit national après les concessions du parti vert / Celui qui parle pour les gens d’en bas et même de tout en bas si ça se trouve / Celle qui en tant que juriste du parti affirme que le dire exprime le sentir des camarades qui n’osent même y penser / Ceux qui voient ce qu’il il y a d’historique dans ce qu’ils sont en train de vivre et que verbalise la journaliste hystérique / Celui qui prétend écrire l’histoire avec son sang après s’être égratigné dans la manif retransmise à la télé / Celle qui décrit son trauma générationnel au vieux psy en jeans troués / Ceux qui racontent la grande déprime des militants à leurs kids nés pendant ou juste après / Celui qui déconstruit le narratif du politologue en pointant son non-dit pulsionnel de représentant patent des mâles dominants blancs / Celle qui a souffert du patriarcat comme tu peux pas l’imaginer mon pauvre Jean-René / Ceux qui sans transition ont passé de l’état de mecs branchés à celui de fiotes larguées, etc. -
La Leçon interrompue

 Nouvelles de Hermann HesseAprès la publication, en traduction française, d’ Enfance d’un magicien, du Dernier été de Klingsor et de Berthold, notamment, voici paraître un nouveau recueil de nouvelles de Herman Hesse qui, toutes, ont pour arrière-fond l’enfance ou les années d’apprentissage de l’auteur, dans un climat mêlé d’effusions radieuses et de mélancolie.De l’un à l’autre des cinq récits très judicieusement rassemblés ici et traduits par Edmond Beaujon sous le titre de celui qui clôt le volume, l’on se balade, de fait, dans le même univers de sensations et de rêveries, dont on dirait qu’elles émanent des paysages d’Allemagne méridionale chantés par les romantiques, de Tübingen à Calw, et jusqu’au lac de Constance.Loin de constituer pourtant des souvenirs d’enfance ou de jeunesse, au sens conventionnel, ces récits nous proposent, sous des angles fort différents – deux d’entre eux datant des débuts de l’écrivain, tandis que les trois autres sont du septuagénaire –, une méditation marquée au sceau du temps sur les événement apparemment insignifiants qui ont contribué à façonner la personnalité de l’auteur.On sent à l’évidence, dans les trois nouvelles extraites des Proses tardives (composées en 1948 et 1949), des préoccupations faisant écho à la crise de conscience de l’époque dont Hesse fut un témoin solitaire et non-conformiste, mais le fond de la perception du monde et des êtres n’en apparaît pas moins d’un seul tenant dans l’ensemble de l’ouvrage, et notons alors la remarquable maturité intérieure du jeune écrivain qui composa, entre 19 et 26 ans, les deux parties de Mon enfance.Déjà alors, Hermann Hesse a de son enfance une image ou le symbole prime sur l’anecdote. Interrogeant ses souvenirs les plus reculés, à la façon d’un Andrei Biély, dans Kotik Letaev, et ce jusqu’en deça de de la troisième année, il cherche à cristalliser la figure de contemplation de cet âge d’or.L’enfant essentielCela étant, l’écrivain se garde bien d’idéaliser une enfance ou le mal à sa part, sa nostalgie l’y portant non parce qu’il y situe le lieu de la parfaite innocence, mais parce que chaque chose y a encore sa fraîcheur et sa densité, sa part de gravité et de mystère. L’enfant que sa mère berce de conte merveilleux, et dont le père dirige la curiosité avec la plus grande bienveillance, pose en toute ingénuité les premières grandes questions de la vie : d’où viennent la pluie et la neige, pourquoi sommes-nous riches alors que notre voisin ferblantier est pauvre, et quand on meurt est-ce pour toujours ?Autant d’interrogations qui associent, sous le même signe de l’Absolu, l’enfant et le sage. Et l’écrivain de relever alors que « l’existence de bien des personnes gagnerait en sérieux, en probité, en déférence, si elles conservaient en elles, au-delà de leur jeunesse, quelque chose de cet esprit de recherche et de ce besoin de questionner et de définir ».Rien de mièvre dans cette remémoration des expériences enfantines de l’auteur : qu’il s’agisse du premier affrontement sérieux opposant le garçon aux siens, du souvenir de la mort précoce d’un de ses camarades de jeux, de certaine mission le délivrant momentanément de sa prison scolaire (dans La Leçon interrompue) pour le confronter aussitôt après à la fatalité qui s’acharne sur certains destins, ou d’une scène lui révélant (dans Le mendiant) la probité digne et charitable à la fois de son père, Hermann Hesse se garde, dans ces rêveries méditatives, et du prône moralisateur et du seul charme incantatoire de la narration.Une réelle magie se dégage pourtant de la plus accomplie de ces nouvelles, intitulée Histoire de mon Novalis. Dans une tonalité qui l’apparie aux romantiques allemands, ses frères en inspiration, le jeune Hesse (qui avait alors 23 ans) se plaît, par la voix d’un aimable bibliophile, à retracer, de mains en mains, l’itinéraire d’une « quatrième augmentée » datant de 1837, des œuvres de Novalis, imprimée à Stuttgart sur papier Java. L’on fait alors connaissance, à Tübingen, de de braves étudiants jurant « par le Styx » et rêvant à de blondes et pures fiancées, de studieux précepteurs et de compères chantant leur joyeux refrain sous les tonnelles –tout cela fleurant bon les nuits claires et mélancoliques.La perte de l’innocenceTrois des récits insérés dans La leçon interrompue datent d’après la Deuxième Guerre mondiale. Il réductible non-converti, le vieux sage, auquel fut décerné le prix Nobel 1946, parle non sans amertume de l’impossibilité de raconter des histoires en toute innocence, comme cela se pouvait encore au siècle passé. L’ambiguïté et le doute frappant désormais toute chose, la narration ne peut plus, décemment, ne pas tenir compte des bouleversements de l’époque.« Ce n’est que très lentement, note l’écrivain, et malgré moi que j’en arrivais, avec les années, à constater que mon mode d’existence et ma conception du récit ne correspondait plus l’un à l’autre ; que, par amour de la narration bien faite, j’avais plus ou moins déformé la plupart des événements et des expériences de ma vie, et que je devais ou bien renoncer à écrire des histoires ou bien me résoudre à devenir un mauvais narrateur. Mes tentatives en ce sens, à partir de Damien, jusqu’au Voyage en Orient, me conduisirent toujours plus loin hors des voies de la bonne et belle tradition narrative »Dans La leçon interrompue, le lecteur sentira tout particulièrement ce passage d’un monde à l’autre, d’une conception de l’homme à l’autre, en dépit de la fidélité à soi-même d’une des grandes consciences de ce temps.Hermann Hesse, La Leçon interrompue. Nouvelles traduites de l’allemand par Edmond Beaujon. Éditions Calmann-Lévy, 1978
Nouvelles de Hermann HesseAprès la publication, en traduction française, d’ Enfance d’un magicien, du Dernier été de Klingsor et de Berthold, notamment, voici paraître un nouveau recueil de nouvelles de Herman Hesse qui, toutes, ont pour arrière-fond l’enfance ou les années d’apprentissage de l’auteur, dans un climat mêlé d’effusions radieuses et de mélancolie.De l’un à l’autre des cinq récits très judicieusement rassemblés ici et traduits par Edmond Beaujon sous le titre de celui qui clôt le volume, l’on se balade, de fait, dans le même univers de sensations et de rêveries, dont on dirait qu’elles émanent des paysages d’Allemagne méridionale chantés par les romantiques, de Tübingen à Calw, et jusqu’au lac de Constance.Loin de constituer pourtant des souvenirs d’enfance ou de jeunesse, au sens conventionnel, ces récits nous proposent, sous des angles fort différents – deux d’entre eux datant des débuts de l’écrivain, tandis que les trois autres sont du septuagénaire –, une méditation marquée au sceau du temps sur les événement apparemment insignifiants qui ont contribué à façonner la personnalité de l’auteur.On sent à l’évidence, dans les trois nouvelles extraites des Proses tardives (composées en 1948 et 1949), des préoccupations faisant écho à la crise de conscience de l’époque dont Hesse fut un témoin solitaire et non-conformiste, mais le fond de la perception du monde et des êtres n’en apparaît pas moins d’un seul tenant dans l’ensemble de l’ouvrage, et notons alors la remarquable maturité intérieure du jeune écrivain qui composa, entre 19 et 26 ans, les deux parties de Mon enfance.Déjà alors, Hermann Hesse a de son enfance une image ou le symbole prime sur l’anecdote. Interrogeant ses souvenirs les plus reculés, à la façon d’un Andrei Biély, dans Kotik Letaev, et ce jusqu’en deça de de la troisième année, il cherche à cristalliser la figure de contemplation de cet âge d’or.L’enfant essentielCela étant, l’écrivain se garde bien d’idéaliser une enfance ou le mal à sa part, sa nostalgie l’y portant non parce qu’il y situe le lieu de la parfaite innocence, mais parce que chaque chose y a encore sa fraîcheur et sa densité, sa part de gravité et de mystère. L’enfant que sa mère berce de conte merveilleux, et dont le père dirige la curiosité avec la plus grande bienveillance, pose en toute ingénuité les premières grandes questions de la vie : d’où viennent la pluie et la neige, pourquoi sommes-nous riches alors que notre voisin ferblantier est pauvre, et quand on meurt est-ce pour toujours ?Autant d’interrogations qui associent, sous le même signe de l’Absolu, l’enfant et le sage. Et l’écrivain de relever alors que « l’existence de bien des personnes gagnerait en sérieux, en probité, en déférence, si elles conservaient en elles, au-delà de leur jeunesse, quelque chose de cet esprit de recherche et de ce besoin de questionner et de définir ».Rien de mièvre dans cette remémoration des expériences enfantines de l’auteur : qu’il s’agisse du premier affrontement sérieux opposant le garçon aux siens, du souvenir de la mort précoce d’un de ses camarades de jeux, de certaine mission le délivrant momentanément de sa prison scolaire (dans La Leçon interrompue) pour le confronter aussitôt après à la fatalité qui s’acharne sur certains destins, ou d’une scène lui révélant (dans Le mendiant) la probité digne et charitable à la fois de son père, Hermann Hesse se garde, dans ces rêveries méditatives, et du prône moralisateur et du seul charme incantatoire de la narration.Une réelle magie se dégage pourtant de la plus accomplie de ces nouvelles, intitulée Histoire de mon Novalis. Dans une tonalité qui l’apparie aux romantiques allemands, ses frères en inspiration, le jeune Hesse (qui avait alors 23 ans) se plaît, par la voix d’un aimable bibliophile, à retracer, de mains en mains, l’itinéraire d’une « quatrième augmentée » datant de 1837, des œuvres de Novalis, imprimée à Stuttgart sur papier Java. L’on fait alors connaissance, à Tübingen, de de braves étudiants jurant « par le Styx » et rêvant à de blondes et pures fiancées, de studieux précepteurs et de compères chantant leur joyeux refrain sous les tonnelles –tout cela fleurant bon les nuits claires et mélancoliques.La perte de l’innocenceTrois des récits insérés dans La leçon interrompue datent d’après la Deuxième Guerre mondiale. Il réductible non-converti, le vieux sage, auquel fut décerné le prix Nobel 1946, parle non sans amertume de l’impossibilité de raconter des histoires en toute innocence, comme cela se pouvait encore au siècle passé. L’ambiguïté et le doute frappant désormais toute chose, la narration ne peut plus, décemment, ne pas tenir compte des bouleversements de l’époque.« Ce n’est que très lentement, note l’écrivain, et malgré moi que j’en arrivais, avec les années, à constater que mon mode d’existence et ma conception du récit ne correspondait plus l’un à l’autre ; que, par amour de la narration bien faite, j’avais plus ou moins déformé la plupart des événements et des expériences de ma vie, et que je devais ou bien renoncer à écrire des histoires ou bien me résoudre à devenir un mauvais narrateur. Mes tentatives en ce sens, à partir de Damien, jusqu’au Voyage en Orient, me conduisirent toujours plus loin hors des voies de la bonne et belle tradition narrative »Dans La leçon interrompue, le lecteur sentira tout particulièrement ce passage d’un monde à l’autre, d’une conception de l’homme à l’autre, en dépit de la fidélité à soi-même d’une des grandes consciences de ce temps.Hermann Hesse, La Leçon interrompue. Nouvelles traduites de l’allemand par Edmond Beaujon. Éditions Calmann-Lévy, 1978 -
Les porteurs de feu

Lecture intégrale de La Route de Cormac McCarthy- Il y a un homme et un enfant.
- Dans la forêt.
- Noir sur fond gris.
- Comme sous un glaucome glacé.
- L’homme émerge d’un rêve.
- Il y a vu une créature aux yeux morts, une créature transparente au cerveau visible sous une cloche de verre mat.
- A la première lueur grise il se lève.
- « Nu, silencieux, impie ».
- Avec l’enfant ils vont vers le sud.
- Impossible de survivre en ces lieux un autre hiver.
- Avec ses jumelles il scrute les alentours lourds de menace.
- L’enfant est son garant.
- « S’il n’est pas la parole de Dieu, Dieu n’a jamais parlé ».
- Ils ont un caddie.
- Comme des personnages de Beckett, mais dégageant une autre sorte d’aura.
- Tout est menace, à commencer par la moindre présence humaine.
- L’homme protège l’enfant. Il a un revolver.
- Chacun est tout l’univers de l’autre.
- Arrivent à une station-service désaffectée.
- Récolte de l’huile, pour leur lampe.
- Continuent dans le paysage carbonisé.
- L’homme croit voir une ville au lointain.
- Le petit ne voit rien.
- Il pleut. Fait très froid.
- Autre trésor : le livre de l’enfant.
- Le petit demande s’ils vont mourir.
- L’homme répond : plus tard.
- Le petit veut savoir ce que l’homme ferait s’il mourait.
- L'homme se dit : « Si seulement mon cœur était de pierre ».
- Quand il se réveille il s’éloigne et demande à Dieu s’il a un cou pour qu’il puisse l’étrangler.
- As-tu une âme, lui demande-t-il en le maudissant.
- Le lendemain ils traversent la ville.
- En grande partie incendiée.
- Ils voient un cadavre.
- L’homme évoque la mémoire : ce qu’il faudra se rappeler et ce qu’il faudra oublier.
- « On oublie ce qu’on a besoin de se rappeler et on se souvient de ce qu’il faut oublier ».
- Puis l’homme se rappelle une journée au bord d0un lac, près de la ferme de son oncle.
- « C’était la journée parfaite de son enfance ».
- Les jours et les semaines qui suivent, ils marchent vers le sud.
- Tout le pays a été brûlé.
- Une nuit l’homme est réveillé par un lointain tonnerre.
- Un seul flocon tombe à un moment donné, « comme la dernière hostie de la chrétienté ».
- Ils s’abritent dans un garage abandonné.
- L’homme y répare le caddie.
- Non loin de là se trouve une grange.
- Dans laquelle ils découvrent trois pendus.
- Le problème des chaussures l’inquiète.
- Et de la nourriture.
- Dans un fumoir, ils trouvent un vieux jambon.
- Croit entendre des bruits de tam-tam.
- En rêve il voit sa pâle fiancée.
- Il se défie des rêves euphoriques.
- Mais il se souvient d’elle, sauf de son odeur.
- « Maintenant insulte ton froid et les ténèbres et sois maudit ».
- Il se sert du caddie à la descente comme d’un bob.
- Cela fait rire l’enfant.
- Du haut d’une côte ils découvrent un lac. Il explique au petit ce qu’est un barrage.
- Il n’y a rien dans le lac : nulle vie.
- Il se rappelle, tout près de là, le piqué d’un faucon fondant sur une volée de grues sauvages.
- Souvenir de la nature vivante.
- A présent l’air est granuleux et grumeleux.
- « Le goût qu’il avait ne vous sortait jamais de la bouche ».
- Puis le temps se lève et le froid faiblit.
- Ils arrivent dans une zone agricole aux bâtiments encore debout.
- Une pancarte invite : visitez Rock City.
- Dans une maison déserte, il récupère des couvertures.
- Il renonce à emporter des conserves, peut-être contaminées.
- Ils arrivent dans les faubourgs d’une ville. Visitent un supermarché.
- Miracle : il trouve un Coca-Cola dans un distributeur défoncé.
- L’homme fait tout boire au petit.
- Qui comprend que ce sera la dernière fois qu’il boit une chose si bonne.
- Arrivent ensuite en ville.
- Où ils croisent des tas de morts momifiés.
- Dont toutes les chaussures ont été volées depuis longtemps.
- On comprend que des années se sont passées depuis le cataclysme.
- Le lendemain, au sud de la ville, ils arrivent à la maison d’enfance de l’homme.
- Qui retrouve quelques souvenirs.
- Le petit est effrayé et voudrait fuir de là.
- Passe de la troisième à la première personne devant sa chambre : « C’est ici que je dormais autrefois ».
- Là qu’il a eu des rêves d’enfant.
- Parfois des cauchemars terribles.
- Mais jamais aussi terribles que celui qui est advenu.
- Trois nuits plus tard la terre semble trembler pendant la nuit.
- Il leur reste une chaîne de montagne a passer pour atteindre la côte.
- Ils doivent passer un col qu’il a passé jadis avec son propre père.
- La montée est extrêmement pénible.
- Le petit surveille tout ce que fait et dit son père.
- Lui rappelant la moindre inconséquence.
- Comme s’il était sa conscience.
- Sur l’autre versant il y a des chutes d’arbres.
- La nuit le petit fait un cauchemar. Où il est question de la rupture du ressort de son pingouin.
- Puis ils arrivent à un torrent et une cascade.
- Ouah, fait le petit.
- Ils se baignent. Puis ils trouvent des morilles. Byzance.
- « C’est un bon endroit, papa ».
- Le père raconte alors d’anciennes histoires « de courage et de justice ».
- Mais on ne peut rester là. Danger partout.
- Ils reprennent la carte en lambeaux.
- Doivent suivre les routes d’Etat, ou ce qu’il en reste.
- Découvrent l’épave d’un semi-remorque.
- Dans la remorque duquel s’empilent des corps humains.
- Poursuivent vers le sud.
- Avisent un type traînant le long de la route. Un grand brûlé. Visiblement foudroyé.
- Le petit aimerait l’aider, mais le père affirme qu’on ne le peut.
- Ce qui bouleverse le petit.
- Avant de l’admettre.
- L’homme revoit des « dieux en loques ».
- La pendule, cette nuit-là, s’est arrêtée à 1h.17.
- « Elle » était encore vivante.
- Il y avait eu une lueur rose mat dans la vitre de la fenêtre.
- Se rappelle le dernier échange de paroles avec elle.
- Qui lui ordonnait d’en finir. Avec le revolver. Lui et l’enfant après elle.
- Elle parle d’eux comme de « morts vivants » et non de survivants.
- Elle finit par le chasser avec le petit et disparaît.
- Nulle psychologie là-dedans. Rien qu’une situation extrême. Le désespoir absolu et l’instinct de survie.
- Mais rien d’abstrait non plus : c’est ainsi, ce fut ainsi. Biblique.
- Il avait des amis.
- Tous morts.
- Une nuit ils sont réveillés par un convoi.
- Des survivants : forcément ennemis.
- Des types avec des flingues.
- Un homme s’en éloigne dans leur direction.
- Devant les signes de menace de l’autre, l’homme le descend.
- Et fuit avec le petit.
- Ne reste plus qu’une cartouche dans le revolver.
- Reviennent ensuite sur les lieux pour récupérer le caddie.
- Entretemps le mort a été dépecé par les autres.
- L’homme lave le petit des éclats de cervelle du mort qui ont souillé son visage.
- On réinvente le sacré : « Ainsi soit-il. Evoque les formes. Quand tu n’as rien d’autre, construis des cérémonies à partir de rien et anime-les de ton souffle ».
- Le petit est son « calice d’or, bon pour abriter un dieu ».
- Comme des paillettes de lumière dans les ténèbres méphitiques.
- Il pense qu’il a tué.
- Il a tué le seul homme auquel il ait parlé depuis un an.
- Il explique au petit qu’il doit tuer les méchants.
- Taille une petite flûte en jonc pour le petit.
- Qui en joue.
- « Une musique informe pour les temps à venir » (p. 71).
- « Ou peut-être l’ultime musique terrestre tirée des cendres des ruines ».
- Reprennent la route, à bout de ressources.
- Un chien aboie soudain.
- Le petit fait promettre à l’homme de ne pas le tuer. L’homme promet.
- Puis le petit croit voir un autre petit.
- Puis tout disparaît.
- Plus loin ils parcourent un verger. Traversé d’un mur tapissé de têtes humaines. Relents de cultes barbares.
- Et passent les méchants. Avec des femmes esclaves. Et des mignons. Visions de l’hiver nucléaire. Beauté vitrifiée de tout ça.
- Et les arbres tombent avec fracas (p.87)
- Le lendemain le petit n’en peut plus au milieu des cèdres abattus.
- Le père lui promet qu’ils ne vont pas mourir.
- D’accord, dit le petit.
- OK. Le dialogue se module comme dans la tête du lecteur.
- Un dialogue « intérieur » ou « mental » comme tous les livres de Mc Carthy.
- L’homme se fait des listes.
- Voient courir deux espèces de joggers, de loin.
- Arrivent à une petite ville.
- Devant une très belle maison dévastée.
- Y entrent malgré la peur du petit.
- L’homme avise une trappe cadenassée.
- Va chercher un outil.
- Dans la cave, découvrent des prisonniers nus, hommes et femmes, qui les supplient de les délivrer.
- Des méchants se pointent là-bas.
- L’homme et le petit fuient comme des dératés.
- Le père demande au petit s’il saura se servir du revolver contre lui-même.
- Puis se demande s’il aura la force d’écraser la tête du petit.
- Se dit qu’il ne l’abandonnera jamais.
- La nuit ils entendent des hurlements en direction de la maison.
- Le petit comprend que les prisonniers seront mangés par les méchants.
- Pendant le sommeil du petit, l’homme se dirige vers une ferme flanquée d’un verger.
- Où il trouve des pommes, des tas de pommes. Et de l’eau.
- Boit alors l’eau : « Rien dans son souvenir nulle part de n’importe quoi d’aussi bon ».
- Ils se gavent ensuite de pommes et d’eau.
- Le petit fait promettre à son père qu’ils ne mangeront personne.
- Et le père promet.
- Parce qu’ils sont du club des gentils.
- Des porteurs de feu.
- Plus loin ils approchent d’une autre maison.
- Dans la cour de laquelle le père trouve quelque chose.
- Une trappe là encore.
- Le petit supplie de passer outre.
- Mais l’intuition du père le retient.
- Et c’est Byzance : un abri plein de tout.
- Des poires des conserves du whisky, etc. Mais pas de revolver ni de muniotions.
- « Il s’était préparé à mourir et à présent il n’allait pas mourir et il fallait qu’il y pense ».
- Puis ils vont visiter la ville fantôme.
- L’homme n’arrive pas à y croire.
- Puis ils repartent avec des vêtements secs et leur caddie bien rempli.
- Ils doivent être à 300 km de la côte.
- Le petit avoue qu’il a jeté la flûte.
- A un moment où il croyait qu’ils mourraient.
- Demande pardon.
- Le petit questionne l’homme sur « les objectifs à long terme ».
- Une expression qu’il a dû entendre autrefois…
- Et voici qu’ils croisent un vagabond.
- Très petit et très vieux.
- Le petit aimerait qu’on l’aide.
- Le père accepte avec regret.
- Lui donnent à manger.
- Mais le père exclut de le prendre avec eux.
- Lui demandent ce que le monde est devenu (p. 144).
- Un aveugle genre prophète nommé Elie. Désespéré fataliste.
- « Il n’y a pas de Dieu et nous sommes ses prophètes ».
- Il pensait ne plus jamais voir d’enfant.
- Ils le quittent.
- Plus loin, pendant que l’homme dort, le petit découvre un train à 8 wagons.
- Ils voient ce train chacun à leur façons mais savent tous deux que jamais plus il ne roulera.
- L’enfant lui demande si la mer est bleue.
- Il lui répond qu’elle l’était.
- Le petit fait un cauchemar.
- Souvenir du drugstore avec la tête réduite.
- Plus loin sur la route trois types les menacent.
- Il les tient en joue.
- Constate qu’il est malade.
- Se rappelle les gens de sa famille.
- Puis lui revient le souvenir d’une bibliothèque calcinée.
- Fragments de cauchemars : le nœud de cent serpents.
- Le père dit au petit qu’il ne doit pas renoncer. Qu’il ne le permettra pas.
- Ils continuent. Des tempêtes de feu ont passé par là.
- Visions dantesques (p. 165).
- Plus loin des gens apparaissent.
- Dont une femme enceinte.
- Plus tard ils repèrent un feu.
- S’en approchent.
- Le petit découvre un nourrisson carbonisé sur une broche.
- Approchent d’une nouvelle maison.
- Le petit craint les cannibales.
- Mais il n’y a personne dans la maison.
- Trouvent des bocaux peut-être comestibles.
- Le père évoquant ceux qui sont à l’affût. (p.181)
- Passent quatre jours dans la maison.
- Pleut sans discontinuer.
- Ils approchent de la côte.
- Mais le père sait qu’il place son espoir « là où il n’avait aucune raison de rien espérer ».
- Et voici qu’ils y arrivent, à la mer. Terrible vision (p.186).
- Le père demande pardon au petit.
- Tant pis, répond celui-ci.
- Une image rappelant l’hiver de Caspar David Friedrich.
- Leur raison d’être, au père et au fils, est de « porter le feu ».
- Rien pour autant de barjo à la Paulo Coelho dans cette vocation.
- Le petit demande ce qu’il y a de l’autre côté de la mer.
- Rien non plus de Saint-Ex là-dedans.
- Le petit aimerait se baigner.
- Le père l’y autorise.
- Il y va. Puis il pleure. (p.188).
- L’homme se rappelle le bonheur avec « elle », quand il se disait que s’il avait été Dieu c’était comme ça qu’il aurait fait le monde et pas autrement.
- Au bord de la mer comme des « batteurs de grèves ».
- Un langage précis, parfois étrangement décalé, voire anachronique, poétique à tout coup, d’une musique sourde dans l’original qui ne passe pas entièrement au français.
- Pas mal quand même dans l’évocation : « Ils firent quelques pas le long du croissant de lune de la plage, restant sur le sable mouillé au-dessous de al ligne de varech des marées. Des flotteurs de verre recouverts d’une croûte grise. Les os d’oiseaux de mer. Sur la ligne de laisse un matelas d’herbes marines enchevêtrées et le long du rivage aussi loin que portait le regard les squelettes de poissons par millions comme une isocline de mort. Un seul vaste sépulcre de sel. Insensé. Insensé. »
- Ils observent un bateau échoué.
- Le père y monte et y trouve de tout.
- Le petit l’interroge sur les gens du bateau.
- Ensuite c’est le petit qui tombe de fièvre.
- Pendant qu’ils étaient éloignés du caddie, on leur a tout fauché.
- Soudain l’homme est atteint par une flèche.
- Il tire une fusée éclairante contre le tireur.
- Pense que la vie a été cruelle, mais qu’ils s’en sont toujours tirés et que telle est leur vocation.
- L’homme est blessé et de plus en plus malade.
- Le petit le regarde cracher du sang.
- « Peut-être que dans la destruction du monde il serait enfin possible de voir comment il était fait ».
- Il y a de plus en plus de débris partout.
- Il voit déjà le petit « debout avec sa valise comme un orphelin en train d’attendre un car ».
- Mais point de car à l’horizon…
- Font un feu sur une pointe de sable.
- Pleut froid.
- Reviennent à l’intérieur des terres où survivent des hortensias et des orchidées sauvages.
- Le père tousse à mort.
- Arrivent à un endroit où il sait qu’il va mourir.
- Le petit l’observe et dit : oh, papa.
- Le père a l’impression que son fils irradie.
- « Regarde autour de toi, dit-il. Il n’y a pas dans la longue chronique de la terre de prophète qui ne soit honoré ici aujourd’hui. De quelque forme que tu aies parlé tu avais raison ».
- L’homme enjoint le petit de continuer sans lui.
- Lui promet de la chance.
- L’enjoint à porter le feu.
- Qu’il voit maintenant en lui.
- Lui dit de ne pas renoncer.
- Lui dit qu’il ne peut tenir dans ses bras son fils mort.
- Lui dit qu’ils se parleront encore sans se voir.
- Le petit dit : d’accord.
- Puis s’en va sur la route. Puis revient : son père dort.
- Le petit lui demande plus tard s’il se souvient du petit garçon.
- Se demande ce qu’il est devenu.
- Le père lui dit que la bonté le trouvera.
- Il dort près de son père qui, au matin, est froid et mort.
- Il prend sa main et dit encore et encore son nom.
- Reste là encore trois jours, couvre son père de toutes les couvertures, et s’en va avec le revolver.
- Arrive un type en blouson de ski jaune.
- Avec un fusil à pompe.
- Lui demande où est l’homme.
- Le petit dit qu’il est mort.
- Le type dit qu’il est désolé.
- L’homme sent la fumée de bois.
- Lui dit de venir avec lui.
- Dit qu’il fait partie des gentils.
- « Tu seras bien », lui promet-il.
- Lui demande s’il porte aussi le feu.
- L’autre lui demande s’il est dérangé.
- Puis il convient, ouais, qu’il porte le feu.
- Il a aussi des enfants.
- Qu’il n’a pas mangés.
- L’homme dit qu’il va s’occuper de l’homme.
- Puis le petit revient vers son père enveloppé d’une couverture et pleure longtemps.
- « Je te parlerai tous les jours »…
- La femme le recueille en lui disant : oh, je suis si contente de te voir.
- Et c’est la dernière phrase à pleurer de ce livre : « Autrefois il y avait des truites de torrent dans les montagnes. On pouvait les voir immobiles dressées dans le courant couleur d’ambre où les bordures blanches de leurs nageoires ondulaient doucement au fil de l’eau. Elles avaient un parfum de mousse quand on les prenait dans la main. Lisses et musclées et élastiques. Sur leur dos il y avait des dessins en pointillé qui étaient des cartes du monde en son devenir. Des cartes et des labyrinthes. D’une chose qu’on ne pourrait pas refaire. Ni réparer. Dans les vals profonds qu’elles habitaient toutes les choses étaient plus anciennes que l’homme et leur murmure était de mystère ».
Cormac McCarthy. La Route. Editions de L’Olivier, 244p. -
Que revienne le chant
 De la rêverie vagabondejamais il ne guérit:même s’aguerrissant là-bas,sous le ciel blessépar les chutes et les rechutes,le revoici ramenéà la vive contemplation -à jamais appelé ...Toi l’enfant trop lucide,menacé trop tôt de savoirce qui manque à la haineet qui la comble de sa faimque rien n’assouvira,ton instinct t’aura détournéde ceci et celapar le démon ou par les fées -qui jamais le saura...Tourne la boule au bal:l’illuminé chavireau rebond du cheval Délire,et ruissellent les motsqui délivrent de la gésineaux gestes consentantset sempiternelles routines -or tel sera l’envoi:que nous revienne enfin le chant...Peinture: Bona Mangangu, Fleur de volcan.
De la rêverie vagabondejamais il ne guérit:même s’aguerrissant là-bas,sous le ciel blessépar les chutes et les rechutes,le revoici ramenéà la vive contemplation -à jamais appelé ...Toi l’enfant trop lucide,menacé trop tôt de savoirce qui manque à la haineet qui la comble de sa faimque rien n’assouvira,ton instinct t’aura détournéde ceci et celapar le démon ou par les fées -qui jamais le saura...Tourne la boule au bal:l’illuminé chavireau rebond du cheval Délire,et ruissellent les motsqui délivrent de la gésineaux gestes consentantset sempiternelles routines -or tel sera l’envoi:que nous revienne enfin le chant...Peinture: Bona Mangangu, Fleur de volcan. -
Par nos racines et nos sources, le paysan survit en nous…


 Une série alémanique diffusée à l’international, Neumatt, et deux livres de grande qualité, Faire paysan de Blaise Hofmann et Les sources de Marie-Hélène Lafon, constituent trois approches d’une réalité souvent problématique voire douloureuse à de multiples égards, mais qui restera, à l’avenir, notre affaire à tous…« La Suisse trait sa vache et vit paisiblement », écrivait Victor Hugo dans La légende des siècles, et la formule – cliché obsolète pour d’aucuns mais qu’on aurait tort de rejeter avec mépris, comme l’a compris Isabelle-Loyse Gremaud qui en a fait le titre (assorti d’un point d’interrogation…) d’un spectacle-témoignage auquel ont participé une trentaine d’agriculteurs de nos régions et qui tourna en Suisse romande il y a deux ou trois ans de ça.Or cette même citation réapparaît dans le dernier livre de Blaise Hofmann, intitulé Faire paysan, relançant lui aussi le dialogue avec quelques paysans de sa connaissance, et j’y ajouterai ici trois vers en bonus: « La Suisse trait sa vache et vit paisiblement. / Sa blanche liberté s’adosse au firmament », et en début de strophe : « La Suisse dans l’histoire aura le dernier mot. / Puisqu’elle est deux fois grande, étant pauvre, et là-haut ; / Puisqu’elle a sa montagne et qu’elle a sa cabane »…Dans la foulée des anti-clichés farouches, je me rappelle en outre le vif agacement de certaine ministre de la culture lausannoise à la seule évocation de la formule fameuse de notre cher Gilles pour qui Lausanne était « une belle paysanne qui a fait ses humanités ».Comme s’il y avait honte à cela ! Et comme s’il n’y avait pas du vrai dans ce raccourci malicieux de poète : comme si, même citadins de naissance, nous n’avions pas tous des liens filiaux, même lointains, avec des aïeux paysans, comme si Les petites fugues d’Yves Yersin, et Pipe son valet de ferme, ou L’âme sœur, chef-d’œuvre de Fredi M. Murer, ne participaient pas de la même culture de souche terrienne – comme si la énième interprétation du Ranz des vaches, à la Fêtes des vignerons, ne nous tirait pas, à toutes et tous, des larmes qui n’ont rien pour autant de chauvin. Et pas besoin, au demeurant, de «faire paysan» pour le ressentir. Mais lire Faire paysan de Blaise Hofmann devrait relever du « devoir citoyen », comme on le dit aujourd’hui pompeusement, à programmer dans les écoles et les universités pour sa formidable synthèse, à la fois subjective et très documentée – chiffres éloquents à l’appui-, appelant au débat pacificateur.Entre la chaise d’écrivain et le botte-cul…« Faire paysan » n’est pas une pose ou une posture : c’est un métier. Blaise Hofmann, fils et petit-fils de paysan, a connu la campagne par le nez avant de la reconnaître par son intelligence sensible et son esprit d’investigation. Comme celle de beaucoup d’entre nous, la mémoire de son enfance est pleine d’odeurs, avec celle, en premier lieu, du fumier-roi.C’est en évoquant son grand-père le Bernois, débarqué de son Belpberg natal chez les « Welches » et fier de son fumier « à la bernoise », aujourd’hui remplacé par une place de parking, que Blaise Hofmann amorce son travail de mémoire englobant ses souvenirs personnels et l’aperçu détaillé d’une évolution dont quelques chiffres précisent l’accélération : « En 1905, il y avait 243.000 exploitations en Suisse. L’agriculture concernait 30% de la population. En 1950, elle représentait encore 20% de la population. En 1970, plus que 6,7%. En 2003, 3%. En 2021, il subsiste 48.864 exploitations, soit 2% de la population. Depuis dix ans, 1500 fermes disparaissent chaque année. Quatre par jour ».De quoi désespérer ou se réfugier dans les images d’un passé maquillé en idylle ? Telle n’est pas du tout la conclusion de Blaise Hofmann au terme de ses nombreuses et souvent belles et enrichissantes rencontres, témoignages parfois contradictoires voire vifs (les sujets qui fâchent ou divisent les générations), au gré desquels s’incarnent les thèmes relevant de l’économie et de la politique, également éclairés par de nombreuses lectures technique ou littéraires, l’écrivain se faisant tantôt historien et tantôt polémiste (mais toujours nuancé), chroniqueur et poète au verbe limpide.Une réconciliation difficileComme on ne cesse de le constater, et que confirment les votations populaires : le clivage ville-campagne ne cesse de s’accentuer dans notre pays, et les préjugés négatifs réciproques, et autres malentendus ne cessent d’altérer les discussions.Réaliste de bonne volonté, Hofmann ne dore pas la pilule, ni ne fait dans l’abstrait idéologique, moins encore dogmatique. Non sans obstacles (pudeur, méfiance de celui qui s’est senti trahi par un reportage télévisé auquel il a participé, etc.), il fait parler les gens, les écoute, compare les expériences, en transmet la substance. « Faire paysan », lui dit un jeune qui débute dans le métier, « c’est travailler plus que tout le monde et gagner moins que tout le monde pour nourrir des gens qui croient qu’on les empoisonne ».Mais c’est, aussi, auprès de (plus ou moins) jeunes agriculteurs entreprenants – femmes et hommes cela va sans dire – que notre enquêteur trouve des raisons de ne pas désespérer.Et d’introduire ces braves : « Il existe plusieurs types de paysans. Il y a le « résigné », un besogneux qui s’acharne dans ses choix, dans le déni de la situation actuelle. Il y a le « nostalgique », un désillusionné qui espère en secret la chute du système et le retour de l’ordre ancien lors de la prochaine grande crise mondiale. Enfin il y a « l’entrepreneur », celui qui a compris les règles su système en vigueur et travaille à y trouver sa place, à répondre aux attentes de la population, en inventant une nouvelle manière de faire. Et voici, après d’autres beaux exemples, Nicolas Pavillard et son entreprise collective, ou voilà le trentenaire Alix Pécoud aux vues largement ouvertes sur le monde en devenir où la qualité primera sur la quantité à tout prix, ou encore c’est Anne Chenevard la courageuse qui envoie promener Migros Suisse et autres distributeurs à marges éhontées ; ce sont les animateurs de la Ferme des Savanes, ou c’est Urs Marti l’écolo « dont le lait végétal n’émet aucun méthane et ne fait souffrir aucun animal », etc. Dans le sillage des figures de haute volée à la Fernand Cuche, également rencontré par Blaise Hofmann, ces divers personnages illustrent la variété des «réponses» à une situation dont l’avenir est aussi «notre affaire», selon l’expression de Denis de Rougemont…Ô rage, ô désespoir…Le chapitre le plus sombre, et le plus émouvant de Faire paysan, est consacré à ceux qui, n’en pouvant plus, ont choisi de se donner la mort, et c’est là qu’en est arrivé, aussi, le paysan Kurt Wyss, très endetté et trompé par sa femme, dont la série alémanique Neumatt (à voir sur Netflix) retrace, en huit épisodes, les tribulations de la famille confrontée à la succession, avec la grand-mère qui s’accroche au domaine et l’épouse prête à céder celui-ci à la commune qui lui en offre plusieurs millions.Marquant immédiatement le contraste brutal entre l’univers urbain mondialisé et néolibéral, qu’incarne le fils aîné Michi - cadre dans une boîte de gestion d’entreprises, gay et rêvant de se déployer en Asie ou aux Etats-Unis -, et le monde de la ferme où son frère cadet Lorenz vient de voir naître son premier veau sous le regard de son père encore vivant, le premier épisode de cette série, signée Sabine Boss et Pierre Monnard, bénéficiant par ailleurs d’une interprétation de tout premier ordre, constitue un véritable concentré des thèmes abordés par Blaise Hofmann.De fait, le discours qu’improvise la veuve à l’église, contre toute attente - son fils aîné ayant renoncé à s’exprimer -, dit autant le désespoir impuissant de la femme de paysan que sa rage envers son conjoint et, avec des accents soudain polémiques, sa révoltante condition…Or celle-ci se trouve précisément documentée dans le chapitre de Faire paysan consacré aux suicides de paysans (un taux de 40% supérieur à la moyenne nationale), où l’aumônier Pierre-André Schütz énonce, comme une litanie déchirante, les raisons qui poussent les agriculteurs même débutants à se donner la mort, tels ces quatre jeunes paysans de la même volée de l’école de Grange Verney, en 2015…Ce qu’il faut pourtant ajouter, à ce sombre tableau, c’est qu’il a son envers lumineux. Le titre du chapitre en question est d’ailleurs Moins de cordes autour des poutres des granges, correspondant à une diminution des suicides de paysans depuis 2018, et l’on se réjouit aussi de la fin heureuse de Neumatt où le fils aîné choisit, contre la volonté de sa mère, de reprendre la ferme avec son frère cadet…La source, les racines et les mots pour le dire…Douleurs paysannes était le titre du premier livre de Corinna Bille, dont les nouvelles se passent en Valais, alors que le très âpre et poignant récit de Campagnes de Louis Calaferte se déroule dans le Dauphiné de l’auteur et que Marie-Hélène Lafon situe la ferme isolée de son dernier roman, Les Sources, sur les hautes terres du Cantal, pour faire parler un drame taiseux, comme le Polonais Ladislas Reymont fait parler ses bouseux sans langage dans la fresque des Paysans, aussi mémorable que La terre d’Emile Zola ou que le premier roman de Ramuz, l’inoubliable Aline, et maints autres ouvrages qu’on pourrait dire de la mémoire paysanne, conçus par des « gratte-papier » qui n’ont jamais mis « la main à la pâte », dont une vingtaine, avec ou sans beau style, sont cités dans la bibliographie de Faire paysan.« Quand on entre dans une étable bien tenue, l’odeur large des bêtes est bonne à respirer, elle nous remet les idées à l’endroit, on est à sa place », écrivait Marie-Hèléne Lafon dans son Joseph (2014), cité par Hofmann qui dit, par ailleurs, avoir été touché par les mots de Gustave Roud dans Campagne perdue, etc.Dans Les sources, où l’écriture si prodigieusement suggestive de Marie-Hélène Lafon parvient à exprimer ce que n'ose dire la femme de Pierre, qui l’a engrossée dès leur mariage et a commencé de la cogner en même temps, et ce qu'elle ressent dans le silence et la peur, entre ses trois enfants terrifiés, ses sœurs qui ont « leur vie », la tante instruite de son mari qui comprend et s’éloigne, son père à elle qui voit tout et se tait, et sa mère lui reprochant de se laisser aller, de grossir, de ne pas «tenir son rang », de n’être en somme que « ce tas » sur lequel son infernal époux se déchaîne.Typique de la vie paysanne que cette violence muette ? Évidemment pas ! Et sachons gré, tous tant que nous sommes, «glébeux » ou pas, à ces fichus écrivains à la langue bien pendue, à ces écrivaines bavardes comme des pies, de savoir dire la merveille que c’est aussi de « sentir le sec après la pluie » ou de voir venir, demain, les grandes journées de printemps…Blaise Hofmann. Faire paysan. Zoé, 2023.Neumatt. Série de Sabine Boss et Pierre Monnard, à voir sur Netflix.Marie-Hélène Lafon, Les sources. Buchet-Chastel, 2023.
Une série alémanique diffusée à l’international, Neumatt, et deux livres de grande qualité, Faire paysan de Blaise Hofmann et Les sources de Marie-Hélène Lafon, constituent trois approches d’une réalité souvent problématique voire douloureuse à de multiples égards, mais qui restera, à l’avenir, notre affaire à tous…« La Suisse trait sa vache et vit paisiblement », écrivait Victor Hugo dans La légende des siècles, et la formule – cliché obsolète pour d’aucuns mais qu’on aurait tort de rejeter avec mépris, comme l’a compris Isabelle-Loyse Gremaud qui en a fait le titre (assorti d’un point d’interrogation…) d’un spectacle-témoignage auquel ont participé une trentaine d’agriculteurs de nos régions et qui tourna en Suisse romande il y a deux ou trois ans de ça.Or cette même citation réapparaît dans le dernier livre de Blaise Hofmann, intitulé Faire paysan, relançant lui aussi le dialogue avec quelques paysans de sa connaissance, et j’y ajouterai ici trois vers en bonus: « La Suisse trait sa vache et vit paisiblement. / Sa blanche liberté s’adosse au firmament », et en début de strophe : « La Suisse dans l’histoire aura le dernier mot. / Puisqu’elle est deux fois grande, étant pauvre, et là-haut ; / Puisqu’elle a sa montagne et qu’elle a sa cabane »…Dans la foulée des anti-clichés farouches, je me rappelle en outre le vif agacement de certaine ministre de la culture lausannoise à la seule évocation de la formule fameuse de notre cher Gilles pour qui Lausanne était « une belle paysanne qui a fait ses humanités ».Comme s’il y avait honte à cela ! Et comme s’il n’y avait pas du vrai dans ce raccourci malicieux de poète : comme si, même citadins de naissance, nous n’avions pas tous des liens filiaux, même lointains, avec des aïeux paysans, comme si Les petites fugues d’Yves Yersin, et Pipe son valet de ferme, ou L’âme sœur, chef-d’œuvre de Fredi M. Murer, ne participaient pas de la même culture de souche terrienne – comme si la énième interprétation du Ranz des vaches, à la Fêtes des vignerons, ne nous tirait pas, à toutes et tous, des larmes qui n’ont rien pour autant de chauvin. Et pas besoin, au demeurant, de «faire paysan» pour le ressentir. Mais lire Faire paysan de Blaise Hofmann devrait relever du « devoir citoyen », comme on le dit aujourd’hui pompeusement, à programmer dans les écoles et les universités pour sa formidable synthèse, à la fois subjective et très documentée – chiffres éloquents à l’appui-, appelant au débat pacificateur.Entre la chaise d’écrivain et le botte-cul…« Faire paysan » n’est pas une pose ou une posture : c’est un métier. Blaise Hofmann, fils et petit-fils de paysan, a connu la campagne par le nez avant de la reconnaître par son intelligence sensible et son esprit d’investigation. Comme celle de beaucoup d’entre nous, la mémoire de son enfance est pleine d’odeurs, avec celle, en premier lieu, du fumier-roi.C’est en évoquant son grand-père le Bernois, débarqué de son Belpberg natal chez les « Welches » et fier de son fumier « à la bernoise », aujourd’hui remplacé par une place de parking, que Blaise Hofmann amorce son travail de mémoire englobant ses souvenirs personnels et l’aperçu détaillé d’une évolution dont quelques chiffres précisent l’accélération : « En 1905, il y avait 243.000 exploitations en Suisse. L’agriculture concernait 30% de la population. En 1950, elle représentait encore 20% de la population. En 1970, plus que 6,7%. En 2003, 3%. En 2021, il subsiste 48.864 exploitations, soit 2% de la population. Depuis dix ans, 1500 fermes disparaissent chaque année. Quatre par jour ».De quoi désespérer ou se réfugier dans les images d’un passé maquillé en idylle ? Telle n’est pas du tout la conclusion de Blaise Hofmann au terme de ses nombreuses et souvent belles et enrichissantes rencontres, témoignages parfois contradictoires voire vifs (les sujets qui fâchent ou divisent les générations), au gré desquels s’incarnent les thèmes relevant de l’économie et de la politique, également éclairés par de nombreuses lectures technique ou littéraires, l’écrivain se faisant tantôt historien et tantôt polémiste (mais toujours nuancé), chroniqueur et poète au verbe limpide.Une réconciliation difficileComme on ne cesse de le constater, et que confirment les votations populaires : le clivage ville-campagne ne cesse de s’accentuer dans notre pays, et les préjugés négatifs réciproques, et autres malentendus ne cessent d’altérer les discussions.Réaliste de bonne volonté, Hofmann ne dore pas la pilule, ni ne fait dans l’abstrait idéologique, moins encore dogmatique. Non sans obstacles (pudeur, méfiance de celui qui s’est senti trahi par un reportage télévisé auquel il a participé, etc.), il fait parler les gens, les écoute, compare les expériences, en transmet la substance. « Faire paysan », lui dit un jeune qui débute dans le métier, « c’est travailler plus que tout le monde et gagner moins que tout le monde pour nourrir des gens qui croient qu’on les empoisonne ».Mais c’est, aussi, auprès de (plus ou moins) jeunes agriculteurs entreprenants – femmes et hommes cela va sans dire – que notre enquêteur trouve des raisons de ne pas désespérer.Et d’introduire ces braves : « Il existe plusieurs types de paysans. Il y a le « résigné », un besogneux qui s’acharne dans ses choix, dans le déni de la situation actuelle. Il y a le « nostalgique », un désillusionné qui espère en secret la chute du système et le retour de l’ordre ancien lors de la prochaine grande crise mondiale. Enfin il y a « l’entrepreneur », celui qui a compris les règles su système en vigueur et travaille à y trouver sa place, à répondre aux attentes de la population, en inventant une nouvelle manière de faire. Et voici, après d’autres beaux exemples, Nicolas Pavillard et son entreprise collective, ou voilà le trentenaire Alix Pécoud aux vues largement ouvertes sur le monde en devenir où la qualité primera sur la quantité à tout prix, ou encore c’est Anne Chenevard la courageuse qui envoie promener Migros Suisse et autres distributeurs à marges éhontées ; ce sont les animateurs de la Ferme des Savanes, ou c’est Urs Marti l’écolo « dont le lait végétal n’émet aucun méthane et ne fait souffrir aucun animal », etc. Dans le sillage des figures de haute volée à la Fernand Cuche, également rencontré par Blaise Hofmann, ces divers personnages illustrent la variété des «réponses» à une situation dont l’avenir est aussi «notre affaire», selon l’expression de Denis de Rougemont…Ô rage, ô désespoir…Le chapitre le plus sombre, et le plus émouvant de Faire paysan, est consacré à ceux qui, n’en pouvant plus, ont choisi de se donner la mort, et c’est là qu’en est arrivé, aussi, le paysan Kurt Wyss, très endetté et trompé par sa femme, dont la série alémanique Neumatt (à voir sur Netflix) retrace, en huit épisodes, les tribulations de la famille confrontée à la succession, avec la grand-mère qui s’accroche au domaine et l’épouse prête à céder celui-ci à la commune qui lui en offre plusieurs millions.Marquant immédiatement le contraste brutal entre l’univers urbain mondialisé et néolibéral, qu’incarne le fils aîné Michi - cadre dans une boîte de gestion d’entreprises, gay et rêvant de se déployer en Asie ou aux Etats-Unis -, et le monde de la ferme où son frère cadet Lorenz vient de voir naître son premier veau sous le regard de son père encore vivant, le premier épisode de cette série, signée Sabine Boss et Pierre Monnard, bénéficiant par ailleurs d’une interprétation de tout premier ordre, constitue un véritable concentré des thèmes abordés par Blaise Hofmann.De fait, le discours qu’improvise la veuve à l’église, contre toute attente - son fils aîné ayant renoncé à s’exprimer -, dit autant le désespoir impuissant de la femme de paysan que sa rage envers son conjoint et, avec des accents soudain polémiques, sa révoltante condition…Or celle-ci se trouve précisément documentée dans le chapitre de Faire paysan consacré aux suicides de paysans (un taux de 40% supérieur à la moyenne nationale), où l’aumônier Pierre-André Schütz énonce, comme une litanie déchirante, les raisons qui poussent les agriculteurs même débutants à se donner la mort, tels ces quatre jeunes paysans de la même volée de l’école de Grange Verney, en 2015…Ce qu’il faut pourtant ajouter, à ce sombre tableau, c’est qu’il a son envers lumineux. Le titre du chapitre en question est d’ailleurs Moins de cordes autour des poutres des granges, correspondant à une diminution des suicides de paysans depuis 2018, et l’on se réjouit aussi de la fin heureuse de Neumatt où le fils aîné choisit, contre la volonté de sa mère, de reprendre la ferme avec son frère cadet…La source, les racines et les mots pour le dire…Douleurs paysannes était le titre du premier livre de Corinna Bille, dont les nouvelles se passent en Valais, alors que le très âpre et poignant récit de Campagnes de Louis Calaferte se déroule dans le Dauphiné de l’auteur et que Marie-Hélène Lafon situe la ferme isolée de son dernier roman, Les Sources, sur les hautes terres du Cantal, pour faire parler un drame taiseux, comme le Polonais Ladislas Reymont fait parler ses bouseux sans langage dans la fresque des Paysans, aussi mémorable que La terre d’Emile Zola ou que le premier roman de Ramuz, l’inoubliable Aline, et maints autres ouvrages qu’on pourrait dire de la mémoire paysanne, conçus par des « gratte-papier » qui n’ont jamais mis « la main à la pâte », dont une vingtaine, avec ou sans beau style, sont cités dans la bibliographie de Faire paysan.« Quand on entre dans une étable bien tenue, l’odeur large des bêtes est bonne à respirer, elle nous remet les idées à l’endroit, on est à sa place », écrivait Marie-Hèléne Lafon dans son Joseph (2014), cité par Hofmann qui dit, par ailleurs, avoir été touché par les mots de Gustave Roud dans Campagne perdue, etc.Dans Les sources, où l’écriture si prodigieusement suggestive de Marie-Hélène Lafon parvient à exprimer ce que n'ose dire la femme de Pierre, qui l’a engrossée dès leur mariage et a commencé de la cogner en même temps, et ce qu'elle ressent dans le silence et la peur, entre ses trois enfants terrifiés, ses sœurs qui ont « leur vie », la tante instruite de son mari qui comprend et s’éloigne, son père à elle qui voit tout et se tait, et sa mère lui reprochant de se laisser aller, de grossir, de ne pas «tenir son rang », de n’être en somme que « ce tas » sur lequel son infernal époux se déchaîne.Typique de la vie paysanne que cette violence muette ? Évidemment pas ! Et sachons gré, tous tant que nous sommes, «glébeux » ou pas, à ces fichus écrivains à la langue bien pendue, à ces écrivaines bavardes comme des pies, de savoir dire la merveille que c’est aussi de « sentir le sec après la pluie » ou de voir venir, demain, les grandes journées de printemps…Blaise Hofmann. Faire paysan. Zoé, 2023.Neumatt. Série de Sabine Boss et Pierre Monnard, à voir sur Netflix.Marie-Hélène Lafon, Les sources. Buchet-Chastel, 2023. -
En réalité
 Ne plus rien dire enfin:nous avons trop parlé,tout se mêle, les mots,le miel et le fiel noir,au ciel de sang caillé,ce ne sont plus que criset que sanglots hagards...Je vais errant sans poids ;il n’est plus de langueque de bois en cendre,âcre au palais sans lèvres...L’âme se tait, aux mursles slogans effacésne rêvent plus à rien;dans le grand jour obscur :pas un chant de regret ;juste une femme au puits,et son enfant muet...Image: l'ange de Dresde.
Ne plus rien dire enfin:nous avons trop parlé,tout se mêle, les mots,le miel et le fiel noir,au ciel de sang caillé,ce ne sont plus que criset que sanglots hagards...Je vais errant sans poids ;il n’est plus de langueque de bois en cendre,âcre au palais sans lèvres...L’âme se tait, aux mursles slogans effacésne rêvent plus à rien;dans le grand jour obscur :pas un chant de regret ;juste une femme au puits,et son enfant muet...Image: l'ange de Dresde. -
Mater furiosa

À propos de Campagnes de Louis Calaferte
Une sombre beauté se dégage de cet affreux tableau de la vie paysanne, qui me fait penser aux souliers et aux gueules du premier Van Gogh de la glèbe hollandaise. La Marie de Calaferte, dans Campagnes, est un personnage de mater furiosa qui réunit à peu près tous les vices, exacerbés par l’alcool, et pourtant il y a une sorte de grandeur dans sa mesquinerie teigneuse, et comme une dimension dostoïevskienne dans la violence de sa passion destructrice, qui nous la rend presque aussi proche, malgré sa rouerie et sa méchanceté, que son Joanny tout droit et consciencieux, qui s’acharne à planquer l’argent qu’elle lui vole en douce et à réparer tout ce qu’elle dégrade ou démolit à mesure, battant ses enfants dès l’aube, vidant le poivrier dans la soupe et menaçant à tout moment les siens de s’égorger ou de se jeter à l’eau.
On n’aime pas cette sale carne, mais le personnage reste terriblement humain, comme Alceste ou Tartuffe, avec ce mélange d’épique et de comique, mais aussi de faiblesse et de détresse, qui fascine autant sinon plus que les figures de victimes ou de justes.
Plus que la Marie, c’est la condition même de ces paysans pauvres de l’époque de la Grande Guerre qui nous semble cruelle et dégradante, et le constat me rappelle ce qu’on m’a raconté des paysans de notre famille fuyant la terre à la même époque : « Des sept enfants, pas un ne restera sur cette terre à laquelle leur père a consacré sa vie. »
Lorsque, après avoir failli tuer Marie, Joanny se retrouve mourant à ses côtés, elle en arrive à boire encore l’eau de Cologne nécessaire à sa toilette, mais sa propre fin à elle ne manquera pas pour autant de gueule, stupéfiant ceux qui la soignent par le courage qu’elle montre face à la Douleur.
Louis Calaferte. Campagnes. Nouvelles. Denoël. -
Ceux qui monétisent leur influence
 Celui dont les images du nombril sont devenues aussi cultes que l’Anus Mundi / Celle qui prône à la fois Chanel et Toyota dans son bain moussant / Ceux qui se font des couilles en or avec les images de leurs triplés devenues porteuses à l’international / Celui qu’enchante cette ubérisation du travail des enfants / Celle qui négocie les vidéos de son fils adoptif devenu la coqueluche du groupe de K-pop Astro / Ceux qui attendent qu’on reconnaisse aussi leurs peluches sympas via le crowdfunding / Celui qui accompagne sa transistion d’une réappropriation du concept de perversion narcissique / Celle qui lisant la BD Gargamelle apprend qu’à l’époque on pouvait accoucher par l’oreille / Ceux qui ont causé pas mal de traumas en cessant de poster sur Insta / Celui qui a installé une webcam open minded dans son confessionnal multigenres / Celle qui se demande s’il y a une vie après Twitter / Ceux qui militent à fond pour leurs sponsors écoresponsables / Celui qui demande à son hamster de sourire à sa rhubarbe / Celle qui presse sa Zoé de trois mois de choisir son camp / Ceux qui ont décidé de ne plus être influencés par leurs parents bios / Celui qui gère la mise en ligne des scanners de sa tumeur / Celle qui demande avant son noviciat s’il y a le wifi au couvent / Ceux qui restent connectés après leur décès qui devrait faire le buzz, etc.
Celui dont les images du nombril sont devenues aussi cultes que l’Anus Mundi / Celle qui prône à la fois Chanel et Toyota dans son bain moussant / Ceux qui se font des couilles en or avec les images de leurs triplés devenues porteuses à l’international / Celui qu’enchante cette ubérisation du travail des enfants / Celle qui négocie les vidéos de son fils adoptif devenu la coqueluche du groupe de K-pop Astro / Ceux qui attendent qu’on reconnaisse aussi leurs peluches sympas via le crowdfunding / Celui qui accompagne sa transistion d’une réappropriation du concept de perversion narcissique / Celle qui lisant la BD Gargamelle apprend qu’à l’époque on pouvait accoucher par l’oreille / Ceux qui ont causé pas mal de traumas en cessant de poster sur Insta / Celui qui a installé une webcam open minded dans son confessionnal multigenres / Celle qui se demande s’il y a une vie après Twitter / Ceux qui militent à fond pour leurs sponsors écoresponsables / Celui qui demande à son hamster de sourire à sa rhubarbe / Celle qui presse sa Zoé de trois mois de choisir son camp / Ceux qui ont décidé de ne plus être influencés par leurs parents bios / Celui qui gère la mise en ligne des scanners de sa tumeur / Celle qui demande avant son noviciat s’il y a le wifi au couvent / Ceux qui restent connectés après leur décès qui devrait faire le buzz, etc. -
Ceux qui l'emporteront en enfer
 Celui qui la traite de tas pour mieux lui taper dedans / Celle qui grossit au lieu de répondre / Ceux qui détournent le regard tellement ça fait mal / Celui qui la redresse vu qu’elle courbe l’échine au travail / Celle qui a déjà trois cicatrices quand le Docteur lui conseille les ligatures / Ceux qui savent tout jusque dans la vallée d’à côté / Celui qui sait cogner sans laisser de traces / Celle qui l’entend venir à sa façon silencieuse de monter l’escalier / Celles qui sont tentées de l’aider mais se demandent si ça se saura / Celui qui lui reproche de n’être même pas à la hauteur du tas de vaisselle qu’elle laisse traîner pendant qu’il fait tout à sa place / Celle qui sait qu’elle est pour quelque chose dans le désastre de sa vie que son silence n’a fait qu’augmenter de jour en jour et les nuits à l'avenant / Ceux qui lui conseillent de parler sans les mentionner / Celui qui lui reproche de ne pas arriver à la cheville de sa mère à lui et de ressembler a son père à elle cette chiffe qui vote Mitterrand à ce qu’on sait / Celle qui pense au cyanure puis se dit qu’elle ferait mieux de ne plus penser / Ceux qui en concluent qu’elle aurait dû réfléchir avant pour éviter ce qui s'est passé par après, etc.(Liste établie après la lecture du dernier roman de Marie-Hélène Lafon dont la lancinante douleur évoquée se trouve modulée par une écriture admirable de concision suggestive et de précision dans la façon de restituer la langue des terriens taiseux...)
Celui qui la traite de tas pour mieux lui taper dedans / Celle qui grossit au lieu de répondre / Ceux qui détournent le regard tellement ça fait mal / Celui qui la redresse vu qu’elle courbe l’échine au travail / Celle qui a déjà trois cicatrices quand le Docteur lui conseille les ligatures / Ceux qui savent tout jusque dans la vallée d’à côté / Celui qui sait cogner sans laisser de traces / Celle qui l’entend venir à sa façon silencieuse de monter l’escalier / Celles qui sont tentées de l’aider mais se demandent si ça se saura / Celui qui lui reproche de n’être même pas à la hauteur du tas de vaisselle qu’elle laisse traîner pendant qu’il fait tout à sa place / Celle qui sait qu’elle est pour quelque chose dans le désastre de sa vie que son silence n’a fait qu’augmenter de jour en jour et les nuits à l'avenant / Ceux qui lui conseillent de parler sans les mentionner / Celui qui lui reproche de ne pas arriver à la cheville de sa mère à lui et de ressembler a son père à elle cette chiffe qui vote Mitterrand à ce qu’on sait / Celle qui pense au cyanure puis se dit qu’elle ferait mieux de ne plus penser / Ceux qui en concluent qu’elle aurait dû réfléchir avant pour éviter ce qui s'est passé par après, etc.(Liste établie après la lecture du dernier roman de Marie-Hélène Lafon dont la lancinante douleur évoquée se trouve modulée par une écriture admirable de concision suggestive et de précision dans la façon de restituer la langue des terriens taiseux...) -
Barque de la nuit
 (quand Lady L. lisait J.B. Pontalis)La petite barque s’en va:tu la vois s’en aller;cela prendra le temps donné,délivré des tracas...C’était, vous vous en souviendrez,dans ce musée de Sienneoù tous deux vous vous trouviezavant que la nuit vienne...Dans la nuit sonore des rues,cependant qu’elle dormait.tu l’as vue, les yeux fermés, nue,dans la barque lâchée...Tu t’en iras la retrouverdans la nuit égyptiennedont vous aurez aussi percéle noir de l’obsidienne...Peinture: Ambrogio Lorenzetti.
(quand Lady L. lisait J.B. Pontalis)La petite barque s’en va:tu la vois s’en aller;cela prendra le temps donné,délivré des tracas...C’était, vous vous en souviendrez,dans ce musée de Sienneoù tous deux vous vous trouviezavant que la nuit vienne...Dans la nuit sonore des rues,cependant qu’elle dormait.tu l’as vue, les yeux fermés, nue,dans la barque lâchée...Tu t’en iras la retrouverdans la nuit égyptiennedont vous aurez aussi percéle noir de l’obsidienne...Peinture: Ambrogio Lorenzetti. -
Ceux qui se disent occupés
 Celui qui l’est autant que le lieu d’aisance où il réfléchit à ce qu’il est en ce moment précis / Celle qui n’a pas que ça à faire dit-elle à son bidet / Ceux qui lancent à celui qui leur avoue qu’il écrit de la poésie : ça occupe ! / Celui qui demande à sa secrétaire d'expliquer une bonne fois à ses clients que sa sieste dure parfois toute la journée / Celle qui occupe les lieux comme à la grande époque des auditoires de Nanterre / Ceux qui déprogramment leurs séquences de méditation / Celui qui lit un poème de Dominique de Villepin dans son espace de confort puis se rendort / Celle qui gère ses endorphines avec méthode / Ceux qui écoutent ce qui se dit dans l’open space avant d'en tirer les conclusions sur la hotline / Celui qui est né avec une cuillère dans la bouche et un couteau dans le beurre / Celle qui ne s’occupe que des oignons de son Gaston / Ceux qui ont fait leur pelote pendant l’Occupation sans en tirer d’autres profits n'est-ce pas / Celui qui n’a pas une minute à te consacrer te dit-il au téléphone avant de retourner sur Tinder / Celle qui délègue de plus en plus sans rien lâcher pour autant / Ceux qui ne produisent plus guère que des déchets que d’autres s’occupent à recycler, etc.
Celui qui l’est autant que le lieu d’aisance où il réfléchit à ce qu’il est en ce moment précis / Celle qui n’a pas que ça à faire dit-elle à son bidet / Ceux qui lancent à celui qui leur avoue qu’il écrit de la poésie : ça occupe ! / Celui qui demande à sa secrétaire d'expliquer une bonne fois à ses clients que sa sieste dure parfois toute la journée / Celle qui occupe les lieux comme à la grande époque des auditoires de Nanterre / Ceux qui déprogramment leurs séquences de méditation / Celui qui lit un poème de Dominique de Villepin dans son espace de confort puis se rendort / Celle qui gère ses endorphines avec méthode / Ceux qui écoutent ce qui se dit dans l’open space avant d'en tirer les conclusions sur la hotline / Celui qui est né avec une cuillère dans la bouche et un couteau dans le beurre / Celle qui ne s’occupe que des oignons de son Gaston / Ceux qui ont fait leur pelote pendant l’Occupation sans en tirer d’autres profits n'est-ce pas / Celui qui n’a pas une minute à te consacrer te dit-il au téléphone avant de retourner sur Tinder / Celle qui délègue de plus en plus sans rien lâcher pour autant / Ceux qui ne produisent plus guère que des déchets que d’autres s’occupent à recycler, etc. -
Choses promises
 À la fin tout va s'éclairerla lumière se feraau fond des villes et par les mersbientôt auréolées...Ce qu'on voyait était voilépar les mots du format,les mots du seul utilitaireet des us militaires,les mots de la seule fonction,les mots du seul profit,les mots du succès délétère,les mots des journaux -raisons ou déraisonsdes réseaux en surnuméraire,les mots gelés des cimetières...Mais les choses ont gardé le goûtde ce qu'elles sont icidans le silence de la vie:les choses délicieusesde saveurs et parfums,à jamais choses capricieuses,mêmes choses à jamaiset chaque fois tout à fait autres,choses et gens allant de pairaux minutes heureuses...Ce que tu vois en revenantà toi chaque matinte regarde et te rendun peu mieux capable du ciel...Sans te payer de mots,très humble sera ton bonheurdans la beauté des heureset des mots écrits sur les eaux...Peinture: Pierre Bonnard.
À la fin tout va s'éclairerla lumière se feraau fond des villes et par les mersbientôt auréolées...Ce qu'on voyait était voilépar les mots du format,les mots du seul utilitaireet des us militaires,les mots de la seule fonction,les mots du seul profit,les mots du succès délétère,les mots des journaux -raisons ou déraisonsdes réseaux en surnuméraire,les mots gelés des cimetières...Mais les choses ont gardé le goûtde ce qu'elles sont icidans le silence de la vie:les choses délicieusesde saveurs et parfums,à jamais choses capricieuses,mêmes choses à jamaiset chaque fois tout à fait autres,choses et gens allant de pairaux minutes heureuses...Ce que tu vois en revenantà toi chaque matinte regarde et te rendun peu mieux capable du ciel...Sans te payer de mots,très humble sera ton bonheurdans la beauté des heureset des mots écrits sur les eaux...Peinture: Pierre Bonnard. -
Prends garde à la douceur
 (Pensées de l'aube, XXXV)De la personne. – Le jour se lève et la bonne nouvelle est que ce jour est une belle personne, j’entends vraiment : la personne idéale qui n’est là que pour ton bien et va t’accompagner du matin au soir comme un chien gentil ou comme une canne d’aveugle ou comme ton ombre mais lumineuse ou comme ton clone mais lumineux et sachant par cœur toute la poésie du monde que résume la beauté de ce jour qui se lève…De la solitude. – Tu me dis que tu es seul, mais tu n’es pas seul à te sentir seul : nous sommes légion à nous sentir seuls et c’est une première grâce que de pouvoir le dire à quelqu’un qui l’entende, mais écoute-moi seulement, ne te délecte pas du sentiment d’être seul à n’être pas entendu alors que toute l’humanité te dit ce matin qu’elle se sent seule sans toi…Des petits gestes.– Ne vous en laissez pas imposer par un bras d’honneur ou le doigt qui encule : c’est un exercice difficile que de se montrer plus fort que le violent et le bruyant, mais tout au long du jour vous grandirez en douceur et en gaîté à déceler l’humble attention d’un regard ou d’une parole, d’un geste de bienveillance ou d’un signe de reconnaissance…De la rêverie. – C’est peut-être de cela qu’ILS sont le plus impatients de t’arracher : c’est le temps que tu prends sur leur horaire à ne rien faire que songer à ta vie, à la vie, à tout, à rien, c’est cela qu’ils ne supportent plus chez toi : c’est ta liberté de rêver même pendant les heures qu’ILS te paient - mais continue, petit, continue de rêver à leurs frais…Des chers objets. – ILS prétendent que c’est du fétichisme ou que c’est du passéisme, ILS ont besoin de mots en « isme » pour vous épingler à leurs mornes tableaux, ILS ne supportent pas de vous voir rendre vie au vieux tableau de la vie, cette vieille horloge que vous réparez, cet orgue de Barbarie ou ce Pinocchio de vos deux ans et demie, un paquet de lettres, demain tous vos fichiers de courriels personnels, d’ailleurs ILS supportent de moins en moins ce mot, personnel, ILS affirment qu’il faut être de son temps ou ne pas être…Aquarelle JLK: Tôt l'aube ce jour-là...
(Pensées de l'aube, XXXV)De la personne. – Le jour se lève et la bonne nouvelle est que ce jour est une belle personne, j’entends vraiment : la personne idéale qui n’est là que pour ton bien et va t’accompagner du matin au soir comme un chien gentil ou comme une canne d’aveugle ou comme ton ombre mais lumineuse ou comme ton clone mais lumineux et sachant par cœur toute la poésie du monde que résume la beauté de ce jour qui se lève…De la solitude. – Tu me dis que tu es seul, mais tu n’es pas seul à te sentir seul : nous sommes légion à nous sentir seuls et c’est une première grâce que de pouvoir le dire à quelqu’un qui l’entende, mais écoute-moi seulement, ne te délecte pas du sentiment d’être seul à n’être pas entendu alors que toute l’humanité te dit ce matin qu’elle se sent seule sans toi…Des petits gestes.– Ne vous en laissez pas imposer par un bras d’honneur ou le doigt qui encule : c’est un exercice difficile que de se montrer plus fort que le violent et le bruyant, mais tout au long du jour vous grandirez en douceur et en gaîté à déceler l’humble attention d’un regard ou d’une parole, d’un geste de bienveillance ou d’un signe de reconnaissance…De la rêverie. – C’est peut-être de cela qu’ILS sont le plus impatients de t’arracher : c’est le temps que tu prends sur leur horaire à ne rien faire que songer à ta vie, à la vie, à tout, à rien, c’est cela qu’ils ne supportent plus chez toi : c’est ta liberté de rêver même pendant les heures qu’ILS te paient - mais continue, petit, continue de rêver à leurs frais…Des chers objets. – ILS prétendent que c’est du fétichisme ou que c’est du passéisme, ILS ont besoin de mots en « isme » pour vous épingler à leurs mornes tableaux, ILS ne supportent pas de vous voir rendre vie au vieux tableau de la vie, cette vieille horloge que vous réparez, cet orgue de Barbarie ou ce Pinocchio de vos deux ans et demie, un paquet de lettres, demain tous vos fichiers de courriels personnels, d’ailleurs ILS supportent de moins en moins ce mot, personnel, ILS affirment qu’il faut être de son temps ou ne pas être…Aquarelle JLK: Tôt l'aube ce jour-là... -
Celles qui ont des antennes
 Celui qui estime que l’intuition féminine est une donnée de la Nature au même titre que les affects de la tique observées par Spinoza / Celle qui lisant L’éthique de Spinoza lance à son compagnon de vie parfois condescendant : et toc ! / Ceux qui savent que le prénom de Spinoza est Bento alors que l’usage de Baruch a été préféré par les antisémites insidieux / Celui qui envoie des messages subliminaux que seules les antennes de Marie-Flore sont en mesure de recevoir 5 sur 5 / Celle qui est également dotée de mandibules qui lui permettent de broyer les proies innocentes que lui ont permis de localiser ses antennes de mante religieuse dernière génération / Ceux qui pensent que la guerre des sexes est la continuation de la politique de l’autruche par d’autres moyens / Celui qui a une femme en lui dont les antennes pointent parfois sous son casque intégral de biker / Celle qui est à l’écoute des voix silencieuses de l’éther en ses volutes parfois traversées de soupirs qui en disent long n’est-ce pas mon Gaston / Ceux qui en ont des paraboliques orientées sur Radio-Vatican / Celui qui trouve les devineresses un tantinet emmerderesses / Celle que sa misandrie empêche de voir ce qu’il y a (parfois) d’ingénu chez les garçons qui en ont comme on dit dans les vestiaires de filles/ Ceux qui entendent même ce qu’elles ne disent pas comme quoi l’intuition typiquement féminine est parfois partagée par la brute mâle / Celui qui a toujours écouté celle qui ne parlait qu’avec son cœur / Celle qui comprenait tout sans raisonner / Ceux qui ne sauraient voler sans elles, etc.Peinture. Pierre Lamalattie.
Celui qui estime que l’intuition féminine est une donnée de la Nature au même titre que les affects de la tique observées par Spinoza / Celle qui lisant L’éthique de Spinoza lance à son compagnon de vie parfois condescendant : et toc ! / Ceux qui savent que le prénom de Spinoza est Bento alors que l’usage de Baruch a été préféré par les antisémites insidieux / Celui qui envoie des messages subliminaux que seules les antennes de Marie-Flore sont en mesure de recevoir 5 sur 5 / Celle qui est également dotée de mandibules qui lui permettent de broyer les proies innocentes que lui ont permis de localiser ses antennes de mante religieuse dernière génération / Ceux qui pensent que la guerre des sexes est la continuation de la politique de l’autruche par d’autres moyens / Celui qui a une femme en lui dont les antennes pointent parfois sous son casque intégral de biker / Celle qui est à l’écoute des voix silencieuses de l’éther en ses volutes parfois traversées de soupirs qui en disent long n’est-ce pas mon Gaston / Ceux qui en ont des paraboliques orientées sur Radio-Vatican / Celui qui trouve les devineresses un tantinet emmerderesses / Celle que sa misandrie empêche de voir ce qu’il y a (parfois) d’ingénu chez les garçons qui en ont comme on dit dans les vestiaires de filles/ Ceux qui entendent même ce qu’elles ne disent pas comme quoi l’intuition typiquement féminine est parfois partagée par la brute mâle / Celui qui a toujours écouté celle qui ne parlait qu’avec son cœur / Celle qui comprenait tout sans raisonner / Ceux qui ne sauraient voler sans elles, etc.Peinture. Pierre Lamalattie. -
Mémoire de la rose
 Lièvre fuyant, douce mémoirequi s’esquive là-basentre les heures écoulées,passe le mot encorequi rappelle le nom des rosesje dirai : baccara -la rose à l’éclat de diva...Ne pas oublier les bouquetsquand finit l’opéra,aussi rappelle-toi le nomdu parfum des allées,aux jardins de nos rendez-vousd’étudiants en amour -le rose aux pétales glamourest une mélodie,et dans le falbala finaldes salutations,lance les noms des couturiers:tous les noms déhanchésdes mémorable défilés...A la fin de sa vie ma doucecherchait, dans le silence,les mots éparpillés,et les noms attachés aux danses;elle se rappelle: Isadora !et le théâtre, à l'infini,au seul grand nom de Nijinsky,ressuscite la transe...Les sentiers bleus des soirs d’étévont s’estompant un peu,après tant d’années écouléescomme aux épaules des collinesles ruisseaux argentés -brassée de roses blanchesaux soirées douces et divinesoù les dieux se déhanchentles yeux perdus aux origines...
Lièvre fuyant, douce mémoirequi s’esquive là-basentre les heures écoulées,passe le mot encorequi rappelle le nom des rosesje dirai : baccara -la rose à l’éclat de diva...Ne pas oublier les bouquetsquand finit l’opéra,aussi rappelle-toi le nomdu parfum des allées,aux jardins de nos rendez-vousd’étudiants en amour -le rose aux pétales glamourest une mélodie,et dans le falbala finaldes salutations,lance les noms des couturiers:tous les noms déhanchésdes mémorable défilés...A la fin de sa vie ma doucecherchait, dans le silence,les mots éparpillés,et les noms attachés aux danses;elle se rappelle: Isadora !et le théâtre, à l'infini,au seul grand nom de Nijinsky,ressuscite la transe...Les sentiers bleus des soirs d’étévont s’estompant un peu,après tant d’années écouléescomme aux épaules des collinesles ruisseaux argentés -brassée de roses blanchesaux soirées douces et divinesoù les dieux se déhanchentles yeux perdus aux origines...