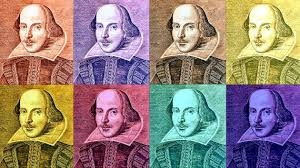
THE GOOD WILL. - L’exploration très attentive et continue du théâtre de Shakespeare, et plus précisément de Timon d’Athènes aujourd’hui, où je vois plutôt une comédie satirique qu’une tragédie, me révèle de mieux en mieux, au noyau de l’œuvre, la sagesse profonde, à la fois populaire et supérieurement aristocratique – au sens de la noblesse de cœur – de cet incomparable génie montrant tant d’humanité et dans tous les registres, et tant de pénétration sensible alliée à tant de fermeté dans l’observation des égarements collectifs et autre vices individuels, à l’écart de toute morale moralisante univoque, mais aussi de toute équivoque au sens actuel.
Ce mardi 8 novembre. - Nous saurons demain matin qui, de Donald Trump ou d’Hillary Clinton, sera le nouveau président des Etats-Unis, avec les conséquences qui en découleront pour notre monde déjà bien mal en point. Pourtant, en termes de politique internationale, je doute qu’il y ait mieux à attendre de Clinton que du grand paltoquet.
Ce qui est sûr, c’est que la victoire de celui-ci achèverait la montée en puissance de la bassesse et de la vulgarité qui a marqué cette campagne, sans qu’on puisse augurer de la tournure que prendra son règne. On se gardera de dire : après nous le déluge, car c’est dans le temps que nous vivons que cela va se jouer - peut-être contre nous mais aussi avec nous.
PIONNIERS. - Très intéressé, et bien plus : captivé dès les premières pages, par le récit épique de la première colonisation «blanche» des territoires côtiers du Nord-ouest des Etats-Unis, telle que la détaille Annie Dillard dans Les Vivants .
Je savais qu’il s’agissait là d’un livre hors du commun, mais je ne m’attendais pas à un tel choc, relevant d’une poésie inouïe – au sens propre du jamais entendu.
Or, l’extraordinaire beauté de presque chaque phrase, des images et des détails qui émaillent ces pages m’a saisi dès que je suis revenu à ce livre qui va constituer ma grande lecture de fin d’année. Pas un instant je n’ai pensé que ce récit consacré aux premiers émigrants du nord de la côte Ouest puisse dégager une telle énergie, pour ainsi dire tellurique, qui me rappelle le rapport de Thoreau avec la nature, mais en humainement plus chaleureux, tendre et violent aussi. Je pourrais ne pas être étonné, car j’admire cet écrivain depuis que j’ai lu Au présent, mais ici l’on passe de l’essai morcelé à une narration de plein air, si l’on peut dire, dans une sorte d’Eden sauvage aussi rafraîchissant que dangereux.
Ce 27 décembre. - Notre chère mère aurait eu 99 ans aujourd’hui. Mais elle ne me manque pas : elle est toujours présente, pas seulement en photo au-dessus de ma table de travail, mais un peu partout, et son André avec pour faire la douce paire.
MÉDIATION. - La lecture de Shakespeare est un révélateur de la complexité humaine, que l’éclairage de René Girard met admirablement en valeur, prouvant qu’une intelligence actualisée peut en revivifier une autre plus ancienne, même si le génie du Big Will a quelque chose d’intemporel et qui anticipe souvent notre vision. Shakespeare, et il faudrait dire Dante avant Shakespeare, Eschyle avant Dante et Homère avant Eschyle, sont à la fois nos maîtres anciens et nos vigies.
À La Désirade, ce 1er janvier 2017. - Je me réveille sur la réalité des bilans. Or je me dis ce matin, après avoir classé la trentaine de grands cahiers chinois dans lesquels j'ai collé tous mes papiers depuis 1969, et repris hier soir la centaine de carnets aquarellés de mon journal, que celui-ci est devenu aussi pléthorique que celui d'Amiel, avec d'égales qualités de porosité et d'expression. En 2016, j'aurai rédigé quelque 300 pages, à quoi s'ajoutent les 300 pages de ma nouvelle série de Pour tout dire.
Sur dix ans j'aurai bien écrit 2000 à 3000 pages de ce journal, et sur 20 ans cela devrait en faire le double ; et comme je rédige ces carnets depuis 1965, de manière sporadique, et quasi quotidienne depuis 1975, dactylographiés depuis le début des années 80, l'ensemble doit approcher des 10.000 pages du Journal intime d'Amiel avec quelque chose des Riches Heures dans la présentation que n'a pas le manuscrit du cher diariste puisque mes carnets sont bonnement enluminés d'images et de peintures. Or je ne me flatte pas plus qu'un pommier qui compterait ses cinquante saisons de pommes mûries et tombées, pourries ou cueillies: je constate.
ARCHIVES. - J’arrive au bout de mes classements et de l’inventaire de la partie (principale) de mon fonds que je transmettrai sous peu aux Archives littéraires de la Bibliothèque nationale, et j’en suis à la fois soulagé et un peu sonné.
Cet exercice m’a aidé à évaluer le chemin parcouru, ses acquis et ses impasses ou ses lacunes paresseuses, tout en me donnant un nouvel élan pour la «suite», si tant est que suite il y ait vu ma santé un peu chancelante, mon souffle raccourci et mes jambes douloureuses, mes problèmes d’oreille interne et autres désagréments de l’âge...
FÉCONDE ILLUSION. - Notre vie est peu de chose, pourrait-on dire, et de plus en plus l’âge venant, et pourtant c’est énorme: non seulement c’est tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes mais tout ce que nous deviendrons, etc.
Toute ma vie, et d’autres vies parallèles, possibles ou interrompues, me sont réapparues en brassant les papiers de cinquante ans d’existence à la fois irrégulière et suivant une ligne continue, conduite par une espèce d’instinct et d’«illusion vitale», selon l’expression d’Ibsen.
LIMITES DU DICIBLE. - Les réflexions d’Annie Dillard dans En vivant en écrivant (The writing life) sont à la fois limpides et comme nimbées de mystère, voire parfois d’obscurité, tout à fait en consonance avec l’obscure clarté de certaine Remarques de Wittgenstein – comme s’il était impossible, voire illusoire, de dire ce qui doit être dit à cet égard, et plus encore de l’écrire.
AM I A WRITER ? - Je souris en lisant ce qu’écrit Annie Dillard du jeune étudiant qui demande à un auteur en vue s’il pense qu’il pourrait être lui aussi un écrivain.
Eh bien, répond l’auteur en vue, je ne sais pas, aimez-vous les phrases ? On imagine la surprise de l’étudiant, qui doit se demander quel rapport il y a avec sa propre question.
Alors Dillard de conclure. «À cause de sa jeunesse, il n’a pas encore compris que les poètes aiment la poésie et que les romanciers aiment les romans, alors que lui n’aime que le rôle de l’écrivain, sa propre image en chapeau».
Cette image du chapeau me faisant penser à ceux-là qui posent, en chapeau justement, à l’écrivain. Tout cela relevant de l’ambiance et du décorum plus que de la chose…
DU ROMAN. - Le roman comme suite du journal par d’autres moyens plus ouverts à la discussion. Le roman comme une dispute au sens ancien. Le roman comme une métaphore en mouvement. Le roman comme une exploration de la réalité multiple – on dira le multivers. Le roman comme une sonde virtuelle du numérique. Le roman comme un tour du monde autour de ma chambre. Le roman comme intégration et dépassement des autres genres par synthèse panoptique, etc.
COUP D’ÉTAT. - Il y a, dans les menées de Donald Trump et de son entourage de milliardaires, quelque chose du coup d’Etat des grandes entreprises qui semble inédit dans les annales de la ploutocratie mondiale, en tout cas sous son aspect de prétendue démocratie invoquant le peuple, insultant les médias et déformant les faits à sa guise.
DE L’INSPIRATION. - Songeant à la poésie, je me dis que la notion d’inspiration correspond bel et bien à une réalité, comme le relève Peter Sloterdijk, sans donner, forcément, dans la mythologie romantique – de fait il y a là, dans l’ordre du verbe et des imprévus du langage, quelque chose qui dépasse l’atmosphère sentimentale du XIXe siècle, relevant du temps humain qui transcende cultures et individus, du fonds de chaque idiosyncrasie et surtout du tréfonds où se constitue le langage. Et si ce tréfonds, relevant du langage d’avant la langue commune, se trouvait le mieux exprimé par l’espéranto de la très prime enfance ?
Ce mardi 28 février. - La poésie, ou plus exactement ma poésie, et la peinture, ma peinture, m’attendent au coin du bois, et je pense à elles tout le temps sans leur accorder assez de mon énergie et de ma présence. Je me laisse trop souvent et facilement distraire par tout et n’importe quoi, mais je m’en vais tâcher ces prochains temps de faire mieux revenant, joyeusement, à mon centre de gravité – gravitation allègre du mot pour un autre et de la couleur appariée.
WORDS, WORDS, WORDS. - La qualification de nihiliste m’ennuie, autant que celle d’athée. Je regimbe même devant le terme d’agnostique, et la notion d’incroyant n’est rien à mes yeux que négation, mais celle de croyant ne m’en impose guère plus. Vraiment je ne saurais me situer par rapport à ces notions par trop étriquées à mes yeux.
Or celle qui me conviendrait encore le mieux serait, peut-être, de chrétien mécréant - à l’instar d’un Théodore Monod. Et voici qu’un enfant nous est promis, par l’une de nos filles, en automne prochain. Or je crois à cela surtout : la vie augmentée qu’investit l’esprit saint…
Ce mercredi 1er mars. - Je viens d’achever ma traversée des 37 pièces de Shakespeare et leur annotation, que je vais développer encore par le truchement de maintes observations complémentaires en rebondissant, notamment, sur ma lecture de Will le Magnifique de Stephen Greenblatt, dont l’approche du Good Will est aussi nourrie et passionnante que les aperçus sur son entourage, la fortune et l’infortune de son père, les pièges de la religion et des mœurs de l’époque, enfin chacune des œuvres replacées dans le temps et les circonstances.
CONTINUUM. - Tu dois changer ta vie, me dis-je tous les jours, comme je me le disais à dix-sept, dix-huit ans, me reprochant déjà mon inconstance et ma dispersion entre trop de choses et d’autres, mais à présent l’urgence se fait plus durement sentir qu’alors vu l’âge qui passe, etc.
J’essaie du moins d’être bon et d’ajouter chaque jour deux ou trois belles choses aux traces éparses que je laisse en écriture ou en peinturlure, qui témoigne tant soit peu de ma quête continue.
CE QUI S’EXPOSE. - Peter Sloterdijk à propos de Rilke et de son sonnet intitulé Torse archaïque d’Apollon, inspiré par Rodin et dont le dernier vers conclut abruptement sur le fameux «Tu dois changer ta vie», cite Paul Celan («La poésie ne s’impose plus, elle s’expose») et conclut : « L’œuvre d’art peut même, à nous, les défroqués de la forme, «dire» encore quelque chose, parce qu’elle n’incarne manifestement pas l’intention de nous étouffer (…) Ce qui s’expose soi-même et a fait ses preuves dans l’épreuve acquiert une autorité dénuée d’arrogance».
ANOTHER DREAM. - Drôle de rêve cette nuit, de la roue à sortir du temps. Une petite fille se trouvait dans la nacelle d’une grande roue comme celle du Prater de Vienne, qui m’invitait à monter à bord. La roue commençait alors à tourner, de manière de plus en plus impérative et vertigineuse, et la petite fille avait disparu quand je me suis retrouvé dans une autre dimension de la ville dont j’ai compris qu’elle se situait hors du temps, etc.
Ce 1er avril. - La blague serait que Donald Trump ne fût qu'une farce de 1er avril, mais la réalité de cette mascarade risque de durer plus longtemps, et que s’aggrave ce qui est à prévoir par l'imprévisible annoncé. Le pire n'est pas atténué quand il s'affiche, et le ton de la chanson ne trompe pas en l'occurrence même relevant de la forfanterie narcissique et de la goujaterie provocatrice.
Pas moins hideux qu'un Poutine en tenue de motard roulant les mécaniques (mais cette affirmation de la Force me semble moins perverse il me semble chez le Russe), le bateleur à groin laqué de la Maison-Blanche inquiète précisément par sa propre revendication de l'imprévisible, genre Néron fardé et chef de guerre de télé-réalité. Reste à savoir s'il n'est qu'un leurre de façade, et qui tire alors les ficelles du pantin, ou si sa folie parano entraînera ceux qui le manipulent à pire qu'il ne saurait faire seul ?
Une belle âme s'étonnait l'autre jour que nous projetions de nous rendre sous peu aux States tant que ce monstre poudré y règne, mais quoi encore ? Que ne faudra-t-il pas pour dorloter nos bonnes consciences ?
SUR L’AMITIÉ. - Proust se méfie de l'amitié, et comme je le comprends. Ce que Voltaire en dit est d'une justesse un peu amère mais non moins utile à titre préventif: «Mon Dieu gardez-moi de mes amis; quant à mes ennemis je m'en charge».
Pour ce qui me concerne cependant je n'ai pas eu à affronter de vrais ennemis, et quant à mes amis je leur suis resté fidèle tant qu'ils ne me forçaient pas à me trahir au nom, précisément, de l'amitié.
RELATIVISME. - La première fois que je suis revenu des States, en 1981, tout m'a semblé comme réduit aux proportions d'un modèle réduit, mais c'est dans le métro de Tokyo, quelques années plus tard, qu'une autre sorte de modification, d'ordre physique et psychique à la fois, m'a confronté à la relativité de ce que représente notre infime personne à la mesure vertigineuse des deux infinis. Autant dire que je m'attends à d'autres vacillements prochains.
Or je retombe à l'instant sur cette note prise à La Nouvelle-Orléans en janvier 1981, qui me semble se situer dans un juste rapport aux choses : «Sur un mur en lettres immenses il est écrit: THE CHURCH THAT BINGO BUILD. Et plus loin: INVEST YOUR MONEY IN GOD.
Entre les deux inscriptions se tient, sur le trottoir, une créature décharnée aux orbites creuses et aux bras tuméfiés de cent stigmates bleu et noir, dont le caddie contient tout le bien».
Ce 7 avril. - Mon frère Pierre aurait eu 75 ans aujourd’hui, et j’en aurai 70 dans deux mois. C’est à n’y pas croire. Serions-nous plus proches s’il avait survécu ? Je me le demande. Ce n’est pas sûr, mais le contraire ne l’est pas non plus. Et notre père ? Oui, sans doute, je me serais encore rapproché du vieil homme, et de notre mère aussi probablement. Quant à moi, j’espère être encore de ce monde quand le premier enfant de nos enfants naîtra, en octobre prochain, en espérant que nos autres enfants connaîtront eux aussi cette joie et nous permettront de la partager.
DE L’ATTENTION. - L'exercice de la notation , autant que le journal intime où les carnets volants, est le plus souvent tenu pour un art mineur, mais comment ne pas voir que tout part de ces traces de mains aux parois de Lascaux ou d'Altamira, me disais-je hier en (re)lisant les pages des Jeunes filles en fleur ou le peintre Elstir raconte, dans son atelier plein de ses marines, ce que dit vraiment le porche roman de l'humble église de Balbec si mal observée par son jeune interlocuteur; et les pages consacrées à ce début de temps retrouvé constituent l'exemple même de l'exercice d'attention auquel j'entends me plier aux States en m’efforçant d'échapper aux clichés qui ne disent rien.
Pâques 2017. - Quand on lui demandait l'heure qu'il était, Ella Maillart répondait: il est maintenant ; et maintenant que Pâques se lève sous un ciel de tout le temps, je retrouve mes notes prises à La Nouvelle-Orléans le lendemain du Nouvel-An de mes 33 ans, une année pile avant de retrouver un flirt de nos dix-huit ans, ma bonne amie, alias Lady L., que je n’ai plus quittée jusqu'en ce jour où nous bouclons nos valises pour rejoindre, en Californie, la première de nos deux infantes qui avait trois mois à la mort de mon père il y a de ça 33 ans et des poussières - mais comment dire tout ça dans le transit temporel chahuté de nos vies ?
PROFOND AUJOURD’HUI. - Nous débarquerons demain à San Diego, dont le nom rappelle la colonisation catholique de la Côte ouest, et nous passerons notre première nuit en vue du port militaire plus que jamais en exercice, non sans penser aux nouveaux dangers que laisse craindre, plus qu'au temps de l'intronisation du cow-boy californien, le nouvel Ubu de la ploutocratie impériale - cependant nous nous réjouissons de vivre l'aujourd'hui de demain en notre fugace temps humain...
ON THE CLOUD. - J'avais 33 ans cette année-là et je prenais au stylo des notes que je recopiais sur mon Hermès Little Boy a capot cabossé, sans imaginer qu'un jour nous skyperions et grappillerions nos impressions sur nos smartphones avant de les balancer sur le Cloud.
CONTRE LE VOYAGE. - Je me suis dit cette nuit en subite lucidité d'insomnie, entre trois et quatre heures du matin, que jamais je n'aurai vraiment aimé le voyage.
Voyager est assommant, me suis-je dit. La vogue actuelle des récits de voyage m'insupporte presque autant que l'irruption d'un paquebot américain dans la lagune vénitienne, et je me suis rappelé cette nuit que jamais je n'aurai vraiment su voyager faute d'oser aborder les gens et de savoir me décarcasser sans argent.
Il y a plus de cinquante ans que je me joue la comédie d'aimer ça mais à présent ça suffit: je vais donc essayer vraiment de noter ce que je ressens sans exagérer ni dans le sens de l'exaltation ni moins encore dans celui de la déploration morose, juste dire ce qui est et comment c'est - juste se rappeler ce qui a été et comment cela n'en finira qu'à la fin du tour du jardin.
Une certaine année, notre père a constaté qu'il ne pourrait plus désormais faire le tour de son jardin, et ce fut ensuite comme s'il s'éloignait de nous et de lui-même, sans un mot pour l'exprimer, mais je revois son regard, et son silence me parle toujours.
Je me rappelle aussi leurs voyages de retraités en divers pays lointains, malgré sa maladie à lui, ses multiples opérations et ses angoisses à elle, tous deux curieux d'Italie ou de temples mexicains, remuant leurs vieilles nageoires dans les lagons ensoleillés des Antilles ou les baignoires de boue israéliennes, ne dédaignant ni les groupes ni les troupes et revenant fatigués mais heureux, selon leur expression, comme des milliers et des millions de voyageurs organisés que pour ma part j'ai toujours fuis.
Ce qu'il y a de pire dans le voyage c'est de voyager seul, mais voyager à deux n’est souvent qu’un enfer augmenté. Voyager seul, quand on ne sait pas bien s'y prendre, relève au départ du cauchemar angoissant, car il faut partir et l'on fait mine à soi-même de s'en réjouir, après quoi ce ne sont que tracas jusqu'au moment où l'on a posé ses affaires et qu'enfin l'on se retrouve là, peu importe où, que ce soit en Andalousie ou au Japon, dans ce pub de Sheffield où sur les crêtes de haute Toscane, et là c'est comme partout: je suis chez moi comme partout et je ne suis plus que reconnaissance devant cela simplement qui m'attendait en silence. Et dans cet état chantant voyager seul, à deux ou plus si affinités, redevient une grâce...
Je décrie le tourisme en cela qu'il est le contraire du voyage quand il se fait à la masse. Le Grand Tour de jadis était une découverte de chaque jour, et lente, et fervente, tandis que l'évasion de la meute est invasion distraite et pillage d'images et simulation festive ou festivalière - à vomir de plaisir.
ALORS VIRGILE : « Ici pourtant tu pourrais reposer avec moi cette nuit, sur le feuillage vert. J’ai pour nous des fruits mûrs, des châtaignes fondantes, du lait caillé en abondance. Dans le lointain déjà fument les toits des fermes et du sommet des monts tombent en grandissant les ombres ».