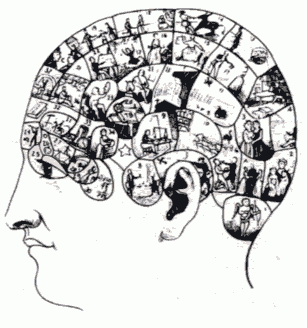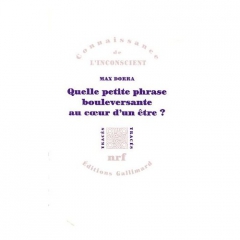Les fulgurants paradoxes d'Annie Dillard
D'innombrables livres actuels ne visent qu'à l'évasion et à l'oubli du réel, tandis que ceux d'Annie Dillard nous y ramènent à tout coup, et particulièrement cet ensemble fascinant de fragments et variations sur de mêmes thèmes que constitue Au présent.
Mais attention: le réel d'Annie Dillard n'a rien à voir avec ce qu'on appelle «le quotidien», entre psychologie de sitcom et plaisirs minuscules. Ce que son regard isole est à la fois réel et inconcevable, qui renvoie au grand pourquoi de toute chose et au comment vivre la vie qui nous est donnée. Pourquoi par exemple y a-t-il au monde, nom de Dieu, des nains à tête d'oiseau, nos frères humains avérés dont les rares qui ne meurent pas en bas âge peuvent atteindre 90 centimètres? Eh bien, au nom même de Dieu, le Talmud stipule une bénédiction appropriée à chaque personne atteinte d'une malformation congénitale. Ainsi sera-t-il recommandé de bénir la naissance de l'enfant à fentes brachiales de requin et à longue queue, le bébé frappé du syndrome de la marionnette («apparemment, prévient le médecin, le rire n'est pas lié à un sentiment de joie») ou le nourrisson sirénomèle qui n'a qu'une jambe et dont le pied est tourné vers l'arrière.
Evoquant le silence professionnel qui entoure de telles naissances, Ernest Becker, cité par l'auteur, affirme que «si l'homme devait appréhender pleinement la condition humaine, il deviendrait fou». Or l'homme loue Dieu. Saint Paul écrit aux chrétiens de Rome: «Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien.» Ce qui fait bondir Dillard: «Et quand donc, au juste? J'ai raté ça.» Et d'ajouter qu'au fil de ses longs voyages autour du monde elle a «vu les riches fermement établis renvoyer les affamés les mains vides», alors que tous, pêle-mêle, se partageaient biens spirituels et déboires physiques en toute injustice «divine»...
Est-ce à dire qu'Annie Dillard rejette toute divinité et toute spiritualité? Au contraire, elle y puise et y plonge à tout instant, avec une sorte de jubilation mystique qui la rapproche de Teilhard de Chardin (l'un de ses champions avec le Baal Shem Tov des Hassidim) qu'elle cite à tout moment dans ses pérégrinations paléontologiques ou ses visions prémonitoires (longtemps interdites de publication par l'Eglise). Passant sans transition d'une histoire naturelle du sable ou de l'observation des nuages à l'évocation du parking jouxtant l'étable légendaire où le Christ gigota, des sacrifices humains consentis par le premier empereur de Chine autant que par Mao à l'accouplement des martinets en plein vol, des statistiques dont on ne peut rien faire («parmi les 75 bébés nés aujourd'hui aux Etats-Unis, un trouvera la mort dans un accident de voiture») au paradoxe apparent d'un Dieu tout-puissant qui n'en demande peut-être pas tant, Annie Dillard ne cesse de nous déconcerter et de nous bousculer, mais aussi de nous remplir les poumons du souffle de sa pensée et de sa parole.
Grande voyageuse au propre et au figuré, reliant à tout moment les deux infinis pascaliens, le froid glacial du cosmos et les nappes ardentes de la vie animée, l'empilement des strates d'occupation humaine (soixante couches dans la grotte française de la Combe Grenal) et le présent multiple qu'elle vit et que nous vivons au même instant, cette aventurière de l'esprit a précisément le mérite de nous rendre le monde et notre vie plus que présents.
Annie Dillard, Au présent. Traduit de l'anglais par Sabine Porte. Christian Bourgois, 220 pp.