… Non, je ne vois aucune beauté dans la guerre, nulle ruine ne sera chantée, mais ton geste est plus fort que la mort, ta grâce déploie partout le ciel pur ce matin des faucons assassins, tu as lavé le ciel de tes larmes et tu as lavé le sang de la terre, l’odeur de phosphore demeure mais le ciel se reflète en toi…
Image Philip Seelen
-
-
La saga de Lady Blues

Alain Gerber a ressuscité Billie Holiday entre dèche, gloire et passions, sur les ailes de la musique. Il vient de publier un nouveau pavé, chez Albin Michel, simplement initulé Blues.
La figure fascinante de Billie Holiday (1915-1959), mélange de fragilité et de violence, de grâce et de trouble, dont la sensibilité catastrophique aura marqué sa voix sans pareille et précipité ses multiples casses, est inséparable d’une destinée dont elle-même a tissé (ou fait tisser) la légende dans Lady sings the blues. On connaît les grands traits de la vie, fracassée par la drogue, de la plus grande chanteuse de blues du XXe siècle, que seule la musique aura sauvée de ses démons, jusque dans ses apparitions les plus pathétiques. Déjà largement documentée, notamment par Donald Clarke dans Wishing on the Moon. The Life and Times of Billie Holiday (Viking Press, 1994) et par Christian Gauffre dans un CD-livre référentiel (Billie Holiday, Vade Retro/Jazz Magazine, 1995), la vie passionnée et la passionnante carrière de Lady Day (comme l’appela Lester Young qui l’aima et la fuit à l’apparition de la première seringue) a en outre inspiré maints auteurs, dont un Marc-Edouard Nabe, et tout récemment encore paraissait une nouvelle « évocation » biographique de Véronique Chalmet, à la fois claire et sommaire, confortant la légende plus que ne l’éclairant de nouveaux aperçus.
Si paradoxal que cela puisse paraître, c’est cependant par le biais de la fiction en pleine pâte, il est vrai fondée sur une immense connaissance du jazz et de son histoire, que le plus « américain » des romanciers français, Alain Gerber réinvestit le monde de Billie Holiday et de ses proches, qu’il fait parler en alternance. Billie elle-même, tantôt canaille et bouleversante, évoquant un personnage « noir » de Chester Himes ou Ring Lardner, mélange de femme-enfant blessée et de furie, d’artiste et de sorcière, est « vécue » de l’intérieur par le romancier, comme l’est aussi Sadie la mère douloureuse, à laquelle sa fille se reproche d’avoir « planté cette putain de seringue dans le cœur ». Au même premier rang des présences les plus vibrantes, tant du point de vue existentiel et affectif que pour sa relation au jazz, Lester Young nous en apprend aussi beaucoup sur la quête éperdue de Billie et sur ses regrets d’avoir négligé sa Lady, tout à sa « musique über alles », cette « fille qui se roule les yeux doux toute seule, qui trinque toute seule, qui danse doute seule, qui s’épouse toute seule et fait la noce toute seule dans son coin, Makin’Whopee… ».
Mais cette « histoire d’amours » mêlant le sordide et le sublime, la prescience enfantine de la mort (qu’Alain Gerber nous dit avoir vécu lui-même avec une intensité foudroyante, et que Billie découvre avec sa mémé Mattie qui la terrifie en essayant de l’entraîner dans la tombe…) et la découverte précoce de l’abjection humaine, d’un bordel l’autre, se déploie et se nuance aussi par les comparses d’un récit à multiples voix, dont celle de la journaliste-romancière noire Melissa, par contrepoint, éclaire de sa lucidité le « rêve américain », qu’elle juge « grossier et primitif », autant que le mentir-vrai de Billie dans ses confessions à William Dufty, véritable auteur de Lady sings the Blues…
« Je ne suis pas poète, nous dit Alain Gerber, mais ce qui m’a quand même intéressé dans le roman, c’est de faire dire aux mots ce que les mots ne sont pas capables de dire. C’est d’ailleurs la définition qu’on donne de la musique...»
Or le romancier torrentiel du Faubourg des coups-de-trique et du Plaisir des sens, entré en littérature sous le patronage de Faulkner, Hemingway et Thomas Wolfe avec La couleur orange (premier titre, datant de 1975, d’une œuvre qui en compte vingt-cinq et vingt autres recueils de nouvelles ou d’essais sur le jazz), donne sa pleine mesure dans la saga de Lady Day. Après les figures de Louie (Armstrong), Chet (Baker) et Charlie (Parker), celle de Billie Holiday revit magnifiquement en dépit de la distance séparant le modèle déjanté de son peintre : «Je vois ces gens vivre et se défoncer, je ne vis absolument pas leur vie de dingues, mais j’essaie néanmoins de les rejoindre en écrivant. De la même façon, je fais de la batterie depuis plus de quarante ans, et je ne suis toujours pas fichu de jouer. Jouer de la musique est un truc tellement mystérieux, au sens le plus fort, presque au sens religieux »…
Or il y a bel et bien du feu sacré dans la passion vouée par Alain Gerber aux gens autant qu’à la musique. Passion communicative…
 Alain Gerber. Lady Day. Fayard, 609p.
Alain Gerber. Lady Day. Fayard, 609p.
Véronique Chalmet. Billie Holiday. Payot, 198p. -
Ceux qui parlent en dormant
Celui qui est sous l’eau / Celle qui rêve à la Ville Sainte / Ceux qui font la paix dans le désert blanc / Celui qui parcourt tous les Calvaires d’Espagne / Celle qui drague entre les tombes / Ceux qui s’estiment les Remparts du Bien Foncier / Celui qui ne supporte pas l’odeur des tenniswomen / Celle qui fait ses lessives en tenue de latex / Ceux qui refusent l’absolution de l’évêque Boubacar Lomé invité à la chapelle des Augustines / Celui qui joue du banjo pour sa cousine trisomique / Celle qui a calculé que le ventilateur la décapiterait avant Minuit / Ceux qui fument de l’opium au Danemark / Celui qui sait tout du Grand Sylvain / Celle qui prétend avoir connu Soubise et ses oignons dans une vie antérieure / Ceux qui ont des fesses à la douceur de bourses en pis de chamelles / Celui qui légifère en fonction des avancées de son cancer du pylore / Celle qui pique les fleurs en papier de la salle d’attente du Docteur Belouga / Ceux qui se font tartir au bord de la mer Caspienne / Celui qui exterminait les hannetons du Champ Dessous au printemps 1955 / Celle qui tire la langue à l’abbé Charrat / Ceux qui se sont rencontrés à l’Amicale des éleveurs de vers à soie / Celui qui rêve d’emballer la caissière bègue de la COOP / Celle qui découvre que le Centre de sophrologie de V. est un vecteur de rencontres échangistes / Ceux qui hantent les tea-rooms de veuves encore faisables / Celui qui fait observer à sa voisine de palier Nadine Cruchon que la pie jacasse elle aussi mais est fidèle / Celle qui croyait que Nadine était une gousse / Ceux que Nadine Cruchon a déçus / Celui qui a repeint son violon aux couleurs de l’Equateur / Celle qui a envoûté Beckham par télépathie afin qu’il marque contre l’Equateur / Ceux qui n’ont jamais su où se trouvait l’Equateur ni les Pouilles / Celui qui a passé toute son enfance dans une township / Celle qui répertorie les blogs sataniques / Ceux qui rompent le pain de l’amitié, etc. -
Au niveau du chien
Où le chien Fellow se livre à des révélations sur sa vie antérieure. Qu’un voeu sincère est parfois exaucé par le Créateur. Des conseils adressés par le chien à ses maîtres.
Cette odeur de soupe à la courge m’a rappelé quelque chose de mon autre vie, à l’époque refoulée du vieux dégoûtant, lorsque j’allais me réfugier chez la Zia. Comme à l’ordinaire, cependant, cela reste confus à l’état de veille; je suis trop plein de cette odeur ronde et dorée qui m’est venue par lampées de la table. Ce n’est qu’en dormant que je ferai revenir les images, mais pour le moment attention: voilà du nouveau.
Cela provient de la cuisine. Monbijou, une fois n’est pas coutume à midi, donne dans la viande préparée. Elle a mis son tablier et Belami chantonne sur la table. Tout à l’heure, me touchant du bout d’un pied, il a sursauté, puis sa main m’a caressé et je l’ai entendu dire affectueusement «Well, mais voilà mon vieux Fellow!», puis il m’a pris entre ses jambes et je me suis laissé faire comme un bon chien à son maître.
Je n’ai d’ailleurs pas à faire semblant, puisque bon chien je suis en effet, à proportion des soins attentifs qui me sont prodigués par mes maîtres; et j’y suis d’autant plus sensible, en y songeant au cours de mes longues après-midi solitaires, que le souvenir de ma vie passée se trouve comme exalté par mon nouvel état.
Une précision biographique s’impose alors: je fus une orpheline attouchée par un vieux dégoûtant, puis une fille angoissée que le corps des beaux garçons rapprochait de Dieu, puis une étoile montante de l’art lyrique des années 1890, puis une diva réclamée sur toutes les scènes, et Dieu me combla jusque post mortem puisque aussi bien Il savait, comme je le répétai maintes fois aux journalistes, que je rêvais de me réincarner sous la forme d’une petite chienne, si possible anglaise. Au demeurant, que cette nouvelle vie qui m’est accordée le soit dans la peau d’un mâle écossais ne m’a jamais fait problème; et de mon point de vue actuel non plus: rien à redire au fait qu’une partie de mes souvenirs soient d’un soprano colorature au nez de gourmet et dont la mémoire des yeux est une véritable Laterna Magica.
Lorsque Monbijou réapparaît dans ma zone d’observation, tandis qu’un cliquetis de vaisselle se fait entendre là-haut, c’est comme le bouquet d’odeurs d’une maison entière qui me revient: ce sont les rôtis des dimanches de la Zia, les dimanche heureux durant lesquels le vieux dégoûtant me laissait tranquille, tout occupé qu’il était par les Affaires du Ciel; et la Zia me consolait: «mais non que tu n’es pas une chienne, chante-moi plutôt quelque chose...» Car à l’époque seule la Zia était sensible à ma voix, tandis que le vieux dégoûtant n’y voyait que ruse du Mauvais.
Le vieux dégoûtant voyait le mal partout, et comme, adolescente, j’attirais tous les garçons du bourg, il ne cessait de me traîner à confesse et de m’obliger à lui mentir afin qu’il pût me châtier selon son penchant. En outre, je le répète, le vieux dégoûtant ne considérait pas d’un bon oeil le don de la nature qui faisait de ma voix celle que les foules allaient adorer dans mes années de célébrité. Bref, le ressouvenir de l’odeur de rat crevé du vieux dégoûtant me soulève le coeur, tandis que celui des parfums de la Zia me ramène à ceux de mes maîtres actuels, la sainte alliance Hermès et Guerlain plus les essences de santal de Dark Lady et le Chipie de Sweet Heart.
Je savoure donc ma vie actuelle. Et c’est cela, soit dit en passant, que je m’efforce de dire et de répéter à mes maîtres du fond de mon regard et par toutes les ondes dont je les enveloppe comme d’écheveaux de tendresse: savourez, savourez mieux, savourez encore mieux le moment qui passe et trépasse
A cet égard, je suis obligé de constater les incessants progrès de Belami sur les voies de l’insouciance et de la paresse sybaritique, tandis que Monbijou continue de s’inquiéter et de se soucier, de prendre sur elle tout le faix du monde et d’en redemander s’il vous plaît. Bref il n’est pas de jour où je ne m’associe occultement à Belami pour souhaiter que de temps à autre Monbijou se laisse aller au divin je m’en fichisme de l’étoile et de l’oursin.
En attendant j’aime à les promener tous les jours et je rends grâces aux odeurs de partout. J’aime aussi me vautrer auprès des demoiselles et recevoir leurs hommages qui me rappellent les câlineries des mes admiratrices dans ma loge de la Scala, quand elles arrivaient par troupes et me submergeaient de compliments et de baisers. Comme il est doux, quand Belami cesse enfin de rester à sa table à faire je ne sais quoi, qu’il branche son AZ 9055 Philips et qu’il me rejoint dans le salon pour se délecter à l’écoute d’Amadeus ou de Puccini, comme il est doux de se repasser ainsi ses vies.
Je sais maintenant qu’il suffit de s’en rêver une pour l’avoir. Or si Dieu me prête une autre vie encore, je voudrais retrouver bientôt mes maîtres dans un nouveau cycle d’avatars mais d’égal degré, afin que les relations en soient facilitées. Ne ferions nous pas de charmantes otaries à nous cinq ? Ou pour de plus longs périples, la vie de baleine à bosse ne nous conviendrait-elle pas mieux encore ?
De ma place sous la table je vois, à l’instant, leurs pieds se trouver, qui se sont cherchés quelque temps. Je sens qu’ils viennent de prendre la bonne décision. Dans un instant il y aura de belles odeurs de corps se partageant l’élixir d’amour. O que de douces remémorations l’apparition des corps nacrés entretient en ma mémoire italienne d’Ecossais à courtes pattes ! O que j’aimais m’allonger dans ma vie passée, après la griserie des salles bondées, sous la dure cambrure d’un choriste de Cavalleria rusticana, et combien j’approuve aujourd’hui les soupirs de mes maîtres, quels bons chiens ils sont quand ils se couchent...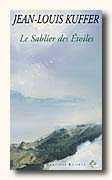 Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le sablier des étoiles, paru chez Bernard Campiche en 1999. Elle a été inspirée par le chien Fellow, alias Filou, qui a quitté ce monde dans la matinée du 16 septembre 2009.
Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le sablier des étoiles, paru chez Bernard Campiche en 1999. Elle a été inspirée par le chien Fellow, alias Filou, qui a quitté ce monde dans la matinée du 16 septembre 2009.

-
Au nom de Claire

Anne Wiazemsky revisite le grand amour de sa mère
ROMAN Dans Mon enfant de Berlin, la romancière rappelle que « la fille de Mauriac » fut surtout une femme remarquable.
C’est un livre à la fois intéressant et très attachant que Mon enfant de Berlin d’Anne Wiazemsky, dont le nom ne lui a pas fait vivre le sort de sa mère trop souvent réduite à être considérée comme « la fille de Mauriac ». Attachant, ce récit « romanesque » l’est par son ton et la tendresse qui le traverse, découlant de l’affection mais aussi de l’admiration qu’Anne Wiazemsky voue à une femme subissant encore le poids d’une société bourgeoise patriarcale où les parents exerçaient une forte pression pour « bien » marier leurs enfants, et particulièrement leurs filles. Or Claire Mauriac, chaperonnée par des parents qu’elle voussoie, aurait dû épouser un certain Patrice, bien sous tous rapports, quand la guerre survint et, pourrait-on dire, « libéra » la jeune fille de son milieu. Engagée dans la Croix-Rouge française, elle vécut ainsi une fin de guerre à la fois mouvementée et intense, même dangereuse quand elle donna sa pleine mesure dans les ruines de Berlin où, du même coup, le destin lui fit rencontrer l’homme de sa vie, Yvan Wiazemski, Russe de naissance, surnommé Wia par tout le monde et dégageant immédiatement un charme fou.
Pour raconter la lumineuse histoire d’amour, sur fond de décombres, qu’auront amorcée ses parents en 1945, Anne Wiazemsky entrecroise les fils narratifs des tribulations de Claire, vue de l’extérieur et des citations de son journal intime ou de lettres échangées avec les siens, surtout avec sa mère. Par ailleurs, on imagine les récits de Claire à sa propre fille, qui nourrissent une autre part intéressante du roman, touchant à la situation des Berlinois (et surtout des Berlinoises !) à l’arrivée des Russes vengeurs et violeurs. Or la lumière, plus que les ombres, baigne ce beau roman « pour mémoire ».
Anne Wiazemsky. Mon enfant de Berlin. Gallimard, 247p.
-
Fellow’s Blues

…Il regardait vers la forêt, ce matin, comme jamais, comme s’il voyait LA forêt, et la mer derrière la forêt, et le désert au-delà de la mer et le ciel au-dessus des arbres, il ne nous entend plus depuis quelque temps ni ne nous voit plus bien non plus, mais ce matin il regardait là-bas et il voyait quelque chose qui ne nous apparaissait pas, il entendait quelque chose que nous n’entendions pas, on eût dit que sa plainte était un appel à Dieu sait qui ou quoi ?
Image : Philip Seelen


