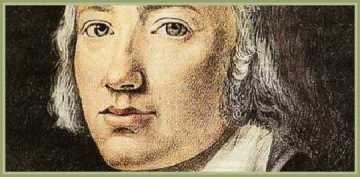La saga de Dylan selon François Bon
On se dit d’abord qu’il attige la moindre, François Bon, en commençant de lire sa chronique biographique de Bob Dylan, quand il se demande par exemple comment il est « donné à un garçon de vingt et un ans d’incarner, avec seulement l’écriture et la voix, cette secousse historique d’un monde», avant d’évoquer, à propos des récentes Chronicles du sexa, l’écrivain nomade avant la lettre que fut Jehan Froissart… Mais dès qu’on s’y coule, dans ce grand livre chaleureux et charpenté à fines chevilles, la crainte d’un excès d’emphase, s’agissant d’un mythe et plus encore, pour toute une génération et plus encore, s’efface dans la matière d’un roman qui m’a aussitôt rappelé l’Amérique lyrique de Thomas Wolfe (pas le Tom Wolfe aux guêtres blanches : le géant de Look homeward, Angel) ou, plus près de nous, et dans cette autre filiation, les romans de jazz d’Alain Gerber. D’emblée, comme celui-ci, François Bon rappelle ce que fut pour nous autres «petits provinciaux», et plus encore que lui les contemporains exacts de Dylan qui ont découvert les premiers rockers (Bill Haley & his Comets, Elvis ou Buddy Holly notre premier deuil avant James Dean…) ce que fut cette Amérique rêvée sur nos transistors puis avec la première TV en noir et blanc, merveilleusement évoqués dans le Radio Days de Woody Allen (cité par FB), entre autres emblèmes mythologiques des fifties finissantes.
« C’est soi-même qu’on recherche», écrit François Bon à la première ligne de son introduction, « et c’est en se cherchant soi-même qu’on trouve Bob Dylan installé. Vieux compagnon, compagnon sombre. Parfois énervant, toujours instable. Ce n’est pas le meilleur côté de nous-mêmes, celui par quel il nous touche ».
Et comme c’est vrai, me dis-je à l’instant en écoutant nasiller le Dylan de 64 sur All I really want do to, qui m’évoque un vieux frangin d'Amérique à drôle de dégaine, combien touchant en effet avec ses yeux bleus et sa gueule d’ange mal coiffé tombé de nulle part.
Or le nulle part d’où débarque le futur Dylan (dont le pseudo découle à la fois de la lecture de Dylan Thomas et de la contraction de deux autres pseudos possibles) fonde entre Duluth, le nulle part des migrants et des mines, et Minneapolis, première vraie ville du jeune Bob, la préhistoire « épique » du récit-roman de François Bon, clair et vif, nourri de diverses bios antérieures mais porté par un ton et des traits personnels, éclairé de surcroît par l’ « autre bout », puisque FB cite volontiers les Chronicles, à découvrir dans la foulée se promet-on...
Mais bon, là, je n’en suis qu’à la page 105 et j’ai déjà l‘impression d’avoir traversé un bout de siècle, alors que Robert Allen Zimmermann, Shabtai Zisel ben Avraham de son nom hébreu, n'en est lui qu'à jeter sur le papier son premier Song to Woody à la gloire du vrai clochard céleste que fut Woodie Guthrie, dans la foulée duquel s’engage le nouvel Ariel du folk en colère – et c’est sur Song to Woody que s’ouvre aussi bien le triptyque de la dernière compil parue cette année sous une belle couve rouge sang de poète, sobrement intitulée Dylan... (A suivre)
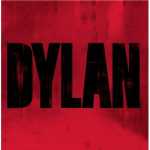 François Bon. Bob Dylan, une biographie. Albin Michel, 485p.
François Bon. Bob Dylan, une biographie. Albin Michel, 485p.
-
-
Dans le fleuve du Temps
Schoorl, ce samedi 20 octobre. – La vieille angoisse d’avant l’aube m’avait repris devant la mer encore noyée dans le noir du nord, une bribe de phrase m’était revenue de la confusion d’un dernier rêve… Eh oui, quand on s’est adossé au fleuve du Temps… Je me suis alors rappelé où nous nous trouvions avec L. dont la mère s’était réfugiée sur une île proche dans une période difficile de sa vie, puis une première clarté s’est délayée dans l’obscur et, comme posées dans la brume, les bêtes en sommeil réapparurent de loin en loin, et le tableau d’une infinie douceur se recomposa tout entier comme un désert aux couleurs montant peu à peu, le vert blanchi de givre des polders, de loin en loin les éclats de miroir de l’eau gelée, là-bas les taches de rouille des petits étangs affleurant le brouillard d’où surgissaient à peine les ailes d’un moulin à l’ancienne, la ligne orangée du levant et le bleu laiteux de la grande toile pure de cette aube, tout proche maintenant ce cheval immense semblant scruter ces deux matinaux, ces flocons de laine des moutons de loin en loin, de temps à autre un vol d'oiseaux migrateurs s’arrachant au petit canal jouxtant le sentier spongieux, enfin cet inimaginable dromadaire bougeant lentement dans la lumière irréelle de ce nouveau jour où notre pas s’accordait à celui du Temps…

La phrase « Eh oui, quand on s’est adossé au fleuve du Temps », est tirée du deuxième recit, All’estero, du recueil Vertiges, de W. G. Sebald qui m’a accompagné durant ce voyage de Delft à Harlingen.
-
Le silence de Hölderlin
Lecture d'Achever Clausewitz, de René Girard (5)
Tristesse de Hölderlin
- BC évoque la résistance à mener par de la l’effondrement d de l’institution de la guerre.
- RG affirme qu’une résistance individuelle est vaine.
- Relève que les Evangiles ont une « intuition formidable du mimétisme ».
- Importance à cet égard des récits apocalyptiques, occultés puis oubliés.
- Rappelle « le temps des païens » cité par Luc.
- Les Evangiles nous disent que le réel n’est pas rationnel mais religieux.
- Evoque le ratage des juifs, malgré les prophètes, et le ratage des chrétiens à travers l’Holocauste.
- Cite la demande de pardon de Jean Paul II à Yad Vashem et y voit un signe des temps, un geste sublime.
- Deux cercles : la vie du Christ qui se termine par la Passion. Et l’histoire des hommes qui se termine par l’Apocalypse. Le second cercle est contenu dans le premier.
- « L’esprit apocalyptique n’a rien d’un nihilisme : il ne peut comprendre l’élan vers le pire que dans les cadres d’une espérance très profonde ».
- Laquelle ne peut faire l’économie d’une eschatologie.
- Comment Luc constate que la violence réconcilie les ennemis après la Passion : « Et à partir de ce jour-là, Pilate et Hérode qui étaient des ennemis devinrent amis ».
- Que « la mauvaise violence est unanime contre le Christ ».
- Cite la première Epître de Paul aux Thessaloniciens, le plus ancien texte du NT, moins de 20 ans après la crucifixion.
- Paul en appelle à la patience des croyants, affirmant que le système va s’effondrer de lui-même.
- Satan sera de plus en plus divisé contre lui-même : c’est la loi mimétique de la montée aux extrêmes. »
- Ce mimétisme est contagieux, qui va atteindre la nature elle-même.
- Matthieu annonce que « l’amour se refroidira chez le grand nombre ».
- Le temps des païens » est à considérer comme « un lent retrait du religieux ».
- On va en outre vers l’effacement de toute distinction entre le naturel et l’artificiel.
- Paul aux Thessaloniciens : « Quand les hommes se diront : paix et sécurité ! C’est alors que tout d’un coup fondra sur eux la perdition ».
- Le Christ dit qu’il n’est pas venu apporter la paix.
- En fait il met un terme à la volonté de dissimuler les mécanismes de la violence.
- « La révélation judéo-chrétienne met à nu ce que les mythes ont toujours tendance à taire ».
- Le paradoxe est que le christianisme provoque la montée aux extrêmes en révélant aux hommes cette violence.
- « Tel est l’avenir affolé du monde, dont les chrétiens portent la responsabilité. Le Christ aura cherché à faire passer l’humanité au stade adulte, mais l’humanité aura refusé cette possibilité. »
- RG reconnaît « un échec foncier ».
- Mais la proximité du chaos n’exclut pas, selon lui, l’espérance.
- BC souligne le fait que la démarche de RG s’inscrit dans une perspective darwinienne
- RG affirme qu’on ne peut entrer en relation avec le divin que dans la distance.
- Et que seule la médiation du Christ permet cette proximité-distance.
Un dieu « tout proche et difficile à saisir ».
- RG en vient alors à Hölderlin.
- Son œuvre l’habite depuis longtemps.
- Hölderlin se retire pendant 40 ans à Tübingen.
- Beaucoup moins hanté par la Grèce qu’on ne l’a dit. RG le voit « effrayé par ce retour au paganisme qui hante le classicisme de son époque ».
- Son âme oscille entre la nostalgie et l’effroi.
- Cite le poème Patmos.
- Qui annonce le retour du Christ beaucoup plus que celui de Dionysos.
- Le Christ « se retire au moment même où il pourrait dominer ».
- C’est le silence de Dieu qui se donne à entendre dans le silence du poète, selon RG,
- Hölderlin devient de plus en plus chrétien, à mesure qu’il se retire du monde.
- Lui-même, notamment avec Goethe, a vécu le mimétisme de manière intense, « un maniaco-dépressif d’une intensité inouïe ».
- « Grâce à Hölderlin, ce grand mendiant de l’affection des autres, j’ai compris que la folie de Nietzsche était liée à l’apothéose de Wagner ».
- Cite le choc que produit sur Nietzsche la lecture des Mémoires écrits dans un souterrain de Dostoïevski.
- Hölderlin choisit le retrait pour dépasser le mimétisme.
- S’il hésite entre Dionysos et le Christ, son choix s'affirme.
- Hölderlin perçoit la différence essentielle entre la promiscuité divine et la présence de Dieu.
- RG affirme qu’il n’y a qu’une bonne proximité, se réduisant à l’imitation du Christ.
- « Malgré toute la pression qu’exercent sur lui la mode et ses amis, le poète pressent la vérité : Dionysos, c’est la violence, et le Christ c’est la paix ».
- Evoque alors la conversion de Hölderlin au catholicisme.
- Et remarque une fois de plus que « la destruction ne porte que sur ce mon de ; pas sur le Royaume ».
 Le Royaume est «ce que Pascal appelait l’ordre de l’esprit, passage nécessaire vers l’ordre de la charité ».
Le Royaume est «ce que Pascal appelait l’ordre de l’esprit, passage nécessaire vers l’ordre de la charité ».- Le modèle mimétique nous fait sans cesse retomber dans l’enfer du désir.
- Les grands écrivains ont compris cette loi : Proust, Dostoïevski, Cervantès, Stendhal, notamment.
- Evoque ensuite les bons modèles qui nous rendent plus libres, et les modèles-obstacles qui nous enchaînent au mimétisme.
- « Echapper au mimétisme, étant donné ce qu’est devenue son emprise croissante, est le propre des génies et des saints ».
- Au risque de régression, RG oppose la recherche d’une médiation…
- Que BC définit comme « médiation intime »
- En revient à l’imitation du Christ, qui ne consiste pas à en être fasciné mais à s’effacer devant lui.
- « L’identification suppose une aptitude singulière à l’empathie ».
- Une excessive empathie est mimétique, mais l’excessive indifférence l’est autant.
- RG évoque alors la réserve polie, l’accueillante distance de Hölderlin dans sa tour, avec ses visiteurs.
- RG finit par évoquer le mythe fondateur védique de Purusha, l’homme archétypal mis à mort par une foule de sacrificateurs. Or que représente cette foule, puisque cet homme est primordial ?
- « De ce meurtre, on voit sortir tout le réel. »
- Un mythe fondateur « tellement vieux que la violence en est sortie »
- « C’est la conception védique, absolument apaisée, de ces choses ».
- RG lui voit une parenté avec la sortie pacifique du mimétisme que signifie la retraite de Hölderlin.-
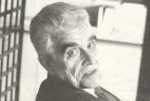 René Girard, Achever Clausewitz. CarnetsNord, 363p.
René Girard, Achever Clausewitz. CarnetsNord, 363p. -
Le blues d’Alain Gerber

Balades en jazz à travers une passion. Miles vient de paraitre
« Rien ne vaut l’enfance, une fois qu’on a été dispensé de jeunesse », écrit Alain Gerber pour qui l’enfance de l’art s’oppose pour ainsi dire à celle du premier âge, et dont la seconde naissance date de décembre 1958, lorsqu’un de ses profs de Belfort lui révéla soudain le jazz.
 «Tout ce que l’enfance fait mine de vous promettre, mais vous refuse avec acharnement – par exemple la bienheureuse ignorance, l’irresponsabilité et son corollaire, le goût du merveilleux», précise-t-il, « tout cela et davantage, le jazz me l’a offert en même temps que je me délivrais d’un coup de mes illusions passées ».
«Tout ce que l’enfance fait mine de vous promettre, mais vous refuse avec acharnement – par exemple la bienheureuse ignorance, l’irresponsabilité et son corollaire, le goût du merveilleux», précise-t-il, « tout cela et davantage, le jazz me l’a offert en même temps que je me délivrais d’un coup de mes illusions passées ».
A cette découverte, et surtout à l’aura mythologique de sa jeunesse de Vitellone belfortin, Alain Gerber a consacré ses deux premiers livres, d’un lyrisme rappelant celui de l’immense Thomas Wolfe (à ne pas confondre avec le Tom Wolfe du Bûcher des vanités), La couleur orange et Le Buffet de la gare. L’on y découvre notamment que le jazz fut pour le garçon, bien plus qu’une passion « parmi d’autres », l’expression la plus pure de toute une Amérique rêvée où les écrivains, de Faulkner à Hemingway, Scott Fitzgerald ou Ring Lardner, faisaient figure de personnages vivants autant que de révélateurs d’un « nulle part » plus habitable que l’ordinaire des jours.
« J’ai découvert au mois de décembre 1958, grace à Henri Baudin, The Man I Love de Miles Davis, Thelonius Monk, Milt Jackson, Percy Heath et Kenny Clarke, comme un chant tombé des étoiles, une eau lustrale versée sur moi du plus haut de la plus haute sphère, écrit Alain Gerber, qu’on sait l’un des plus grands connaisseurs français de la Chose. Pourtant ce n’est pas en spécialiste qu’il compose ces Balades en jazz : plutôt en amateur, au sens de celui qui aime. « J’ai tenté de faire croire le contraire (non sans un certain succès parfois, au oint d’en avoir tiré l’essentiel de ma subsistance) mais je n’ai jamais rien compris à cette musique, ou si peu ». Il dit avoir écouté The Man I Love des centaines de fois, sans en venir à bout. Autant dire qu’il parle du jazz comme d’un incompréhensible amour, dont le blues serait l’une des expressions les plus caractéristiques à cet égard, le blues qui « parle en images à ceux qui n’en comprennent pas les paroles ».
 Qu’on en se figure pas pour autant une passion pure entretenue les yeux au ciel, car le jazz a tantôt un « charme de gouttière » et tantôt une volubilité hugolienne (comme certaines pages de Gerber d’ailleurs, notamment quand il évoque le Chat qui pêche o ù il rencontre Stan Getz, son dieu tombé de son piédestal, pour un petit concert privé qui le marque à vie), tantôt se mue en confidence lancinante avec Chet Baker, qui vit sa dérive mortelle loin de nous et nous rejoint de sa double voix: « J’écoutais cette musique refaire le monde à son image, marcher toute seule quand la ville dort, marcher derrières les bruits de ses pas, traverser en dehors des clous, mêler son haleine au brouillard, ramasser les mégots de la nuit ».
Qu’on en se figure pas pour autant une passion pure entretenue les yeux au ciel, car le jazz a tantôt un « charme de gouttière » et tantôt une volubilité hugolienne (comme certaines pages de Gerber d’ailleurs, notamment quand il évoque le Chat qui pêche o ù il rencontre Stan Getz, son dieu tombé de son piédestal, pour un petit concert privé qui le marque à vie), tantôt se mue en confidence lancinante avec Chet Baker, qui vit sa dérive mortelle loin de nous et nous rejoint de sa double voix: « J’écoutais cette musique refaire le monde à son image, marcher toute seule quand la ville dort, marcher derrières les bruits de ses pas, traverser en dehors des clous, mêler son haleine au brouillard, ramasser les mégots de la nuit ».
Qu’il évoque New York ou les projections cinématographiques du jazz (plus que le Bird de Clint Eastwood, Honkytonk Man, où le jazz parle comme par allusion, au deuxième degré), les figures de Duke Ellington ou de Martial Solal, Louis Armstrong qui est un roman à lui seul (Alain Gerber l’a d’ailleurs écrit), du Paris jazzy de Henri Crolla, de John Lewis « minimaliste prodigue » ou de Kenny Clarke, parfait escort drummer qui « déteste les solos de tambour » mais habite le secret des dieux, Alain Gerber est essentiellement lui-même dans ces Balades en jazz, essentiellement écrivain, poète à sa façon de sanglier des Vosges, du genre vieux môme qui emportera ses jouets dans sa tombe vu que la mort, c’est connu, à un vieux faible pour le jazz.
Alain Gerber. Balades en jazz. Folio Senso (Inédit), avec une quinzaine de photos du meilleur choix, 141p.Alain Gerber vient de publier un nouveau roman consacre a Miles Davis, sous le titre de Miles, chez Fayard.