 Ce qu’il y a de super, avec le Réseau, c’est qu’on est à la fois tout le monde et personne. T’as pas besoin de mettre un masque. A la limite, même si tu scannes ton portrait t’es pas obligé que ce soit le tien. T’es derrière ton écran et t’as pas de comptes à rendre; en tout cas tant que tu débloques pas t’as pas de comptes à rendre. Moi par exemple, après la mort de Raoul, ça m’a drôlement apporté. Parce que, pendant des jours, ça a été encore plus galère que de son vivant. Déjà que ça avait pas toujours été évident quand je l’avais sur les bras, surtout à la fin avec tout le sang qu’il crachait, mais enfin j’avais l’impression d’exister, même si je savais maintenant que je lui devais pas la vie je lui donnais volontiers tout ce qu’il fallait dans l’urgence , je faisais des heures sup pour éponger ses méfaits et gestes les plus graves, comme il disait, je l’avais adopté même s’il était pas celui que je croyais - l’autre je m’en foutais bien à présent: c’était quand même pour Raoul que j’avais fini par voter après l’avoir bien agoni pour ce qu’il nous avait fait endurer, au point de souhaiter qu’il disparaisse et qu’on n’en parle plus.
Ce qu’il y a de super, avec le Réseau, c’est qu’on est à la fois tout le monde et personne. T’as pas besoin de mettre un masque. A la limite, même si tu scannes ton portrait t’es pas obligé que ce soit le tien. T’es derrière ton écran et t’as pas de comptes à rendre; en tout cas tant que tu débloques pas t’as pas de comptes à rendre. Moi par exemple, après la mort de Raoul, ça m’a drôlement apporté. Parce que, pendant des jours, ça a été encore plus galère que de son vivant. Déjà que ça avait pas toujours été évident quand je l’avais sur les bras, surtout à la fin avec tout le sang qu’il crachait, mais enfin j’avais l’impression d’exister, même si je savais maintenant que je lui devais pas la vie je lui donnais volontiers tout ce qu’il fallait dans l’urgence , je faisais des heures sup pour éponger ses méfaits et gestes les plus graves, comme il disait, je l’avais adopté même s’il était pas celui que je croyais - l’autre je m’en foutais bien à présent: c’était quand même pour Raoul que j’avais fini par voter après l’avoir bien agoni pour ce qu’il nous avait fait endurer, au point de souhaiter qu’il disparaisse et qu’on n’en parle plus.
C’est pourtant vrai que j’avais fini par le prendre en charge alors que tous se défilaient plus ou moins. Je m’étais installé dans son deux-pièces de la Cité des Oiseaux et quelque part ça m’arrangeait, je me suis occupé de l’Armoire au Trésor, comme il appelait sa planque à factures, j’ai tout assumé ou à peu près, j’ai débarqué avec mon Mac et je lui ai fait découvrir le monde de la Toile, il s’est pris au jeu quelque temps avant de tomber par hasard sur les saletés de Wonderland, juste avant que ce club de tarés ne soit démantelé, il a vu le sexe et le fric partout et n’en revenait pas avec son bon naturel de coureur des bois pas vicieux pour un jeton, et là nous avons causé de tout ça, il m’a montré tout ce qu’il y avait de mal barré dans ce pseudo-monde et j’ai reconnu que c’était le risque quand on se met à débloquer, bref on a refait ami-ami, je lui ai pardonné tout ce qu’il a foutu en l’air de notre vie et de celle d’Elena, et d’abord parce qu’il m’a raconté son Elena à lui, tout ce que j’ignorais de mon côté, tout ce qu’elle lui a fait subir que je ne savais pas - même s’il en remettait je sentais qu’il y avait du vrai, et je le sentais revivre de me voir l’écouter, il était encore suffisamment sur ses pattes pour qu’on recommence à se balader ensemble, on est allés en montagne et dans les réserves du bout du Haut Lac, je lui ai appris des trucs sur l’écosystème et il m’en a appris d’autres en m’amenant chez tous ceux qu’il avait fréquentés à l’époque de la distillerie, il n’y avait quasiment plus de soirs ou de fins de semaine que nous ne passions ensemble, même qu’Elena, qui ne me voyait pour ainsi dire plus, sauf pour mon linge, commençait à la trouver mauvaise.
D’ailleurs c’est ce moment-là qu’elle a choisi, Elena, pour faire sa révélation, et là c’est plutôt elle qui s’est montrée sous son moche côté, mais moi je n’ai rien vu venir, enfin peut-être que ça devait tourner ainsi, probable même que c’était obligé: que ça devait se passer comme ça, et voilà qu’un jour où je me disais que Raoul repiquait et que je lance comme ça à Elena, sans penser la vexer, que tous les deux, papa et moi, nous nous sommes retrouvés et que ça donne un peu plus de sens à nos bouts de chemins, voilà qu’elle se met à rire drôlement et qu’elle m’apprend que Raoul n’est pas vraiment celui que je crois: qu’elle n’a jamais voulu me le dire mais qu’à présent elle me le dit, que mon vrai géniteur est un autre mais que je ne saurai jamais qui vu que le nom de celui-là elle se le rappelle même pas, ou disons qu’elle pourrait l’appeller le courant d’air...
A Raoul je n’en ai pas parlé: c’était vraiment le plus mauvais moment, alors que tout semblait plus ou moins s’arranger. Je ne lui ai rien dit, pas le moindre reproche, d’ailleurs sa faute à lui était autant dire rien par rapport à l’autre, et puis je ne savais même pas s’il savait, mais il y a ce qu’on sent, il y a ce que Raoul a dû ressentir de ma part malgré que je m’efforçais toujours de lui envoyer de bonnes ondes; et ce qu’il a ressenti ces jours-là devait venir aussi d’elle, elle qui diffusait de sales vibes depuis l’autre bout de la ville, elle qui nous en voulait maintenant d’autant plus qu’elle regrettait sûrement de m’avoir balancé ça sans crier gare, parce que je sais qu’elle est au fond pas si néfaste, et c’est ma mère ça c’est prouvé, enfin bref loin de m’éloigner de Raoul la nouvelle m’a tellement chaviré que ça m’a rapproché de lui tandis qu’il recommençait à saigner.
Au début, sur le Réseau, j’aimais bien me faire passer pour le fils d’un footballeur célèbre ou pour un animateur de chaîne, mais après la mort de Raoul j’ai revisité les sites qu’il avait classés, je suis tombé dans certaines tchatches où son nom était connu, et tout à coup ça a été comme si je le retrouvais dans un jeu de miroirs, ça me faisait bizarre, ça m’a troublé comme lorsque je suis allé annoncer sa mort à quelques-uns de ses très vieux complices de la Brasserie des Abattoirs. J’avais parfois eu honte de Raoul quand j’allais le rechercher et qu’on se faisait toute la rue au vu des gens comme il faut, mais à présent c’était plutôt le contraire qui se passait, on me demandait de parler de lui ou on m’envoyait des mails persos à son propos et je voyais se former une autre image de mon pseudo-pater: je comprenais mieux pourquoi tout ça lui était arrivé, je lui en voulais de moins en moins, et d’autant que je supportais de moins en moins, à mon tour, la vie de ces gens qu’on dit justement comme il faut.
C’est Raoul qui m’a montré, le premier, la folie du monde, et bien avant que je ne zone sur la Toile, bien avant même qu’il se mette à ne plus rentrer, bien avant qu’il ne se noie dans son verre.
- La folie, mon garçon, m’avait-il alors dit, c’est à peu près tout ce qu’on estime ordinaire de nos jours. La folie c’est la vie bridée, c’est le travail rien que pour le dinar et le dinar rien que pour la frime. La folie c’est cette course de rats, me disait Raoul, et quand j’étais encore ado il m’a traîné un peu partout en ville, il m’a fait voir les gens se bousculer et se faire la gueule, il m’a fait voir les regards salauds et les gestes qui tuent, puis il m’a emmené de café en café et de bar en bar et m’a présenté ceux qu’il disait les sans merci ou les sans laisse.
Ce que Raoul ne supportait pas, je l’ai compris en me rappelant ce qu’il avait été avant de tout laisser se défaire de ce qu’il avait fait, c’était cette vie accroupie, cette vie rancie, cette vie protégée de tous côtés, cette vie assoupie: ce semblant de vie.
Lui qui avait joué les gagneurs et que nous avions connu sur la crête de la vague, comme disait Elena, s’était vu un jour dans une vitrine avec son costume gris et son attaché-case de barge d’affaires, et d’un coup ses yeux se sont ouverts: le même soir il envoyait tout valdinguer et nous avec - ça je dois quand même le compter dans la colonne déficit.
Mais comment compter avec Raoul ? Autant décider qu’on va scotcher le vent et le mettre en cage. Autant l’autre était courant d’air, comme disait Elena, que je pouvais oublier vite fait, autant l’autre n’avait fait qu’entrer et sortir dans la vie d’Elena, autant l’autre ne faisait que glacer mes recoins, autant le souffle de Raoul m’avait fait respirer et me décoiffait à vie; autant la force de l’autre me semblait nulle, autant la faiblesse de Raoul me rendait à nos enfances partagées et à sa grande ombre colorée de divinité des sous-bois; autant l’absence de l’autre se décolorait à tout jamais, autant la présence de Raoul m’était regagnée dans le jardin suspendu de notre maison où tous et toutes nous l’avions tenu pour Superman.
Le vieux dandy clodo a mis trois jours pour se décider. Trois jours pour me filer les clefs de l’Armoire au Trésor. Depuis trois jours je le sentais pas à l’aise, depuis que j’avais débarqué aux Oiseaux et après qu’il m’eut raconté pas mal de ses méfaits et gestes, comme il disait.
Il avait alors une dégaine à faire peur, mais je sentais que ma présence lui redonnait un peu de cran. Il m’avait tourné autour sans oser l’ouvrir quand j’avais attaqué le probème Number One que représentait l’évier de sa cuisine, dont les strates superposées racontaient l’hisoire de sa malbouffe solitaire de trop de mois. Il s’est retenu pendant des heures, je sentais qu’il avait quelque chose à lâcher mais qu’il hésitait à y venir, et puis je me suis dit que peut-être je me faisais des idées.
Le troisième jour il riait tout seul dans un coin à relire Le filou scrupuleux de O’Henry, qu’il m’avait fait découvrir à quinze ans lors d’une campée entre nous sur les hauts gazons de Friance; il se poilait entre deux accès de toux à s’arracher les poumons, je le regardais comme s’il était plus jeune que moi, je le voyais tout à coup dépendant et un peu caqueux, je savais maintenant qu’il allait m’annoncer quelque chose, je n’avais même pas remarqué jusque-là la grande armoire verrouillée, je grattais comme un grillon du foyer et lui me citait de temps à autre une fine moulure de l’humoriste, mais j’avais plutôt envie de l’invectiver pour son insouciance et je sentais qu’il le sentait, et tout à coup il fut là, devant moi, debout, petit et grand à la fois, en tout cas solennel comme il savait l’être même quand il titubait sous l’effet de sa dernière tuée, comme il disait, il était là et il me tendait une clef en me désignant ce vilain meuble juste bon à finir à l’Armée du Salut:
- C’est là-dedans que ça se passe, fils à moi.
Et cela se passa, de fait, comme annoncé. Cela n’attendit pas l’ouverture complète du double battant: cela sortit parce que cela devait sortir, cela ne pouvait pas ne pas sortir, cela s’écroula donc, ce fut une avalanche de papiers et de bordereaux, de cahiers, de classeurs et de factures, cela faillit nous assommer puis un tas s’éleva devant nous et Raoul, l’air d’un enfant pris en faute, me lâcha en me regardant par en dessous:
-Voilà le trésor que je te lègue...
Le courant d’air ne m’a rien laissé en souvenir, tandis que Raoul nous a légué le vent du dernier jour, qui nous a tous réunis lui et nous.
Les dettes de Raoul nous ont fait nous retrouver à son insu deux trois fois pour entendre d’abord Elena se lamenter et mes frères développer des théories morales de gens comme il faut.
Pour ma part, je leur ai dit l’état de Raoul. Je leur ai détaillé mes premières mesures d’assainissement du marécage raoulien. Puis, tout à trac, je leur ai dit que Raoul ne serait bientôt plus en mesure de s’occuper de lui-même et que moi non plus: que j’en avais ma claque de ne pas les voir se remuer le train. Je leur ai dit que les dettes de Raoul pouvaient attendre mais qu’il fallait lui trouver une maison peinarde pour ses derniers mois, je leur ai dit que Raoul avait encore des trucs à leur apprendre et que ça le ferait revivre un peu plus de n’avoir pas qu’un fils mais bien trois comme à la belle époque des écrevisses et des fins de mois mirifiques, je leur ai dit que j’étais fier d’être le fils de Raoul (mes faux frères n’étaient pas censés savoir que je n’étais, moi, que le rejeton d’un courant d’air), j’ai dit à Elena que je comprenais qu’elle ait aimé le cher lascar, enfin je leur ai proposé de m’aider à aider Raoul et pas un n’a résisté cela va sans dire.
Raoul m’en a d’abord voulu de le caser en maison, mais je lui ai dit de se la coincer avant de lui expliquer la situation générale et particulière.
Comme il pouvait s’en rendre compte lui-même, Raoul se faisait parmi et saignait à se saigner. Or ça n’allait pas s’arranger. Bientôt il aurait besoin, son naturopathe me l’avait prédit, de solides doses de morphine et de divers soins compliqués, même s’il était entendu qu’on n’allait pas s’acharner à le retenir dans ce triste monde. Tout ça coûterait encore quelques factures d’assurances en retard et ce n’était pas lui, qu’on sache, qui allait dégager les fonds de l’opération Bons Soins. Bref, Raoul comprit et baissa la tête, puis il la releva et me sourit l’air malin.
C’est à cette dernière époque, je crois, que nous avons vraiment retrouvé, Elena son jules de vingt ans, et nous trois notre paternel plus ou moins par le sang.
Tout ça je me le suis raconté cent fois, après la mort de Raoul, mais ça ne m’aidait pas à surmonter le blues. J’étais complètement à terre. J’arrivais pas à croire qu’il nous avait fait ça alors que c’était annoncé quasiment à l’heure près. Mais on a beau savoir, on a beau avoir parlé de ça en long et en large: quand t’es devant qui t’aime qui bouge pas plus qu’un mort, là c’est vraiment que t’as touché le fond.
Pourtant Raoul avait une sacrée belle figure en tant que macchabée: Elena lui a retrouvé un costard de ses années glorieuses, on l’a coiffé et manucuré, il avait son noeud papillon et ses boutons de manchettes à diamants réchappés de toutes les saisies, bref on aurait dit qu’il allait réclamer sa canne à pommeau pour se relever comme un Lazare de dancing.
Je me suis raconté ça tout seul tous mes soirs d’après le dernier jour, mais c’est grâce au Réseau que j’en ai fait cette espèce de story.
Un jour que je parle de ces histoires de courant d’air et de vent à Sally Burke de Bradford, dont la Home Page m’avait flashé, elle me demande si je connais Le vent souffle de Mansfield, et moi je lui que non: je pense à Jayne, évidemment, et je lui réponds comme ça par mail que je n’ai pas vu le film. Alors elle m’explique que ce n’est pas de la Mansfield américaine au buste considérable qu’elle me cause, mais de la Néo-Zélandaise à l’air de fée un peu fêlée, une raconteuse d’histoires sur laquelle elle travaille pour son Master, et du coup elle me balance Le vent souffle en pièce attachée; et surtout, Sally me dit qu’il faut que j’écrive ce que je lui ai raconté: que ça peut m’aider et que c’est exactement ce qui manque sur la Toile et partout, parce que c’est une histoire vraie comme les écrivait Mansfield la Néo-Zélandaise.
Donc je recommence à mettre ça par écrit, et comme il s’est passé du temps entre deux ça se met à vivre autrement, je me le rappelle comme un scénar de quelqu’un d’autre, puis j’en arrive tout doucement à sentir, vraiment, qu’il y a comme du vent dans mon tas de papiers.
Et c’est pour ça, sûrement, que c’est le dernier jour que je préfère me rappeler: parce qu’il m’a donné le titre de cette histoire et que c’est alors seulement qu’a commencé de souffler l’esprit de mon père.
- Putain ce vent, mais putain, dirent mes frères sur le champ d’herbes sauvages surplombant le fleuve où Raoul nous avait demandé de répandre ses cendres, et c’est ce vent qui nous a ressoudés à jamais, ce vent avant le vin qui roulerait dans les verres (je lui avais promis que nous nous soulerions tous à sa mémoire), ce vent de vie qui foutait la pagaille dans les cheveux d’Elena et qui séchait, dans nos yeux, les larmes qui faisaient de nous trois les frères de notre vieux.
«Un grand vapeur, d’où coule
une longue boucle de fumée,
va vers le large, ses sabords sont
allumés, il a des lumières partout.
Le vent ne l’arrête pas, il coupe
les vagues et se dirige vers
l’ouverture béante entre les rocs
pointus qui mène à... C’est la lumière
qui lui donne cette beauté si terrible
et ce mystère.»
(Katherine Mansfield)
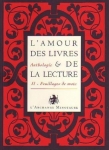



 En lisant Cavalier seul de Jérôme Garcin et Vous dansez de Marie Nimier
En lisant Cavalier seul de Jérôme Garcin et Vous dansez de Marie Nimier Ce qu’il y a de super, avec le Réseau, c’est qu’on est à la fois tout le monde et personne. T’as pas besoin de mettre un masque. A la limite, même si tu scannes ton portrait t’es pas obligé que ce soit le tien. T’es derrière ton écran et t’as pas de comptes à rendre; en tout cas tant que tu débloques pas t’as pas de comptes à rendre. Moi par exemple, après la mort de Raoul, ça m’a drôlement apporté. Parce que, pendant des jours, ça a été encore plus galère que de son vivant. Déjà que ça avait pas toujours été évident quand je l’avais sur les bras, surtout à la fin avec tout le sang qu’il crachait, mais enfin j’avais l’impression d’exister, même si je savais maintenant que je lui devais pas la vie je lui donnais volontiers tout ce qu’il fallait dans l’urgence , je faisais des heures sup pour éponger ses méfaits et gestes les plus graves, comme il disait, je l’avais adopté même s’il était pas celui que je croyais - l’autre je m’en foutais bien à présent: c’était quand même pour Raoul que j’avais fini par voter après l’avoir bien agoni pour ce qu’il nous avait fait endurer, au point de souhaiter qu’il disparaisse et qu’on n’en parle plus.
Ce qu’il y a de super, avec le Réseau, c’est qu’on est à la fois tout le monde et personne. T’as pas besoin de mettre un masque. A la limite, même si tu scannes ton portrait t’es pas obligé que ce soit le tien. T’es derrière ton écran et t’as pas de comptes à rendre; en tout cas tant que tu débloques pas t’as pas de comptes à rendre. Moi par exemple, après la mort de Raoul, ça m’a drôlement apporté. Parce que, pendant des jours, ça a été encore plus galère que de son vivant. Déjà que ça avait pas toujours été évident quand je l’avais sur les bras, surtout à la fin avec tout le sang qu’il crachait, mais enfin j’avais l’impression d’exister, même si je savais maintenant que je lui devais pas la vie je lui donnais volontiers tout ce qu’il fallait dans l’urgence , je faisais des heures sup pour éponger ses méfaits et gestes les plus graves, comme il disait, je l’avais adopté même s’il était pas celui que je croyais - l’autre je m’en foutais bien à présent: c’était quand même pour Raoul que j’avais fini par voter après l’avoir bien agoni pour ce qu’il nous avait fait endurer, au point de souhaiter qu’il disparaisse et qu’on n’en parle plus.





