
C’est un immense artiste, sûrement l’un des plus grands peintres de paysages de l’art occidental, que documente et célèbre la passionnante exposition consacrée à Turner et ses peintres, visible ces jours au Grand Palais après la Tate Britain de Londres et avant le Prado de Madrid.
Le nom de Turner, immédiatement évocateur de toiles incandescentes où flamboient, en fusions polychromes, des paysages de mer ou de montagne, de terres éthérées ou de ciels irréels, est déjà fort connu en nos contrées et très cher à beaucoup d’amateurs de paysages alpins ou de peinture « explosée » annonçant Monet et l’art non figuratif du XXe siècle.
Cependant, avant d’être ce précurseur indéniable, Turner fut l’un des derniers maîtres anciens très nourri d’autres maîtres anciens (de Titien à Poussin ou de Rembrandt à Claude Gellée dit Le Lorrain, son préféré) autant qu’il était attentif à l’art anglais et européen de son temps.
Formé, dès l’âge de quatorze ans, aux préceptes de l’art et au métier dans les ateliers de la Royal Academy de Londres, Joseph Mallord William Turner (1775-1851) concilia très tôt une conscience vive de l’importance de la tradition, et la préservation de sa vision artistique personnelle. Celle-ci supposait une autonomie financière dont Turner, fils de petites gens, ne disposait pas. L’époque n’étant plus aux grands mécénats de l’Eglise, de l’Etat ou des princes, le jeune artiste compensa son éducation sommaire et son manque d’appuis sociaux par un travail effréné qui lui valut la reconnaissance de la Royal Academy, attachée à la méritocratie, relayée par une exploitation commerciale adéquate de son métier. « Il avait la passion de l’art (…) et il avait la passion beaucoup plus commune de l’argent », note un biographe. Et David Solkin, maître d’œuvre du catalogue de l’exposition, de préciser : « La clé du succès économique de Turner résidait dans son empressement et sa capacité à produire un éventail étonnamment vaste de biens artistiques de grande qualité ». Ces données « triviales», liées au marché artistique de l’époque et à la furieuse concurrence qui y régnait, sont d’autant plus intéressantes qu’elles révèlent un Turner à multiples faces, immensément ambitieux et non moins attaché au perfectionnement de son métier, curieux du travail des autres (il pleure en découvrant le tableau d’un rival qu’il craint de ne pouvoir égaler) et aspirant à égaler les plus grands : il voudra par testament que son legs à la National Gallery permette à ses plus beaux tableaux d’être accrochés près de ceux de Claude Lorrain...
Paysage et pensée
Captivante par ses rapprochements, l’exposition Turner et ses peintres montre autant les admirations du maître anglais que l’affirmation de sa propre vision. L’exercice est passionnant, qui montre à quel point un paysage, loin d’être la seule représentation de la nature, est à la fois pensée et point de vue. Des Italiens classiques aux Flamands « quotidiens », des Français néoclassiques aux Suisses romantiques, Turner enjambe les frontières et les siècles en quête de « sa » vision. Celle-ci tend à se dépouiller de toute « littérature » pour aller vers le chant pur de la couleur et des énergies formelles, mais tirer Turner vers « nous » est peut-être excessif. Le maître ancien était plein lui aussi d’une frémissante jeunesse, comme en témoignent ses merveilleuses aquarelles sans âge, et le pur voyant n’existerait pas sans la double patience de la pensée et de l’art.
Paris. Galeries nationales, Grand Palais, jusqu’au 24 mai 2010. À recommander : le catalogue de l’exposition, Turner et ses peintres, rassemblant des articles des meilleurs spécialistes anglais actuels de Turner et une iconographie fabuleuse.

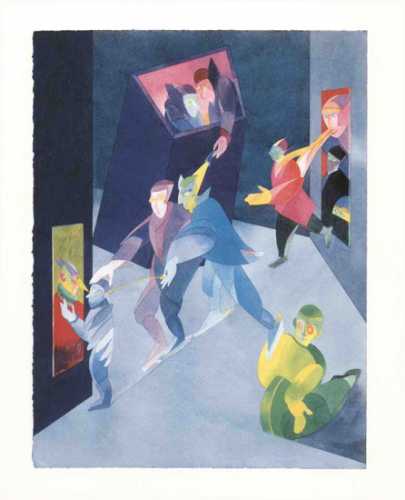
 Neuchâtel. Musée d’art et d’histoire, jusqu’au 16 mai 2010.
Neuchâtel. Musée d’art et d’histoire, jusqu’au 16 mai 2010.