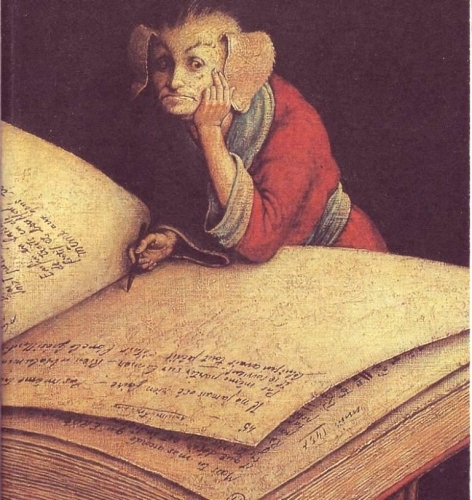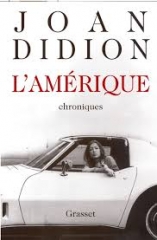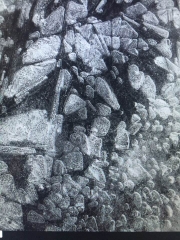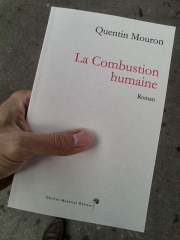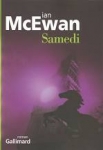À propos d'une polémique relancée par Michel Onfray, de l'admirable film The Dig de Simon Stone, et de deux enfants du siècle à venir...
Ce dimanche 31 janvier. – Me réveillant beaucoup trop tard ce matin (10 heures, shame on you !), je relève, sur Messenger, un mot gentil de l’ami Quentin qui me propose de « partager » un texte de Michel Onfray à propos de la pandémie, qu’il me dit « pertinent », et comme ni lui ni moi ne sommes des adulateurs aveugles du « philosophe national » de la France plus ou moins profonde, j’y vais voir illico en commençant par lire les commentaires de la meute, plus que jamais divisée par l’esprit binaire de nos chers voisins de palier; après quoi je lis l’entier de l’écrit de l’Onfray, qui m’impressionne en effet par son argumentation détaillée et sa défense de la notion de fraternité, assez à l’opposé de sa crânerie « libertaire » habituelle. Ce qu’il dit en appelle en somme à ce que Peter Sloterdijk a déjà appelé de ses vœux dans ses multiples éloges de la « collaboration » entre frères humains – au dam évidemment des « collabos » et autres idiots utiles -, et sa façon de déculotter ses confrères intellectuels (Comte-Sponville, BHL, Beigbeder et Nicolas Bedos, notamment) prônant plus ou moins la sélection naturelle et le seul cluster des « catégories à risques », m’a paru recevable même si je sens là-dessous un relent de querelle d’influenceurs médiatiques.
« Affaire française », me dis-je aussi en estimant que les Helvètes s’en sont un peu mieux tirés dans leur gestion du chaos, et surtout avec moins de justifications idéologico-politiques stériles. L’exemple de Quentin, participant à la Protection civile non sans égrener ses proses acides, m’en semble d’ailleurs une preuve sympathique – mais voilà que le mignon se fait porter pâle, j’espère sans occurrence virale...
Sur quoi voici débarquer nos petits garçons pour un frichti dominical sans masques mais non sans précautions…
DE LA POÉSIE. – Resongeant à ce que j’ai lu jusque-là de Michel Onfray, je me dis qu’en dépit de son très grand savoir et de sa belle intelligence polémique, ce brasseur et classeur d’idées remarquable manque de deux qualités pour me convaincre à tout coup, et c’est la fibre poétique et la sensibilité fine à la langue , qui ferait de lui un véritable écrivain, et le sens de l’humour qui lui permettrait, par delà la tendance tellement française à exclure en fonction des critères binaires me semblant dépassés, au lieu d’inclure comme en étaient capables Rabelais et Montaigne, Molière et Victor Hugo dont le Shakespeare est le dernier mot en la matière…

LE TRÉSOR. – C’est à l’un des plus beaux livres du monde, à savoir L’Île au trésor, que me fait penser The Dig qui raconte, avec une sorte de candeur rarissime aujourd’hui, une quête analogue associant quelques personnages de tous les âges et aux motivations variées, qu’il s’agisse des deux protagonistes (l’archéologue amateur Brown et la riche veuve elle aussi passionnée en la matière qui l’engage à creuser sur son domaine privé où elle pressent que des vestiges historique intéressants sont enterrés), le petit garçon de celle-ci aux curiosités inter-galactiques bien de son âge, l’archéologue attitré du British Museum, une paire de jeunes gens qui se trouvent en participant aux recherches, notamment.
Tous ces personnages sont admirablement dessinés, autant dans le registre « taiseux » que par le dialogue, et la poésie des images (le magnifique travail du chef op) se trouve immédiatement en phase, comme chez Stevenson, avec la triple métaphore de la recherche du trésor perdu (un bateau enfoui sur les hauteurs du fleuve, daté bientôt de l’époque des Anglo-saxons et battant en brèche l’hypothèse locale des Vikings), du sens affectif et métaphysique de la vie personnelle de chacun des personnages et enfin des destinée liées à la communauté humaine puisque l’histoire (histoire vraie, mais le poème sublime le documentaire) se passe dans les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, laquelle risque d’effacer une fois de plus les traces singulières de nos frères humains.
Est-ce un chef d’œuvre du 7e art que ce film infiniment délicat, aux interprètes aussi inspirés que sa scénariste et son réalisateur ou son imagier ? Je n’en sais rien, mais ce dont je suis sûr, en l’occurrence, comme je l’ai éprouvé toute proportions gardées -, en découvrant Retour du printemps et première neige de Germinal Roaux, c’est de me trouver dans la plus-que-présence de ce qu’on appelle l’Art, ou la Poésie à l’état pur, dont la compréhension apparie chez Simon Stone un enfant et une femme en butte à une maladie mortelle, deux vieux fous passionnés et deux jeunes gens amoureux, sous le signe précisément de ce qu’on appelle l’amour…

TONY ET TIM. - Enfin ce bonheur paisiblement turbulent de Midi, avec nos petits lascars d’un et trois ans. Tim ne prononçant encore que quelques mots, alors que sa langue-gestes s’affirme autant que son caractère, je demande à Tony de répéter le mot difficile d’héautontimorouménos, sur lequel il trébuche un peu avant de répondre sans hésiter à sa mère qui l’interroge sur la signification du mot magma : « mélange de gaz et de roches brisées », et voilà pour nos deux volcans à domicile en période de très aléatoire confinement…