
À propos de la paranoïa ambiante et des moyens de la dépasser. Divers exemples à l'appui entre grêlons et pluies limpides.
Ce vendredi 29 janvier. – Un poème à la logique folle me vient ce matin en deux temps trois mouvements tandis qu’il tonne et que se déverse soudain une pluie de grêlons sur les palmiers et le lac.
Dans la foulée, Lady L. m’apprend qu’un cluster de contamination a été décelé dans l’immeuble voisin de l’école internationale d’hôtellerie majoritairement fréquentée par de jeunes Chinois qui m’adressent tous les soirs des sourires de connivence, à vrai dire destinés au fox Snoopy, quand j’en croise des grappes ou des groupes au cours de notre rituelle balade. La logique folle étant bien celle-ci : que des Chinois de provenance probable de Singapour ou de Taïwan, soient contaminés quoique jeunes, ou l’inverse, par des adultes responsables de l’Administration de leur école longtemps fermée les mois derniers et réouverte on ne sait trop pourquoi – à vrai dire l’incertitude règne et voici mes contrerimes :
Malicieux logiciens
(Pour Fabrice P., majordome au CNRS)
Au vrai le mal imaginaire
faussement dénié
par certains experts achetés
et leurs commissionnaires,
ne s’était répandu de fait,
au dam des lois anciennes,
que par des ingénus
ne sachant rien des recettes.
Au lobby concerné
du palace aux drapeaux en berne,
certains des préposés
conseillèrent l’usage de clefs
aussitôt décrié
par ceux-là de l’autre partie
qu’on aura dite adverse,
mais sans autre preuve établie.
La certitude étant malade,
on ne la nourrit plus
que de maigres salades,
on la sevra de jus,
on lui mit des menottes
après lui avoir interdit
tout voyage au piano,
toute forme d’écrit,
au mépris de tout allegro.
Le mal qui sans l’être l’était
par la faute des banquises,
ou des lémures, ou des athées
et autres yeux bridés,
ne fut oublié qu’à la fin
de ce temps suspendu
à un fil si blanc et ténu
que jamais on ne sut
si vraiment il avait disparu...
FÉE ET SORCIÈRE. – Je me suis attelé hier à la lecture de L’Amérique, de Joan Didion, après avoir vu, sur Netflix, le documentaire à la fois passionnant et émouvant que lui a consacré son neveu Griffin Dunne, enrichi de très nombreux documents d’archives et vibrant aussi de la présence de la vieille dame très émaciée, au faciès de musaraigne ridée. J’avais lu, il y a quelques années, son poignant récit de deuil, que j’ai repris l’autre soir sur Kindle, et je crois avoir lu aussi, mais en surface, sans qu’il ne m’en soit rien resté, ses essais des années 60-80, mais y revenir en même temps que je lis Samedi d’Ian McEwan me semble aujourd’hui d’un tout autre intérêt, en phase avec mes réflexions personnelles sur mon roman en chantier.
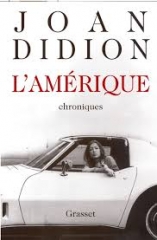
Personnel : c’est le mot-clef relatif à la position intérieure de Joan Didion par rapport à sa génération, mais aussi en ce qui concerne celle-ci par rapport aux générations précédentes, qui ont vécu la guerre, et suivantes, un peu perdues et titubant entre drogue et politique, fugues et culture alternative. Joan, née en 1934, se sent proche des « enfants » nés dix ou quinze ans plus tard, qu’elle se garde de juger mais qu’elle observe avec des yeux dénués de la complaisance convenue avec laquelle les journalistes ordinaires de l’époque parlaient des hippies ou de l’underground, notamment. Or je me suis trouvé, entre 1966 et 1973, à peu près dans la même situation, vivant comme les gens de mon âge mais incapable de m’identifier aux discours de ma génération, parfois même taxé de « vieux » ou de « réactionnaire » à vingt-cinq ans…
Joan Didion, sans jamais user des concepts ou des termes courants dans la gauche radicale de l’époque, pratique une observation intuitive qui va plus loin et plus profond dans la perception du malaise américain (ou occidental) d’époque, toujours valable aujourd’hui à ce qu’il me semble. Il y a chez elle un réalisme aussi incisif que celui d’une Patricia Highsmith, de dix ans son aînée, ou d’une Alice Munro dans une autre configuration sociale. Trois exemples, soit dit en passant, qui tranchent violemment avec les journalistes et autres femmes de lettres françaises, si souvent coupées de la réalité avec leurs besicles freudo-marxisantes et leurs bas bleus…

SHAKESPEARE & CO. – Les théâtres sont fermés mais pas pour tout le monde, me disais-je la nuit passée en visionnant et annotant la dernière des 37 pièces du Good Will enregistrées par la BBC, dans laquelle figure la bouleversante confrontation d’une femme de bonne foi en voie de répudiation par son roi de mari, Henri VIII plus précisément, et d’un prélat félon cristallisant tous les vices de cupidité et d’hypocrisie, de cruauté machiavélique et de bassesse sous ses dehors de suave servilité, à quoi le redoutable Timothy West au faciès de boucher à grimaces prête son immense talent aussi imposant dans l’abjection glorieuse que dans le retournement final du proscrit repenti, prodiguant alors ses conseils de modération à Cromwell ; et Claire Bloom en Catherine d’Aragon est à la lumière ce qu’il est aux ténèbres.

AVEC LES MOYENS DU BORD. - Comme le fait Germinal Roaux avec son téléphone portable, Quentin Mouron multiplie les notations quotidiennes dans les espèces de croquis-nouvelles qu’il balance par courriel ou sur Facebook, et j’y vois le meilleur exercice qu’on puise faire à l’heure qu’il est pour pallier la paranoïa ambiante et dépasser la procrastination gémissante, comme d’autres l’ont fait en Iran ou en Corée du nord, il y a pas mal d’années déjà, au titre du témoignage plus ou moins sauvage en terrain surveillé, ou comme Alain Cavalier en filmeur attaché lui aussi à enrichir le « journal de bord de l’humanité » en lequel John Cowper Powys voyait l’une des justifications de la littérature et des arts. Tout cela relève d’une nouvelle pratique que je dirais presque «de guerre», et Germinal, autant qu’Alain Cavalier, ou Quentin à sa façon, prouvent que les objets qui en procèdent peuvent relever d’un nouvel art…