
DU RICANEMENT. - La grimace du démon mesquin et la morgue du cynique me semblent produire cette caricature hideuse du rire que j’ai dû subir pendant des années dans le cadre de mon activité mercenaire exercée dans la proximité « sympa » d’un zombie de la culture culturelle. J’en garde une horreur quasi sacrée, sans rancune d’ailleurs pour la personne en question, plutôt reconnaissant d’avoir identifié à travers elle un travers humain combien répandu en cette époque où la dérision entache à peu près tout ce qui est digne d’être admiré. Au demeurant je m’efforce de ne plus me contenter de l’adjectif « admirable » pour quelque objet que ce soit, bonnement propice à susciter le ricanement en question...

Ce samedi 6 juin. – Donald Trump brandissant la Bible en menaçant d’envoyer la troupe contre les « émeutiers » qu’il ne cesse de provoquer par réseaux sociaux interposés, représente une telle caricature qu’on devrait lui être reconnaissant d’incarner si parfaitement la démagogie de cette Amérique à la fois pillarde et bigote, dont la violence et la vulgarité font pour ainsi dire figure de modèles repoussoirs. Tout de cet homme, né le même jour que Che Guevara et que moi-même (en personne), est humainement hideux, suant la stupidité satisfaite et le vide intellectuel, la brutalité du mafieux sous l’aspect d’un poupon-baudruche trépignant à la moindre contrariété.
Cela état, comme le disait Zinoviev des Russes par rapport aux Soviets, et comme les Allemands auront dû le reconnaître à propos d’Hitler, les Américains peuvent le dire aujourd’hui : qu'il l’auront voulu, et probablement faudra-t-il plus qu’un virus pour se débarraser non seulement du vilain personnage mais de tout ce qu’il représente, qui continue d’enchanter nos « libéraux »...
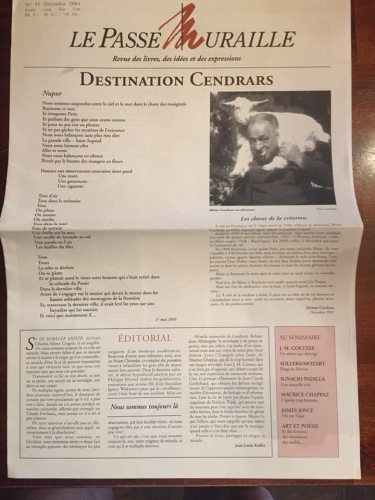
DÉGRINGOLADE. – Travaillant tous les jours, avec l’adorable Joël, à la réédition d’une partie des considérables archives du Passe-Muraille, je me dis que le commentaire littéraire, et toute forme de débat intellectuel, en Suisse romande autant qu’en France parisienne, sont tombés à un niveau d’insignifiance dont ce râleur de Cornelius Castoriadis à tête d’œuf avait raison d’annoncer l’inexorable montée.
Bien pire que le confinement hygiénique en cours, cette espèce d’affadissement et d’aplatisssement généralisé du discours critique, cette asthénie et ce recroquevillement sur soi manifesté jusque dans les rangs des plus jeunes, qui se foutent apparemment de tout ce qui ne concerne pas leur seul quart d’heure de gloriole, cette atomisation et cette paresse devraient nous décourager de plus rien faire, et pourtant non, parions pour les quelques pelés et autres tondues qui ont encore à cœur de dire quelque chose, semons et restons joyeux au lieu de céder au pire que représente l’aigreur.
À la Désirade, ce dimanche 7 juin.- Grisaille pluvieuse ce matin, qui me rend tout pensif après un rêve d’une étrange splendeur. Or j’aimerais, précisément, revenir à la Beauté et m’y tenir comme à la fin de sa vie notre ami Thierry s’efforçait de s’y tenir, coupant court à ce qu’il appelait ses zéphyrs.
Cela commence, en ce qui me concerne, par la mise en ordre rigoureuse de mes affaires à tous égards et en mes divers lieux, par la rédaction plus scrupuleuse de mon journal, par la poésie et la peinture, par la finition parfaite de tous mes écrits consignés sur mes divers supports numériques, par la suite du classement des papiers du Passe-Muraille et par la marche à pied - tout cela dans la bonne et belle humeur qui est la meilleure façon de rendre grace à la bonne vie.

GUILLAUME ET LE CHANT DU MONDE . - Il faisait l’autre matin un temps à se pendre et je trouvais le monde affreux, infâme le Président américain brandissant sa Bible comme une arme et méprisable la meute de ses larbins racistes; et j’avais beau savoir, le vivant tous les jours, que ce quart d’heure de noir absolu se dissiperait comme un brouillard dès que je me remettrais en chemin en souriant à mon ange gardien: l’image de ce pauvre George Floyd qu’un imbécile de flic haineux avait empêché de respirer m’accablait de tout le poids du monde quand une autre image de rien du tout, surgie d’un fin petit livre paru chez mes ami d’Autre part, intitulé Les Toupies d’Indigo street et signé Guillaume Gagnière, m’est revenue et avec elle le chant du monde - l’image heureuse recyclée par un jeune homme de trente ans pile, du poète japonais Bashô qui avait peint cet haïku sur le ciel de soie: «À un piment, ajoutez des ailes : une libellule rouge »…
Un an après une année d’errance, Guillaume Gagnière accomplit à peu près le même travail d’orfèvre que celui de Nicolas Bouvier ciselant les phrases du Poisson-scorpion, au fil d’un récit visant à la simplicité et au naturel, jamais trop visiblement «voulu poétique», bien incarné mais sans graisse, qui rend scrupuleusement les changements de relief et de couleurs du décor évoqué par Bouvier avec les détails propres aux virée de sa génération, la troisième ou la quatrième après Blaise Cendrars et Charles-Albert Cingria, les périples d’Ella Maillart et des compères Bouvier et Vernet, le «trip» des routards partis pour Katmandou et plus ou moins échoués à Goa dont Lorenzo Pestelli, dans Le Long été, a laissé la trace la plus scintillante quant au verbe et la plus désenchantée quant à l’esprit, et jusqu’aux backpackers actuels.
Ainsi le petit Guillaume trouve-t-il aussitôt son ton, pimenté d’humour, et son rythme allant, ses formules propres et la juste distance d’une écriture ni jetée comme dans un carnet de notes brutes ni trop fioriturée.
Cela commence par un Soliloque du corps marqué par une première crise d’urticaire, entre la Malaisie et la Thaïlande, lequel corps subira plus tard force cloques et autres claquages de muscles, jusqu’à «une sorte de lupus» au fil de marches de plus de mille kilomètres, sans parler d’un épisode de pénible yoga soumis aux contorsions du caméléon écartelé ou du chameau asthmatique,entre autres coups de blues et de déprimes qui rappellent aussi celles du cher Nicolas à Ceylan…
Cependant le corps exultera aussi en sa juvénile ardeur, de parties de surf en étreintes passagères, etc.
L'opuscule reproduit un tracé cyclique partant de la rue Indigo sri lankaise évoquée par Nicolas Bouvier, pour y revenir, non sans une pointe de mélancolie («la rue du récit, sa rue a sombré», avec une affectueuse lettre posthume du jeune homme à son modèle tutélaire. Rien pour autant de platement imitatif dans le récit du trentenaire, dont la poésie et la plasticité ont leur propre fraîcheur. Comme Bashô et Bouvier dans leur voyages respectifs, il multiplie ainsi les brèves notations, mais dans son langage à lui : « C’est alors qu’apparaissent les nuages, de larges masses d’un jaune de mégot froid », ou ceci : « Le soir, plat de curry en solitaire sous la Grande Ourse, les étoiles scintillent dans la casserole »…
Parvenant au dernier des 88 temples, enfin, c’est avec un éclat de rire final qu’il fait ce constat : «Deux mois d’efforts sur plus de mille kilomètres, et à l’arrivée, un sommet baignant dans une épaisse purée de pois », ajoutant en sage mal rasé et puant sûrement le bouc: « Serait-ce un peu ça, le but : s’effacer à tel point que la notion de mort en devient naturelle ». Et pour dépasser toute morosité nihiliste : « Finalement c’est peut-être ça, le « secret » : des montées, des descentes, des remontées et tout en haut, un grand calme : l’ataraxie. J’avais presque oublié à quel point cela pouvait être simple et beau, d’être en vie »…