
À propos d'un genre littéraire trop décrié naguère, et sans doute trop adulé aujourd'hui. De la multiplicité des sous-espèces, de l'enquête policière classique à l'exploration des bas-fonds sociaux ou des abysses psychiques, en passant par le roman théologique ou le thriller gore. Du mauvaise genre en pays romand, avec L'Âge de l'héroïne de Quentin Mouron et Le Dragon du Muveran de Marc Voltenauer.
1. De Sherlock à Jo Nesbø...
Georges Simenon se plaignait naguère de ce que la critique et le public français le considérassent (pour parler comme San Antonio) strictement comme un auteur de romans policiers, alors que le reste du monde voyait en lui un écrivain à part entière.
Or s’il est vrai que la France, patrie historique de la Littérature avec une grand aile (c’est elle qui le dit), aime à séparer ce qui est « noble » des genres dits mineurs (polar, science fiction, littérature popu en un mot), il n’est pas moins évident que le rompol a ses règles spécifiques qui en font, qu’on le veuille ou non, et sans mépris, un genre particulier.
Simenon reconnaissait, le premier, que la série de Maigret obéissait à certains schémas dont il éprouva, à un moment donné, le besoin de se libérer. Cela ne signifie pas que ses Maigret soient tous schématiques, mais le fait est que le meilleur de Simenon échappe aux normes du polar, y compris sous le label Maigret. Lettre à mon juge ou Le bourgmestre de Furnes, La neige était sale, Les inconnus dans la maison, Feux rouges, Les gens d’en face, L’homme qui regardait passer les trains ou La boule noire, pour ne citer que ceux-là, ressortissent bel et bien à la meilleure littérature, comme il en va de Crime et châtiment de Dostoïevski, si proche de certains romans noirs contemporains…
La confusion s’accentue pourtant aujourd’hui, où le terme de polar englobe des auteurs et des formes extrêmement variés à tous points de vue, et de niveaux qualitatifs oscillant entre le pire (qui est Légion) et le meilleur (plus rare), avec ce dénominateur pourtant commun de l’omniprésence du Mal et de la Mort.
De la belle énigme sophistiquée classique (Double assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Allan Poe ou Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux) aux embrouilles glauques du Ripley de Patricia Highsmith, en passant par les enquêtes socio-politiques de Michael Connelly (le dernier paru, La Lumière noire, est des meilleurs), les incursions dans le monde des Indien pueblos de Tony Hillerman ou les nouveaux auteurs français de Manchette à Fred Vargas, les atmosphères et les thématiques du « polar » sont aujourd’hui aussi diverses, à vrai dire, que celles des romans ordinaires.
Mais le polar gagne-t-il à se voir acclimaté et promu au rang de « noble » littérature. La multiplication chic des références au genre choc laisse songeur, et les élégants pastiches d’un Jean Echenoz ne font guère illusion quand on les compare aux descentes aux enfers des auteurs sondant les ténèbres du cœur humain, tels Patricia Highsmith (qu’un Graham Greene qualifiait de « poète de l’angoisse ») ou Robin Cook dans le terrifiant J’étais Dora Suarez, ce roman noir qui vous fait ressentir quasi physiquement le sort de la victime et de son bourreau dément, préfigurant les ténèbres de Cormac Mc Carthy, James Lee Burke, Jo Nesbø et autre Henning Mankell...
Du catholique Chesterton au visionnaire moraliste Dürrenmatt, les plus grands écrivains ont passé par les rues sombres du polar, pour en tirer parfois des vérités humaines éclairantes et de vraies pages de littérature. Autant dire que le polar en soi n’est qu'une appellation fourre-tout, alors même que le Mal et la Mort échapperont toujours aux classifications et autres tendances…

2. Mauvais genre en pays romand: Quentin Mouron ou la noire mélancolie du dandy.
On ne pourrait voir, en L’âge de l’héroïne de Quentin Mouron, qu’un polar frotté de littérature et de clichés américains, à la fois clinquant et snob, vite ficelé et répondant mal aux attentes des lecteurs et aux exigences du genre. Ceux qui ont été captivés par les grands romans américains ou nordiques de James Ellroy, Michael Connelly ou James Lee Burke, Jo Nesbø ou Henning Mankell, pour ne citer que quelques « stars » de la littérature noire la plus récente, souriront peut-être en découvrant ce petit roman de la « nouvelle étoile suisse du polar ».
Or il est absurde et injuste de comparer les romans polyphoniques de grands professionnels du genre, dont tous ne brillent pas d’ailleurs par leur écriture, à un livre aussi bref, compact et concis - et non moins dense et remarquable par sa rythmique verbale et les multiples traits de son ironie - qu’on pourrait dire, en dépit de ses dehors apparemment cyniques et provocateurs, un conte moral d’époque aux fulgurances inattendues, pur produit lucide et grinçant de la nouvelle génération.
De fait, Quentin Mouron est typiquement un enfant de ce nouveau siècle, mais son protagoniste désenchanté, tout brillant voire artificiel qu’il paraisse en surface, traduit un sentiment et pose une question de fond, à la fois existentielle et littéraire, touchant au sens de la vie et à la valeur de la parole, qui rejoint les interrogations des aînés de l’auteur.
Le canevas narratif de L’Âge de l’héroïne, autant que la dramaturgie de son intrigue policière, sont à la fois sommaires (d’où la frustration prévisible de nombreux lecteurs en quête d’enquêtes subtiles ou compliquées) et sans importance. L’intérêt du livre est ailleurs : dans la confrontation d’un univers déliquescent (notre monde) et de personnages obéissant à la logique folle de celui-ci, ou lui résistant de diverses façons.
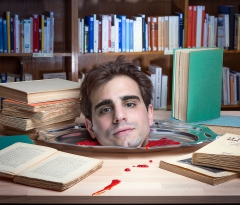
Cela commence par une Ouverture baroque carabinée, qui voit le protagoniste baiser une libraire berlinoise intensément consentante, avant que celle-ci ne se fasse décapiter par un adepte bavarois de la charia fâché de trouver le Mahomet de Voltaire dans sa vitrine… Or on verra plus loin ce que signifie incidemment, pour l’auteur, le passage du baroque au classique, ou du tragique au grotesque. Littérature gratuite que tout ça ? Pas du tout : point de vue sur le monde, dont la connotation policière relève juste de la culture populaire d’époque.
Dans L’Âge de l’héroïne, faisant suite au premier polar de Quentin Mouron intitulé Trois gouttes de sang et un nuage de coke , nous retrouvons Franck, le détective dandy, quadra las d’un peu tout et se raccrochant à la littérature de façon à la fois formelle (en fou de bibliophilie) et plus substantielle (il achoppe à la parole de Bossuet dans un décor parcouru de hell’s angels…), troublé en profondeur par la toute jeune Leah, incarnation double de la culture de fast food et d’une révolte absolue contre la vie.
Autour de ces deux-là gravitent quelques personnages aux airs de brutes conventionnelles sorties de quelque série télé dans le genre de Bannshee, nuance sous-Tarantino, sur arrière-fond de saloons pour touristes multinationaux et de décharge publique. Or plus qu’une image crédible de l’univers américain dans une histoire vraisemblable de trafic de drogue, voyons-y plutôt, une projection chaotique du grotesque contemporain avec ses héros improbables (tel vétéran de l’Afghanistan aura-t-il été plus héroïque que la kamikaze dont il est une des victimes survivantes ?) et, plus profondément paradoxale, l’héroïne du titre dont le double sens est plus qu’un jeu de mots...

Dans cette perspective dégagée de toute problématique « policière », la réflexion sous-jacente de Franck sur la dilution du tragique (qui donnait sens à la parole d’un Bossuet au XVIIe siècle) dans la jactance grotesque des temps qui courent, se rattache au noyau de la « poétique » développée par Quentin Mouron dès Au point d’effusion des égouts, son premier livre, tout en rejoignant le constat d’un Friedrich Dürrenmatt sur la fin de la tragédie. Là encore, pas question de comparer ce sombre joyau que représente La Promesse du grand Fritz, tragédie noire adaptée par Sean Penn sous le titre de The Pledge, au cinquième ouvrage du jeune auteur, en dépit de ses remarquables qualités, mais cette réserve ne fait qu’accentuer l’attente que suscite la production à venir de l’écrivain...
Quentin Mouron, L’Âge de l’héroïne. La Grande Ourse, 135p.
3. Mauvais genre dans les Préalpes vaudoises : Marc Voltenaur ou le châtiment de devoir divin.
 Une clef de lecture du Dragon du Muveran, premier roman policier de Marc Voltenaur, petit-fils d’un évêque luthérien suédois, se trouve peut-être dans le dernier essai lumineux d’Etienne Barilier, fils de pasteur calviniste, intitulé Vertige de la force, où le romancier vaudois traducteur de Friedrich Dürrenmatt, fils de pasteur bernois, repère et définit, à propos des djihadistes islamistes, la notion de « crime de devoir sacré ».
Une clef de lecture du Dragon du Muveran, premier roman policier de Marc Voltenaur, petit-fils d’un évêque luthérien suédois, se trouve peut-être dans le dernier essai lumineux d’Etienne Barilier, fils de pasteur calviniste, intitulé Vertige de la force, où le romancier vaudois traducteur de Friedrich Dürrenmatt, fils de pasteur bernois, repère et définit, à propos des djihadistes islamistes, la notion de « crime de devoir sacré ».
Les pasteurs sont en effet très présents dans Le dragon du Muveran, qui n’a pourtant rien d’un roman « mômier ». C’est une pasteur, au prénom d’Erica, qui découvre le premier corps poignardé au cœur et énucléé, disposé comme un crucifié sur l’autel, dans le temple où elle s’apprête à prononcer son sermon dominical inspiré par l’apôtre Matthieu ; et d’autres pasteurs, de plusieurs générations, éclaireront ensuite divers signes et paroles bibliques laissés sur ses traces par le tueur.
Ainsi que l’a relevé un Albert Camus (premier maître à penser de Barilier, qui lui a consacré l’un de ses livres), le XXe siècle a inventé le « crime de logique », aboutissant à l’organisation planifiée des camps de concentration et d’extermination. Ce crime « rationnel » de haute technicité rompt avec ce qu’on peut dire le « crime de passion », à caractère éruptif et sporadique, dont la jalousie (dès le Caïn biblique) est l’une des motivations récurrentes. Or il est une autre sorte de crime millénaire, conjuguant la violence des deux espèces, qu’on peut dire le «crime de devoir sacré ».
Parce qu’ils étaient blasphémateurs, les collaborateurs de Charlie Hebdo répondaient de l’offense faite à Dieu et à son prophète. Parce qu’elles étaient juives, les victimes de la Porte de Vincennes méritaient le châtiment des « infidèles », de même que les 140 étudiants chrétiens massacrés en mars 2015 dans la ville kényane de Garissa. Quant à la tuerie aveugle de novembre 2015, suivie par le massacre de Nice et le non moins abominable assassinat du prêtre Jacques Hamel, ils illustrent diversement la force à l’état pur, dirigée contre tous ceux qui étaient supposés se vautrer dans l’impureté.
Mais l’obsession de la pureté n’a-t-elle pas fait, aussi, des ravages dans notre propre histoire ? C’est ce qu’illustre incidemment Le dragon du Muveran, qui traite de l’innocence bafouée d’un enfant et des conséquences « cosmiques » de son humiliation dont le fameux dragon de la légende est l’emblème.
Dès le Prologue du roman, une sorte de déni de culpabilité, ou plutôt de déplacement implicite de sa responsabilité dans une logique de châtiment divin, présente le tueur sous le masque de « l’homme qui n’était pas un meurtrier ». Belle idée de romancier, qui nous réserve d’autres surprises…
Nul besoin, au demeurant, d’avoir une licence de théologie dans sa poche-revolver pour démêler l’imbroglio de cette sombre histoire sur fond de prairies idylliques : le roman de Marc Voltenauer joue d’emblée sur la simplicité narrative d’un feuilleton à épisodes, chacun des 110 petits chapitres qui constituent ses 660 pages se trouvant balisé par le lieu et l’heure précise de l’action.

La lectrice et le lecteur de nos régions y (re)trouveront en outre le charme familier de lieux connus (Gryon et environs) et un scénario ancré dans le présent (on roule en 4x4) avec coucher initial rose orangé sur la mythique dalle de calcaire du Miroir de l’Argentine, vue proche sur la face du Grand Muveran célébrée par Ferdinand Hodler ; vue plus dégagée vers les Dents du Midi, non moins illustre créneau, et zoom latéral sur le chalet vintage de l’inspecteur de la criminelle lausannoise Andreas Auer, dans une clairière paradisiaque – tout cela expliquant plus ou moins l’immédiat succès populaire du roman par identification locale, mais il n’y a pas que ça, loin s’en faut.
De fait, Le Dragon du Muveran, malgré son écriture limpide et prodigue de détails très concrets (en allemand on dirait sachclich), sa tournure un peu carrée parfois ou affligée de quelques clichés, brasse une matière très riche, qui touche autant aux composantes économiques et psychologiques d’une société en mutation qu’à une tragédie aux résonances à la fois personnelles et collectives.
Sur cette ligne tragique verticale, c’est, d’une part, l’histoire d’un gosse mal aimé, puis violemment maltraité, qui aime Dieu et croit trouver en ce Père suprême la justification d’une vengeance « absolue ». Mais c’est aussi, dans le même pays quelques décennies plus tard, l’histoire du petit Luca défrayant la chronique valaisanne; ou c’est l’histoire de nombreux enfants « placés » et souvent abusés, ou encore l’histoire du terrifiant « sadique de Romont », qu’on a dit violé par un prêtre pédophile et dont une des victimes reproduisit l’agression sur d’autres enfants - cercle vicieux sempiternel exacerbé par le vertige de la force.
De façon plus immédiate et horizontale, Le Dragon du Muveran, roman policier, se structure par l’enquête menée conjointement par Andreas Auer - dont l’auteur souligne immédiatement l’ego surdimensionné, le narcissisme et la complexion de bientôt quadra, gay et professionnellement très compétent – et sa sympathique équipe aussi typées que dans une série télé genre The closer, en alternance avec le récit, modulé comme en sourdine, de ce que le futur tueur psychopathe a vécu en son enfance et sa jeunesse, avant son exil aux States.

En observateur frontal et perspicace de la nouvelle classe moyenne plus ou moins enrichie, Marc Voltenauer étoffe en outre son récit à partir des trajectoires de personnages représentatifs de celle-ci, tel l’agent immobilier Alain Gautier, le promoteur Jacques Charrier ou l’entrepreneur Maurice Fournier, personnages en vue et mêlés à divers trafics et autres parties fines impliquant des mineures ; tout un petit monde à la fois « normal » et possiblement « à la limite » de la légalité professionnelle ou privée, qu’on imagine se retrouvant entre barbecues et clubs échangistes.
Ce milieu à la fois conventionnel et « libéré », un Jacques Etienne Bovard en avait donné une première évocation il y a vingt ans de ça dans ses Nains de jardin (Campiche, 1996), et l’on en a trouvé d’autres aperçus littéraires dans quelques ouvrages plus récents, dont le polar de mœurs Canines, paru en 2010 à l’enseigne de Xénia, où le conseiller d’Etat Oskar Freysinger (mais si !) détaillait la scandaleuse affaire du petit Luca, ou encore dans les romans non moins « mauvais genre » de Daniel Abimi.
Cette composante sociologique du roman apparaît dès la présentation du compagnon de l’inspecteur Auer, Mikaël Achard, journaliste désormais libre qui revient d’un grand reportage en Angola où il a constaté lui-même les effets de la dévastation sociale liée à la spéculation financière, et le même type d’observations se module tout au long du livre par des reflets intéressants de notre univers économico-social, tant urbain que néo-rural, impliquant par exemple la Lex Weber...

Un pied-plat de nos régions, sévissant sur nos blogs lémaniques, s’est offusqué de ce que Marc Voltenauer pût imaginer un viol dans nos montagnes immaculées où meugle la vache d’Eugène Burnand. De surcroît, avec sa délicatesse coutumière, le bêta pseudo-nommé Géo ajoute que, sûrement, le succès populaire et médiatique du Dragon du Muveran tient au fait que l’inspecteur du roman soit homo ! Arguments débiles mais combien significatifs, propres à une Suisse décidément au-dessus de tout soupçon pour certains, alors même que le « retour du refoulé », ici comme ailleurs (du Portugal au Québec, en France, à Boston dans le film Spotlight, ou dans la campagne alémanique de L’enfance volée de Markus Imboden, entre cent autres exemples multinationaux) aligne les exemples de maltraitance , d’humiliations ou d’abus sexuels naguère camouflés et désormais moins invisibles, sinon moins impunis.
Exercice proposé aux écoliers de notre cher pays : comparez l’hypocrisie dont est victime la petite Aline du premier roman de Ramuz, baisée et ensuite larguée, enceinte, par le fils du syndic Damon, et celle qui « couvre » l’agression sexuelle dont se rend coupable un autre fils de syndic, à Gryon, septante ans plus tard, avant le déchaînement du dragon par le feu et le meurtre de « devoir divin »…
Marc Voltenauer n’a pas le génie d’une Flannery O’Connor, qui a sondé elle aussi les abysses des « fous de Dieu », notamment dans son roman intitulé Le malin, dont John Huston a tiré un film mémorable. Comme il en a témoigné, plutôt modestement, dans les médias, il a écrit Le Dragon du Muveran pour se faire plaisir et donner une suite à ses nombreuses lectures de passionné du « mauvais genre » noir, notamment dans ses récentes percées nordiques.
Cele étant et même si, stylistiquement, l’on relèvera qu’il « peut mieux faire », le nouvel auteur épate par le sérieux de son propos, la très large palette de son observation en matière sociale et psychologique, ou disons simplement humaine, qui rend ses personnages à la fois présents et attachants, à commencer par Mikaël le compagnon d’Andreas , journaliste intelligent (un ex-rédacteur fictif de 24 heures, soit dit en passant), de la mordante Karine partenaire d’Andreas ou du légiste dûment hurluberlu, entre autres...
 De surcroît, son propos “théologique” est des plus fondés, qui renvoie à la fois à une certaine violence monothéiste et à une lecture fondamentaliste autorisant aujourd’hui un évêque suisse, autant qu’une flopée d’imams ou de fous de Dieu de toute obédience, à recommander la peine de mort pour les homosexuels, entre autres applications terroristes du “devoir divin”...
De surcroît, son propos “théologique” est des plus fondés, qui renvoie à la fois à une certaine violence monothéiste et à une lecture fondamentaliste autorisant aujourd’hui un évêque suisse, autant qu’une flopée d’imams ou de fous de Dieu de toute obédience, à recommander la peine de mort pour les homosexuels, entre autres applications terroristes du “devoir divin”...
Un bémol tout de même à propos de la fin « américaine » du roman, qui prête au vengeur vaudois un passé de serial killer émasculant ses multiples victimes, au risque pour l’intrigue initiale de basculer dans un autre registre du roman, limite gore et plus rebattu – n’est pas Stephen King qui veut et c’est tant mieux. Sous les dehors d’une sorte de feuilleton populaire à la façon actuelle, probable exorcisme personnel, aussi, des hantises de l’auteur, Le Dragon du Muveran allie l’habileté parfois naïve d’un roman policier bien ficelé, et les coups de sonde d’un frère humain dans les ténèbres de la souffrance et du mal, de la pureté pervertie et d’une empathie figurée par l’ultime scène du roman, où l’exécuteur par « devoir divin » s’applique à lui-même le suprême châtiment…
Marc Voltenauer. Le Dragon du Muveran. Plaisir de lire, 668p.


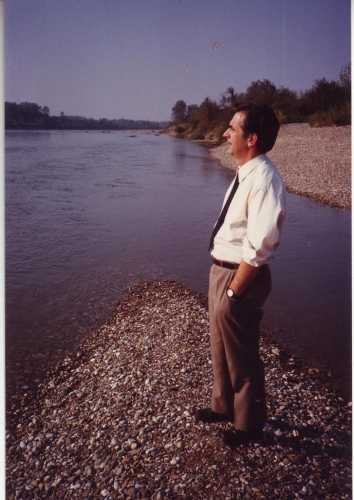 Drogy Brat,
Drogy Brat,

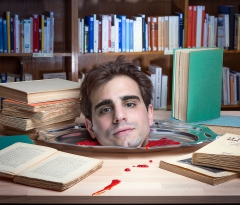

 Une clef de lecture du Dragon du Muveran, premier roman policier de Marc Voltenaur, petit-fils d’un évêque luthérien suédois, se trouve peut-être dans le dernier essai lumineux d’Etienne Barilier, fils de pasteur calviniste, intitulé Vertige de la force, où le romancier vaudois traducteur de Friedrich Dürrenmatt, fils de pasteur bernois, repère et définit, à propos des djihadistes islamistes, la notion de « crime de devoir sacré ».
Une clef de lecture du Dragon du Muveran, premier roman policier de Marc Voltenaur, petit-fils d’un évêque luthérien suédois, se trouve peut-être dans le dernier essai lumineux d’Etienne Barilier, fils de pasteur calviniste, intitulé Vertige de la force, où le romancier vaudois traducteur de Friedrich Dürrenmatt, fils de pasteur bernois, repère et définit, à propos des djihadistes islamistes, la notion de « crime de devoir sacré ». 


 De surcroît, son propos “théologique” est des plus fondés, qui renvoie à la fois à une certaine violence monothéiste et à une lecture fondamentaliste autorisant aujourd’hui un évêque suisse, autant qu’une flopée d’imams ou de fous de Dieu de toute obédience, à recommander la peine de mort pour les homosexuels, entre autres applications terroristes du “devoir divin”...
De surcroît, son propos “théologique” est des plus fondés, qui renvoie à la fois à une certaine violence monothéiste et à une lecture fondamentaliste autorisant aujourd’hui un évêque suisse, autant qu’une flopée d’imams ou de fous de Dieu de toute obédience, à recommander la peine de mort pour les homosexuels, entre autres applications terroristes du “devoir divin”...