
De Daniel Vuataz, dit le Kid, à JLK, dit le Papillon
En ville, le dimanche 14 avril 2013.
Cher toi,
Hier j’ai accompagné Marie-Louise à Montchoisi. Un chauffeur est venu nous chercher dans la cours pavée de Prélaz, au milieu des machines de chantier et des tas de terre mouillée. Eh oui, je n’ai toujours pas le permis. Le type, un bénévole turc d’origine kurde, a installé Marie-Louise à l’arrière sur le siège adapté. Il venait d’amener une classe de gamins à la piscine, c’était son dernier trajet avant la pause. Je suis monté à l’avant du bus. Pendant qu’il conduisait, Erdan m’a parlé du bouquin qu’il lisait en ce moment et qui était posé, à l’envers, sur la troisième banquette avant ; un essai d’une journaliste turque sur les déplacements de populations. En Arménie. Je lui ai raconté une partie de mon voyage dans son pays, dont tu sais aussi deux ou trois choses. Edran m’a fait jurer d’aller visiter l’est et les grands plateaux de « l’autre Turquie », la prochaine fois.
 Il nous a déposé, Marie-Louise et moi, devant la porte électrique en bois de la clinique. Comme il pleuvait (ça pourrait être n’importe quand entre janvier et maintenant), il a déployé un grand parapluie transparent pendant que je prenais Marie-Louise par la main, et il nous a suivi jusqu’à la porte. C’est moi qui suis allé annoncer Marie-Louise à la réception, parce qu’elle n’atteint pas la hauteur du comptoir et que, de toute façon, sa famille compte sur moi pour m’occuper d’elle. Dans la salle d’attente du département de radiologie, j’ai tenté de rassurer un peu Marie-Louise, qui jetait des regards angoissés à tous les autres patients. Elle ne tenait pas en place. Elle a appelé sa maman à plusieurs reprises et m’a demandé où nous nous trouvions. Je lui ai expliqué, pour la dixième fois de la matinée, que c’était moi qui l’accompagnais aujourd’hui et qu’elle allait passer une radiographie. Je ne suis pas sûr qu’elle connaisse ce mot. Elle m’a demandé si je resterais avec elle pendant la consultation. Je lui ai dit que oui. Dans la salle d’attente, Marie-Louise triturait les cordons de son pull, les tordait autour de ses petits doigts, jetais des regards effarouchés autour d’elle, dernière elle. Chaque fois que la porte s’ouvrait, elle sursautait un peu. La pluie battait les vitres propres. A un moment, le médecin est arrivé. J’ai accompagné Marie-Louise dans les pas de la blouse blanche, qui ne se retournait jamais dans les coudes des couloirs, se contentant de nous tenir les portes et d’appuyer sur les interrupteurs. Il paraissait plutôt vieux et voûté, il traînait un peu des pieds. Dans la petite salle de consultation, il m’a demandé de déshabiller Marie-Louise et de la coucher sur le lit. Je lui ai demandé s’il fallait que j’enlève aussi ses couches. Il a jeté un œil, et m’a dit qu’on ferait avec, qu’elle pouvait les laisser. Comme Marie-Louise, toute nue sur sa grosse feuille de papier, ne voulait pas rester tranquille, j’ai dû lui tenir la main pendant que le scanner survolait lentement son corps et que le docteur regardait l’image apparaître sur son écran, une strate horizontale après l’autre. Ça m’a fait penser à l’époque des premières connections Internet. Le survol a duré une vingtaine de minutes. Je crois que Marie-Louise s’est même endormie un moment, pendant que je lui tenais la main. Ensuite je l’ai rhabillée, et nous sommes revenus ensemble dans la salle d’attente, où un autre médecin nous attendait avec les résultats.
Il nous a déposé, Marie-Louise et moi, devant la porte électrique en bois de la clinique. Comme il pleuvait (ça pourrait être n’importe quand entre janvier et maintenant), il a déployé un grand parapluie transparent pendant que je prenais Marie-Louise par la main, et il nous a suivi jusqu’à la porte. C’est moi qui suis allé annoncer Marie-Louise à la réception, parce qu’elle n’atteint pas la hauteur du comptoir et que, de toute façon, sa famille compte sur moi pour m’occuper d’elle. Dans la salle d’attente du département de radiologie, j’ai tenté de rassurer un peu Marie-Louise, qui jetait des regards angoissés à tous les autres patients. Elle ne tenait pas en place. Elle a appelé sa maman à plusieurs reprises et m’a demandé où nous nous trouvions. Je lui ai expliqué, pour la dixième fois de la matinée, que c’était moi qui l’accompagnais aujourd’hui et qu’elle allait passer une radiographie. Je ne suis pas sûr qu’elle connaisse ce mot. Elle m’a demandé si je resterais avec elle pendant la consultation. Je lui ai dit que oui. Dans la salle d’attente, Marie-Louise triturait les cordons de son pull, les tordait autour de ses petits doigts, jetais des regards effarouchés autour d’elle, dernière elle. Chaque fois que la porte s’ouvrait, elle sursautait un peu. La pluie battait les vitres propres. A un moment, le médecin est arrivé. J’ai accompagné Marie-Louise dans les pas de la blouse blanche, qui ne se retournait jamais dans les coudes des couloirs, se contentant de nous tenir les portes et d’appuyer sur les interrupteurs. Il paraissait plutôt vieux et voûté, il traînait un peu des pieds. Dans la petite salle de consultation, il m’a demandé de déshabiller Marie-Louise et de la coucher sur le lit. Je lui ai demandé s’il fallait que j’enlève aussi ses couches. Il a jeté un œil, et m’a dit qu’on ferait avec, qu’elle pouvait les laisser. Comme Marie-Louise, toute nue sur sa grosse feuille de papier, ne voulait pas rester tranquille, j’ai dû lui tenir la main pendant que le scanner survolait lentement son corps et que le docteur regardait l’image apparaître sur son écran, une strate horizontale après l’autre. Ça m’a fait penser à l’époque des premières connections Internet. Le survol a duré une vingtaine de minutes. Je crois que Marie-Louise s’est même endormie un moment, pendant que je lui tenais la main. Ensuite je l’ai rhabillée, et nous sommes revenus ensemble dans la salle d’attente, où un autre médecin nous attendait avec les résultats.
 Il a dit à Marie-Louise – en sachant que c’était moi qui écoutais, moi qui me souviendrais du rapport – qu’elle n’avait pas d’ostéoporose, ce qui était une bonne chose, mais qu’elle devait à présent faire attention à son équilibre, parce que ses chutes à répétition et les fractures qui en découlaient allaient la clouer définitivement dans un fauteuil roulant. Marie-Louise ne regardait pas le médecin mais posait sur moi ses yeux insolubles de coucou. Marie-Louise a presque nonante ans. Sur la feuille administrative que je dois tendre aux médecins lorsque je l’accompagne, comme aujourd’hui, pour une consultation hors de la Fondation, il est inscrit : « Diagnostic général : classe 12 ». Je ne sais pas ce que ça signifie, cher Jean-Louis, je ne connais pas les subtilités ni les catégories de cette échelle de la santé physique et mentale, mais je sais que la plupart des résidents que je côtoie se situent autour des classes 7 ou 8. L’Alzheimer de Marie-Louise est à un stade difficilement imaginable.
Il a dit à Marie-Louise – en sachant que c’était moi qui écoutais, moi qui me souviendrais du rapport – qu’elle n’avait pas d’ostéoporose, ce qui était une bonne chose, mais qu’elle devait à présent faire attention à son équilibre, parce que ses chutes à répétition et les fractures qui en découlaient allaient la clouer définitivement dans un fauteuil roulant. Marie-Louise ne regardait pas le médecin mais posait sur moi ses yeux insolubles de coucou. Marie-Louise a presque nonante ans. Sur la feuille administrative que je dois tendre aux médecins lorsque je l’accompagne, comme aujourd’hui, pour une consultation hors de la Fondation, il est inscrit : « Diagnostic général : classe 12 ». Je ne sais pas ce que ça signifie, cher Jean-Louis, je ne connais pas les subtilités ni les catégories de cette échelle de la santé physique et mentale, mais je sais que la plupart des résidents que je côtoie se situent autour des classes 7 ou 8. L’Alzheimer de Marie-Louise est à un stade difficilement imaginable.
Voilà, mon cher jeune et fringuant retraité, une toute petite partie de mon quotidien de ces cinq dernier mois. Quand je t’ai écrit pour la dernière fois, en novembre passé, je m’apprêtais à pénétrer, après un cours fédéral aussi obligatoire que désastreux, les couloirs de formica patinés de la Fondation Clémence, pour six mois. Les six derniers de mon service civil, après les sept autres passés au service d’un génial « petit vieux » de douze ans et demi et trente-six mille ans prénommé Charles-Albert.
 Ici, je suis affecté à l’animation. Concrètement, sur le papier du moins, ça implique de servir des repas, des cafés, d’accompagner des résidents sur le lieu de leurs activités ou rendez-vous, de leur apporter un peu de compagnie, de leur proposer des activités personnelles ou collectives. Il y a le choix: poterie, aquarelle, tricot, cuisine, jeux de cartes ou de société (Scrabble, Hâte-toi lentement), lecture du journal (20 Minutes et « La Feuille »), concerts, offices religieux, promenades… Un civiliste qui terminait au moment où je suis arrivé, en décembre, m’a montré le résultat d’une petite enquête menée dans un autre EMS, il y a quelques années, au sujet des préoccupations principales des résidents. Les services que l’« animation » propose arrivaient loin derrière les besoins de base, sacrés, révérés : manger et dormir. Pourtant, chaque jour passé ici m’a fait comprendre à quel point ce que je fais est essentiel.
Ici, je suis affecté à l’animation. Concrètement, sur le papier du moins, ça implique de servir des repas, des cafés, d’accompagner des résidents sur le lieu de leurs activités ou rendez-vous, de leur apporter un peu de compagnie, de leur proposer des activités personnelles ou collectives. Il y a le choix: poterie, aquarelle, tricot, cuisine, jeux de cartes ou de société (Scrabble, Hâte-toi lentement), lecture du journal (20 Minutes et « La Feuille »), concerts, offices religieux, promenades… Un civiliste qui terminait au moment où je suis arrivé, en décembre, m’a montré le résultat d’une petite enquête menée dans un autre EMS, il y a quelques années, au sujet des préoccupations principales des résidents. Les services que l’« animation » propose arrivaient loin derrière les besoins de base, sacrés, révérés : manger et dormir. Pourtant, chaque jour passé ici m’a fait comprendre à quel point ce que je fais est essentiel.
Le plus facile, pour moi, c’est le contact. Le bête et pas si bête rapport humain. J’ai l’impression d’avoir fait ça toute ma vie, ou toute une autre vie. Même s’il faut trois ou quatre mois pour que les résidents les plus valides commencent à retenir mon nom, même si certains jours tout va de travers, il y a une dimension presque sacrée – en dépit des odeurs de pisse, de café froid, de médicaments, de désinfectant et de vieille pantoufles – qui meuble le temps et l’espace.
Evidemment, le stress et le surmenage guettent à chaque étage (et ici il y en a cinq, pour une centaine de résidents « longs-séjour », quarante « bénéficiaires du Centre d’accueil temporaire », une vingtaine de pensionnaires des « courts-séjours » et douze locataires des appartements protégés), tant le statut de « civiliste » inscrit sur nos badges (nous sommes entre cinq et dix dans la maison) donne la possibilité à n’importe quel membre du personnel fixe de nous employer pour une tâche ou une autre. Il y a des journées-girouettes. Mais des rapports se construisent, malgré tout, avec une poignée de résidents à qui j’ai affaire presque tous les jours, du petit-déjeuner au repas du soir.
Il faut que je te précise que ces EMS modernes sont en fait, bel et bien, des « mouroirs ». C’est un fait. Je crois que la durée moyenne d’un « long séjour », avant de repartir les pieds en avant, est de dix-huit mois. La moyenne d’âge, à mon étage, frise les nonante ans. Les familles qui placent leurs parents en établissement, au XXIe siècle, ne le font qu’au tout dernier moment, en toute dernière option. Avant cela, durant ce fameux « troisième âge » que tu connais depuis peu (je n’invente rien, il commence officiellement à la retraite mon cher), et pendant une partie des « âges » suivants, il existe toutes sortes de configurations qui tiennent les seniors hors des murs des Fondations, souvent fort heureusement. Une famille prévoyante et disponible, des services de soins à domicile, des appartements protégés… Franchement, ceux qui prennent leur dernier quartier ici appartiennent à la catégorie ultime. Troubles cognitifs graves (la plupart ont connu des accidents vasculaires ou cérébraux handicapant), perte presque totale de l’indépendance, gros soucis physiques, maladies typiques de la vieillesse. Des esprits sains piégés dans des corps foutus. Des têtes vides au-dessus de carcasses plus ou moins opérationnelles. C’est à chaque fois injuste. J’ai passé les trois premières semaines, honnêtement, à retenir des larmes, des émotions, de la colère.
Trente fauteuils roulants qui chevrotent « Voici Noël » en fermant les yeux pendant qu’une bénévole plaque des accords protestants sur un piano désaccordé : à la télé, c’est un sketch, mais dans la réalité, dans une réalité constamment répétée, c’est un coup dans la nuque. Un papy que je regarde, pendant une dizaine de minutes, tenter de se lever de son siège, centimètre de genou par centimètre de genou. Des histoires qui tournent en boucle. Des instants de grâce. Un étage à moitié décimé par une grippe. Une octogénaire qui éternue du sang. Des couples qui se reforment à presque cent ans. Des familles qu’on ne voit jamais, d’autres qui établissent le campement de guerre. Des histoires, des histoires, des histoires…
Je suis arrivé en même temps que Louis, le tatoué, qui a passé quinze ans de sa jeunesse dans la marine marchande, entre l’Amérique centrale et la Scandinavie. A Cuba, les putes n’attendaient même pas sur le quai, elles montaient sur le cargo dès qu’il touchait la grève. Sa femme est morte dans un accident de voiture à Göteborg, alors qu’elle n’avait pas quarante ans. Celle d’André, le chauffeur des TL qui ne connaît pas Marius, est aussi décédée depuis peu, mais lui ne le sait toujours pas, et ne le saura jamais. Il passe son temps à l’attendre, immobile, les yeux grands ouverts sur la dernière chaise du couloir, face à la porte vitrée décorée de fleurs en papier et de mains découpées dans du bristol de couleur, exactement comme aux fenêtres des enfantines. Quand on l’informe de la nouvelle, il sourit de l’air de celui à qui on ne la fait pas. Il a les mêmes yeux de Rosa, quand elle me montre une photo d’elle, en noir et blanc, prise dans les années 1950 alors qu’elle se lançait, à vingt ans, dans le mannequinat. Elle sort l’image de son portefeuille, la déplie lentement, souffle dessus, me la tend, et m’explique qu’elle ne peut plus la voir à cause de ses yeux qui l’ont presque complètement lâchée. Elle ne voit pas non plus le vertige temporel qui me soulève à la confrontation de ce souvenir, j’ai les visions simultanées du modèle, de la photo, puis de mon corps que j’observe soudain projeté en avant, dédoublé, ridé et déposé sur une chaise immobile à côté de Rosa. Mathilde et Roger sont un des rares couples de la Fondation. Lui est un grand-papa gâteau, brave sur la pente ignoble de son Parkinson, et puis soudain ses yeux s’embuent et il tape du point sur ses cuisses à se fendre le fémur, de rage, alors qu’il m’explique dans le cabinet du dentiste qu’aucun médicament n’a plus d’effet sur lui. La plupart lui donnent des hallucinations qu’il redoute plus que tout, même que sa femme. Willy, qui cultive un sale Parkinson lui-aussi, me raconte sa bibliothèque idéale (Balzac, Maupassant, Dumas, Dostoïevski et Cendrars) et me récite, de tête, les Soliloques du pauvre et Un cœur en hiver. Chaque vers prend dix minutes. Parfois, on a l’impression qu’il va simplement s’arrêter de parler et se figer, comme une statue dans un séisme microscopique. Suzanne a eu mon arrière-grand-mère comme maîtresse d’école à Genève. Elle adorait écouter Roger Vuataz à la radio le week-end, mais elle ne sais jamais à quel étage elle « habite ». A tout le monde elle répète qu’elle est « dans le cirage ». Jan m’a tout de suite fait penser, physiquement, à mon grand-père vers la fin de sa vie. Ses narines sont rétrécies, il a des quintes de toux parfois très longues, il est très maigre et très léger. Il es né à Alexandrie, a inventé le commerce international de la noix de cajou et a occupé un poste ministériel dans l’agriculture du Gabon dans les années septante. Il a laissé tout l’argent à sa femme, quinze ans plus jeune que lui, pour se faire pardonner des nombreuses libertés prises avec elle. Maintenant il vit au crochet de l’Etat et mange son pain toasté tous les matins, que lui apporte son infirmière préférée, Pauline. Je lui apprends l’étymologie des mots savants qu’il a oubliés, il semble à la fois incrédule et passionné. Parfois il m’insulte violemment. Il parle sept langues, encore parfaitement. La plupart des autres résidents sont à peine partis de leurs villages natals. Les familles nombreuses sont légions (jusqu’à quinze ou seize frères et sœurs). Les métiers modestes aussi. Beaucoup d’imprimeurs, de relieurs, de typographes.
Lausanne, ville de journaux. Quand je leur lis des Contes lausannois de Marcel Raoux, même si c’est plutôt la génération de leurs propres parents, la géographie leur parle. Depuis les toits et les balcons à véranda de l’avenue de Morges, en pleine ville, ils peuvent voir jour après jour la cité se métamorphoser. Sur les questions d’urbanisme ancien, ils sont incollables.
 Le jour de la Saint-Valentin, je suis allé à la morgue. L’hiver avait emporté le quart de mon étage. Quatre décès en deux semaines. Lucette était morte la veille, après sa dernière fondue. C’est l’animatrice qui m’a proposé de descendre. Une fois dans la pièce froide, en béton nu, une fois devant le lit, seul dans la pièce au sous-sol de la Fondation, une fois à côté de ce corps nu tout juste recouvert d’un drap très fin tiré jusqu’au thorax, du coton dans les yeux et les oreilles, le menton soutenu par une armature en fil de fer, j’ai réalisé que c’était le premier mort que je voyais de ma vie. Il ne ressemblait pas du tout à Lucette. Il ne ressemblait pas du tout à quelque chose de vivant. J’ai pu rester une minute ou une heure, je ne sais pas.
Le jour de la Saint-Valentin, je suis allé à la morgue. L’hiver avait emporté le quart de mon étage. Quatre décès en deux semaines. Lucette était morte la veille, après sa dernière fondue. C’est l’animatrice qui m’a proposé de descendre. Une fois dans la pièce froide, en béton nu, une fois devant le lit, seul dans la pièce au sous-sol de la Fondation, une fois à côté de ce corps nu tout juste recouvert d’un drap très fin tiré jusqu’au thorax, du coton dans les yeux et les oreilles, le menton soutenu par une armature en fil de fer, j’ai réalisé que c’était le premier mort que je voyais de ma vie. Il ne ressemblait pas du tout à Lucette. Il ne ressemblait pas du tout à quelque chose de vivant. J’ai pu rester une minute ou une heure, je ne sais pas.
Et puis un quart d’heure plus tard, j’avais enfilé ma chemise noire satinée et je croonais What a wonderful world à la clarinette, un étage au-dessus, pour égayer la Saint-Valentin d’une quinzaine de couples de la Fondation. Je vois encore Lucette, maintenant, quand je ferme les yeux. J’apprends à faire la part des choses. On est tous un peu schizos, ici.
Tu y penses, toi, à ta mort ? Tu y songes, à ta vieillesse, celle qui te tiendra éloignée de tes chemins de traverses, de ton isba, de tes promenades avec Snoopy, de ta Jazz, des rayons les plus élevés de tes étagères remplies de pavés ? Tu te vois comment, toi, en petit vieux ? Et ta bonne amie ? Moi, je te jure, je n’y ai jamais autant pensé. C’est un miroir tendu, un brise-glace silencieux, Sisyphe assis sur son caillou version Rodin, ce service civil. Le soir je rentre en bus jusqu’à Bellevaux, le monde me semble étrange, grouillant, bruyant, et il me faut plusieurs heures pour réussir à me plonger dans quelque chose d’absorbant. Parfois c’est paralysant. Parfois c’est grisant. La vieillesse, la mort, la vie, l’altérité à soi, ce sont des pierres au fond de mon ventre. Je n’y ai jamais autant pensé. Et puis je n’ai jamais, non plus, compris autant.
On s’habitue à tout. Ça me fout les boules, d’un côté. Il y a des jours où je peux me tordre de rire avec les infirmières parce que Francine a uriné partout dans sa chambre, ou dire d’un air détaché, avec un collègue, que « Monsieur Rochat a bien baissé » et que ça ne m’étonnerait pas qu’on ait « bientôt une chambre de libre »…
Et puis, en même temps, je continue à découvrir. A propos de moi, des autres, de toute cette drôle de ronde, des danses des morts peintes sur les murs jaunes des églises anciennes de Slovénie, de l’attachement, du détachement, de la cruauté, de la beauté, du souvenir, de l’écriture. Il n’y a plus de vide entre les dalles. Ma sœur vient de m’annoncer qu’elle attend un gamin.
À chaque fois que je trouve ma tâche compliquée, je pense à Marie-Louise, cher Jean-Louis, et je tente de l’imaginer, à cinq ans, à dix ans, à mon âge, à trente ans, à cinquante ans, à la retraite, à ton âge, sur la table de Lucette. Je n’y arrive pas. Jamais. Marie-Louise est à la fois cette vieille dame vulnérable et isolée, et cette très petite fille inquiète qui appelle sa maman. Elle ne peut pas être autre chose. Il n’y a rien d’autre à dire.
Tu vois, j’aurais voulu te parler de tout ce qui m’arrive de « concret » depuis 5 mois. Un bouquin qui fait des échos, des projets qui aboutissent, l’AJAR, des jobs qui se profilent. Des choix assumés, des livres lus, même des livres vendus. Je mène une vie fragmentée puisque je n’ai renoncé à presque rien de mes activités d’« avant » pendant ce service obligatoire qui m’occupe pourtant de 8h à 18h – j’ai renoncé à une partie de mon sommeil et de ma vie sociale, c’est vrai, et mon rythme s’est ralenti.
 J’aurais voulu te raconter les dernières nouvelles et les derniers ragots du royaume éphémère des lettres d’ici et d’ailleurs. Tu aurais souri de bienveillance, ou tu m’aurais traité de petit con inculte, peut-être, avant de renchérir sur l’avancée de tes Cervins, de tes livres qui poussent aux quatre vents, de tes découvertes récentes, tes déceptions, tes coups de blues ou tes âges d’or. Tu aurais houspillé « ceux qui freinent à la montée », raillé « celui qui retire l’échelle derrière lui » et dénoncé « celle qui est atteinte de jeunisme ». On aurait pu débattre de tout ça. Puis, finalement, tu vois, je crois que je t’ai parlé de ce qui a vraiment compté pour moi depuis ma dernière lettre. Je ne m’étends pas tellement autour de moi à ce sujet, d’ailleurs, à part sous forme de debriefing naturel, avec Camille. Et ça me fait pourtant très plaisir de te l’écrire, ça me paraît d’une évidence imparable. Il y a une année jours pour jours, aujourd’hui, je tournais le dos à l’Afrique et à deux potes magnétisés pour rentrer au bercail. J’avais la mort dans l’âme. On est des pommes, je te le dis, quand il s’agit de se projeter dans le temps, en avant ou en arrière. Il y a des choses qu’il ne faut pas perdre de vue. Pour le reste, on a le temps, et le présent…
J’aurais voulu te raconter les dernières nouvelles et les derniers ragots du royaume éphémère des lettres d’ici et d’ailleurs. Tu aurais souri de bienveillance, ou tu m’aurais traité de petit con inculte, peut-être, avant de renchérir sur l’avancée de tes Cervins, de tes livres qui poussent aux quatre vents, de tes découvertes récentes, tes déceptions, tes coups de blues ou tes âges d’or. Tu aurais houspillé « ceux qui freinent à la montée », raillé « celui qui retire l’échelle derrière lui » et dénoncé « celle qui est atteinte de jeunisme ». On aurait pu débattre de tout ça. Puis, finalement, tu vois, je crois que je t’ai parlé de ce qui a vraiment compté pour moi depuis ma dernière lettre. Je ne m’étends pas tellement autour de moi à ce sujet, d’ailleurs, à part sous forme de debriefing naturel, avec Camille. Et ça me fait pourtant très plaisir de te l’écrire, ça me paraît d’une évidence imparable. Il y a une année jours pour jours, aujourd’hui, je tournais le dos à l’Afrique et à deux potes magnétisés pour rentrer au bercail. J’avais la mort dans l’âme. On est des pommes, je te le dis, quand il s’agit de se projeter dans le temps, en avant ou en arrière. Il y a des choses qu’il ne faut pas perdre de vue. Pour le reste, on a le temps, et le présent…
Prends soin de toi,
Le kid

 Or curieusement, c'est justement le summum de l'artifice qui m'a intéressé dans cette version frisant parfois le surréalisme dans le kitsch visuel, comparable au parti pris esthétique hyper-kitsch du Querelle de Jean Genet adapté par Rainer Werner Fassbinder, autre exemple d'une transposition paradoxalement très proche du texte en dépit de sa féerie plastique. Car les mots du texte de Fitzgerald traversent le film de part en part, sous la plume de Nick Carraway le narrateur.
Or curieusement, c'est justement le summum de l'artifice qui m'a intéressé dans cette version frisant parfois le surréalisme dans le kitsch visuel, comparable au parti pris esthétique hyper-kitsch du Querelle de Jean Genet adapté par Rainer Werner Fassbinder, autre exemple d'une transposition paradoxalement très proche du texte en dépit de sa féerie plastique. Car les mots du texte de Fitzgerald traversent le film de part en part, sous la plume de Nick Carraway le narrateur.  Je comprends, cela va sans dire, la frustration de ceux qui s'attendaient à une adaptation plus "classique" du Great Gatsby, tant par le décor que par l'atmosphère de l'époque. En l'occurrence, cependant le "décor" numérique de New York et des châteaux, évoquant plus le Las Vegas d'un cocaïnomane que les demeures patriciennes de la côte Est, touche au rêve éveillé par sa grandiose folie autant que par l'hyperréalisme de BD des scènes misérabilistes, constituant une sorte d'objet en soi et ressortissant plus à la manipulations d'images virtuelles qu'au cinéma ordinaire, dans lequel s'inscrivent les protagonistes.
Je comprends, cela va sans dire, la frustration de ceux qui s'attendaient à une adaptation plus "classique" du Great Gatsby, tant par le décor que par l'atmosphère de l'époque. En l'occurrence, cependant le "décor" numérique de New York et des châteaux, évoquant plus le Las Vegas d'un cocaïnomane que les demeures patriciennes de la côte Est, touche au rêve éveillé par sa grandiose folie autant que par l'hyperréalisme de BD des scènes misérabilistes, constituant une sorte d'objet en soi et ressortissant plus à la manipulations d'images virtuelles qu'au cinéma ordinaire, dans lequel s'inscrivent les protagonistes. Cela étant, les personnages du drame sont bien là, physiquement présents et "dégageant" leur aura particulière, autant en ce qui concerne Jay Gatsby campé par le magistral Leonardo di Caprio, que l'adorable Daisy en son double rôle (Carey Mulligan) et le "narrateur" Nick Carraway (Tobey Maguire) dont la présence décentrée de témoin est bien rendue par un jeu distancié non dénué d'attention amicale.
Cela étant, les personnages du drame sont bien là, physiquement présents et "dégageant" leur aura particulière, autant en ce qui concerne Jay Gatsby campé par le magistral Leonardo di Caprio, que l'adorable Daisy en son double rôle (Carey Mulligan) et le "narrateur" Nick Carraway (Tobey Maguire) dont la présence décentrée de témoin est bien rendue par un jeu distancié non dénué d'attention amicale. 

 La nouvelle édition critique des Oeuvres complètes
La nouvelle édition critique des Oeuvres complètes  Vélocipédiste savant sillonnant l’Europe, d’Ouchy à Sienne ou de Genève à Paris, en passant par le Maroc et la Provence, avec sa petite valise aux manuscrits, son béret basque, ses boîtes de cachous (pour les enfants) et ses pantalons golf, Cingria fut le plus atypique des écrivains issus de Suisse romande. Pittoresque et bien plus, ce fils de famille cosmopolite (Turco-polonaise et genevoise d’assimilation) d’abord aisée et ensuite ruinée, ne gagna jamais sa pitance qu’en écrivant. Des tables l’accueillaient un peu partout pour le
Vélocipédiste savant sillonnant l’Europe, d’Ouchy à Sienne ou de Genève à Paris, en passant par le Maroc et la Provence, avec sa petite valise aux manuscrits, son béret basque, ses boîtes de cachous (pour les enfants) et ses pantalons golf, Cingria fut le plus atypique des écrivains issus de Suisse romande. Pittoresque et bien plus, ce fils de famille cosmopolite (Turco-polonaise et genevoise d’assimilation) d’abord aisée et ensuite ruinée, ne gagna jamais sa pitance qu’en écrivant. Des tables l’accueillaient un peu partout pour le À relever alors: que ses écrits follement originaux, lumineusement profonds, furieusement toniques, mais aussi précieux, voire parfois abscons, n’ont jamais cessé d’être lus depuis la mort de l’écrivain. De nouvelles générations d’amateurs et de commentateurs se bousculent ainsi au portillon du paradis poétique de celui qu’on appelle familièrement Charles-Albert, comme Rousseau est appelé Jean-Jacques.
À relever alors: que ses écrits follement originaux, lumineusement profonds, furieusement toniques, mais aussi précieux, voire parfois abscons, n’ont jamais cessé d’être lus depuis la mort de l’écrivain. De nouvelles générations d’amateurs et de commentateurs se bousculent ainsi au portillon du paradis poétique de celui qu’on appelle familièrement Charles-Albert, comme Rousseau est appelé Jean-Jacques. Une constellation d 'hommage persillés
Une constellation d 'hommage persillés
 Les portraits du vivant de Ramuz nous le montrent sous un visage austère. Il a l’air bien grave, Monsieur Ramuz, sur les photos. Pas le genre bohème ou romantique, même en sa jeunesse, d’un Rimbaud ou d’un Blaise Cendrars, le grand voyageur qui fait rêver les adolescents. L’air digne, Ramuz n’a rien d’une « icône » de la littérature, comme on le dit aujourd’hui. Son apparence est d’un homme de lettres posé, non sans élégance avec sa cape noire, l’air un peu démodé.
Les portraits du vivant de Ramuz nous le montrent sous un visage austère. Il a l’air bien grave, Monsieur Ramuz, sur les photos. Pas le genre bohème ou romantique, même en sa jeunesse, d’un Rimbaud ou d’un Blaise Cendrars, le grand voyageur qui fait rêver les adolescents. L’air digne, Ramuz n’a rien d’une « icône » de la littérature, comme on le dit aujourd’hui. Son apparence est d’un homme de lettres posé, non sans élégance avec sa cape noire, l’air un peu démodé. Entre le lac et le soleil, la terre est travaillée par l’homme, comme il en a été de tout temps et partout. Or, les personnages de Ramuz, même vivant à la campagne ou à la montagne, nous touchent au cœur par les drames qu’ils vivent, comme les ont vécu les hommes de tous les temps et de tous les lieux de la terre.
Entre le lac et le soleil, la terre est travaillée par l’homme, comme il en a été de tout temps et partout. Or, les personnages de Ramuz, même vivant à la campagne ou à la montagne, nous touchent au cœur par les drames qu’ils vivent, comme les ont vécu les hommes de tous les temps et de tous les lieux de la terre.
 Ramuz détestait les bourgeois encaqués dans leur confort, sans céder pour autant aux sirènes des idéologies de son époque, nazisme ou communisme. Il fut un grand romancier des destinées individuelles dans ses cinq premier romans, avant une mutation marquée par la publication d’
Ramuz détestait les bourgeois encaqués dans leur confort, sans céder pour autant aux sirènes des idéologies de son époque, nazisme ou communisme. Il fut un grand romancier des destinées individuelles dans ses cinq premier romans, avant une mutation marquée par la publication d’




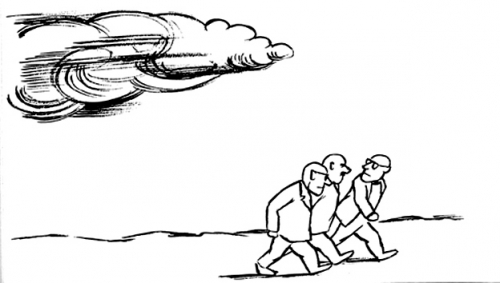










 Bref, ce jeune auteur romand s'est enfilé dans la brèche de langage et de vérité peu reluisante ouverte naguère par l'Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, dans un roman-profération qui fait suite aussi, en Suisse romande, à la romance-pamphlet de L'Amour nègre de Jean-Michel Olivier. Comme le temps est venu de tomber les masques, je précise que le petit con en question, juste un peu moins choyé des pétasses que cet autre jeune crevé de Joël Dicker, n'est autre que Quentin Moron. Vous n'allez pas vous faire chier en Lisant La Combustion humaine, même si c'est encore un petit livre. S'il n'est pas phagocyté par une pétasse, ou flingué par un connard jaloux, à moins encore qu'il ne se jette dans le Rhône entre le quartier des putes et celui des banques, Quentin nous fera plus tard de grands livres. Et FUCK si je me plante...
Bref, ce jeune auteur romand s'est enfilé dans la brèche de langage et de vérité peu reluisante ouverte naguère par l'Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, dans un roman-profération qui fait suite aussi, en Suisse romande, à la romance-pamphlet de L'Amour nègre de Jean-Michel Olivier. Comme le temps est venu de tomber les masques, je précise que le petit con en question, juste un peu moins choyé des pétasses que cet autre jeune crevé de Joël Dicker, n'est autre que Quentin Moron. Vous n'allez pas vous faire chier en Lisant La Combustion humaine, même si c'est encore un petit livre. S'il n'est pas phagocyté par une pétasse, ou flingué par un connard jaloux, à moins encore qu'il ne se jette dans le Rhône entre le quartier des putes et celui des banques, Quentin nous fera plus tard de grands livres. Et FUCK si je me plante... 
 Six mois donc que je me suis lancé dans le fleuve avec notre cher Kid, six mois que ma maison, c'est un grand sac prêté par un grand frère et un petit sac prêté par un autre grand frère, six mois le long d'un tracé sur l'océan et une étroite bande d'un autre continent. Six mois que tu m'as dit « forza! » sur le parking à vélos devant le Buffet de la Gare. Peu avant, tu m'avais téléphoné pour qu'on se voie avant mon départ, je descendais la rue du Bugnon, je sortais de la polyclinique avec dans le sang un vaccin contre la rage bubonique de Palombie (ou quelque mal similaire). Tu m'as appelé et comme je te demandais s'il fallait prendre Proust ou Dostoïevski pour mes dix jours de cargo, tu m'as conseillé de prendre Dosto ou mieux encore, Conrad ou Naipaul, en ajoutant : « tu liras Proust en prison ! »
Six mois donc que je me suis lancé dans le fleuve avec notre cher Kid, six mois que ma maison, c'est un grand sac prêté par un grand frère et un petit sac prêté par un autre grand frère, six mois le long d'un tracé sur l'océan et une étroite bande d'un autre continent. Six mois que tu m'as dit « forza! » sur le parking à vélos devant le Buffet de la Gare. Peu avant, tu m'avais téléphoné pour qu'on se voie avant mon départ, je descendais la rue du Bugnon, je sortais de la polyclinique avec dans le sang un vaccin contre la rage bubonique de Palombie (ou quelque mal similaire). Tu m'as appelé et comme je te demandais s'il fallait prendre Proust ou Dostoïevski pour mes dix jours de cargo, tu m'as conseillé de prendre Dosto ou mieux encore, Conrad ou Naipaul, en ajoutant : « tu liras Proust en prison ! »
 Il est vrai que la pensée de la mort s'accentue avec l'âge, surtout avant le premier café du matin, mais ce n'est pas de cet état d'âme à composante surtout physique, non sans résonance métaphysique évidemment, que j'ai envie et plus encore besoin de te parler en ces jours d'entre saisons: c'est plutôt de la vie et, par contraste, de ce qu'on pourrait dire la vie amortie que je vais tâcher de te parler par manière de réponse.
Il est vrai que la pensée de la mort s'accentue avec l'âge, surtout avant le premier café du matin, mais ce n'est pas de cet état d'âme à composante surtout physique, non sans résonance métaphysique évidemment, que j'ai envie et plus encore besoin de te parler en ces jours d'entre saisons: c'est plutôt de la vie et, par contraste, de ce qu'on pourrait dire la vie amortie que je vais tâcher de te parler par manière de réponse.  Tout ça n'est pas tout à fait nouveau. Il y a bien un siècle et même plus (on pense à Dostoïevski, avant Metropolis et Kafka) que ce processus de déshumanisation formatée, de nettoyage et de liquidation a été pressenti et ensuite décrit par ces observateurs délicats de notre société dite évoluée que sont les écrivains, bien avant les sociologues. Dino Buzzati, avec sa Chasse aux vieux et son évocation de l'usine-hôpital, est aussi à relire...
Tout ça n'est pas tout à fait nouveau. Il y a bien un siècle et même plus (on pense à Dostoïevski, avant Metropolis et Kafka) que ce processus de déshumanisation formatée, de nettoyage et de liquidation a été pressenti et ensuite décrit par ces observateurs délicats de notre société dite évoluée que sont les écrivains, bien avant les sociologues. Dino Buzzati, avec sa Chasse aux vieux et son évocation de l'usine-hôpital, est aussi à relire... Le piquant de la situation tient au fait que ton refus de servir t'ait permis d'éviter de ne servir à rien, dans les rangs de l'armée ordinaire, pour servir la culture et le social. Je suis un peu de mauvaise foi, en tant qu'ancien canonnier de montagne, en affirmant que l'armée ordinaire suisse ne sert à rien puisque c'est sous l'uniforme, et notamment dans la tenue d'assaut pourvue de 15 poches, qu'il m'a été donné de lire l'intégralité des pièces et des récits d'Anton Pavlovich Tchékhov, au soleil des monts ou par fortins et fenils, durant les heures de pauses constituant l'essentiel de la formation et de l'activité militaires.
Le piquant de la situation tient au fait que ton refus de servir t'ait permis d'éviter de ne servir à rien, dans les rangs de l'armée ordinaire, pour servir la culture et le social. Je suis un peu de mauvaise foi, en tant qu'ancien canonnier de montagne, en affirmant que l'armée ordinaire suisse ne sert à rien puisque c'est sous l'uniforme, et notamment dans la tenue d'assaut pourvue de 15 poches, qu'il m'a été donné de lire l'intégralité des pièces et des récits d'Anton Pavlovich Tchékhov, au soleil des monts ou par fortins et fenils, durant les heures de pauses constituant l'essentiel de la formation et de l'activité militaires.  Je suis également entrain de lire la correspondance de Cendrars avec Henry Miller et là aussi tu verras combien la rue, autant que l'hôpital ou l'asile de dingues, est une école plus enseignante que l'école des enseignants. Note que je ne jette aucune pierre. Tchékhov était hanté par le désir de voir plus d'instituteurs dans la Russie du début du XXe siècle, et c'est peut-être ça aussi qui nous manque en lieu et place d'enseignants et d'apprenants formatés pour le Système: des instituteurs qui savent tout et sont respectés par tous. On peut rêver...
Je suis également entrain de lire la correspondance de Cendrars avec Henry Miller et là aussi tu verras combien la rue, autant que l'hôpital ou l'asile de dingues, est une école plus enseignante que l'école des enseignants. Note que je ne jette aucune pierre. Tchékhov était hanté par le désir de voir plus d'instituteurs dans la Russie du début du XXe siècle, et c'est peut-être ça aussi qui nous manque en lieu et place d'enseignants et d'apprenants formatés pour le Système: des instituteurs qui savent tout et sont respectés par tous. On peut rêver... Aux alentours de Mai 68, le climat de la faculté des Lettres de Lausanne m'a immédiatement oppressé et découragé; dès la séance d'accueil où le Doyen nous a fait comprendre qu'aimer la littérature était pour ainsi dire rédhibitoire en ces lieux où l'on étudierait scientifiquement la textualité textuelle et les structures structurales; et sa mine de pion navré, l'ambiance compassée et feutrée de l'Ancienne Académie où avaient couvé les oeufs pâles de tants d'autres pions rassis, m'a vite fait établir mes quartiers entre le bar à café bien nommé Barbare et la librairie anar de Claude Frochaux, entre autres points de chute de mes universités buissonnières.
Aux alentours de Mai 68, le climat de la faculté des Lettres de Lausanne m'a immédiatement oppressé et découragé; dès la séance d'accueil où le Doyen nous a fait comprendre qu'aimer la littérature était pour ainsi dire rédhibitoire en ces lieux où l'on étudierait scientifiquement la textualité textuelle et les structures structurales; et sa mine de pion navré, l'ambiance compassée et feutrée de l'Ancienne Académie où avaient couvé les oeufs pâles de tants d'autres pions rassis, m'a vite fait établir mes quartiers entre le bar à café bien nommé Barbare et la librairie anar de Claude Frochaux, entre autres points de chute de mes universités buissonnières. Il y avait là des personnages. Le vieux critique musical Henri Jaton usait et abusait du subjonctif plus-que-parfait et donnait du Maître avec une componction qui nous faisait pouffer autant que les cols de loutre des grands manteaux d'Antoine Livio, revenant à tout moment de Bayreuth. Ou encore le toujours enthousiaste Freddy Buache, dont la Cinémathèque héroïque se trouvait encore dans un cagnard insalubre jouxtant la cathédrale, qui tempêtait contre la Censure et vilipendait le cinéma commercial avant de commenter le dernier Fellini ou le dernier Bergman en longues phrases alambiquées.
Il y avait là des personnages. Le vieux critique musical Henri Jaton usait et abusait du subjonctif plus-que-parfait et donnait du Maître avec une componction qui nous faisait pouffer autant que les cols de loutre des grands manteaux d'Antoine Livio, revenant à tout moment de Bayreuth. Ou encore le toujours enthousiaste Freddy Buache, dont la Cinémathèque héroïque se trouvait encore dans un cagnard insalubre jouxtant la cathédrale, qui tempêtait contre la Censure et vilipendait le cinéma commercial avant de commenter le dernier Fellini ou le dernier Bergman en longues phrases alambiquées.  À vingt-deux ans, j'ai fait en Tunisie un premier reportage sur les aléas du tourisme de masse en ses débuts, qui m'a fait découvrir aussi l'inadéquation de mes codes marxisants appliqués à la complexité du réel. Mes camarades de la Jeunesse progressiste me voyaient évoluer d'un mauvais oeil. Mais dès l'âge de dix-neuf ans, en Pologne, découvrant Auscchwitz puis le socialisme réel que vivaient des amis polonais, mon début de dogmatisme idéologique s'était trouvé lézardé; et mon cas s'est énormément aggravé, en 1972, lorsque je suis allé interviewer l'ordure fasciste incarnée en la personne de Lucien Rebatet, condamné à mort qui avait écrit, les fers aux pieds, l'un des plus beaux romans français de la première moitié du XXe siècle, intitulé Les deux étendards et pur de toute idéologie. En mon for intérieur, je savais pertinemment que cette rencontre et la publication de cet entretien d'une pleine page, dans La Feuille d'Avis de Lausanne, grâce à la liberté d'esprit d'Henri-Charles Tauxe, me vaudrait les pires critiques (je me suis d'ailleurs fait injurier par un camarade dans un bistrot, appelant à ma liquidation après être monté sur une table !), mais c'était ma façon de vivre ma liberté dans une position de décentrage qui fut toujours ma préférée, jusqu'aux séquelles, à L'Âge d'Homme, de la guerre en ex-Yougoslavie.
À vingt-deux ans, j'ai fait en Tunisie un premier reportage sur les aléas du tourisme de masse en ses débuts, qui m'a fait découvrir aussi l'inadéquation de mes codes marxisants appliqués à la complexité du réel. Mes camarades de la Jeunesse progressiste me voyaient évoluer d'un mauvais oeil. Mais dès l'âge de dix-neuf ans, en Pologne, découvrant Auscchwitz puis le socialisme réel que vivaient des amis polonais, mon début de dogmatisme idéologique s'était trouvé lézardé; et mon cas s'est énormément aggravé, en 1972, lorsque je suis allé interviewer l'ordure fasciste incarnée en la personne de Lucien Rebatet, condamné à mort qui avait écrit, les fers aux pieds, l'un des plus beaux romans français de la première moitié du XXe siècle, intitulé Les deux étendards et pur de toute idéologie. En mon for intérieur, je savais pertinemment que cette rencontre et la publication de cet entretien d'une pleine page, dans La Feuille d'Avis de Lausanne, grâce à la liberté d'esprit d'Henri-Charles Tauxe, me vaudrait les pires critiques (je me suis d'ailleurs fait injurier par un camarade dans un bistrot, appelant à ma liquidation après être monté sur une table !), mais c'était ma façon de vivre ma liberté dans une position de décentrage qui fut toujours ma préférée, jusqu'aux séquelles, à L'Âge d'Homme, de la guerre en ex-Yougoslavie. L'Âge d'Homme a été, tu le sais, un autre point de chute de mes études buissonnières, où j'ai commencé vraiment de trouver à partager mes passions, avec le fort répondant de Dimitri. Sans celui-ci, jamais je ne me serais intéressé, sans doute, à l'auteur-penseur-artiste qui m'a le mieux aidé à résister à la vie amortie, telle que je la percevais déjà en germe, en la personne du génial polygraphe et peintre polonais Stanislaw Ignacy Witkiewicz, dont je n'ai cessé de lire et relire L'Adieu à l'automne et L'Inassouvissement.
L'Âge d'Homme a été, tu le sais, un autre point de chute de mes études buissonnières, où j'ai commencé vraiment de trouver à partager mes passions, avec le fort répondant de Dimitri. Sans celui-ci, jamais je ne me serais intéressé, sans doute, à l'auteur-penseur-artiste qui m'a le mieux aidé à résister à la vie amortie, telle que je la percevais déjà en germe, en la personne du génial polygraphe et peintre polonais Stanislaw Ignacy Witkiewicz, dont je n'ai cessé de lire et relire L'Adieu à l'automne et L'Inassouvissement.  Après la découverte irradiante de Charles-Albert Cingria, dont tu es l'un des rares youngsters à connaître le nom et défendre allègement la mémoire, celle de Witkacy (ainsi nommé pour le distinguer de son père Stanislaw Witkiewicz, lui aussi peintre et théoricien de l'art) a été un choc incomparable en cela que son oeuvre constituait la critique la plus percutante et la plus indépendante, quant aux idéologies toujours en lutte, du monde où toutes ses prémonitions (datant des années 1920-1925) se réalisaient sous nos yeux.
Après la découverte irradiante de Charles-Albert Cingria, dont tu es l'un des rares youngsters à connaître le nom et défendre allègement la mémoire, celle de Witkacy (ainsi nommé pour le distinguer de son père Stanislaw Witkiewicz, lui aussi peintre et théoricien de l'art) a été un choc incomparable en cela que son oeuvre constituait la critique la plus percutante et la plus indépendante, quant aux idéologies toujours en lutte, du monde où toutes ses prémonitions (datant des années 1920-1925) se réalisaient sous nos yeux. Après Orwell et Koestler, Witkiewicz est un des maîtres de la contre-utopie littéraire, mais son originalité est, à mon sens, dans le détail. Personne n'a parlé comme lui à cette époque (sauf Strindrerg au théâtre) des enchevêtrailles du psychisme et du corps, de la guerre ses sexes et de l'acclimatation progressive de toute différence au nom de la norme "libérée". Surtout, Witkiewicz est le peintre à l'acide de la société nivelée, notamment sous les auspices d'un parti "nivelliste", visant à l'établissement de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui le Wellness mondial, entièrement voué à l'entretien du bien-être et à la normalisation du tout-conso...
Après Orwell et Koestler, Witkiewicz est un des maîtres de la contre-utopie littéraire, mais son originalité est, à mon sens, dans le détail. Personne n'a parlé comme lui à cette époque (sauf Strindrerg au théâtre) des enchevêtrailles du psychisme et du corps, de la guerre ses sexes et de l'acclimatation progressive de toute différence au nom de la norme "libérée". Surtout, Witkiewicz est le peintre à l'acide de la société nivelée, notamment sous les auspices d'un parti "nivelliste", visant à l'établissement de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui le Wellness mondial, entièrement voué à l'entretien du bien-être et à la normalisation du tout-conso... Avec quelques compères de ces années-là (surtout Jil Silberstein et Richard Aeschlimann), réunis autour de Dimitri, nous avons trouvé en Witkiewicz, autant qu'une espèce de modèle-héros dont les frasques relevaient de la légende: l'incarnation d'une révolte fondamentale contre l'uniformisation et la médiocrité, dont le sérieux fondamental, sur fond de tragédie, sous-tendait une vision d'une prodigieuse lucidité. Le propre de pas mal de jeunes écrivains consiste à vouloir TOUT DIRE, Avec Witkacy, nous étions à bonne école...
Avec quelques compères de ces années-là (surtout Jil Silberstein et Richard Aeschlimann), réunis autour de Dimitri, nous avons trouvé en Witkiewicz, autant qu'une espèce de modèle-héros dont les frasques relevaient de la légende: l'incarnation d'une révolte fondamentale contre l'uniformisation et la médiocrité, dont le sérieux fondamental, sur fond de tragédie, sous-tendait une vision d'une prodigieuse lucidité. Le propre de pas mal de jeunes écrivains consiste à vouloir TOUT DIRE, Avec Witkacy, nous étions à bonne école...  La révolte de Witkiewicz contre l'accroupissement général, au nom de tous les relativismes et autres programmes utilitaires, nous a bel et bien habités, à un moment où la contestation juvénile commençait de se normaliser: nous avons véritablement vécu cet "inassouvissement" dont il décrit les innombrables formes, physiques ou métaphysiques, et je reste pour ma part très redevable, aujourd'hui encore, à sa perception phénoménale de ce qu'on pourrait dire le "poids du monde", à l'antipode de ce qu'on pourrait dire le "chant du monde", évidemment incarné par Cingria - la vie amortie étant en somme l'interzone où se réalise le bonheur généralisé entre barbecues et jacuzzis...
La révolte de Witkiewicz contre l'accroupissement général, au nom de tous les relativismes et autres programmes utilitaires, nous a bel et bien habités, à un moment où la contestation juvénile commençait de se normaliser: nous avons véritablement vécu cet "inassouvissement" dont il décrit les innombrables formes, physiques ou métaphysiques, et je reste pour ma part très redevable, aujourd'hui encore, à sa perception phénoménale de ce qu'on pourrait dire le "poids du monde", à l'antipode de ce qu'on pourrait dire le "chant du monde", évidemment incarné par Cingria - la vie amortie étant en somme l'interzone où se réalise le bonheur généralisé entre barbecues et jacuzzis... Et vous là-dedans, youngsters ? Ah mais, vous ne semblez pas pressés de répondre ! L'ami Claude Frochaux qui a conclu, dans L'Homme seul et L'Homme achevé - essais par ailleurs remarquable composés pour ainsi dire dans les coulisses de L'Age d'Homme-, que la créativité occidentale avait connu son terme au mitan des années 60, vous a condamnés d'avance.
Et vous là-dedans, youngsters ? Ah mais, vous ne semblez pas pressés de répondre ! L'ami Claude Frochaux qui a conclu, dans L'Homme seul et L'Homme achevé - essais par ailleurs remarquable composés pour ainsi dire dans les coulisses de L'Age d'Homme-, que la créativité occidentale avait connu son terme au mitan des années 60, vous a condamnés d'avance.  Pour le moment, c'est vrai: pas grand monde au portillon, et moins encore dans nos pays de nantis que chez les "émergeants". As-tu un seul nom d'écrivain de moins de trente ans à me citer, Daniel, qui sorte réellement du lot des jolis talents, genre Quentin Mouron ou Joël Dicker, et dont on puisse attendre une oeuvre forte, au niveau d'un Bret Easton Ellis aux Etats-Unis ou de Michel Houellebecq en France ? Fais-moi signe au cas où. Pour ma part, je ne vois pas. J'attends beaucoup de Quentin, je te l'ai dit. Je suis impatient aussi de lire le prochain roman de Joël Dicker, surdoué de la narration dont j'espère qu'il échappera à la spirale du succès. Depuis quarante ans que j'observe l'évolution des talents dits prometteurs, je ne compte plus les "révélations" d'un jour sans lendemain. Avec l'effet amplificateur démentiel des médias actuels et la tendance écervelée de certains éditeurs à ne miser que sur le coup et l'effet, la confusion brouille les esprits, encore accentuée par le clabaudage du Café du commerce mondialisé sur la Toile et les réseaux dits sociaux.
Pour le moment, c'est vrai: pas grand monde au portillon, et moins encore dans nos pays de nantis que chez les "émergeants". As-tu un seul nom d'écrivain de moins de trente ans à me citer, Daniel, qui sorte réellement du lot des jolis talents, genre Quentin Mouron ou Joël Dicker, et dont on puisse attendre une oeuvre forte, au niveau d'un Bret Easton Ellis aux Etats-Unis ou de Michel Houellebecq en France ? Fais-moi signe au cas où. Pour ma part, je ne vois pas. J'attends beaucoup de Quentin, je te l'ai dit. Je suis impatient aussi de lire le prochain roman de Joël Dicker, surdoué de la narration dont j'espère qu'il échappera à la spirale du succès. Depuis quarante ans que j'observe l'évolution des talents dits prometteurs, je ne compte plus les "révélations" d'un jour sans lendemain. Avec l'effet amplificateur démentiel des médias actuels et la tendance écervelée de certains éditeurs à ne miser que sur le coup et l'effet, la confusion brouille les esprits, encore accentuée par le clabaudage du Café du commerce mondialisé sur la Toile et les réseaux dits sociaux.  Je trouve merveilleux que tu te sois passionné pour Cingria et que tu aies consacré plusieurs années à documenter l'aventure de la Gazette littéraire. Mais à présent, fils, faut te bouger. S'occuper des vieux, c'est bien joli, mais ta jeunesse doit s'exprimer aussi, en se rappelant qu'elle n'est rien en tant que telle. Je te cite Cendrars dans une lettre à Miller: "De la jeunesse, Baudelaire écrivait: "Le jeunesse se prend pour un sacerdoce !" C'est aujourd'hui plus vrai que jamais. Seuls sont "jeunes " les "vieux" qui s'en foutent. Voyez Rabelais".
Je trouve merveilleux que tu te sois passionné pour Cingria et que tu aies consacré plusieurs années à documenter l'aventure de la Gazette littéraire. Mais à présent, fils, faut te bouger. S'occuper des vieux, c'est bien joli, mais ta jeunesse doit s'exprimer aussi, en se rappelant qu'elle n'est rien en tant que telle. Je te cite Cendrars dans une lettre à Miller: "De la jeunesse, Baudelaire écrivait: "Le jeunesse se prend pour un sacerdoce !" C'est aujourd'hui plus vrai que jamais. Seuls sont "jeunes " les "vieux" qui s'en foutent. Voyez Rabelais".  La mort, mon ami ? Eh bien c'est d'un autre ami cher, Thierry Vernet, qui succomba il y a juste vingt ans à son cancer, que je vais te citer ces mots auxquels je souscris en toute sérénité: "La mort, ma mort, je veux la faire chier un max à attendre devant ma porte, à piétiner le paillasson. Mais quand il sera manifeste que le temps est venu de la faire entrer, je lui offrirai le thé et la recevrai cordialement »...
La mort, mon ami ? Eh bien c'est d'un autre ami cher, Thierry Vernet, qui succomba il y a juste vingt ans à son cancer, que je vais te citer ces mots auxquels je souscris en toute sérénité: "La mort, ma mort, je veux la faire chier un max à attendre devant ma porte, à piétiner le paillasson. Mais quand il sera manifeste que le temps est venu de la faire entrer, je lui offrirai le thé et la recevrai cordialement »... 
 Il nous a déposé, Marie-Louise et moi, devant la porte électrique en bois de la clinique. Comme il pleuvait (ça pourrait être n’importe quand entre janvier et maintenant), il a déployé un grand parapluie transparent pendant que je prenais Marie-Louise par la main, et il nous a suivi jusqu’à la porte. C’est moi qui suis allé annoncer Marie-Louise à la réception, parce qu’elle n’atteint pas la hauteur du comptoir et que, de toute façon, sa famille compte sur moi pour m’occuper d’elle. Dans la salle d’attente du département de radiologie, j’ai tenté de rassurer un peu Marie-Louise, qui jetait des regards angoissés à tous les autres patients. Elle ne tenait pas en place. Elle a appelé sa maman à plusieurs reprises et m’a demandé où nous nous trouvions. Je lui ai expliqué, pour la dixième fois de la matinée, que c’était moi qui l’accompagnais aujourd’hui et qu’elle allait passer une radiographie. Je ne suis pas sûr qu’elle connaisse ce mot. Elle m’a demandé si je resterais avec elle pendant la consultation. Je lui ai dit que oui. Dans la salle d’attente, Marie-Louise triturait les cordons de son pull, les tordait autour de ses petits doigts, jetais des regards effarouchés autour d’elle, dernière elle. Chaque fois que la porte s’ouvrait, elle sursautait un peu. La pluie battait les vitres propres. A un moment, le médecin est arrivé. J’ai accompagné Marie-Louise dans les pas de la blouse blanche, qui ne se retournait jamais dans les coudes des couloirs, se contentant de nous tenir les portes et d’appuyer sur les interrupteurs. Il paraissait plutôt vieux et voûté, il traînait un peu des pieds. Dans la petite salle de consultation, il m’a demandé de déshabiller Marie-Louise et de la coucher sur le lit. Je lui ai demandé s’il fallait que j’enlève aussi ses couches. Il a jeté un œil, et m’a dit qu’on ferait avec, qu’elle pouvait les laisser. Comme Marie-Louise, toute nue sur sa grosse feuille de papier, ne voulait pas rester tranquille, j’ai dû lui tenir la main pendant que le scanner survolait lentement son corps et que le docteur regardait l’image apparaître sur son écran, une strate horizontale après l’autre. Ça m’a fait penser à l’époque des premières connections Internet. Le survol a duré une vingtaine de minutes. Je crois que Marie-Louise s’est même endormie un moment, pendant que je lui tenais la main. Ensuite je l’ai rhabillée, et nous sommes revenus ensemble dans la salle d’attente, où un autre médecin nous attendait avec les résultats.
Il nous a déposé, Marie-Louise et moi, devant la porte électrique en bois de la clinique. Comme il pleuvait (ça pourrait être n’importe quand entre janvier et maintenant), il a déployé un grand parapluie transparent pendant que je prenais Marie-Louise par la main, et il nous a suivi jusqu’à la porte. C’est moi qui suis allé annoncer Marie-Louise à la réception, parce qu’elle n’atteint pas la hauteur du comptoir et que, de toute façon, sa famille compte sur moi pour m’occuper d’elle. Dans la salle d’attente du département de radiologie, j’ai tenté de rassurer un peu Marie-Louise, qui jetait des regards angoissés à tous les autres patients. Elle ne tenait pas en place. Elle a appelé sa maman à plusieurs reprises et m’a demandé où nous nous trouvions. Je lui ai expliqué, pour la dixième fois de la matinée, que c’était moi qui l’accompagnais aujourd’hui et qu’elle allait passer une radiographie. Je ne suis pas sûr qu’elle connaisse ce mot. Elle m’a demandé si je resterais avec elle pendant la consultation. Je lui ai dit que oui. Dans la salle d’attente, Marie-Louise triturait les cordons de son pull, les tordait autour de ses petits doigts, jetais des regards effarouchés autour d’elle, dernière elle. Chaque fois que la porte s’ouvrait, elle sursautait un peu. La pluie battait les vitres propres. A un moment, le médecin est arrivé. J’ai accompagné Marie-Louise dans les pas de la blouse blanche, qui ne se retournait jamais dans les coudes des couloirs, se contentant de nous tenir les portes et d’appuyer sur les interrupteurs. Il paraissait plutôt vieux et voûté, il traînait un peu des pieds. Dans la petite salle de consultation, il m’a demandé de déshabiller Marie-Louise et de la coucher sur le lit. Je lui ai demandé s’il fallait que j’enlève aussi ses couches. Il a jeté un œil, et m’a dit qu’on ferait avec, qu’elle pouvait les laisser. Comme Marie-Louise, toute nue sur sa grosse feuille de papier, ne voulait pas rester tranquille, j’ai dû lui tenir la main pendant que le scanner survolait lentement son corps et que le docteur regardait l’image apparaître sur son écran, une strate horizontale après l’autre. Ça m’a fait penser à l’époque des premières connections Internet. Le survol a duré une vingtaine de minutes. Je crois que Marie-Louise s’est même endormie un moment, pendant que je lui tenais la main. Ensuite je l’ai rhabillée, et nous sommes revenus ensemble dans la salle d’attente, où un autre médecin nous attendait avec les résultats. Il a dit à Marie-Louise – en sachant que c’était moi qui écoutais, moi qui me souviendrais du rapport – qu’elle n’avait pas d’ostéoporose, ce qui était une bonne chose, mais qu’elle devait à présent faire attention à son équilibre, parce que ses chutes à répétition et les fractures qui en découlaient allaient la clouer définitivement dans un fauteuil roulant. Marie-Louise ne regardait pas le médecin mais posait sur moi ses yeux insolubles de coucou. Marie-Louise a presque nonante ans. Sur la feuille administrative que je dois tendre aux médecins lorsque je l’accompagne, comme aujourd’hui, pour une consultation hors de la Fondation, il est inscrit : « Diagnostic général : classe 12 ». Je ne sais pas ce que ça signifie, cher Jean-Louis, je ne connais pas les subtilités ni les catégories de cette échelle de la santé physique et mentale, mais je sais que la plupart des résidents que je côtoie se situent autour des classes 7 ou 8. L’Alzheimer de Marie-Louise est à un stade difficilement imaginable.
Il a dit à Marie-Louise – en sachant que c’était moi qui écoutais, moi qui me souviendrais du rapport – qu’elle n’avait pas d’ostéoporose, ce qui était une bonne chose, mais qu’elle devait à présent faire attention à son équilibre, parce que ses chutes à répétition et les fractures qui en découlaient allaient la clouer définitivement dans un fauteuil roulant. Marie-Louise ne regardait pas le médecin mais posait sur moi ses yeux insolubles de coucou. Marie-Louise a presque nonante ans. Sur la feuille administrative que je dois tendre aux médecins lorsque je l’accompagne, comme aujourd’hui, pour une consultation hors de la Fondation, il est inscrit : « Diagnostic général : classe 12 ». Je ne sais pas ce que ça signifie, cher Jean-Louis, je ne connais pas les subtilités ni les catégories de cette échelle de la santé physique et mentale, mais je sais que la plupart des résidents que je côtoie se situent autour des classes 7 ou 8. L’Alzheimer de Marie-Louise est à un stade difficilement imaginable. Ici, je suis affecté à l’animation. Concrètement, sur le papier du moins, ça implique de servir des repas, des cafés, d’accompagner des résidents sur le lieu de leurs activités ou rendez-vous, de leur apporter un peu de compagnie, de leur proposer des activités personnelles ou collectives. Il y a le choix: poterie, aquarelle, tricot, cuisine, jeux de cartes ou de société (Scrabble, Hâte-toi lentement), lecture du journal (20 Minutes et « La Feuille »), concerts, offices religieux, promenades… Un civiliste qui terminait au moment où je suis arrivé, en décembre, m’a montré le résultat d’une petite enquête menée dans un autre EMS, il y a quelques années, au sujet des préoccupations principales des résidents. Les services que l’« animation » propose arrivaient loin derrière les besoins de base, sacrés, révérés : manger et dormir. Pourtant, chaque jour passé ici m’a fait comprendre à quel point ce que je fais est essentiel.
Ici, je suis affecté à l’animation. Concrètement, sur le papier du moins, ça implique de servir des repas, des cafés, d’accompagner des résidents sur le lieu de leurs activités ou rendez-vous, de leur apporter un peu de compagnie, de leur proposer des activités personnelles ou collectives. Il y a le choix: poterie, aquarelle, tricot, cuisine, jeux de cartes ou de société (Scrabble, Hâte-toi lentement), lecture du journal (20 Minutes et « La Feuille »), concerts, offices religieux, promenades… Un civiliste qui terminait au moment où je suis arrivé, en décembre, m’a montré le résultat d’une petite enquête menée dans un autre EMS, il y a quelques années, au sujet des préoccupations principales des résidents. Les services que l’« animation » propose arrivaient loin derrière les besoins de base, sacrés, révérés : manger et dormir. Pourtant, chaque jour passé ici m’a fait comprendre à quel point ce que je fais est essentiel. Le jour de la Saint-Valentin, je suis allé à la morgue. L’hiver avait emporté le quart de mon étage. Quatre décès en deux semaines. Lucette était morte la veille, après sa dernière fondue. C’est l’animatrice qui m’a proposé de descendre. Une fois dans la pièce froide, en béton nu, une fois devant le lit, seul dans la pièce au sous-sol de la Fondation, une fois à côté de ce corps nu tout juste recouvert d’un drap très fin tiré jusqu’au thorax, du coton dans les yeux et les oreilles, le menton soutenu par une armature en fil de fer, j’ai réalisé que c’était le premier mort que je voyais de ma vie. Il ne ressemblait pas du tout à Lucette. Il ne ressemblait pas du tout à quelque chose de vivant. J’ai pu rester une minute ou une heure, je ne sais pas.
Le jour de la Saint-Valentin, je suis allé à la morgue. L’hiver avait emporté le quart de mon étage. Quatre décès en deux semaines. Lucette était morte la veille, après sa dernière fondue. C’est l’animatrice qui m’a proposé de descendre. Une fois dans la pièce froide, en béton nu, une fois devant le lit, seul dans la pièce au sous-sol de la Fondation, une fois à côté de ce corps nu tout juste recouvert d’un drap très fin tiré jusqu’au thorax, du coton dans les yeux et les oreilles, le menton soutenu par une armature en fil de fer, j’ai réalisé que c’était le premier mort que je voyais de ma vie. Il ne ressemblait pas du tout à Lucette. Il ne ressemblait pas du tout à quelque chose de vivant. J’ai pu rester une minute ou une heure, je ne sais pas.  J’aurais voulu te raconter les dernières nouvelles et les derniers ragots du royaume éphémère des lettres d’ici et d’ailleurs. Tu aurais souri de bienveillance, ou tu m’aurais traité de petit con inculte, peut-être, avant de renchérir sur l’avancée de tes Cervins, de tes livres qui poussent aux quatre vents, de tes découvertes récentes, tes déceptions, tes coups de blues ou tes âges d’or. Tu aurais houspillé « ceux qui freinent à la montée », raillé « celui qui retire l’échelle derrière lui » et dénoncé « celle qui est atteinte de jeunisme ». On aurait pu débattre de tout ça. Puis, finalement, tu vois, je crois que je t’ai parlé de ce qui a vraiment compté pour moi depuis ma dernière lettre. Je ne m’étends pas tellement autour de moi à ce sujet, d’ailleurs, à part sous forme de debriefing naturel, avec Camille. Et ça me fait pourtant très plaisir de te l’écrire, ça me paraît d’une évidence imparable. Il y a une année jours pour jours, aujourd’hui, je tournais le dos à l’Afrique et à deux potes magnétisés pour rentrer au bercail. J’avais la mort dans l’âme. On est des pommes, je te le dis, quand il s’agit de se projeter dans le temps, en avant ou en arrière. Il y a des choses qu’il ne faut pas perdre de vue. Pour le reste, on a le temps, et le présent…
J’aurais voulu te raconter les dernières nouvelles et les derniers ragots du royaume éphémère des lettres d’ici et d’ailleurs. Tu aurais souri de bienveillance, ou tu m’aurais traité de petit con inculte, peut-être, avant de renchérir sur l’avancée de tes Cervins, de tes livres qui poussent aux quatre vents, de tes découvertes récentes, tes déceptions, tes coups de blues ou tes âges d’or. Tu aurais houspillé « ceux qui freinent à la montée », raillé « celui qui retire l’échelle derrière lui » et dénoncé « celle qui est atteinte de jeunisme ». On aurait pu débattre de tout ça. Puis, finalement, tu vois, je crois que je t’ai parlé de ce qui a vraiment compté pour moi depuis ma dernière lettre. Je ne m’étends pas tellement autour de moi à ce sujet, d’ailleurs, à part sous forme de debriefing naturel, avec Camille. Et ça me fait pourtant très plaisir de te l’écrire, ça me paraît d’une évidence imparable. Il y a une année jours pour jours, aujourd’hui, je tournais le dos à l’Afrique et à deux potes magnétisés pour rentrer au bercail. J’avais la mort dans l’âme. On est des pommes, je te le dis, quand il s’agit de se projeter dans le temps, en avant ou en arrière. Il y a des choses qu’il ne faut pas perdre de vue. Pour le reste, on a le temps, et le présent…