
De Daniel Vuataz, dit Le Kid, à JLK
Charmey, 7 juin 2012
Dear Old Gangsta,
Il y a trois mois, je partais dans un vieux van bleu-vert et pétrolais dans les Balkans, jusqu’à Istanbul et la pointe sud de l’Anatolie, avec deux vieux amis. Dix ans auparavant, on jouait de la guitare et de la flûte à bec dans les champs de cresson d’un Gymnase lacustre, après des cours sur Kant et Levinas. La clope était encore tolérée dans les pentes de Burier. Les filles avaient des liquettes de Supertramp, très peu d’inhibitions, on passait nos nuits dans des cabanes avec du vin, de la raclette et des djembés. Là, ces deux fous furieux lorgnaient sur l’Afrique depuis des années. Julien avait acheté une immense carte qu’il avait punaisé au mur de sa chambre, sous-gare. David avait passé son hiver dans l’atelier d’un garagiste de Bex pour remettre à neuf le moteur d’un vieux T4. Ils avaient économisé pendant leur uni, venaient d’obtenir un Master (Economie et Science de la vie) et avaient eu la bonne idée de ne pas écouter les avis de parents et autres connaisseurs prêts à tout pour les décourager. C’était leur projet. En Afrique par la route. Mon père était parti lui aussi, avec ma mère, à vingt-cinq ans, et j’avais des histoires plein les tempes. Je me suis joint à l’aventure, au dernier moment, pour un mois de vadrouille (eux en avaient huit devant eux, et toutes les plaines du Soudan, les savanes du Kenya et les montagnes de l’Ethiopie dans des guides de voyage). C’était le 11 mars. Le 11 avril, je m’arrêtais face à l’Afrique et rebroussais chemin, la mort dans l’âme, l’âme ferrée dans les grands containers du port marchand de Mersin, laissant les deux potes en transit sur leur Méditerranée. La Syrie était à cent kilomètres. Le Groenland à quelques milliers. Eux avaient les lions de plage de la Namibie en ligne de mire, les sables orange de la Zambie, l’ambre de Madagascar…
 Je ne t’ai pas écrit depuis tout ce temps. Ou, plus exactement, je t’ai écrit régulièrement, mais n’ai rien achevé, n’ai rien envoyé. Il s’est passé pas mal de choses, depuis mon retour. De Mersin j’ai pris un bus Ulusoy à l’odeur de cuir neuf jusqu’à Istanbul, et vu sur l’écran incrusté de mon siège, simultanément dans les écrans de tous les autres passagers, simultanément dans les reflets des vitres du bus entier, l’accident mortel d’un autre bus semblable, quelque part sur la même autoroute. J’ai relu Tranströmer dans un taxi lancé à tombeau ouvert contre les ponts blancs du Bosphore, sur la rive Asiatique. J’ai retrouvé mon vieil appartement de la rive européenne, acheté de la viande de bœuf, pleuré sur les quais de la Marmara en regardant les souvenirs d’un mois de liberté absolue se dissoudre dans la pluie des pavés millénaires. J’ai bu du çay avec des ombres dans les cybercafés humides de Kumkapi, acheté toutes sortes de t-shirts à moustaches et bicyclettes avec de la petite monnaie trouble, bu des jus d’orange sanguine et chanté du Brassens dans ma tête jusqu’à la folie. J’ai pris des bus bondés et passé ma monnaie vers l’avant, marché sur des autoroutes à quatre pistes, écrit dans des mosquées, pissé dans des bouteilles de Turka Cola, vu des types très pauvres avec des dents en or et des types très riches avec des mouches dans les cheveux. Et puis je suis rentré, en cargo jusqu’à Montfalcone, en huit jours huileux et inconcevables entre les îles grecques, les ombres déchiquetées des Pouilles et le violet profond de l’Adriatique supérieure. Il y avait des tortues sous la poupe du navire, disait l’adjoint du capitaine.
Je ne t’ai pas écrit depuis tout ce temps. Ou, plus exactement, je t’ai écrit régulièrement, mais n’ai rien achevé, n’ai rien envoyé. Il s’est passé pas mal de choses, depuis mon retour. De Mersin j’ai pris un bus Ulusoy à l’odeur de cuir neuf jusqu’à Istanbul, et vu sur l’écran incrusté de mon siège, simultanément dans les écrans de tous les autres passagers, simultanément dans les reflets des vitres du bus entier, l’accident mortel d’un autre bus semblable, quelque part sur la même autoroute. J’ai relu Tranströmer dans un taxi lancé à tombeau ouvert contre les ponts blancs du Bosphore, sur la rive Asiatique. J’ai retrouvé mon vieil appartement de la rive européenne, acheté de la viande de bœuf, pleuré sur les quais de la Marmara en regardant les souvenirs d’un mois de liberté absolue se dissoudre dans la pluie des pavés millénaires. J’ai bu du çay avec des ombres dans les cybercafés humides de Kumkapi, acheté toutes sortes de t-shirts à moustaches et bicyclettes avec de la petite monnaie trouble, bu des jus d’orange sanguine et chanté du Brassens dans ma tête jusqu’à la folie. J’ai pris des bus bondés et passé ma monnaie vers l’avant, marché sur des autoroutes à quatre pistes, écrit dans des mosquées, pissé dans des bouteilles de Turka Cola, vu des types très pauvres avec des dents en or et des types très riches avec des mouches dans les cheveux. Et puis je suis rentré, en cargo jusqu’à Montfalcone, en huit jours huileux et inconcevables entre les îles grecques, les ombres déchiquetées des Pouilles et le violet profond de l’Adriatique supérieure. Il y avait des tortues sous la poupe du navire, disait l’adjoint du capitaine.
 La première fois que je t’ai écrit, c’était dans un camping de varappeurs, près d’Antalya, où nous venions de passer une petite semaine en immersion. Paradise lost, de Massive Attack, passait dans le petit transistor de la salle commune, sorte de cabane dans un immense eucalyptus, face au calcaire rouillé du cirque alentour où grimpaient des Danois et des Australiens. Une araignée trottinant sur la neige, un bouddha, et je pensais à Chappaz. Un employé du Climbers Garden, dans la petite cuisine en lino, marcel délavé et avant-bras surdimensionnés, préparait des crèmes à l’orange. C’était un resting day, les pensionnaires peignaient notre bus au soleil. On avait roulé depuis Sofia, presque d’une traite, par la mer Noir et jusqu’à Istanbul. Et puis, en suivant les contours de la mer Egée, plus loin au sud sur les presqu’îles turques où les téléphones reçoivent le réseau grec et les gens, sous leurs moustaches, élèvent des bateaux de bois noble pour les multimillionnaires hollandais. Je lisais La Haute Route au sommet des collines de Bozburun, à Julien et David ensommeillés sur les rochers coupants, le vent dans le visage, le soleil parfaitement blanc, alors qu’un aiglon fendait le bleu ferreux du ciel et que les baies à espadons avaient toutes sortes de mauves sur les pentes à coraux, cinq cents mètres au-dessous. David avait des envies de parapente. Et puis je lisais Jack London, à haute voix encore (Un steak et Construire un feu), pendant que Julien conduisait, à la lampe frontale, seuls au monde sur les semi autoroute d’Anatolie. David, le soir, bouquinait Destruction massive, de ton cher postfacier qui adore trop en faire mais n’en fait jamais assez. Julien écornait Sur la route, le reposait, le reprenait, cherchait à savoir ce que ce livre pouvait bien avoir de culte. Je ne pouvais pas l’aider, je ne l’ai jamais fini. Restaient Les Promesses de l’aube, pour la semaine suivante, en feuilleton.
La première fois que je t’ai écrit, c’était dans un camping de varappeurs, près d’Antalya, où nous venions de passer une petite semaine en immersion. Paradise lost, de Massive Attack, passait dans le petit transistor de la salle commune, sorte de cabane dans un immense eucalyptus, face au calcaire rouillé du cirque alentour où grimpaient des Danois et des Australiens. Une araignée trottinant sur la neige, un bouddha, et je pensais à Chappaz. Un employé du Climbers Garden, dans la petite cuisine en lino, marcel délavé et avant-bras surdimensionnés, préparait des crèmes à l’orange. C’était un resting day, les pensionnaires peignaient notre bus au soleil. On avait roulé depuis Sofia, presque d’une traite, par la mer Noir et jusqu’à Istanbul. Et puis, en suivant les contours de la mer Egée, plus loin au sud sur les presqu’îles turques où les téléphones reçoivent le réseau grec et les gens, sous leurs moustaches, élèvent des bateaux de bois noble pour les multimillionnaires hollandais. Je lisais La Haute Route au sommet des collines de Bozburun, à Julien et David ensommeillés sur les rochers coupants, le vent dans le visage, le soleil parfaitement blanc, alors qu’un aiglon fendait le bleu ferreux du ciel et que les baies à espadons avaient toutes sortes de mauves sur les pentes à coraux, cinq cents mètres au-dessous. David avait des envies de parapente. Et puis je lisais Jack London, à haute voix encore (Un steak et Construire un feu), pendant que Julien conduisait, à la lampe frontale, seuls au monde sur les semi autoroute d’Anatolie. David, le soir, bouquinait Destruction massive, de ton cher postfacier qui adore trop en faire mais n’en fait jamais assez. Julien écornait Sur la route, le reposait, le reprenait, cherchait à savoir ce que ce livre pouvait bien avoir de culte. Je ne pouvais pas l’aider, je ne l’ai jamais fini. Restaient Les Promesses de l’aube, pour la semaine suivante, en feuilleton.
 Et moi j’entamais la dernière partie de Bourlinguer, par tranches, sous les voies d’escalade en dévers de Trabenna, sur les toilettes du camping, dans l’embrasure des douches mixtes, à la lueur de la bougie, à l’arrière de notre van sur quinze kilos d’oranges, avant de m’endormir. J’aurais pu être marin, je crois. Ou vivre dans les ports, simplement, entre des litres de kérosène, des putes et des sacs de sucre de Cuba. Un bouquin pour oreiller.
Et moi j’entamais la dernière partie de Bourlinguer, par tranches, sous les voies d’escalade en dévers de Trabenna, sur les toilettes du camping, dans l’embrasure des douches mixtes, à la lueur de la bougie, à l’arrière de notre van sur quinze kilos d’oranges, avant de m’endormir. J’aurais pu être marin, je crois. Ou vivre dans les ports, simplement, entre des litres de kérosène, des putes et des sacs de sucre de Cuba. Un bouquin pour oreiller.
 La deuxième fois que je t’ai écrit, les arbres avaient changé. A Olympos les citronniers poussaient entre les diner pseudo Far West de la route en terre battue et les cactus importés qui menaient à la mer. Il y avait des types à dreadlocks et des hippies de seize ans dans tous les hamacs, assis en tailleurs sur toutes les plates-formes à pachas des cabanes en bois noir. Des Portugaises venaient sauver les tortues de mer. Des Danoises étaient en crise mystique. Le lieu était épatant : plage de galets noirs, vachettes sans cloches en semi liberté, flots turquoise entre des montagnes sacrées, eucalyptus immenses, pins bleu-vert et coquelicots : tu aurais pu peindre, comme ça, pendant des heures, depuis ton balcon. Les coquelicots étaient peut-être des pavots. Et mon grand-père mourrait, pendant le vingtième jour, alors que j’arpentais, sans savoir encore qu’il était parti, les vestiges lyciens, latins et grecs d’une acropole antique, sous les dunes et la lune, dans les forêts marines. Je suis resté une demi nuit au bord d’un ruisseau à ruminer ce début de voyage. La nuit je me couchais entre deux potes, entre deux filles, entre deux tortues ou entre deux ombres longues, sur la plage face à l’Afrique, et les étoiles tournaient dans tous les sens. Il me restait dix jours. J’aurais pu m’installer n’importe où et ouvrir un troquet. L’enterrement aurait lieu sans moi, le mardi, à Saint-Légier.
La deuxième fois que je t’ai écrit, les arbres avaient changé. A Olympos les citronniers poussaient entre les diner pseudo Far West de la route en terre battue et les cactus importés qui menaient à la mer. Il y avait des types à dreadlocks et des hippies de seize ans dans tous les hamacs, assis en tailleurs sur toutes les plates-formes à pachas des cabanes en bois noir. Des Portugaises venaient sauver les tortues de mer. Des Danoises étaient en crise mystique. Le lieu était épatant : plage de galets noirs, vachettes sans cloches en semi liberté, flots turquoise entre des montagnes sacrées, eucalyptus immenses, pins bleu-vert et coquelicots : tu aurais pu peindre, comme ça, pendant des heures, depuis ton balcon. Les coquelicots étaient peut-être des pavots. Et mon grand-père mourrait, pendant le vingtième jour, alors que j’arpentais, sans savoir encore qu’il était parti, les vestiges lyciens, latins et grecs d’une acropole antique, sous les dunes et la lune, dans les forêts marines. Je suis resté une demi nuit au bord d’un ruisseau à ruminer ce début de voyage. La nuit je me couchais entre deux potes, entre deux filles, entre deux tortues ou entre deux ombres longues, sur la plage face à l’Afrique, et les étoiles tournaient dans tous les sens. Il me restait dix jours. J’aurais pu m’installer n’importe où et ouvrir un troquet. L’enterrement aurait lieu sans moi, le mardi, à Saint-Légier.
La troisièm e fois que je t’ai écrit, c’est juste après la lecture du dernier Roland De Muralt, L’Espoir d’une parole à venir, reçu la veille du départ avec une courte paraphe, et terminé à la lueur du soleil dans le rétroviseur. On avait passé une nouvelle frontière. Sur Paul Celan, pudiquement placé entre parenthèses, voilà ce qu’écrivait mon ancien prof de français au gymnase : « ([…] Il lui arrive souvent de penser que s’il cessait d’écrire, il n’aurait plus à entretenir ces conversations insolites et épuisantes avec les morts, conversations au cours desquelles ils devisent de la langue allemande, de la désolation de Dieu qui manque à son trône, de son découronnement, de l’absence ou encore des poèmes qui sont comme l’avoine de plage qui fixe les reliefs dunaires. Il n’aurait plus à aider les morts à parler… Mais personne, pas plus le témoin que le poète, ne peut aider les morts à parler ! Il faudrait pour cela qu’ils reviennent, qu’ils secouent les cendres et racontent leur propre mort. Parmi ces morts, tous ne seraient pas des poètes, mais tous seraient des témoins qui raconteraient la réalité – et celle-ci serait la vérité, la vérité de ces morts plus inachevées que d’autres.) » Je n’ai pas vu la guerre qu’a vu Celan, ma famille n’est pas morte dans des camps nazis – mon grand-père s’est éteint avec toute sa tête dans le gros lit blanc d’un hôpital suisse, à la fenêtre d’un jardin de printemps poussée de bégonias –, je n’ai pas de point de compréhension, tout cela est abstrait, et pourtant moi aussi, par moment, je me dis que seuls les morts devraient écrire, et les vivants écouter. Et puis je vois déguerpir une vachette dans les cailloux, je vois passer un vieux turc avec son plateau de çay, je vois David et Julien jouer au tavla en s’engueulant, je vois deux couples dans l’eau sous les falaises, j’entends Ugur le marin chanter ses complaintes arméniennes, je sens l’eau douce de Kas sur mes pieds nus, et je reprends le stylo. Ou la route. Ce qui est la même chose, d’une certaine façon. Immanquablement.
e fois que je t’ai écrit, c’est juste après la lecture du dernier Roland De Muralt, L’Espoir d’une parole à venir, reçu la veille du départ avec une courte paraphe, et terminé à la lueur du soleil dans le rétroviseur. On avait passé une nouvelle frontière. Sur Paul Celan, pudiquement placé entre parenthèses, voilà ce qu’écrivait mon ancien prof de français au gymnase : « ([…] Il lui arrive souvent de penser que s’il cessait d’écrire, il n’aurait plus à entretenir ces conversations insolites et épuisantes avec les morts, conversations au cours desquelles ils devisent de la langue allemande, de la désolation de Dieu qui manque à son trône, de son découronnement, de l’absence ou encore des poèmes qui sont comme l’avoine de plage qui fixe les reliefs dunaires. Il n’aurait plus à aider les morts à parler… Mais personne, pas plus le témoin que le poète, ne peut aider les morts à parler ! Il faudrait pour cela qu’ils reviennent, qu’ils secouent les cendres et racontent leur propre mort. Parmi ces morts, tous ne seraient pas des poètes, mais tous seraient des témoins qui raconteraient la réalité – et celle-ci serait la vérité, la vérité de ces morts plus inachevées que d’autres.) » Je n’ai pas vu la guerre qu’a vu Celan, ma famille n’est pas morte dans des camps nazis – mon grand-père s’est éteint avec toute sa tête dans le gros lit blanc d’un hôpital suisse, à la fenêtre d’un jardin de printemps poussée de bégonias –, je n’ai pas de point de compréhension, tout cela est abstrait, et pourtant moi aussi, par moment, je me dis que seuls les morts devraient écrire, et les vivants écouter. Et puis je vois déguerpir une vachette dans les cailloux, je vois passer un vieux turc avec son plateau de çay, je vois David et Julien jouer au tavla en s’engueulant, je vois deux couples dans l’eau sous les falaises, j’entends Ugur le marin chanter ses complaintes arméniennes, je sens l’eau douce de Kas sur mes pieds nus, et je reprends le stylo. Ou la route. Ce qui est la même chose, d’une certaine façon. Immanquablement.
 A ce moment-là, les Poussières du monde récoltées par Bouvier tournaient en boucle dans la voiture, et, au lieu de leur en lire L’Usage, j’expliquais à David et Julien ce que je savais d’Heidegger, de la poésie de Celan, de l’écriture après l’inimaginable, l’inconcevable. Il est inconcevable de ne plus écrire, j’ai peut-être dit. Et ma braguette était ouverte. Les violons de Vittorio Monti vibraient dans le petit haut-parleur de bois brut, et j’imaginais Nicolas et Thierry capturant les tziganes d’Albanie sur leur Revox à bande, passant aux mêmes endroits que nous, sur la route de l’Orient, et puis bifurquant d’un coup vers l’Iran et cette saloperie de Syrie. Trop de gens sont déjà passés aux mêmes endroits, dit le vieux roublard, et comme pour me rejoindre, sans un mot, David avait tourné vers l’Ouest, sur une route de terre rouge, entre les oliviers en effeuille.
A ce moment-là, les Poussières du monde récoltées par Bouvier tournaient en boucle dans la voiture, et, au lieu de leur en lire L’Usage, j’expliquais à David et Julien ce que je savais d’Heidegger, de la poésie de Celan, de l’écriture après l’inimaginable, l’inconcevable. Il est inconcevable de ne plus écrire, j’ai peut-être dit. Et ma braguette était ouverte. Les violons de Vittorio Monti vibraient dans le petit haut-parleur de bois brut, et j’imaginais Nicolas et Thierry capturant les tziganes d’Albanie sur leur Revox à bande, passant aux mêmes endroits que nous, sur la route de l’Orient, et puis bifurquant d’un coup vers l’Iran et cette saloperie de Syrie. Trop de gens sont déjà passés aux mêmes endroits, dit le vieux roublard, et comme pour me rejoindre, sans un mot, David avait tourné vers l’Ouest, sur une route de terre rouge, entre les oliviers en effeuille.
 La quatrième fois que je t’ai écrit, j’étais de retour à Istanbul, et Camille m’avait rapporté un peu d’herbe sourde de nos cantons boisés. Elle avait des scarabées dans les cheveux, un pull bleu-vert. Istanbul avait pris d’un coup un climat de Pléiades : sous la pluie, à Taksim, la ville continuait sa transe comme si de rien n’était, et les vendeurs de café noir et de cartes mémoire devenaient des vendeurs de parapluie. C’est là que tu m’as appelé, depuis ton haut chalet, peut-être assis au frais de ton balcon face aux Alpes françaises, alors que nous partagions quelques kilos de cacahouètes au sésame en buvant thé sur thé, au deuxième étage d’un cafetier stambouliote, attendant que l’averse se calme. Tu me parlais de mes croquis de voyage, de tous les jeunes auteurs que tu découvrais ces jours, ces semaines, et puis de ta nouvelle amitié avec un kangourou boxeur, de tes espoirs, de Quentin, de Ziegler et de Radio-Lausanne. Camille écoutait en souriant. Derrière les fenêtres sans vitres, le bruit plastifié des flots du ciel en furie résonnait dans les ruelles. L’air était frais, lavé, et l’averse a duré trois jours. Les toits et les rues sans aucune bouche d’égout devenaient des plans d’eau. En rentrant à l’appartement de notre ruelle sans nom, nous étions trempés comme les hippocampes des jardins du Rivage, par gros coup de Joran sur le lac. Sous la pluie et le soir rouge, entre la Mosquée bleue et Sainte-Sophie, les voies du plus vieux tramways d’Europe brillaient bien plus que des vitraux.
La quatrième fois que je t’ai écrit, j’étais de retour à Istanbul, et Camille m’avait rapporté un peu d’herbe sourde de nos cantons boisés. Elle avait des scarabées dans les cheveux, un pull bleu-vert. Istanbul avait pris d’un coup un climat de Pléiades : sous la pluie, à Taksim, la ville continuait sa transe comme si de rien n’était, et les vendeurs de café noir et de cartes mémoire devenaient des vendeurs de parapluie. C’est là que tu m’as appelé, depuis ton haut chalet, peut-être assis au frais de ton balcon face aux Alpes françaises, alors que nous partagions quelques kilos de cacahouètes au sésame en buvant thé sur thé, au deuxième étage d’un cafetier stambouliote, attendant que l’averse se calme. Tu me parlais de mes croquis de voyage, de tous les jeunes auteurs que tu découvrais ces jours, ces semaines, et puis de ta nouvelle amitié avec un kangourou boxeur, de tes espoirs, de Quentin, de Ziegler et de Radio-Lausanne. Camille écoutait en souriant. Derrière les fenêtres sans vitres, le bruit plastifié des flots du ciel en furie résonnait dans les ruelles. L’air était frais, lavé, et l’averse a duré trois jours. Les toits et les rues sans aucune bouche d’égout devenaient des plans d’eau. En rentrant à l’appartement de notre ruelle sans nom, nous étions trempés comme les hippocampes des jardins du Rivage, par gros coup de Joran sur le lac. Sous la pluie et le soir rouge, entre la Mosquée bleue et Sainte-Sophie, les voies du plus vieux tramways d’Europe brillaient bien plus que des vitraux.
 La cinquième fois que je t’ai écrit, Camille et moi nous apprêtions à remettre les voiles. On laissait derrière nous les rues à thème d’Istanbul (rue des robinets, rue des clarinettes turques, rue des épices, rue des cordes et ficelles, rue des voleurs, rue des Internet cafés…), les quais défoncés de Kumkapi et l’éternel réinvention – métamorphose solide – de cette ville impossible à doubler. Pourtant on y a cuisiné, fait la lessive, marché, couru, baisé, rit, erré, attendu, parlé, joué, mangé, lu, photographié, tiré les rideaux, arpenté les bazars et bu la pluie tombée. On était au milieu du mois d’avril, sur un ferry pour Gemlik, cent kilomètres au sud dans un bras brun de la mer de Marmara, et une tempête à Yalova nous avait fait prendre un jour de retard. De loin, par-dessus l’épaule de Camille, sur les flots déchaînés, Istanbul s’étalais sur des centaines de collines, en tapis de maisons bossues, aussi loin que portait le regard. Le ciel était vert. A Gemlik le minaret de la mosquée était à la même hauteur que notre fenêtre d’hôtel, à une envergure de cormoran, et le Burger King avait une immense terrasse panoramique. Les immeubles du bord de mer étaient verts, jaunes, roses, oranges, mauves. Le ciel transportait des nuages en rouleaux de pluie blanche. La silhouette brune du port de fret, à un kilomètre dans la baie suivante, s’observait à la longue vue statique pour une lire turque. Les grues fumaient dans la poussière du soleil retrouvé, entre les cargos italiens et les gravières. Camille recevait un sms de sa mère, à Chardonne. Le prunier était tombé, déraciné, sur la cahute des voisins. Tout s’écroulait et pourtant rien ne bougeait, disait-elle. Moi je ne parvenais pas à finir Bourlinguer, pris dans les méandres de Gênes et d’enfance. Ça sentait le vieux sucre dans les rues de Gemlik.
La cinquième fois que je t’ai écrit, Camille et moi nous apprêtions à remettre les voiles. On laissait derrière nous les rues à thème d’Istanbul (rue des robinets, rue des clarinettes turques, rue des épices, rue des cordes et ficelles, rue des voleurs, rue des Internet cafés…), les quais défoncés de Kumkapi et l’éternel réinvention – métamorphose solide – de cette ville impossible à doubler. Pourtant on y a cuisiné, fait la lessive, marché, couru, baisé, rit, erré, attendu, parlé, joué, mangé, lu, photographié, tiré les rideaux, arpenté les bazars et bu la pluie tombée. On était au milieu du mois d’avril, sur un ferry pour Gemlik, cent kilomètres au sud dans un bras brun de la mer de Marmara, et une tempête à Yalova nous avait fait prendre un jour de retard. De loin, par-dessus l’épaule de Camille, sur les flots déchaînés, Istanbul s’étalais sur des centaines de collines, en tapis de maisons bossues, aussi loin que portait le regard. Le ciel était vert. A Gemlik le minaret de la mosquée était à la même hauteur que notre fenêtre d’hôtel, à une envergure de cormoran, et le Burger King avait une immense terrasse panoramique. Les immeubles du bord de mer étaient verts, jaunes, roses, oranges, mauves. Le ciel transportait des nuages en rouleaux de pluie blanche. La silhouette brune du port de fret, à un kilomètre dans la baie suivante, s’observait à la longue vue statique pour une lire turque. Les grues fumaient dans la poussière du soleil retrouvé, entre les cargos italiens et les gravières. Camille recevait un sms de sa mère, à Chardonne. Le prunier était tombé, déraciné, sur la cahute des voisins. Tout s’écroulait et pourtant rien ne bougeait, disait-elle. Moi je ne parvenais pas à finir Bourlinguer, pris dans les méandres de Gênes et d’enfance. Ça sentait le vieux sucre dans les rues de Gemlik.
 Embarquer sur un cargo n’a rien de simple, et je te raconterai une autre fois comment on s’y est pris, en plusieurs jours, en plusieurs heures. Le stress qui monte, la hantise que ça ne fonctionne pas. Et puis tout va très vite. Soudain on est dans la bouche béante du monstre, à quai, dans l’ascenseur, puis dans les labyrinthes de couloirs bleus, devant de lourdes portes en fonte, contre des hublots sous les flots. Des pancartes partout, des signes, des écriteaux, de têtes de morts et des masques à gaz. Un marin en training qui nous dresse deux lits, rapidement. Deux heures du matin. Une fois au neuvième étage du SPES, en route pour l’Italie, le lendemain, à dix heures dans la loupe d’un ciel d’après-pluie, assis sur deux mille cinq cents Fiat neuves de toutes les couleurs, une fois le quai décroché, les amarres enroulées, tu peux vraiment sentir le monde glisser sous toi. De l’huile sur la fesse du monde. Et cette odeur de mazout, de peinture fraîche et de grand air iodé. La vie sur ce blindé, huit jours durant, seuls passagers au milieu des gradés italiens et des hommes de main philippins, te vaudra une nouvelle lettre, ou un après-midi dans ton Isba. David et Julien me paraissaient déjà très loin, les grimpeurs d’Antalya encore plus, le couch-surfing de Sofia presque enterré. Je me douchais à l’eau déssalée, courait sur le pont en short des San Antonio Spurs, dormait dans le ressac des Dardanelles, comptait les couleurs de la mer, regardais New York stories et puis offrait le DVD aux Philippins. On tenait des carnets. Parlait beaucoup. David et Julien, eux, tentaient de récupérer leur van à Alexandrie, traversaient un désert, suivaient le Nil jusqu’en Ethiopie. Cela je ne l’ai su que plus tard, parce qu’il n’y avait alors aucun moyen de communication. Je me détachais de plus en plus, et finissait La Pêche à la truite en Amérique.
Embarquer sur un cargo n’a rien de simple, et je te raconterai une autre fois comment on s’y est pris, en plusieurs jours, en plusieurs heures. Le stress qui monte, la hantise que ça ne fonctionne pas. Et puis tout va très vite. Soudain on est dans la bouche béante du monstre, à quai, dans l’ascenseur, puis dans les labyrinthes de couloirs bleus, devant de lourdes portes en fonte, contre des hublots sous les flots. Des pancartes partout, des signes, des écriteaux, de têtes de morts et des masques à gaz. Un marin en training qui nous dresse deux lits, rapidement. Deux heures du matin. Une fois au neuvième étage du SPES, en route pour l’Italie, le lendemain, à dix heures dans la loupe d’un ciel d’après-pluie, assis sur deux mille cinq cents Fiat neuves de toutes les couleurs, une fois le quai décroché, les amarres enroulées, tu peux vraiment sentir le monde glisser sous toi. De l’huile sur la fesse du monde. Et cette odeur de mazout, de peinture fraîche et de grand air iodé. La vie sur ce blindé, huit jours durant, seuls passagers au milieu des gradés italiens et des hommes de main philippins, te vaudra une nouvelle lettre, ou un après-midi dans ton Isba. David et Julien me paraissaient déjà très loin, les grimpeurs d’Antalya encore plus, le couch-surfing de Sofia presque enterré. Je me douchais à l’eau déssalée, courait sur le pont en short des San Antonio Spurs, dormait dans le ressac des Dardanelles, comptait les couleurs de la mer, regardais New York stories et puis offrait le DVD aux Philippins. On tenait des carnets. Parlait beaucoup. David et Julien, eux, tentaient de récupérer leur van à Alexandrie, traversaient un désert, suivaient le Nil jusqu’en Ethiopie. Cela je ne l’ai su que plus tard, parce qu’il n’y avait alors aucun moyen de communication. Je me détachais de plus en plus, et finissait La Pêche à la truite en Amérique.
 Camille lisait Gatsby le magnifique en anglais. On passait du temps, du temps qui avait un poids réel, appréciable, mesurable. Au loin les côtes se faisaient plus vertes, plus montagneuses, et la Suisse était bientôt à portée de vue – entre temps ils avaient rasé les Alpes. A Ravenne, lors de notre seule escale, on est sorti dans le port immensément vide pour sauter dans un taxi et célébrer le souvenir de la libération italienne (Rome, ville ouverte…). Au musée national, les mosaïques dorées des basiliques byzantines avaient quelque chose de tes livres : un découpage bordélique et craquelé de très près, et puis, pour qui prend la peine de prendre du recul, de faire deux pas de côté, un sens doré et une vraie beauté pleine… D’Istanbul à Byzance, il y a donc un cargo vers le Nord. Et il nous restait une nuit jusqu’au mont du Faucon. Je ne voulais pas que ça s’arrête.
Camille lisait Gatsby le magnifique en anglais. On passait du temps, du temps qui avait un poids réel, appréciable, mesurable. Au loin les côtes se faisaient plus vertes, plus montagneuses, et la Suisse était bientôt à portée de vue – entre temps ils avaient rasé les Alpes. A Ravenne, lors de notre seule escale, on est sorti dans le port immensément vide pour sauter dans un taxi et célébrer le souvenir de la libération italienne (Rome, ville ouverte…). Au musée national, les mosaïques dorées des basiliques byzantines avaient quelque chose de tes livres : un découpage bordélique et craquelé de très près, et puis, pour qui prend la peine de prendre du recul, de faire deux pas de côté, un sens doré et une vraie beauté pleine… D’Istanbul à Byzance, il y a donc un cargo vers le Nord. Et il nous restait une nuit jusqu’au mont du Faucon. Je ne voulais pas que ça s’arrête.
 La sixième fois que je t’ai écrit, j’étais bien de retour. Il grêlait sur la frange du Léman. Tout me paraissait confiné. Je m’étais fait interrompre par un Skype de David et Julien, assis dans ma véranda des Pléiades à corriger les épreuves de mon bouquin sur Jotterand et la Gazette littéraire. Ton côté n’existait plus, le brouillard s’était levé en fin d’après midi. David me racontait qu’il avait appris la mort d’un de ses amis, dans les montagnes valaisannes, quelques jours auparavant. Il me racontait sa guerre des six jours pour récupérer la voiture au port d’Alexandrie, leur passage sur la place révolutionnaire du Caire, les aventures d’une bouteille de vinaigre que les douaniers prenaient pour de la picole, sa barbe qui prenait de l’ampleur, celle de Julien qui ne poussait pas. David avait le nez bouché, et Julien trafiquait, en direct, le micro de leur ordinateur pour rétablir la connexion qui s’interrompait toute les vingt secondes. Ces dernières nouvelles m’avaient ramené dans les nues, et puis celles du Soudan et de l’Ethiopie m’avaient fait basculer, avec ces photos hallucinées de barges remplies à ras bord, de ciels solides dans des tempêtes de sable curry, d’oiseaux inconcevables, de dentitions pourries… ce vagues à l’âme, ce trouble quand je revois leurs tête, le van, les objets que j’ai côtoyé deux mois durant. J’avais fermé ta lettre.
La sixième fois que je t’ai écrit, j’étais bien de retour. Il grêlait sur la frange du Léman. Tout me paraissait confiné. Je m’étais fait interrompre par un Skype de David et Julien, assis dans ma véranda des Pléiades à corriger les épreuves de mon bouquin sur Jotterand et la Gazette littéraire. Ton côté n’existait plus, le brouillard s’était levé en fin d’après midi. David me racontait qu’il avait appris la mort d’un de ses amis, dans les montagnes valaisannes, quelques jours auparavant. Il me racontait sa guerre des six jours pour récupérer la voiture au port d’Alexandrie, leur passage sur la place révolutionnaire du Caire, les aventures d’une bouteille de vinaigre que les douaniers prenaient pour de la picole, sa barbe qui prenait de l’ampleur, celle de Julien qui ne poussait pas. David avait le nez bouché, et Julien trafiquait, en direct, le micro de leur ordinateur pour rétablir la connexion qui s’interrompait toute les vingt secondes. Ces dernières nouvelles m’avaient ramené dans les nues, et puis celles du Soudan et de l’Ethiopie m’avaient fait basculer, avec ces photos hallucinées de barges remplies à ras bord, de ciels solides dans des tempêtes de sable curry, d’oiseaux inconcevables, de dentitions pourries… ce vagues à l’âme, ce trouble quand je revois leurs tête, le van, les objets que j’ai côtoyé deux mois durant. J’avais fermé ta lettre.
 Je t’ai écrit six fois, et puis bien d’autres encore, dans ma tête, sur mon scooter, en déménageant mes meubles et mes livres avec Camille, du Calvaire en direction du Mont, en faisant la brasse coulée à la piscine municipale de Vevey, en jouant au beach volley à Blonay, en réglant des comptes avec de vieux démons, en récitant des histoires de vendanges, en regardant les images argentiques de mon grand-père se révéler sous la pellicule liquide d’une révélation chimique, en chantant Heart of gold de Neil Young devant des pasteurs réformés, en venant te voir entouré d’amis dans un café de Chauderon où sautillait le Kangourou, rigolait Blacky, maraudait le Loup et butinaient toutes sortes d’autres insectes attachants, je t’ai écrit toutes sortes de lettres, cher Old Boy, et tu ne les a jamais lues. Parce que je ne te les ai pas envoyées, ou, souvent, pas écrites. La septième fois, c’était la bonne. Depuis les collines crémeuses de la Gruyère, mon vieux rebelle, loin du « milieu lémanique romand » (pour paraphraser l’éditeur qui m’embauche), je t’envoie ces lignes denses et un peu bordéliques, que je relis lentement en pensant à ces derniers mois.
Je t’ai écrit six fois, et puis bien d’autres encore, dans ma tête, sur mon scooter, en déménageant mes meubles et mes livres avec Camille, du Calvaire en direction du Mont, en faisant la brasse coulée à la piscine municipale de Vevey, en jouant au beach volley à Blonay, en réglant des comptes avec de vieux démons, en récitant des histoires de vendanges, en regardant les images argentiques de mon grand-père se révéler sous la pellicule liquide d’une révélation chimique, en chantant Heart of gold de Neil Young devant des pasteurs réformés, en venant te voir entouré d’amis dans un café de Chauderon où sautillait le Kangourou, rigolait Blacky, maraudait le Loup et butinaient toutes sortes d’autres insectes attachants, je t’ai écrit toutes sortes de lettres, cher Old Boy, et tu ne les a jamais lues. Parce que je ne te les ai pas envoyées, ou, souvent, pas écrites. La septième fois, c’était la bonne. Depuis les collines crémeuses de la Gruyère, mon vieux rebelle, loin du « milieu lémanique romand » (pour paraphraser l’éditeur qui m’embauche), je t’envoie ces lignes denses et un peu bordéliques, que je relis lentement en pensant à ces derniers mois.
 Des satellites tournent autour du Monde, produisant leurs propres flashes Iridium. Je crois que je suis planté sur place. Les prochains mois seront tout aussi beaux, j’en suis sûr, et la matière – sensible, physique, faiblement chargée d’ors, brûlante dans la paume – ne devrait pas manquer. Il y a ce stage éditorial, et puis la correction des carnets de guerre de Pourtalès, enfin les Archives littéraires suisses qui m’attendent pour Donzé à la fin de l’été, un livre en chantier, d’autres dans le fond des yeux, l’AJAR que tu parraine spontanément, des lectures, des journaux à faire paraître, des photos à révéler, des concerts, des Cervins à mettre aux murs, des amis à retrouver, le vent du sud à digérer… et la route à reprendre ! Je te dis donc : à très vite. Prends soin de ta retraite, celle depuis laquelle tu surplombes la plupart des hommes sans les prendre de haut, et celle dans laquelle tu t’installes pour de bon, dear bloody Oblomov, et pour longtemps encore ! Ecris-moi bientôt – du premier coup, si tu y arrives ! Le Kid
Des satellites tournent autour du Monde, produisant leurs propres flashes Iridium. Je crois que je suis planté sur place. Les prochains mois seront tout aussi beaux, j’en suis sûr, et la matière – sensible, physique, faiblement chargée d’ors, brûlante dans la paume – ne devrait pas manquer. Il y a ce stage éditorial, et puis la correction des carnets de guerre de Pourtalès, enfin les Archives littéraires suisses qui m’attendent pour Donzé à la fin de l’été, un livre en chantier, d’autres dans le fond des yeux, l’AJAR que tu parraine spontanément, des lectures, des journaux à faire paraître, des photos à révéler, des concerts, des Cervins à mettre aux murs, des amis à retrouver, le vent du sud à digérer… et la route à reprendre ! Je te dis donc : à très vite. Prends soin de ta retraite, celle depuis laquelle tu surplombes la plupart des hommes sans les prendre de haut, et celle dans laquelle tu t’installes pour de bon, dear bloody Oblomov, et pour longtemps encore ! Ecris-moi bientôt – du premier coup, si tu y arrives ! Le Kid
 De JLK, dit le Papillon, à Daniel Vuataz, dit le Kid
De JLK, dit le Papillon, à Daniel Vuataz, dit le Kid
La Désirade, ce vendredi 8 juin.
Dear youngsta,
Ta toute bonne lettre, faite de celles que tu ne m’as pas envoyées et plus encore, m’a fait du bien au moment où je l’ai reçue. La veille j’en avais reçue une d’un Nobody qui ne t’aurait pas loupé si tu t’étais trouvé sur sa route. Cette lettre m’est arrivée comme de l’enfer et n’a pas manqué de terrifier ma bonne amie et de semer d’autres troubles. Depuis trois jours je pense à ceux qui sont tombés dans les pattes de ce morne exterminateur qu’on appelle « le mort » dans sa prison, comme je l’ai raconté dans mes Chemins de traverse, et qui me fait la leçon en me rappelant, après avoir lu mon livre, qu’il est vivant. Certes, vivant encore et obsédé, j’ose l’espérer, par les tortures qu’il a infligées aux innocents qu’il a ensuite massacrés. Mais on m’a dit qu’il se branlait encore en pensant à ses victimes. Moi je n’en sais rien et cela ne m’intéresse pas d’en savoir plus. Cependant je lui ai répondu, j’ai même fait le compassionnel parce que je crois que son mal « vient de plus loin » et qu’il passe tout jugement humain. Je suis à vrai dire de moins en moins sûr qu’il y ait un Dieu pour en juger: ce qu’on appelle la « justice divine » a légitimé tous les massacrs, mais je me rappelle à l’instant l’exergue du Viol de l’ange que j’empruntais au penseur américain R.A. Torrey : « L’enfer est l’asile d’aliénés de l’univers, où les hommes seront persécutés par leurs souvenirs ».
 Pardon, Kiddy, de t’infliger ce début de réponse si lugubre, mais il y a en toi assez de santé et de générosité, de joie de vivre et de sérieux pour absorber et filtrer les ombres rampant dans nos plus noires ténèbres. Tu liras bientôt le deuxième roman de Quentin, Notre-Dame-de-la-Merci, qui sonde lui aussi les grands fonds de la déréliction humaine en interrogeant quelques destinées paumées le temps d’une tempête dans la forêt québecoise. Tu verras que les promesses de son premier livre sont tenues et dépassées, dans un livre apparemment sombre mais lumineux par dedans – je veux dire : éclairé et réchauffé par une espèce d’affection attentive sans rien de la pitié démago ou de la commisération à bon marché. Je me garderai de crier au chef-d’œuvre, le souvenir de Typhon de Joseph Conrad (qui n’est d’ailleurs pas son chef-d’œuvre) peut nous rappeler les largeurs de la grande littérature, mais je ne vois aucun auteur de votre génération, pour le moment, à toucher si juste et si profond dans le registre de l’émotion. Ta papatte à toi est tout autre, ainsi que ta façon de voyager et d’évoquer le monde en trouvère à basquettes, mais je sais que tu couperas à l’envie parce que tu sais que tu es unique autant que nous le sommes tous. Donc le prochain Passe-Muraille, auquel je mets la dernière main, s’ouvrira avec un début de chapitre de Notre-Dame-de-La-Merci et suivront dix pages égrenant ton épatante chronique du métro lausannois, un bel extrait du prochain roman de Douna Loup, trois nouvelles également originales de Noémi Schaub, Elodie Glerum et Fanny Wobmann-Richard, sans oublier tes complices de l’AJAR - Guy et Matthieu, plus Nicolas et Bruno qui revient de Madagascar -, Sébastien Meyer qui revient de Buenos Aires ou Max le Blacky en pleine composition d’un roman à crime de sang…
Pardon, Kiddy, de t’infliger ce début de réponse si lugubre, mais il y a en toi assez de santé et de générosité, de joie de vivre et de sérieux pour absorber et filtrer les ombres rampant dans nos plus noires ténèbres. Tu liras bientôt le deuxième roman de Quentin, Notre-Dame-de-la-Merci, qui sonde lui aussi les grands fonds de la déréliction humaine en interrogeant quelques destinées paumées le temps d’une tempête dans la forêt québecoise. Tu verras que les promesses de son premier livre sont tenues et dépassées, dans un livre apparemment sombre mais lumineux par dedans – je veux dire : éclairé et réchauffé par une espèce d’affection attentive sans rien de la pitié démago ou de la commisération à bon marché. Je me garderai de crier au chef-d’œuvre, le souvenir de Typhon de Joseph Conrad (qui n’est d’ailleurs pas son chef-d’œuvre) peut nous rappeler les largeurs de la grande littérature, mais je ne vois aucun auteur de votre génération, pour le moment, à toucher si juste et si profond dans le registre de l’émotion. Ta papatte à toi est tout autre, ainsi que ta façon de voyager et d’évoquer le monde en trouvère à basquettes, mais je sais que tu couperas à l’envie parce que tu sais que tu es unique autant que nous le sommes tous. Donc le prochain Passe-Muraille, auquel je mets la dernière main, s’ouvrira avec un début de chapitre de Notre-Dame-de-La-Merci et suivront dix pages égrenant ton épatante chronique du métro lausannois, un bel extrait du prochain roman de Douna Loup, trois nouvelles également originales de Noémi Schaub, Elodie Glerum et Fanny Wobmann-Richard, sans oublier tes complices de l’AJAR - Guy et Matthieu, plus Nicolas et Bruno qui revient de Madagascar -, Sébastien Meyer qui revient de Buenos Aires ou Max le Blacky en pleine composition d’un roman à crime de sang…
 Te retrouver lisant La Haute Route de Maurice Chappaz, que j’avais jugé assez rudement à l’époque, tant son lyrisme et ses jodlées vocales me semblaient artificielle ou disons forcées, m’a rappelé nos propres équipées entre Saas-Fee, Zermatt et Chamonix, il y a de ça plus de quarante putains d’années ! Mais ton histoire d’accident de bus m’a rappelé le premier mort que nous avons découvert, sous une avalanche de la nuit même, au pied du col du Strahlhorn, et tes varappes exotiques m’ont fait retrouver mon ami Reynald, tombé dans les séracs du bien-nommé Dolent le 15 août 1985 (l’année de naissance de Julie) ou nos grimpes marines avec Anicet Sarrasin dans les Calanques d’En Vau – mon rude compagnon passant la journée sous une pierre tant il craignait le soleil des hippies bronzant à poil tout à côté.
Te retrouver lisant La Haute Route de Maurice Chappaz, que j’avais jugé assez rudement à l’époque, tant son lyrisme et ses jodlées vocales me semblaient artificielle ou disons forcées, m’a rappelé nos propres équipées entre Saas-Fee, Zermatt et Chamonix, il y a de ça plus de quarante putains d’années ! Mais ton histoire d’accident de bus m’a rappelé le premier mort que nous avons découvert, sous une avalanche de la nuit même, au pied du col du Strahlhorn, et tes varappes exotiques m’ont fait retrouver mon ami Reynald, tombé dans les séracs du bien-nommé Dolent le 15 août 1985 (l’année de naissance de Julie) ou nos grimpes marines avec Anicet Sarrasin dans les Calanques d’En Vau – mon rude compagnon passant la journée sous une pierre tant il craignait le soleil des hippies bronzant à poil tout à côté.
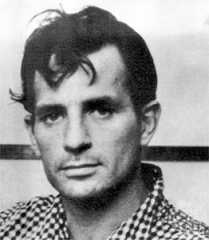 Je vous vois très bien aussi lire Jack London on the Road – et soit dit en passant, je partage tout à fait votre perplexité à l’égard du livre « culte » de Kerouac, dont le romantisme de surface ne m’a jamais scotché -, tu sais combien je partage aussi ta passion pour Cendrars et Charles-Albert, et cela m’a beaucoup touché également de savoir ton pote lisant Destruction massive de Jean le fou auquel je parlais d’ailleurs hier soir de vous tous, nos youngsters (toi, Quentin, Blacky, Douna, Matthieu, Bruno et j’en passe) et de l’espoir que vous nous donnez que tout n’est pas définitivement avili et foutu.
Je vous vois très bien aussi lire Jack London on the Road – et soit dit en passant, je partage tout à fait votre perplexité à l’égard du livre « culte » de Kerouac, dont le romantisme de surface ne m’a jamais scotché -, tu sais combien je partage aussi ta passion pour Cendrars et Charles-Albert, et cela m’a beaucoup touché également de savoir ton pote lisant Destruction massive de Jean le fou auquel je parlais d’ailleurs hier soir de vous tous, nos youngsters (toi, Quentin, Blacky, Douna, Matthieu, Bruno et j’en passe) et de l’espoir que vous nous donnez que tout n’est pas définitivement avili et foutu.
 Ta bonne lettre te vaudra deux des trois Cervins que je t’ai promis. Le troisième te reviendra quand tu nous fileras ton tapuscrit promis pour la collection Le Passe-Muraille des éditions d’autre part. Pascal t’attend de pied ferme tout souriant. Tu sais quelle rigueur jurassienne cache ce sourire. Tu devrais absolument lire Le prochains, son dernier livre. C’est une galerie de portraits que je préfère pour ma part aux «vies minuscules » de Pierre Michon - même si c’est nettement moins ciselé en finesse et moins « gravé dans le marbre » - , à proportion de la tendresse jamais mielleuse de l’auteur et de sa générosité, de sa poésie « dans la vie » et de son tonus verbal. Ce mec est « classe », pour parler ton volapück: non seulement il ne m’en a pas voulu d’aller voir chez Olivier Morattel si j’y étais, mais il m’a complimenté en appelant mes Chemins de traverse le livre d’un « Mensch ». Je ne peux que te dire la même chose de lui : « Isch a guët Mensch »…
Ta bonne lettre te vaudra deux des trois Cervins que je t’ai promis. Le troisième te reviendra quand tu nous fileras ton tapuscrit promis pour la collection Le Passe-Muraille des éditions d’autre part. Pascal t’attend de pied ferme tout souriant. Tu sais quelle rigueur jurassienne cache ce sourire. Tu devrais absolument lire Le prochains, son dernier livre. C’est une galerie de portraits que je préfère pour ma part aux «vies minuscules » de Pierre Michon - même si c’est nettement moins ciselé en finesse et moins « gravé dans le marbre » - , à proportion de la tendresse jamais mielleuse de l’auteur et de sa générosité, de sa poésie « dans la vie » et de son tonus verbal. Ce mec est « classe », pour parler ton volapück: non seulement il ne m’en a pas voulu d’aller voir chez Olivier Morattel si j’y étais, mais il m’a complimenté en appelant mes Chemins de traverse le livre d’un « Mensch ». Je ne peux que te dire la même chose de lui : « Isch a guët Mensch »…
 Je ne sais pas si, dans ton ermitage fribourgeois de ces jours, tu as entendu la belle édition d’Entre les lignes que les sieurs Félix et Ciocca m’ont consacrée cette semaine. Tu peux encore la podcaster si tu veux nous entendre – moi je n’ai pas osé la réécouter. Ce que j’ai beaucoup aimé, de la part de la paire, c’est leur attention sans faille, la compétence avec laquelle ils ont préparé l’émission que mon incontinence verbale a quelque peu chahutée je crois. Ce qui est sûr est que j’avais l’impression d’être avec des amis des mots et des livres, des idées et de la vie, le comédien Frédéric Lugon a super bien lu deux ou trois de mes pages, Christian Ciocca a fait une magnifique présentation de mon opuscule après une entrée en matière non moins bienveillante de Jean-Marie Félix, bref toi qui revient d’Istambul tu sais ce que signifie l’expression ç’a été Byzance.
Je ne sais pas si, dans ton ermitage fribourgeois de ces jours, tu as entendu la belle édition d’Entre les lignes que les sieurs Félix et Ciocca m’ont consacrée cette semaine. Tu peux encore la podcaster si tu veux nous entendre – moi je n’ai pas osé la réécouter. Ce que j’ai beaucoup aimé, de la part de la paire, c’est leur attention sans faille, la compétence avec laquelle ils ont préparé l’émission que mon incontinence verbale a quelque peu chahutée je crois. Ce qui est sûr est que j’avais l’impression d’être avec des amis des mots et des livres, des idées et de la vie, le comédien Frédéric Lugon a super bien lu deux ou trois de mes pages, Christian Ciocca a fait une magnifique présentation de mon opuscule après une entrée en matière non moins bienveillante de Jean-Marie Félix, bref toi qui revient d’Istambul tu sais ce que signifie l’expression ç’a été Byzance.
 Ce qui me botte d’ailleurs de plus en plus à la Radio c’est ça : la compétence. Putain ce que j’aime la compétence. Pas que l’efficience technique évidemment, même si tout se tient : mais la compétence à tous les degrés de la perception, de l’analyse, de la compréhension et de l’exercice chanté. Compétence de Federer trop évidente, mais aussi compétence des duettistes Félix & Ciocca quand ils se faufilent « entre mes lignes ». Compétence de l’équipe de Philippe Revaz le soir quand j’écoute Forum à l’isba sur mon sans-fil, sans discontinuer mes travaux d’incompétent charpentier-menuisier-peinturlureur. Compétence de Charles Sigel dans ses formidables émissions où la culture devient si vivante qu’on en mangerait. Compétence de Jean Leclair dans Histoire vivante dont les récentes séries sur Céline et Churchill m’ont passionné. La même putain de compétence que tu as déployée dans ton mémoire de lettres sur Jotterand et sa Gazette littéraire dont les feuillets aux belles illustrations à l’argentique ont tapissé ma première cabane dans les bois. Compétence, j’veux dire : amour de la chose et du travail artisanal bien fait pour la beauté de la chose et de la chaise. L’Art excède évidemment la compétence, mais tu sais l’importance des ateliers de Rembrandt ou Velasquez…
Ce qui me botte d’ailleurs de plus en plus à la Radio c’est ça : la compétence. Putain ce que j’aime la compétence. Pas que l’efficience technique évidemment, même si tout se tient : mais la compétence à tous les degrés de la perception, de l’analyse, de la compréhension et de l’exercice chanté. Compétence de Federer trop évidente, mais aussi compétence des duettistes Félix & Ciocca quand ils se faufilent « entre mes lignes ». Compétence de l’équipe de Philippe Revaz le soir quand j’écoute Forum à l’isba sur mon sans-fil, sans discontinuer mes travaux d’incompétent charpentier-menuisier-peinturlureur. Compétence de Charles Sigel dans ses formidables émissions où la culture devient si vivante qu’on en mangerait. Compétence de Jean Leclair dans Histoire vivante dont les récentes séries sur Céline et Churchill m’ont passionné. La même putain de compétence que tu as déployée dans ton mémoire de lettres sur Jotterand et sa Gazette littéraire dont les feuillets aux belles illustrations à l’argentique ont tapissé ma première cabane dans les bois. Compétence, j’veux dire : amour de la chose et du travail artisanal bien fait pour la beauté de la chose et de la chaise. L’Art excède évidemment la compétence, mais tu sais l’importance des ateliers de Rembrandt ou Velasquez…
 Ta remontée du Sud en cargo, le long des côtes adriatiques, m’a rappelé ma descente le long du même littoral aux ports de marbre évoquant la splendeur vénitienne passée, en 1993, quand les Croates et les Serbes se battaient sur les crêtes, comme je l’ai raconté en détail dans L’Ambassade du papillon. Or une fois de plus je constate que tes voyages, comme les miens, se dédoublent en lectures. Là tu parles de L’Espoir d’une langue à venir, thème que je vis pour ainsi dire ces jours en lisant Rabelais, et qui me ramène à la conversation que nous avons prolongée l’autre jour avec Christian Ciocca, après l’émission, sur la terrasse du Café de la Radio, où ce nouvel ami (je crois que je peux dire ça) m’a parlé du livre de Roland de Muralt. Qui m’a rappelé une autre conversation avec Quentin sur Adorno. Et voilà que du cites Heidegger. Qui me rappelle une crise de rage de Dimitri quand je me permettais, un soir, de critiquer le philosophe pour sa pleutrerie face aux nazis. Qui me rappelle aussi que j’ai repris l’autre jour la lecture du Courage d’être de Tillich, émigré aux States dès 1933. Sur quoi tu évoques « cette saloperie de Syrie », à laquelle fait écho Jean le fou dans sa postface à mes Chemins et qui me ramène ce matin aux Carnets de Homs de Jonathan Littell que je viens d’aborder. Comme quoi tout revient toujours à la case réel – tout se tenant.
Ta remontée du Sud en cargo, le long des côtes adriatiques, m’a rappelé ma descente le long du même littoral aux ports de marbre évoquant la splendeur vénitienne passée, en 1993, quand les Croates et les Serbes se battaient sur les crêtes, comme je l’ai raconté en détail dans L’Ambassade du papillon. Or une fois de plus je constate que tes voyages, comme les miens, se dédoublent en lectures. Là tu parles de L’Espoir d’une langue à venir, thème que je vis pour ainsi dire ces jours en lisant Rabelais, et qui me ramène à la conversation que nous avons prolongée l’autre jour avec Christian Ciocca, après l’émission, sur la terrasse du Café de la Radio, où ce nouvel ami (je crois que je peux dire ça) m’a parlé du livre de Roland de Muralt. Qui m’a rappelé une autre conversation avec Quentin sur Adorno. Et voilà que du cites Heidegger. Qui me rappelle une crise de rage de Dimitri quand je me permettais, un soir, de critiquer le philosophe pour sa pleutrerie face aux nazis. Qui me rappelle aussi que j’ai repris l’autre jour la lecture du Courage d’être de Tillich, émigré aux States dès 1933. Sur quoi tu évoques « cette saloperie de Syrie », à laquelle fait écho Jean le fou dans sa postface à mes Chemins et qui me ramène ce matin aux Carnets de Homs de Jonathan Littell que je viens d’aborder. Comme quoi tout revient toujours à la case réel – tout se tenant.

L’autre jour à la radio romande, une consoeur compétente et non sans courage (parce que le type ne fait pas de cadeau) demandait à Jonathan Littell ce qui le poussait à se rendre en Tchétchénie ou en Syrie alors qu’il est « surtout » écrivain. Or l’auteur des Bienveillantes, que je crois l’un des livres français majeurs de la première décennie passée, ne s’est pas contenté de dire qu’il ne se considérait pas fondamentalement comme un écrivain – et je l’ai entendu sans coquetterie de sa part – et que ce qui l’attirait sur de tels foyers de violence ne s’expliquait pas. Non sans maladresse, la journaliste a comparé la démarche de Littell à celle de BHL, ce qui lui a valu une réaction poliment dilatoire, mais en lisant Carnet de Homs, comme en lisant Les Bienveillantes du même Littell, qui invoquait le travail de Michel Foucault à l’instant où son interlocutrice évoquait le « thème du Mal », je crois entendre Patricia Higshmith me dire que la seule chose qui l’intéresse est la réalité et ses objets. Et cela me ramène au tueur dont je parlais au début de cette lettre. Cela me ramène à cette lettre que j’ai ouvert en tremblant après avoir lu le nom de son interlocuteur, immédiatement identifié. Cela me ramène à l’impensable, quel qu’il soit.
 Faut-il taire ce dont on ne peut pas parler, Kiddy ? Je me le demande. N’est-ce pas une folie que de nous exposer ainsi sur la Toile et ses réseaux multiples ? Jusqu’où peut-on jouer avec le virtuel ? Que nous dit l’exhibition mondiale des webcams ? Comment penser cette destruction de l'intimité ? Pourquoi la littérature actuelle parle-t-elle si peu de ce que nous avons sous les yeux ? Un dossier récent de la revue Transfuge accuse la littérature française d’être rétrograde, mais avec des arguments tellement vieillots qu’on a l’impression que les morts s’enterrent entre eux. Ainsi parle-t-on des Bienveillantes comme d’un livre tourné vers le passé. Foutaise incroyable ! Chichis germanopratins !
Faut-il taire ce dont on ne peut pas parler, Kiddy ? Je me le demande. N’est-ce pas une folie que de nous exposer ainsi sur la Toile et ses réseaux multiples ? Jusqu’où peut-on jouer avec le virtuel ? Que nous dit l’exhibition mondiale des webcams ? Comment penser cette destruction de l'intimité ? Pourquoi la littérature actuelle parle-t-elle si peu de ce que nous avons sous les yeux ? Un dossier récent de la revue Transfuge accuse la littérature française d’être rétrograde, mais avec des arguments tellement vieillots qu’on a l’impression que les morts s’enterrent entre eux. Ainsi parle-t-on des Bienveillantes comme d’un livre tourné vers le passé. Foutaise incroyable ! Chichis germanopratins !
 Lorsque j’ai retrouvé Dimitri après quinze ans de séparation, notre cher ami m’a donné à lire un petit livre d’un jeune informaticien chrétien intitulé L’Enfer d’Internet. Hélas l’essai en question n’est que la mise en garde d’un enfant de chœur, relançant les recommandations vertueuses à « nos jeunes ». Jacqueline de Romilly était plus futée, quand je lui demandais comment elle agirait avec des enfants par rapport à la télé. « Surtout ne pas interdire ! », s’est-elle aussitôt exclamée. «Ne pas dramatiser ou moraliser, mais parler, discuter, exercer le sens critique, donner des contrepoids ». Le bon sens même, quoi, que nous aurons pratiqué avec nos filles sans même y penser. Elles ont beau avoir vu toutes les horreurs imaginables: elles sont aujourd'hui bonnement équilibrées et encore romantiques à tout crin.
Lorsque j’ai retrouvé Dimitri après quinze ans de séparation, notre cher ami m’a donné à lire un petit livre d’un jeune informaticien chrétien intitulé L’Enfer d’Internet. Hélas l’essai en question n’est que la mise en garde d’un enfant de chœur, relançant les recommandations vertueuses à « nos jeunes ». Jacqueline de Romilly était plus futée, quand je lui demandais comment elle agirait avec des enfants par rapport à la télé. « Surtout ne pas interdire ! », s’est-elle aussitôt exclamée. «Ne pas dramatiser ou moraliser, mais parler, discuter, exercer le sens critique, donner des contrepoids ». Le bon sens même, quoi, que nous aurons pratiqué avec nos filles sans même y penser. Elles ont beau avoir vu toutes les horreurs imaginables: elles sont aujourd'hui bonnement équilibrées et encore romantiques à tout crin.
 Internet un enfer ou une poubelle, pour reprendre les termes d'Alain Finkielkraut ? Je comprends très bien les prudences hautaines d’un Philippe Sollers à l’égard du seul ordinateur et de la Toile évidemment: c’est de sa génération et de son style perso à stylo bleu. Moi vieille peau je me sens de la tienne en matière de curiosité. J‘ai découvert Internet à seize ans. Nous avions à peine la télé, à la maison, mais des tours se sont construites sur la colline dominant le quartier de notre adolescence, trois tours, les tours de Valmont des hauts de Lausanne que les journaux ont appelé le Mur de la Honte : trois tours présentant la nuit des milliers de fenêtres-écrans qui ont en somme inauguré ma carrière de voyeur internaute cliquant sur le site WorldWideWebcam.com et regardant l'inconcevable, l'impensable platitude de l'Exhibition mondialisée.
Internet un enfer ou une poubelle, pour reprendre les termes d'Alain Finkielkraut ? Je comprends très bien les prudences hautaines d’un Philippe Sollers à l’égard du seul ordinateur et de la Toile évidemment: c’est de sa génération et de son style perso à stylo bleu. Moi vieille peau je me sens de la tienne en matière de curiosité. J‘ai découvert Internet à seize ans. Nous avions à peine la télé, à la maison, mais des tours se sont construites sur la colline dominant le quartier de notre adolescence, trois tours, les tours de Valmont des hauts de Lausanne que les journaux ont appelé le Mur de la Honte : trois tours présentant la nuit des milliers de fenêtres-écrans qui ont en somme inauguré ma carrière de voyeur internaute cliquant sur le site WorldWideWebcam.com et regardant l'inconcevable, l'impensable platitude de l'Exhibition mondialisée.
 D’un clic j’accède à ta bonne lettre, mon bien cher. D’un autre clic j’accède à toutes les images que toi et tes compères avez grappillées au long de votre périple. D'un clic je balance entre Hitler et le Christ. À ce propos tu devrais regarder le film Import/Export d’Ulrich Seidl, un garçon sérieux qui voit de la beauté jusque dans la pire laideur. Il y est question, notamment, d’une jeune femme qui fuit l’enfer industriel ukrainien où sa mère va rester à s’occuper de son enfant « naturel », tandis qu’elle cherche un job en Autriche. Son premier point de chute est une espèce d’immense loft subdivisé en « salons » dans lesquels des filles, larguées comme elle, s’agitent devant des oeilletons de webcams dont on entend les clients-voyeurs vociférer des quatre coins du monde. Peep-show mondial. Il faut regarder ça attentivement et y réfléchir, même si ça ne dure que trois minutes dans le film. Ce n’est pas, évidemment, toute la réalité, mais c’est un aspect de l’irréalité réelle du virtuel qui tisse le « roman » d’aujourd’hui.
D’un clic j’accède à ta bonne lettre, mon bien cher. D’un autre clic j’accède à toutes les images que toi et tes compères avez grappillées au long de votre périple. D'un clic je balance entre Hitler et le Christ. À ce propos tu devrais regarder le film Import/Export d’Ulrich Seidl, un garçon sérieux qui voit de la beauté jusque dans la pire laideur. Il y est question, notamment, d’une jeune femme qui fuit l’enfer industriel ukrainien où sa mère va rester à s’occuper de son enfant « naturel », tandis qu’elle cherche un job en Autriche. Son premier point de chute est une espèce d’immense loft subdivisé en « salons » dans lesquels des filles, larguées comme elle, s’agitent devant des oeilletons de webcams dont on entend les clients-voyeurs vociférer des quatre coins du monde. Peep-show mondial. Il faut regarder ça attentivement et y réfléchir, même si ça ne dure que trois minutes dans le film. Ce n’est pas, évidemment, toute la réalité, mais c’est un aspect de l’irréalité réelle du virtuel qui tisse le « roman » d’aujourd’hui.
 À part quoi la vie bonne continue. Un SMS et tu peux dire à tes enfants que tu les aimes, qui te répondent dans la minute. L’Abbaye de Thélème est partout. L’isba en est une succursale qui s’ouvrira bientôt avec 12.000 livres, une table à écrire, une bouteille de rouge, une autre de Turka Cola, des sèches pour ceux qui sèchent les Conseils du Médecin, un lit, un pot de chambre sous le lit qui se rince à la cascade - sinon toute une forêt pour la petite et la grande commission. Rousseau eût kiffé l’écart. On t’y attend, chenapan…
À part quoi la vie bonne continue. Un SMS et tu peux dire à tes enfants que tu les aimes, qui te répondent dans la minute. L’Abbaye de Thélème est partout. L’isba en est une succursale qui s’ouvrira bientôt avec 12.000 livres, une table à écrire, une bouteille de rouge, une autre de Turka Cola, des sèches pour ceux qui sèchent les Conseils du Médecin, un lit, un pot de chambre sous le lit qui se rince à la cascade - sinon toute une forêt pour la petite et la grande commission. Rousseau eût kiffé l’écart. On t’y attend, chenapan…
Con un abbraccio, Jls
 Il est vrai que la pensée de la mort s'accentue avec l'âge, surtout avant le premier café du matin, mais ce n'est pas de cet état d'âme à composante surtout physique, non sans résonance métaphysique évidemment, que j'ai envie et plus encore besoin de te parler en ces jours d'entre saisons: c'est plutôt de la vie et, par contraste, de ce qu'on pourrait dire la vie amortie que je vais tâcher de te parler par manière de réponse.
Il est vrai que la pensée de la mort s'accentue avec l'âge, surtout avant le premier café du matin, mais ce n'est pas de cet état d'âme à composante surtout physique, non sans résonance métaphysique évidemment, que j'ai envie et plus encore besoin de te parler en ces jours d'entre saisons: c'est plutôt de la vie et, par contraste, de ce qu'on pourrait dire la vie amortie que je vais tâcher de te parler par manière de réponse. 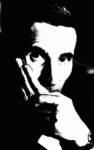 Tout ça n'est pas tout à fait nouveau. Il y a bien un siècle et même plus (on pense à Dostoïevski, avant Metropolis et Kafka) que ce processus de déshumanisation formatée, de nettoyage et de liquidation a été pressenti et ensuite décrit par ces observateurs délicats de notre société dite évoluée que sont les écrivains, bien avant les sociologues. Dino Buzzati, avec sa Chasse aux vieux et son évocation de l'usine-hôpital, est aussi à relire...
Tout ça n'est pas tout à fait nouveau. Il y a bien un siècle et même plus (on pense à Dostoïevski, avant Metropolis et Kafka) que ce processus de déshumanisation formatée, de nettoyage et de liquidation a été pressenti et ensuite décrit par ces observateurs délicats de notre société dite évoluée que sont les écrivains, bien avant les sociologues. Dino Buzzati, avec sa Chasse aux vieux et son évocation de l'usine-hôpital, est aussi à relire... Le piquant de la situation tient au fait que ton refus de servir t'ait permis d'éviter de ne servir à rien, dans les rangs de l'armée ordinaire, pour servir la culture et le social. Je suis un peu de mauvaise foi, en tant qu'ancien canonnier de montagne, en affirmant que l'armée ordinaire suisse ne sert à rien puisque c'est sous l'uniforme, et notamment dans la tenue d'assaut pourvue de 15 poches, qu'il m'a été donné de lire l'intégralité des pièces et des récits d'Anton Pavlovich Tchékhov, au soleil des monts ou par fortins et fenils, durant les heures de pauses constituant l'essentiel de la formation et de l'activité militaires.
Le piquant de la situation tient au fait que ton refus de servir t'ait permis d'éviter de ne servir à rien, dans les rangs de l'armée ordinaire, pour servir la culture et le social. Je suis un peu de mauvaise foi, en tant qu'ancien canonnier de montagne, en affirmant que l'armée ordinaire suisse ne sert à rien puisque c'est sous l'uniforme, et notamment dans la tenue d'assaut pourvue de 15 poches, qu'il m'a été donné de lire l'intégralité des pièces et des récits d'Anton Pavlovich Tchékhov, au soleil des monts ou par fortins et fenils, durant les heures de pauses constituant l'essentiel de la formation et de l'activité militaires.  Je suis également entrain de lire la correspondance de Cendrars avec Henry Miller et là aussi tu verras combien la rue, autant que l'hôpital ou l'asile de dingues, est une école plus enseignante que l'école des enseignants. Note que je ne jette aucune pierre. Tchékhov était hanté par le désir de voir plus d'instituteurs dans la Russie du début du XXe siècle, et c'est peut-être ça aussi qui nous manque en lieu et place d'enseignants et d'apprenants formatés pour le Système: des instituteurs qui savent tout et sont respectés par tous. On peut rêver...
Je suis également entrain de lire la correspondance de Cendrars avec Henry Miller et là aussi tu verras combien la rue, autant que l'hôpital ou l'asile de dingues, est une école plus enseignante que l'école des enseignants. Note que je ne jette aucune pierre. Tchékhov était hanté par le désir de voir plus d'instituteurs dans la Russie du début du XXe siècle, et c'est peut-être ça aussi qui nous manque en lieu et place d'enseignants et d'apprenants formatés pour le Système: des instituteurs qui savent tout et sont respectés par tous. On peut rêver... Aux alentours de Mai 68, le climat de la faculté des Lettres de Lausanne m'a immédiatement oppressé et découragé; dès la séance d'accueil où le Doyen nous a fait comprendre qu'aimer la littérature était pour ainsi dire rédhibitoire en ces lieux où l'on étudierait scientifiquement la textualité textuelle et les structures structurales; et sa mine de pion navré, l'ambiance compassée et feutrée de l'Ancienne Académie où avaient couvé les oeufs pâles de tants d'autres pions rassis, m'a vite fait établir mes quartiers entre le bar à café bien nommé Barbare et la librairie anar de Claude Frochaux, entre autres points de chute de mes universités buissonnières.
Aux alentours de Mai 68, le climat de la faculté des Lettres de Lausanne m'a immédiatement oppressé et découragé; dès la séance d'accueil où le Doyen nous a fait comprendre qu'aimer la littérature était pour ainsi dire rédhibitoire en ces lieux où l'on étudierait scientifiquement la textualité textuelle et les structures structurales; et sa mine de pion navré, l'ambiance compassée et feutrée de l'Ancienne Académie où avaient couvé les oeufs pâles de tants d'autres pions rassis, m'a vite fait établir mes quartiers entre le bar à café bien nommé Barbare et la librairie anar de Claude Frochaux, entre autres points de chute de mes universités buissonnières. Il y avait là des personnages. Le vieux critique musical Henri Jaton usait et abusait du subjonctif plus-que-parfait et donnait du Maître avec une componction qui nous faisait pouffer autant que les cols de loutre des grands manteaux d'Antoine Livio, revenant à tout moment de Bayreuth. Ou encore le toujours enthousiaste Freddy Buache, dont la Cinémathèque héroïque se trouvait encore dans un cagnard insalubre jouxtant la cathédrale, qui tempêtait contre la Censure et vilipendait le cinéma commercial avant de commenter le dernier Fellini ou le dernier Bergman en longues phrases alambiquées.
Il y avait là des personnages. Le vieux critique musical Henri Jaton usait et abusait du subjonctif plus-que-parfait et donnait du Maître avec une componction qui nous faisait pouffer autant que les cols de loutre des grands manteaux d'Antoine Livio, revenant à tout moment de Bayreuth. Ou encore le toujours enthousiaste Freddy Buache, dont la Cinémathèque héroïque se trouvait encore dans un cagnard insalubre jouxtant la cathédrale, qui tempêtait contre la Censure et vilipendait le cinéma commercial avant de commenter le dernier Fellini ou le dernier Bergman en longues phrases alambiquées. 
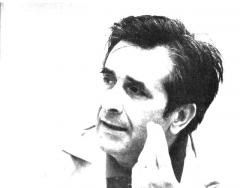
 Après la découverte irradiante de Charles-Albert Cingria, dont tu es l'un des rares youngsters à connaître le nom et défendre allègement la mémoire, celle de Witkacy (ainsi nommé pour le distinguer de son père Stanislaw Witkiewicz, lui aussi peintre et théoricien de l'art) a été un choc incomparable en cela que son oeuvre constituait la critique la plus percutante et la plus indépendante, quant aux idéologies toujours en lutte, du monde où toutes ses prémonitions (datant des années 1920-1925) se réalisaient sous nos yeux.
Après la découverte irradiante de Charles-Albert Cingria, dont tu es l'un des rares youngsters à connaître le nom et défendre allègement la mémoire, celle de Witkacy (ainsi nommé pour le distinguer de son père Stanislaw Witkiewicz, lui aussi peintre et théoricien de l'art) a été un choc incomparable en cela que son oeuvre constituait la critique la plus percutante et la plus indépendante, quant aux idéologies toujours en lutte, du monde où toutes ses prémonitions (datant des années 1920-1925) se réalisaient sous nos yeux. Après Orwell et Koestler, Witkiewicz est un des maîtres de la contre-utopie littéraire, mais son originalité est, à mon sens, dans le détail. Personne n'a parlé comme lui à cette époque (sauf Strindrerg au théâtre) des enchevêtrailles du psychisme et du corps, de la guerre ses sexes et de l'acclimatation progressive de toute différence au nom de la norme "libérée". Surtout, Witkiewicz est le peintre à l'acide de la société nivelée, notamment sous les auspices d'un parti "nivelliste", visant à l'établissement de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui le Wellness mondial, entièrement voué à l'entretien du bien-être et à la normalisation du tout-conso...
Après Orwell et Koestler, Witkiewicz est un des maîtres de la contre-utopie littéraire, mais son originalité est, à mon sens, dans le détail. Personne n'a parlé comme lui à cette époque (sauf Strindrerg au théâtre) des enchevêtrailles du psychisme et du corps, de la guerre ses sexes et de l'acclimatation progressive de toute différence au nom de la norme "libérée". Surtout, Witkiewicz est le peintre à l'acide de la société nivelée, notamment sous les auspices d'un parti "nivelliste", visant à l'établissement de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui le Wellness mondial, entièrement voué à l'entretien du bien-être et à la normalisation du tout-conso... Avec quelques compères de ces années-là (surtout Jil Silberstein et Richard Aeschlimann), réunis autour de Dimitri, nous avons trouvé en Witkiewicz, autant qu'une espèce de modèle-héros dont les frasques relevaient de la légende: l'incarnation d'une révolte fondamentale contre l'uniformisation et la médiocrité, dont le sérieux fondamental, sur fond de tragédie, sous-tendait une vision d'une prodigieuse lucidité. Le propre de pas mal de jeunes écrivains consiste à vouloir TOUT DIRE, Avec Witkacy, nous étions à bonne école...
Avec quelques compères de ces années-là (surtout Jil Silberstein et Richard Aeschlimann), réunis autour de Dimitri, nous avons trouvé en Witkiewicz, autant qu'une espèce de modèle-héros dont les frasques relevaient de la légende: l'incarnation d'une révolte fondamentale contre l'uniformisation et la médiocrité, dont le sérieux fondamental, sur fond de tragédie, sous-tendait une vision d'une prodigieuse lucidité. Le propre de pas mal de jeunes écrivains consiste à vouloir TOUT DIRE, Avec Witkacy, nous étions à bonne école...  La révolte de Witkiewicz contre l'accroupissement général, au nom de tous les relativismes et autres programmes utilitaires, nous a bel et bien habités, à un moment où la contestation juvénile commençait de se normaliser: nous avons véritablement vécu cet "inassouvissement" dont il décrit les innombrables formes, physiques ou métaphysiques, et je reste pour ma part très redevable, aujourd'hui encore, à sa perception phénoménale de ce qu'on pourrait dire le "poids du monde", à l'antipode de ce qu'on pourrait dire le "chant du monde", évidemment incarné par Cingria - la vie amortie étant en somme l'interzone où se réalise le bonheur généralisé entre barbecues et jacuzzis...
La révolte de Witkiewicz contre l'accroupissement général, au nom de tous les relativismes et autres programmes utilitaires, nous a bel et bien habités, à un moment où la contestation juvénile commençait de se normaliser: nous avons véritablement vécu cet "inassouvissement" dont il décrit les innombrables formes, physiques ou métaphysiques, et je reste pour ma part très redevable, aujourd'hui encore, à sa perception phénoménale de ce qu'on pourrait dire le "poids du monde", à l'antipode de ce qu'on pourrait dire le "chant du monde", évidemment incarné par Cingria - la vie amortie étant en somme l'interzone où se réalise le bonheur généralisé entre barbecues et jacuzzis... Et vous là-dedans, youngsters ? Ah mais, vous ne semblez pas pressés de répondre ! L'ami Claude Frochaux qui a conclu, dans L'Homme seul et L'Homme achevé - essais par ailleurs remarquable composés pour ainsi dire dans les coulisses de L'Age d'Homme-, que la créativité occidentale avait connu son terme au mitan des années 60, vous a condamnés d'avance.
Et vous là-dedans, youngsters ? Ah mais, vous ne semblez pas pressés de répondre ! L'ami Claude Frochaux qui a conclu, dans L'Homme seul et L'Homme achevé - essais par ailleurs remarquable composés pour ainsi dire dans les coulisses de L'Age d'Homme-, que la créativité occidentale avait connu son terme au mitan des années 60, vous a condamnés d'avance. 
 Je trouve merveilleux que tu te sois passionné pour Cingria et que tu aies consacré plusieurs années à documenter l'aventure de la Gazette littéraire. Mais à présent, fils, faut te bouger. S'occuper des vieux, c'est bien joli, mais ta jeunesse doit s'exprimer aussi, en se rappelant qu'elle n'est rien en tant que telle. Je te cite Cendrars dans une lettre à Miller: "De la jeunesse, Baudelaire écrivait: "Le jeunesse se prend pour un sacerdoce !" C'est aujourd'hui plus vrai que jamais. Seuls sont "jeunes " les "vieux" qui s'en foutent. Voyez Rabelais".
Je trouve merveilleux que tu te sois passionné pour Cingria et que tu aies consacré plusieurs années à documenter l'aventure de la Gazette littéraire. Mais à présent, fils, faut te bouger. S'occuper des vieux, c'est bien joli, mais ta jeunesse doit s'exprimer aussi, en se rappelant qu'elle n'est rien en tant que telle. Je te cite Cendrars dans une lettre à Miller: "De la jeunesse, Baudelaire écrivait: "Le jeunesse se prend pour un sacerdoce !" C'est aujourd'hui plus vrai que jamais. Seuls sont "jeunes " les "vieux" qui s'en foutent. Voyez Rabelais". 


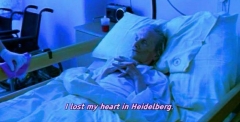 Il nous a déposé, Marie-Louise et moi, devant la porte électrique en bois de la clinique. Comme il pleuvait (ça pourrait être n’importe quand entre janvier et maintenant), il a déployé un grand parapluie transparent pendant que je prenais Marie-Louise par la main, et il nous a suivi jusqu’à la porte. C’est moi qui suis allé annoncer Marie-Louise à la réception, parce qu’elle n’atteint pas la hauteur du comptoir et que, de toute façon, sa famille compte sur moi pour m’occuper d’elle. Dans la salle d’attente du département de radiologie, j’ai tenté de rassurer un peu Marie-Louise, qui jetait des regards angoissés à tous les autres patients. Elle ne tenait pas en place. Elle a appelé sa maman à plusieurs reprises et m’a demandé où nous nous trouvions. Je lui ai expliqué, pour la dixième fois de la matinée, que c’était moi qui l’accompagnais aujourd’hui et qu’elle allait passer une radiographie. Je ne suis pas sûr qu’elle connaisse ce mot. Elle m’a demandé si je resterais avec elle pendant la consultation. Je lui ai dit que oui. Dans la salle d’attente, Marie-Louise triturait les cordons de son pull, les tordait autour de ses petits doigts, jetais des regards effarouchés autour d’elle, dernière elle. Chaque fois que la porte s’ouvrait, elle sursautait un peu. La pluie battait les vitres propres. A un moment, le médecin est arrivé. J’ai accompagné Marie-Louise dans les pas de la blouse blanche, qui ne se retournait jamais dans les coudes des couloirs, se contentant de nous tenir les portes et d’appuyer sur les interrupteurs. Il paraissait plutôt vieux et voûté, il traînait un peu des pieds. Dans la petite salle de consultation, il m’a demandé de déshabiller Marie-Louise et de la coucher sur le lit. Je lui ai demandé s’il fallait que j’enlève aussi ses couches. Il a jeté un œil, et m’a dit qu’on ferait avec, qu’elle pouvait les laisser. Comme Marie-Louise, toute nue sur sa grosse feuille de papier, ne voulait pas rester tranquille, j’ai dû lui tenir la main pendant que le scanner survolait lentement son corps et que le docteur regardait l’image apparaître sur son écran, une strate horizontale après l’autre. Ça m’a fait penser à l’époque des premières connections Internet. Le survol a duré une vingtaine de minutes. Je crois que Marie-Louise s’est même endormie un moment, pendant que je lui tenais la main. Ensuite je l’ai rhabillée, et nous sommes revenus ensemble dans la salle d’attente, où un autre médecin nous attendait avec les résultats.
Il nous a déposé, Marie-Louise et moi, devant la porte électrique en bois de la clinique. Comme il pleuvait (ça pourrait être n’importe quand entre janvier et maintenant), il a déployé un grand parapluie transparent pendant que je prenais Marie-Louise par la main, et il nous a suivi jusqu’à la porte. C’est moi qui suis allé annoncer Marie-Louise à la réception, parce qu’elle n’atteint pas la hauteur du comptoir et que, de toute façon, sa famille compte sur moi pour m’occuper d’elle. Dans la salle d’attente du département de radiologie, j’ai tenté de rassurer un peu Marie-Louise, qui jetait des regards angoissés à tous les autres patients. Elle ne tenait pas en place. Elle a appelé sa maman à plusieurs reprises et m’a demandé où nous nous trouvions. Je lui ai expliqué, pour la dixième fois de la matinée, que c’était moi qui l’accompagnais aujourd’hui et qu’elle allait passer une radiographie. Je ne suis pas sûr qu’elle connaisse ce mot. Elle m’a demandé si je resterais avec elle pendant la consultation. Je lui ai dit que oui. Dans la salle d’attente, Marie-Louise triturait les cordons de son pull, les tordait autour de ses petits doigts, jetais des regards effarouchés autour d’elle, dernière elle. Chaque fois que la porte s’ouvrait, elle sursautait un peu. La pluie battait les vitres propres. A un moment, le médecin est arrivé. J’ai accompagné Marie-Louise dans les pas de la blouse blanche, qui ne se retournait jamais dans les coudes des couloirs, se contentant de nous tenir les portes et d’appuyer sur les interrupteurs. Il paraissait plutôt vieux et voûté, il traînait un peu des pieds. Dans la petite salle de consultation, il m’a demandé de déshabiller Marie-Louise et de la coucher sur le lit. Je lui ai demandé s’il fallait que j’enlève aussi ses couches. Il a jeté un œil, et m’a dit qu’on ferait avec, qu’elle pouvait les laisser. Comme Marie-Louise, toute nue sur sa grosse feuille de papier, ne voulait pas rester tranquille, j’ai dû lui tenir la main pendant que le scanner survolait lentement son corps et que le docteur regardait l’image apparaître sur son écran, une strate horizontale après l’autre. Ça m’a fait penser à l’époque des premières connections Internet. Le survol a duré une vingtaine de minutes. Je crois que Marie-Louise s’est même endormie un moment, pendant que je lui tenais la main. Ensuite je l’ai rhabillée, et nous sommes revenus ensemble dans la salle d’attente, où un autre médecin nous attendait avec les résultats. Il a dit à Marie-Louise – en sachant que c’était moi qui écoutais, moi qui me souviendrais du rapport – qu’elle n’avait pas d’ostéoporose, ce qui était une bonne chose, mais qu’elle devait à présent faire attention à son équilibre, parce que ses chutes à répétition et les fractures qui en découlaient allaient la clouer définitivement dans un fauteuil roulant. Marie-Louise ne regardait pas le médecin mais posait sur moi ses yeux insolubles de coucou. Marie-Louise a presque nonante ans. Sur la feuille administrative que je dois tendre aux médecins lorsque je l’accompagne, comme aujourd’hui, pour une consultation hors de la Fondation, il est inscrit : « Diagnostic général : classe 12 ». Je ne sais pas ce que ça signifie, cher Jean-Louis, je ne connais pas les subtilités ni les catégories de cette échelle de la santé physique et mentale, mais je sais que la plupart des résidents que je côtoie se situent autour des classes 7 ou 8. L’Alzheimer de Marie-Louise est à un stade difficilement imaginable.
Il a dit à Marie-Louise – en sachant que c’était moi qui écoutais, moi qui me souviendrais du rapport – qu’elle n’avait pas d’ostéoporose, ce qui était une bonne chose, mais qu’elle devait à présent faire attention à son équilibre, parce que ses chutes à répétition et les fractures qui en découlaient allaient la clouer définitivement dans un fauteuil roulant. Marie-Louise ne regardait pas le médecin mais posait sur moi ses yeux insolubles de coucou. Marie-Louise a presque nonante ans. Sur la feuille administrative que je dois tendre aux médecins lorsque je l’accompagne, comme aujourd’hui, pour une consultation hors de la Fondation, il est inscrit : « Diagnostic général : classe 12 ». Je ne sais pas ce que ça signifie, cher Jean-Louis, je ne connais pas les subtilités ni les catégories de cette échelle de la santé physique et mentale, mais je sais que la plupart des résidents que je côtoie se situent autour des classes 7 ou 8. L’Alzheimer de Marie-Louise est à un stade difficilement imaginable. Ici, je suis affecté à l’animation. Concrètement, sur le papier du moins, ça implique de servir des repas, des cafés, d’accompagner des résidents sur le lieu de leurs activités ou rendez-vous, de leur apporter un peu de compagnie, de leur proposer des activités personnelles ou collectives. Il y a le choix: poterie, aquarelle, tricot, cuisine, jeux de cartes ou de société (Scrabble, Hâte-toi lentement), lecture du journal (20 Minutes et « La Feuille »), concerts, offices religieux, promenades… Un civiliste qui terminait au moment où je suis arrivé, en décembre, m’a montré le résultat d’une petite enquête menée dans un autre EMS, il y a quelques années, au sujet des préoccupations principales des résidents. Les services que l’« animation » propose arrivaient loin derrière les besoins de base, sacrés, révérés : manger et dormir. Pourtant, chaque jour passé ici m’a fait comprendre à quel point ce que je fais est essentiel.
Ici, je suis affecté à l’animation. Concrètement, sur le papier du moins, ça implique de servir des repas, des cafés, d’accompagner des résidents sur le lieu de leurs activités ou rendez-vous, de leur apporter un peu de compagnie, de leur proposer des activités personnelles ou collectives. Il y a le choix: poterie, aquarelle, tricot, cuisine, jeux de cartes ou de société (Scrabble, Hâte-toi lentement), lecture du journal (20 Minutes et « La Feuille »), concerts, offices religieux, promenades… Un civiliste qui terminait au moment où je suis arrivé, en décembre, m’a montré le résultat d’une petite enquête menée dans un autre EMS, il y a quelques années, au sujet des préoccupations principales des résidents. Les services que l’« animation » propose arrivaient loin derrière les besoins de base, sacrés, révérés : manger et dormir. Pourtant, chaque jour passé ici m’a fait comprendre à quel point ce que je fais est essentiel. Le jour de la Saint-Valentin, je suis allé à la morgue. L’hiver avait emporté le quart de mon étage. Quatre décès en deux semaines. Lucette était morte la veille, après sa dernière fondue. C’est l’animatrice qui m’a proposé de descendre. Une fois dans la pièce froide, en béton nu, une fois devant le lit, seul dans la pièce au sous-sol de la Fondation, une fois à côté de ce corps nu tout juste recouvert d’un drap très fin tiré jusqu’au thorax, du coton dans les yeux et les oreilles, le menton soutenu par une armature en fil de fer, j’ai réalisé que c’était le premier mort que je voyais de ma vie. Il ne ressemblait pas du tout à Lucette. Il ne ressemblait pas du tout à quelque chose de vivant. J’ai pu rester une minute ou une heure, je ne sais pas.
Le jour de la Saint-Valentin, je suis allé à la morgue. L’hiver avait emporté le quart de mon étage. Quatre décès en deux semaines. Lucette était morte la veille, après sa dernière fondue. C’est l’animatrice qui m’a proposé de descendre. Une fois dans la pièce froide, en béton nu, une fois devant le lit, seul dans la pièce au sous-sol de la Fondation, une fois à côté de ce corps nu tout juste recouvert d’un drap très fin tiré jusqu’au thorax, du coton dans les yeux et les oreilles, le menton soutenu par une armature en fil de fer, j’ai réalisé que c’était le premier mort que je voyais de ma vie. Il ne ressemblait pas du tout à Lucette. Il ne ressemblait pas du tout à quelque chose de vivant. J’ai pu rester une minute ou une heure, je ne sais pas. 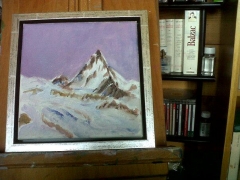 J’aurais voulu te raconter les dernières nouvelles et les derniers ragots du royaume éphémère des lettres d’ici et d’ailleurs. Tu aurais souri de bienveillance, ou tu m’aurais traité de petit con inculte, peut-être, avant de renchérir sur l’avancée de tes Cervins, de tes livres qui poussent aux quatre vents, de tes découvertes récentes, tes déceptions, tes coups de blues ou tes âges d’or. Tu aurais houspillé « ceux qui freinent à la montée », raillé « celui qui retire l’échelle derrière lui » et dénoncé « celle qui est atteinte de jeunisme ». On aurait pu débattre de tout ça. Puis, finalement, tu vois, je crois que je t’ai parlé de ce qui a vraiment compté pour moi depuis ma dernière lettre. Je ne m’étends pas tellement autour de moi à ce sujet, d’ailleurs, à part sous forme de debriefing naturel, avec Camille. Et ça me fait pourtant très plaisir de te l’écrire, ça me paraît d’une évidence imparable. Il y a une année jours pour jours, aujourd’hui, je tournais le dos à l’Afrique et à deux potes magnétisés pour rentrer au bercail. J’avais la mort dans l’âme. On est des pommes, je te le dis, quand il s’agit de se projeter dans le temps, en avant ou en arrière. Il y a des choses qu’il ne faut pas perdre de vue. Pour le reste, on a le temps, et le présent…
J’aurais voulu te raconter les dernières nouvelles et les derniers ragots du royaume éphémère des lettres d’ici et d’ailleurs. Tu aurais souri de bienveillance, ou tu m’aurais traité de petit con inculte, peut-être, avant de renchérir sur l’avancée de tes Cervins, de tes livres qui poussent aux quatre vents, de tes découvertes récentes, tes déceptions, tes coups de blues ou tes âges d’or. Tu aurais houspillé « ceux qui freinent à la montée », raillé « celui qui retire l’échelle derrière lui » et dénoncé « celle qui est atteinte de jeunisme ». On aurait pu débattre de tout ça. Puis, finalement, tu vois, je crois que je t’ai parlé de ce qui a vraiment compté pour moi depuis ma dernière lettre. Je ne m’étends pas tellement autour de moi à ce sujet, d’ailleurs, à part sous forme de debriefing naturel, avec Camille. Et ça me fait pourtant très plaisir de te l’écrire, ça me paraît d’une évidence imparable. Il y a une année jours pour jours, aujourd’hui, je tournais le dos à l’Afrique et à deux potes magnétisés pour rentrer au bercail. J’avais la mort dans l’âme. On est des pommes, je te le dis, quand il s’agit de se projeter dans le temps, en avant ou en arrière. Il y a des choses qu’il ne faut pas perdre de vue. Pour le reste, on a le temps, et le présent…

 Le temps : je t’ai laissé sans nouvelles depuis trois mois. Et ces cinq seuls petits jours passés ici, à Schwarzenburg, me semblent déjà mille fois moins supportables, et mille fois plus longs ! J’ai avec moi un vieil ordinateur qui ne veut plus tellement être transporté, quelques habits inadaptés, des films de zombies et le gros machin de Dicker. Toi, tu connais bien la valeur du temps : le sablier majestueux de ton balcon à phalènes, face à la France ; les ellipses fulgurantes de tes lectures partagées diffusées dans toutes les directions de la blogosphère ; la dilatation des nuits faibles et les sursauts de nos sommeils paradoxaux, tout ça, tu le connais. Moi je ne savais pas. Que le temps pouvait être lent à ce point. Frustrant. Insupportable. Dicker ? Peut-être que je devrais tenter d’y entrer maintenant, dans son roman dont tout le monde parle depuis quelques semaines, peut-être que je devrais m’y plonger, m’y glisser comme dans une chaussette propre et me laisser porter par le temps de Dicker, celui de l’Amérique, de la narration, pour oublier celui qui m’oppresse ici ? Peut-être que c’est le bon moment ? Je pourrais alors te raconter, au jour le jour, mes impressions de lectures. Confronter mes notes aux tiennes. Mais va savoir pourquoi, j’hésite. A la place, je t’écris, à toi.
Le temps : je t’ai laissé sans nouvelles depuis trois mois. Et ces cinq seuls petits jours passés ici, à Schwarzenburg, me semblent déjà mille fois moins supportables, et mille fois plus longs ! J’ai avec moi un vieil ordinateur qui ne veut plus tellement être transporté, quelques habits inadaptés, des films de zombies et le gros machin de Dicker. Toi, tu connais bien la valeur du temps : le sablier majestueux de ton balcon à phalènes, face à la France ; les ellipses fulgurantes de tes lectures partagées diffusées dans toutes les directions de la blogosphère ; la dilatation des nuits faibles et les sursauts de nos sommeils paradoxaux, tout ça, tu le connais. Moi je ne savais pas. Que le temps pouvait être lent à ce point. Frustrant. Insupportable. Dicker ? Peut-être que je devrais tenter d’y entrer maintenant, dans son roman dont tout le monde parle depuis quelques semaines, peut-être que je devrais m’y plonger, m’y glisser comme dans une chaussette propre et me laisser porter par le temps de Dicker, celui de l’Amérique, de la narration, pour oublier celui qui m’oppresse ici ? Peut-être que c’est le bon moment ? Je pourrais alors te raconter, au jour le jour, mes impressions de lectures. Confronter mes notes aux tiennes. Mais va savoir pourquoi, j’hésite. A la place, je t’écris, à toi. Dicker : on en a beaucoup parlé à Aoste le week-end passé. Un éditeur des Préalpes fribourgeoises a fait miroiter son nom (un peu obscène) devant la petite dizaine de lauréats réunis de l’autre côté du tunnel du mont Blanc le temps d’une cérémonie : celle du PIJA (Prix Interrégional Jeunes Auteurs, créé par les Editions de l’Hèbe), dont je m’occupe depuis quelques années. On y a érigé son livre en modèle éditorial, économique, on a fait du parcours de Dicker la panacée de l’écrivain « romand », celui qui brise le signe indien, qui fait mieux que quiconque avant lui. Celui qui inaugure l’ère – mais y en aura-t-il d’autres pour qu’on puisse parler de phénomène ? – des écrivains « de chez nous » qui créent le buzz à Paris. Et bientôt dans le monde. Hollywood n’est pas loin. J’ai compris ta leçon : je n’en parlerai pas avant de l’avoir lu, ce livre. Mais j’aime bien l’enthousiasme qu’il suscite chez les jeunes et les académiciens, hors des discours habituels. Bon, c’était un peu mauvais ton de dénigrer Frochaux publiquement comme l’a fait Dicker, mais c’est sûr que pour lui, revendiquer la figure de feu Dimitri, qu’il confesse avoir vu « une fois avant la sortie du bouquin », c’est plus costaud, niveau légende et légitimité. J’ai un ami libraire un peu cynique qui a une théorie : il prétend que « les gens qui ne lisent pas » forment une catégorie exigeante, et que cette catégorie attend, tous les deux ou trois ans, qu’on leur désigne un bon gros livre qu’ils pourront « lire » sans avoir à choisir dans la production, ou qu’ils pourront acheter et poser dans leur bibliothèque (majorité de Folio et de hardcovers traduits), ou qu’ils pourront éventuellement offrir, parce qu’on leur aura bien expliqué qu’il s’agit du bon objet, chiffres et critiques se combinant à merveille. Dicker, ce serait ce livre. Right time, right place. On en pensera ce qu’on voudra… Moi je ne retiens que ce qui m’arrange : on découvre soudainement, les bras ballants, qu’on écrit bien (ou plutôt, dans ce cas, qu’on raconte bien des histoires) quand on a 26 ans et qu’on habite (tout juste) en Suisse romande.
Dicker : on en a beaucoup parlé à Aoste le week-end passé. Un éditeur des Préalpes fribourgeoises a fait miroiter son nom (un peu obscène) devant la petite dizaine de lauréats réunis de l’autre côté du tunnel du mont Blanc le temps d’une cérémonie : celle du PIJA (Prix Interrégional Jeunes Auteurs, créé par les Editions de l’Hèbe), dont je m’occupe depuis quelques années. On y a érigé son livre en modèle éditorial, économique, on a fait du parcours de Dicker la panacée de l’écrivain « romand », celui qui brise le signe indien, qui fait mieux que quiconque avant lui. Celui qui inaugure l’ère – mais y en aura-t-il d’autres pour qu’on puisse parler de phénomène ? – des écrivains « de chez nous » qui créent le buzz à Paris. Et bientôt dans le monde. Hollywood n’est pas loin. J’ai compris ta leçon : je n’en parlerai pas avant de l’avoir lu, ce livre. Mais j’aime bien l’enthousiasme qu’il suscite chez les jeunes et les académiciens, hors des discours habituels. Bon, c’était un peu mauvais ton de dénigrer Frochaux publiquement comme l’a fait Dicker, mais c’est sûr que pour lui, revendiquer la figure de feu Dimitri, qu’il confesse avoir vu « une fois avant la sortie du bouquin », c’est plus costaud, niveau légende et légitimité. J’ai un ami libraire un peu cynique qui a une théorie : il prétend que « les gens qui ne lisent pas » forment une catégorie exigeante, et que cette catégorie attend, tous les deux ou trois ans, qu’on leur désigne un bon gros livre qu’ils pourront « lire » sans avoir à choisir dans la production, ou qu’ils pourront acheter et poser dans leur bibliothèque (majorité de Folio et de hardcovers traduits), ou qu’ils pourront éventuellement offrir, parce qu’on leur aura bien expliqué qu’il s’agit du bon objet, chiffres et critiques se combinant à merveille. Dicker, ce serait ce livre. Right time, right place. On en pensera ce qu’on voudra… Moi je ne retiens que ce qui m’arrange : on découvre soudainement, les bras ballants, qu’on écrit bien (ou plutôt, dans ce cas, qu’on raconte bien des histoires) quand on a 26 ans et qu’on habite (tout juste) en Suisse romande. Laisse-moi te dire deux mots d’Aoste, encore, si tu veux bien. Ce Prix jeunes auteurs a le génie de proposer un week-end complet à ses lauréats (en plus de récompenses en espèce). Il sait susciter les rencontres, les contacts, les découvertes. L’AJAR, pour bonne partie, n’est pas née d’autre chose. Il y avait cette année des Français, des Belges, des Suisses, une Lettone, une Argentine, des Valdôtains. Le ciel bleu et dégagé laissait passer des nuages rapides au-dessus des petits villages enrochés. Pendant quatre jours, on a causé, écrit, mangé du saucisson, bu du Petit rouge et de l’Arvine locale, visité d’étonnants châteaux transformés en musées d’art moderne, des charcuteries familiales, des caves immenses, des coopératives, des sculpteurs sur bois peint, des cafés-librairies, on a flâné dans les ruines nettoyées par la Restitution ou logées sous les montagnes ou posées en plein cœur des villes, on a parcouru de long en large ce drôle de Valais parallèle, un peu plus sauvage, un peu moins bétonné, un peu plus sinueux que le nôtre. Le premier prix de cette année (un Valaisan justement), répondant au nom un peu ramuzien de Lucien Zuchuat, nous a bluffés. Son texte, pour commencer : La Jeune fille et les néons est une pièce de théâtre claire obscure, dure et poétique, un conte noir sur la jeunesse urbaine, la fin de l’innocence, la perversion sourde des rapports humains, l’angoisse des adultes. Une œuvre intense qui possède des vraies qualités, un style sûre, une histoire. Et qui se joue bien. En plus, Lucien a une gueule d’ange. Il paraît qu’à l’autre bout du lac c’est un argument béton pour vendre un quart de million d’exemplaires en trois semaines. Je ne crois pas trop m’avancer en te disant que Lucien Zuchuat, tout comme d’autres jeunes auteurs de la volée du PIJA 2012, possède ce qu’il faut pour se faire une place. They’ve got what it takes, comme on dit dans les bons rom-coms américains. L’éditeur a d’ailleurs répété tout le week-end, à qui voulait l’entendre, que Dicker lui aussi est « issu » du PIJA : promotion 2005, eh oui. Tu devrais essayer de mettre la main sur son « Tigre » d’alors, la nouvelle sibérienne qui avait charmé Anne-Lise Grobéty et ses compères du jury final (au point que des suspicions de plagiat avaient flotté sur le texte pendant une partie des délibérations…) Je ne sais pas si Joël s’en souvient. En tout cas, à lire son site web, ce texte et ce prix marquent le vrai début de la carrière du juriste prodige. Sera-t-il le chef de file de cette relève que tu as décrite en partie dans ton dernier Passe-Muraille, et qu’au regard de « l’histoire » tu as malheureusement sorti six mois trop tôt ? Cette relève qui possède un point commun troublant : ce fameux PIJA. Fais le compte : Burri, Fournier, Rychner, Flükiger, Urech, Dicker, et la moitié de l’AJAR… On écrira peut-être cette histoire un jour. Bon, il y a aussi des anomalies : Quentin a essayé mais s’est fait recaler. Comme quoi…
Laisse-moi te dire deux mots d’Aoste, encore, si tu veux bien. Ce Prix jeunes auteurs a le génie de proposer un week-end complet à ses lauréats (en plus de récompenses en espèce). Il sait susciter les rencontres, les contacts, les découvertes. L’AJAR, pour bonne partie, n’est pas née d’autre chose. Il y avait cette année des Français, des Belges, des Suisses, une Lettone, une Argentine, des Valdôtains. Le ciel bleu et dégagé laissait passer des nuages rapides au-dessus des petits villages enrochés. Pendant quatre jours, on a causé, écrit, mangé du saucisson, bu du Petit rouge et de l’Arvine locale, visité d’étonnants châteaux transformés en musées d’art moderne, des charcuteries familiales, des caves immenses, des coopératives, des sculpteurs sur bois peint, des cafés-librairies, on a flâné dans les ruines nettoyées par la Restitution ou logées sous les montagnes ou posées en plein cœur des villes, on a parcouru de long en large ce drôle de Valais parallèle, un peu plus sauvage, un peu moins bétonné, un peu plus sinueux que le nôtre. Le premier prix de cette année (un Valaisan justement), répondant au nom un peu ramuzien de Lucien Zuchuat, nous a bluffés. Son texte, pour commencer : La Jeune fille et les néons est une pièce de théâtre claire obscure, dure et poétique, un conte noir sur la jeunesse urbaine, la fin de l’innocence, la perversion sourde des rapports humains, l’angoisse des adultes. Une œuvre intense qui possède des vraies qualités, un style sûre, une histoire. Et qui se joue bien. En plus, Lucien a une gueule d’ange. Il paraît qu’à l’autre bout du lac c’est un argument béton pour vendre un quart de million d’exemplaires en trois semaines. Je ne crois pas trop m’avancer en te disant que Lucien Zuchuat, tout comme d’autres jeunes auteurs de la volée du PIJA 2012, possède ce qu’il faut pour se faire une place. They’ve got what it takes, comme on dit dans les bons rom-coms américains. L’éditeur a d’ailleurs répété tout le week-end, à qui voulait l’entendre, que Dicker lui aussi est « issu » du PIJA : promotion 2005, eh oui. Tu devrais essayer de mettre la main sur son « Tigre » d’alors, la nouvelle sibérienne qui avait charmé Anne-Lise Grobéty et ses compères du jury final (au point que des suspicions de plagiat avaient flotté sur le texte pendant une partie des délibérations…) Je ne sais pas si Joël s’en souvient. En tout cas, à lire son site web, ce texte et ce prix marquent le vrai début de la carrière du juriste prodige. Sera-t-il le chef de file de cette relève que tu as décrite en partie dans ton dernier Passe-Muraille, et qu’au regard de « l’histoire » tu as malheureusement sorti six mois trop tôt ? Cette relève qui possède un point commun troublant : ce fameux PIJA. Fais le compte : Burri, Fournier, Rychner, Flükiger, Urech, Dicker, et la moitié de l’AJAR… On écrira peut-être cette histoire un jour. Bon, il y a aussi des anomalies : Quentin a essayé mais s’est fait recaler. Comme quoi… Je repense à ce week-end radieux et puis je me souviens que je suis coincé à Berne. Pour le moment il faut se dépêtrer de ce « Bourg noir » qui m’enferme. Trois Suisses allemands regardent Zurich et Lucerne jouer au foot sous la neige. Des animateurs boivent des Heineken sous les lampes de papier de la salle commune. La serveuse du bar-café, anneau argenté au frein de la gencive, discute avec un vieux aux cheveux jaunes. Elle fait sottement bander la moitié des mecs de la salle ; pauvre de nous, mâles en mal de gonzesses, gamins gonflés à la testostérone après quatre jours de promiscuité. C’est jeudi soir, quartier libre, et les Romands sont au village « pour se soûler la gueule ». Je le savais déjà avant de venir : je ne suis pas fait pour ce genre de groupes. Ceux de garçons, en particulier. J’ai évité l’armée comme je l’ai pu, choisi de « servir » la communauté et même la culture pour des pives et un brin de reconnaissance (tu connais l’histoire de Cingria et mes impressions de civiliste à ce sujet), mais je n’ai en revanche jamais choisi de me retrouver emmuré ici, dans ce soft-goulag à la bernoise où je passe mes journées à écouter les inepties d’un « animateur » amateur et peu inspiré, sorte d’Antoine Jaccoud argentin (je dis ça pour le côté déprimé et le frottement incessant de ses yeux par dessous les lunettes, pas du tout pour les compétences de Jaccoud, qui doit d’ailleurs frémir de plaisir du succès de Siter aux USA ; en dehors de ça, aussi fou que ça puisse paraître, notre animateur a, je te jure, l’accent de Popescu ! Si seulement il avait un quart de son bagou), ce « coach » donc, est plus ou moins qualifié dans les relations internationales mais terriblement stérile dans son rôle d’instructeur. Javier (c’est son nom) fait de ce module de « Résolutions des conflits sans violence » une séance de thérapie de groupe obscène et ridicule pour laquelle je dois me faire, précisément, violence. Sous peine de craquer et de m’enfuir à poil dans la neige, hurler dans les bois givrés ma haine de ce sinistre hinterland. Le paternalisme national et les velléités démagogiques de ce cours fédéral me dépriment : j’aurais envie de signifier mon désaccord, mettre à jour les lourdeurs de ce programme (« tout se vaut », « tout dépend de tout », « rien n’est faux » dans la république des mous instaurée par Javier le tolérant), couper les ficelles faciles de ce petit projet nauséeux. Pire que tout, cette sinistre Ecole des fans s’est terminée par une pièce de théâtre affolante dans laquelle des comédiens ont voulu nous apprendre, merci grande Helvetia, à nous comporter adéquatement non seulement dans nos futurs établissements d’affectation (ce qui est compréhensible), mais aussi… dans nos couples, dans notre vie privée, dans nos ménages ! Une éducation collective à la sauce douce confédérale ! Et la gentille horde des civilistes dociles, pourtant censés être de convaincus antimilitaristes, plutôt instruits et logiquement volontaires, d’applaudir comme des ahuris cette mascarade de propagande proprette. Un comportement neutralisé dans un pays flasque. On croit rêver. La prison sans murs dont tu m’as souvent parlé a gagné un nouveau barreau de guimauve décoratif. Sa mission : l’éducation morale d’un « honnête suisse » béatement bienveillant.
Je repense à ce week-end radieux et puis je me souviens que je suis coincé à Berne. Pour le moment il faut se dépêtrer de ce « Bourg noir » qui m’enferme. Trois Suisses allemands regardent Zurich et Lucerne jouer au foot sous la neige. Des animateurs boivent des Heineken sous les lampes de papier de la salle commune. La serveuse du bar-café, anneau argenté au frein de la gencive, discute avec un vieux aux cheveux jaunes. Elle fait sottement bander la moitié des mecs de la salle ; pauvre de nous, mâles en mal de gonzesses, gamins gonflés à la testostérone après quatre jours de promiscuité. C’est jeudi soir, quartier libre, et les Romands sont au village « pour se soûler la gueule ». Je le savais déjà avant de venir : je ne suis pas fait pour ce genre de groupes. Ceux de garçons, en particulier. J’ai évité l’armée comme je l’ai pu, choisi de « servir » la communauté et même la culture pour des pives et un brin de reconnaissance (tu connais l’histoire de Cingria et mes impressions de civiliste à ce sujet), mais je n’ai en revanche jamais choisi de me retrouver emmuré ici, dans ce soft-goulag à la bernoise où je passe mes journées à écouter les inepties d’un « animateur » amateur et peu inspiré, sorte d’Antoine Jaccoud argentin (je dis ça pour le côté déprimé et le frottement incessant de ses yeux par dessous les lunettes, pas du tout pour les compétences de Jaccoud, qui doit d’ailleurs frémir de plaisir du succès de Siter aux USA ; en dehors de ça, aussi fou que ça puisse paraître, notre animateur a, je te jure, l’accent de Popescu ! Si seulement il avait un quart de son bagou), ce « coach » donc, est plus ou moins qualifié dans les relations internationales mais terriblement stérile dans son rôle d’instructeur. Javier (c’est son nom) fait de ce module de « Résolutions des conflits sans violence » une séance de thérapie de groupe obscène et ridicule pour laquelle je dois me faire, précisément, violence. Sous peine de craquer et de m’enfuir à poil dans la neige, hurler dans les bois givrés ma haine de ce sinistre hinterland. Le paternalisme national et les velléités démagogiques de ce cours fédéral me dépriment : j’aurais envie de signifier mon désaccord, mettre à jour les lourdeurs de ce programme (« tout se vaut », « tout dépend de tout », « rien n’est faux » dans la république des mous instaurée par Javier le tolérant), couper les ficelles faciles de ce petit projet nauséeux. Pire que tout, cette sinistre Ecole des fans s’est terminée par une pièce de théâtre affolante dans laquelle des comédiens ont voulu nous apprendre, merci grande Helvetia, à nous comporter adéquatement non seulement dans nos futurs établissements d’affectation (ce qui est compréhensible), mais aussi… dans nos couples, dans notre vie privée, dans nos ménages ! Une éducation collective à la sauce douce confédérale ! Et la gentille horde des civilistes dociles, pourtant censés être de convaincus antimilitaristes, plutôt instruits et logiquement volontaires, d’applaudir comme des ahuris cette mascarade de propagande proprette. Un comportement neutralisé dans un pays flasque. On croit rêver. La prison sans murs dont tu m’as souvent parlé a gagné un nouveau barreau de guimauve décoratif. Sa mission : l’éducation morale d’un « honnête suisse » béatement bienveillant. Cette nuit il a neigé sur tout l’Oberland, pour de bon. Les alentours en sont allégés, l’atmosphère plus supportable. Le huis clos s’éternise. Je ronge toujours mon frein, oscillant entre amusement détaché, cynisme placide et dévissages intérieurs. Je me dis que c’est comme ça qu’on formate des esprits : non pas pour la guerre ou la survie ou la dureté ou une quelconque idéologie totalitaire, comme de l’autre côté, mais (est-ce pire ?) pour la petite citoyenneté bien pensante, fière, dénuée de tous préjugés et équipée d’outils psychologiques faits de bric et de broc peints à la sauce fédérale. Une bombe de conneries à retardement. Tu devrais nous voir jouer aux apprentis « médiateurs », reproduisant nos schémas simplifiés, nous érigeant doctement contre les violences qui nous entourent. Le retour de manivelle sera terrible. Toi qui prévois un grand livre sur la Suisse, toi qui l’ausculte sous toutes ses coutures, ses filigranes et ses faux-fils, ne rate pas ce chapitre encore trop méconnu (ces centres d’instruction pour civilistes sont tout nouveaux) : certes, le Service civil est une alternative intelligente à l’obligation militaire (ce n’est pas moi qui dirai le contraire), mais cette semaine de cours préalable est une énormité qu’il ne faut pas laisser passer.
Cette nuit il a neigé sur tout l’Oberland, pour de bon. Les alentours en sont allégés, l’atmosphère plus supportable. Le huis clos s’éternise. Je ronge toujours mon frein, oscillant entre amusement détaché, cynisme placide et dévissages intérieurs. Je me dis que c’est comme ça qu’on formate des esprits : non pas pour la guerre ou la survie ou la dureté ou une quelconque idéologie totalitaire, comme de l’autre côté, mais (est-ce pire ?) pour la petite citoyenneté bien pensante, fière, dénuée de tous préjugés et équipée d’outils psychologiques faits de bric et de broc peints à la sauce fédérale. Une bombe de conneries à retardement. Tu devrais nous voir jouer aux apprentis « médiateurs », reproduisant nos schémas simplifiés, nous érigeant doctement contre les violences qui nous entourent. Le retour de manivelle sera terrible. Toi qui prévois un grand livre sur la Suisse, toi qui l’ausculte sous toutes ses coutures, ses filigranes et ses faux-fils, ne rate pas ce chapitre encore trop méconnu (ces centres d’instruction pour civilistes sont tout nouveaux) : certes, le Service civil est une alternative intelligente à l’obligation militaire (ce n’est pas moi qui dirai le contraire), mais cette semaine de cours préalable est une énormité qu’il ne faut pas laisser passer. Peut-être parce que je viens de jeter un œil sur les derniers articles de Matthieu sur son blog, sa traversée de l’Atlantique en cargo et son arrivée à New York, ses errements dans la Grosse Pomme hipster, ses photos merveilleuses ; autant de choses qui me rappellent que je pourrais y être, moi aussi, de l’autre côté du miroir atlantique. J’aurais dû poursuivre sur ma lancée. Je t’ai parlé un peu du Pays basque, déjà, en sa compagnie. De nos expériences de couch surfing épatantes dans les Bardenas Reales, à San Sebastian, à Saint-Jean-de-Luz. Il y a des amitiés qui comptent, et qui se décident sur quelques coups de dés. Tu sais ça.
Peut-être parce que je viens de jeter un œil sur les derniers articles de Matthieu sur son blog, sa traversée de l’Atlantique en cargo et son arrivée à New York, ses errements dans la Grosse Pomme hipster, ses photos merveilleuses ; autant de choses qui me rappellent que je pourrais y être, moi aussi, de l’autre côté du miroir atlantique. J’aurais dû poursuivre sur ma lancée. Je t’ai parlé un peu du Pays basque, déjà, en sa compagnie. De nos expériences de couch surfing épatantes dans les Bardenas Reales, à San Sebastian, à Saint-Jean-de-Luz. Il y a des amitiés qui comptent, et qui se décident sur quelques coups de dés. Tu sais ça. Et puis voilà l’avenir : lundi je découvre mon EMS, à Lausanne. Mon nouveau quotidien pour six mois. Des habitudes à prendre. J’appréhende et je me réjouis. Il y aura de la sagesse, du désespoir, de la vie, de la mort, des lentes gestations de mots. De l’inspiration, qui sait ? Peut-être quelques rencontres déterminantes. C’est de cela qu’on tire les pages des meilleurs livres, non ? De ça et de la déflagration du monde. Et puis, dans moins de deux mois, mon bouquin sur Franck Jotterand débarquera, accompagné d’un exemplaire tout neuf de la Nouvelle Gazette littéraire ! L’éditeur (le même que celui du PIJA) a accompli un boulot impensable ! J’ai hâte que tu puisses voir le résultat. Il y a quelque chose qui se passe dans l’espace, dans le temps, je le sens autour de moi, et toi aussi, c’est sûr ; cette nouvelle gazette a d’ailleurs un avenir qui se dessine devant elle, au-delà de ce simple numéro. Un recommencement, quarante ans plus tard. La littérature en Suisse romande connaît une mue de plus, l’insecte se développe, des ailes se décollent. On s’en fout qu’il soit indigène ou endémique. L’essentiel étant de connaître de quoi il est fait et d’anticiper ses pontes et ses cycles de développement. Ne pas commettre l’erreur du Temps, celle de ses gentils rédacteurs un peu oublieux ou simplement myopes (j’exclus l’ignorance) : comme si la « littérature romande » n’avait jamais vécu de période d’exaltation ! Tu liras à ce sujet le très bon article de Maggetti dans la Gazette à venir. Et puis aussi les mots de Franck Jotterand lui-même, qui résonnent aujourd’hui singulièrement. On en reparle en janvier.
Et puis voilà l’avenir : lundi je découvre mon EMS, à Lausanne. Mon nouveau quotidien pour six mois. Des habitudes à prendre. J’appréhende et je me réjouis. Il y aura de la sagesse, du désespoir, de la vie, de la mort, des lentes gestations de mots. De l’inspiration, qui sait ? Peut-être quelques rencontres déterminantes. C’est de cela qu’on tire les pages des meilleurs livres, non ? De ça et de la déflagration du monde. Et puis, dans moins de deux mois, mon bouquin sur Franck Jotterand débarquera, accompagné d’un exemplaire tout neuf de la Nouvelle Gazette littéraire ! L’éditeur (le même que celui du PIJA) a accompli un boulot impensable ! J’ai hâte que tu puisses voir le résultat. Il y a quelque chose qui se passe dans l’espace, dans le temps, je le sens autour de moi, et toi aussi, c’est sûr ; cette nouvelle gazette a d’ailleurs un avenir qui se dessine devant elle, au-delà de ce simple numéro. Un recommencement, quarante ans plus tard. La littérature en Suisse romande connaît une mue de plus, l’insecte se développe, des ailes se décollent. On s’en fout qu’il soit indigène ou endémique. L’essentiel étant de connaître de quoi il est fait et d’anticiper ses pontes et ses cycles de développement. Ne pas commettre l’erreur du Temps, celle de ses gentils rédacteurs un peu oublieux ou simplement myopes (j’exclus l’ignorance) : comme si la « littérature romande » n’avait jamais vécu de période d’exaltation ! Tu liras à ce sujet le très bon article de Maggetti dans la Gazette à venir. Et puis aussi les mots de Franck Jotterand lui-même, qui résonnent aujourd’hui singulièrement. On en reparle en janvier. J’ai Léman noir sur les genoux, ça me fait plaisir de me retrouver là-dedans à tes côtés, avec Noémi, Chauma, Meizoz, d’autres que je découvre. Ça part dans tous les sens, cette petite anthologie, mais l’âme romande se dilue à merveille dans les flaques de pétrole et de sang de « la Route » (c’est Ramuz qui appelait le lac comme ça, je crois) ! Salue-le bien pour moi, ce beau Léman béant que tu distilles tous les jours dans tes aquarelles. Rajoute-y un peu d’ombres et de lumières sous le passage leste des nuages. La nuit a du potentiel. Encore une pleine lune bernoise et puis je fais mon sac, bye bye Schwarzenburg (il doit y avoir quelque chose d’inconscient avec Schwarzenbach…), je me tire d’ici pour de bon. Je monterai te voir au passage.
J’ai Léman noir sur les genoux, ça me fait plaisir de me retrouver là-dedans à tes côtés, avec Noémi, Chauma, Meizoz, d’autres que je découvre. Ça part dans tous les sens, cette petite anthologie, mais l’âme romande se dilue à merveille dans les flaques de pétrole et de sang de « la Route » (c’est Ramuz qui appelait le lac comme ça, je crois) ! Salue-le bien pour moi, ce beau Léman béant que tu distilles tous les jours dans tes aquarelles. Rajoute-y un peu d’ombres et de lumières sous le passage leste des nuages. La nuit a du potentiel. Encore une pleine lune bernoise et puis je fais mon sac, bye bye Schwarzenburg (il doit y avoir quelque chose d’inconscient avec Schwarzenbach…), je me tire d’ici pour de bon. Je monterai te voir au passage. De JLK, dit le Papillon, à Daniel Vuataz, dit Le Kid.
De JLK, dit le Papillon, à Daniel Vuataz, dit Le Kid.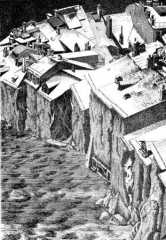 Pour en revenir à mon objection de conscience de teenager angélique, je ne sais plus trop comment elle s'est effritée et diluée dans le climat de contestation croissante de l'époque ? Peut-être pour de confuses raisons politiques - histoire de se frotter au peuple, n'est-ce pas, en tant que camarade responsable -, ou pour ne pas trop chahuter mon père, si peu militariste qu'il fût, ou par goût sportif de l'alpinisme, je ne sais plus, mais ce que je sais est que j'ai bien supporté nos quatre premiers mois d'exercice souvent imbécile mais en plein air, avec de solides Valaisans. J'y ai en outre rencontré un jeune écrivain bientôt devenu mon ami cher, et notre compagnie comptait pas mal de lascars hors norme, de tel grand voyageur intraitable à tel chef de cuisine de haute volée, en passant par un tringlot et sa mule qui m'ont pris en affection. Dans la foulée, bénéficiant de notre nouvelle tenue d'assaut à dix-huit poches, j'ai emporté les vingt volumes des Oeuvres complètes de Tchékhov dont j'ai lu tous les récits et les pièces par monts et vaux. Comme j'étais étudiant et plutôt ferré en haute montagne, notre capitaine n'a pas manqué de me désigner comme futur officier, mais là j'ai regimbé, je me suis cabré et j'ai mis les pieds aux murs: pas question de donner des ordres dans une armée à la botte du Grand Capital; l'année d'après je passai donc en tribunal et fus condamné pour l'exemple mais avec sursis et sans être jamais rappelé, conformément au flottement d'une époque où l'obligation de grader se délitait en même temps que progressait la cause des objecteurs. Cela étant, je ne regrette pas d'avoir fait, par la suite, toutes mes périodes obligatoires, n'était-ce que pour rencontrer des mecs parfois intéressants et pour lire au fil de pauses de plus en longues, proportionnées à la vacuité stupide d'exercices qui ne nous apprenaient rien. Un lieu commun veut que l'armée suisse de milice soit un lien social, et c'est assez vrai, mais c'est également une base d'observations assez consternantes sur le pecus moyen coupé des siens et de son travail, à ne rien foutre que siffler des demis et rouler les mécaniques le soir dans les bars, comme tu l'as décrit.
Pour en revenir à mon objection de conscience de teenager angélique, je ne sais plus trop comment elle s'est effritée et diluée dans le climat de contestation croissante de l'époque ? Peut-être pour de confuses raisons politiques - histoire de se frotter au peuple, n'est-ce pas, en tant que camarade responsable -, ou pour ne pas trop chahuter mon père, si peu militariste qu'il fût, ou par goût sportif de l'alpinisme, je ne sais plus, mais ce que je sais est que j'ai bien supporté nos quatre premiers mois d'exercice souvent imbécile mais en plein air, avec de solides Valaisans. J'y ai en outre rencontré un jeune écrivain bientôt devenu mon ami cher, et notre compagnie comptait pas mal de lascars hors norme, de tel grand voyageur intraitable à tel chef de cuisine de haute volée, en passant par un tringlot et sa mule qui m'ont pris en affection. Dans la foulée, bénéficiant de notre nouvelle tenue d'assaut à dix-huit poches, j'ai emporté les vingt volumes des Oeuvres complètes de Tchékhov dont j'ai lu tous les récits et les pièces par monts et vaux. Comme j'étais étudiant et plutôt ferré en haute montagne, notre capitaine n'a pas manqué de me désigner comme futur officier, mais là j'ai regimbé, je me suis cabré et j'ai mis les pieds aux murs: pas question de donner des ordres dans une armée à la botte du Grand Capital; l'année d'après je passai donc en tribunal et fus condamné pour l'exemple mais avec sursis et sans être jamais rappelé, conformément au flottement d'une époque où l'obligation de grader se délitait en même temps que progressait la cause des objecteurs. Cela étant, je ne regrette pas d'avoir fait, par la suite, toutes mes périodes obligatoires, n'était-ce que pour rencontrer des mecs parfois intéressants et pour lire au fil de pauses de plus en longues, proportionnées à la vacuité stupide d'exercices qui ne nous apprenaient rien. Un lieu commun veut que l'armée suisse de milice soit un lien social, et c'est assez vrai, mais c'est également une base d'observations assez consternantes sur le pecus moyen coupé des siens et de son travail, à ne rien foutre que siffler des demis et rouler les mécaniques le soir dans les bars, comme tu l'as décrit. 
 Ou plutôt peinture, tiens, puisque tu évoques mes Cervin. Car voici qu'après les trois premiers, qui te reviendront comme promis, j'ai décidé d'en brosser cent, dont les premiers douze sont achevés. Cela peut sembler une lubie, mais j'y crois. Je me suis amusé à présenter la chose comme un concept à la mode; d'ailleurs c'est en visitant l'expo des autoportraits sérigraphiés d'Andy Warhol, il y a quelque temps à Sheffield, avec mon ami Bona Mangangu, que l'idée m'en est venue. Mais tu te doutes bien que dudit concept je me balance tout à fait: c'est mon seul plaisir de peinturlure que je vise, avec ce défi consistant à ne jamais se répéter sur le même motif cent fois revisité. Curieusement, je n'avais plus peinturé depuis des mois, mais le désir n'a cessé de me travailler, et tout à coup tout me vient tout seul comme si j'avais passé des nuits à l'exercice; et tout ce que j'ai vu de tous les Cervin, en août dernier à Zermatt et à chaque passage de la Haute-Route, mais aussi en regardant les monts de Savoie d'en face à toutes les saisons, et la Sainte Victoire tant qu'à faire, et tous les paysages et les visages de Turner et de l'Hodler de la toute fin genre abstraction lyrique américaine - tout ça me revient étrangement comme j'en rêvais à quatorze ans en me la jouant Utrillo dans le Vieux Quartier.
Ou plutôt peinture, tiens, puisque tu évoques mes Cervin. Car voici qu'après les trois premiers, qui te reviendront comme promis, j'ai décidé d'en brosser cent, dont les premiers douze sont achevés. Cela peut sembler une lubie, mais j'y crois. Je me suis amusé à présenter la chose comme un concept à la mode; d'ailleurs c'est en visitant l'expo des autoportraits sérigraphiés d'Andy Warhol, il y a quelque temps à Sheffield, avec mon ami Bona Mangangu, que l'idée m'en est venue. Mais tu te doutes bien que dudit concept je me balance tout à fait: c'est mon seul plaisir de peinturlure que je vise, avec ce défi consistant à ne jamais se répéter sur le même motif cent fois revisité. Curieusement, je n'avais plus peinturé depuis des mois, mais le désir n'a cessé de me travailler, et tout à coup tout me vient tout seul comme si j'avais passé des nuits à l'exercice; et tout ce que j'ai vu de tous les Cervin, en août dernier à Zermatt et à chaque passage de la Haute-Route, mais aussi en regardant les monts de Savoie d'en face à toutes les saisons, et la Sainte Victoire tant qu'à faire, et tous les paysages et les visages de Turner et de l'Hodler de la toute fin genre abstraction lyrique américaine - tout ça me revient étrangement comme j'en rêvais à quatorze ans en me la jouant Utrillo dans le Vieux Quartier.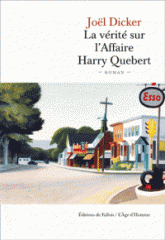 Quant à Joël Dicker, ben oui: t'as qu'à le lire. C'est un livre super, pour parler ton langage. C'est un roman merveilleusement allant et délié, dont j'ai dit tout le bien que j'en ai pensé aussitôt que Bernard de Fallois me l'eut envoyé, lu en deux jours et relu depuis lors dans sa dernière version légèrement améliorée. Ce que tu me dis de vos propos "autour" de ce livre m'étonne aussi peu que tout cequi a été dit "autour" des Bienveillantes de Jonathan Littell, il y a quelques années, par des gens qui en jugeaient d'autant plus vite qu'ils ne l'avaient lu. Je me rappelle trop d'imbécillités injustes et jalouses dans les commentaires de mon blog, où j'avais recopié la totalité de mes trente pages de notes. Au reste, je ne compare pas du tout le contenu ni la portée de ces deux livres, mais je sais que La vérité sur l'affaire Harry Dicker est bien plus qu'un polar de plus en cela que c'est un roman portant sur le processus de la création romanesque enté sur la vie et le temps, une approche du possiblement vrai et de l'éventuellement faux, un regard sur les mécanismes aliénants de la société en matière d'édition ou de publicité, une histoire d'amitié et une drôle d'histoire d'amour, une interrogation sur les multiples mobiles aboutissant à une possible culpabilité, et tout cela sans qu'on ait l'impression qu'aucune thèse soit assenée, tout ça pris dans le mouvement de la vie avec tout ce que, dans la narration de genre, cela peut avoir de "téléphoné". On pourrait dire, à cet égard, que L'Amour nègre de Jean-Michel Olivier, qui a précédé Dicker au top des ventes, et plus encore dans une certaine rupture du ronron romand, a aussi quelque chose de "téléphoné" dans sa dynamique narrative, mais son jeu sur les marques et les "pipoles" est tout à fait décapant et révélateur comme peu de romans français contemporains.
Quant à Joël Dicker, ben oui: t'as qu'à le lire. C'est un livre super, pour parler ton langage. C'est un roman merveilleusement allant et délié, dont j'ai dit tout le bien que j'en ai pensé aussitôt que Bernard de Fallois me l'eut envoyé, lu en deux jours et relu depuis lors dans sa dernière version légèrement améliorée. Ce que tu me dis de vos propos "autour" de ce livre m'étonne aussi peu que tout cequi a été dit "autour" des Bienveillantes de Jonathan Littell, il y a quelques années, par des gens qui en jugeaient d'autant plus vite qu'ils ne l'avaient lu. Je me rappelle trop d'imbécillités injustes et jalouses dans les commentaires de mon blog, où j'avais recopié la totalité de mes trente pages de notes. Au reste, je ne compare pas du tout le contenu ni la portée de ces deux livres, mais je sais que La vérité sur l'affaire Harry Dicker est bien plus qu'un polar de plus en cela que c'est un roman portant sur le processus de la création romanesque enté sur la vie et le temps, une approche du possiblement vrai et de l'éventuellement faux, un regard sur les mécanismes aliénants de la société en matière d'édition ou de publicité, une histoire d'amitié et une drôle d'histoire d'amour, une interrogation sur les multiples mobiles aboutissant à une possible culpabilité, et tout cela sans qu'on ait l'impression qu'aucune thèse soit assenée, tout ça pris dans le mouvement de la vie avec tout ce que, dans la narration de genre, cela peut avoir de "téléphoné". On pourrait dire, à cet égard, que L'Amour nègre de Jean-Michel Olivier, qui a précédé Dicker au top des ventes, et plus encore dans une certaine rupture du ronron romand, a aussi quelque chose de "téléphoné" dans sa dynamique narrative, mais son jeu sur les marques et les "pipoles" est tout à fait décapant et révélateur comme peu de romans français contemporains. 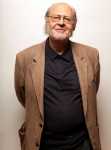 Le drame de Claude est de ne trouver belle et folle que notre jeunesse, dans les années 60, et de tirer ensuite l'échelle derrière lui, conclusion d'une extraordinaire réflexion personnelle menée dans L'Homme seul, grand livre fascinant d'un esprit déterministe qui a réduit le monde à une sorte de fantasmagorie logomachique, avec une foison de réflexions pertinentes et d'observations justes. Bref, nous reparlerons du roman de Dicker quand tu auras daigné y mettre le nez. Pour ma part je retourne aux Frères Karamazov, que je lis en alternance avec la composition de mes notes quotidienne à l'isba qui constitueront la matière d'un nouvelle très vaste chronique kaléidscopique courant de 2008, date de mes retrouvailles avec Dimitri, au début de 2013, incluant de grandes lectures (René Girard, Annie Dillard, Dostoïevski, Gustave Thibon, Georges Haldas retrouvé, notamment), pas mal de voyages (notamment en Tunisie avec ma bonne amie) et des rencontres, des morts (de Maître Jacques, de Chappaz, de Georges Haldas et de Dimitri) et la vie qui va et rebondit.
Le drame de Claude est de ne trouver belle et folle que notre jeunesse, dans les années 60, et de tirer ensuite l'échelle derrière lui, conclusion d'une extraordinaire réflexion personnelle menée dans L'Homme seul, grand livre fascinant d'un esprit déterministe qui a réduit le monde à une sorte de fantasmagorie logomachique, avec une foison de réflexions pertinentes et d'observations justes. Bref, nous reparlerons du roman de Dicker quand tu auras daigné y mettre le nez. Pour ma part je retourne aux Frères Karamazov, que je lis en alternance avec la composition de mes notes quotidienne à l'isba qui constitueront la matière d'un nouvelle très vaste chronique kaléidscopique courant de 2008, date de mes retrouvailles avec Dimitri, au début de 2013, incluant de grandes lectures (René Girard, Annie Dillard, Dostoïevski, Gustave Thibon, Georges Haldas retrouvé, notamment), pas mal de voyages (notamment en Tunisie avec ma bonne amie) et des rencontres, des morts (de Maître Jacques, de Chappaz, de Georges Haldas et de Dimitri) et la vie qui va et rebondit.
 Je ne t’ai pas écrit depuis tout ce temps. Ou, plus exactement, je t’ai écrit régulièrement, mais n’ai rien achevé, n’ai rien envoyé. Il s’est passé pas mal de choses, depuis mon retour. De Mersin j’ai pris un bus Ulusoy à l’odeur de cuir neuf jusqu’à Istanbul, et vu sur l’écran incrusté de mon siège, simultanément dans les écrans de tous les autres passagers, simultanément dans les reflets des vitres du bus entier, l’accident mortel d’un autre bus semblable, quelque part sur la même autoroute. J’ai relu Tranströmer dans un taxi lancé à tombeau ouvert contre les ponts blancs du Bosphore, sur la rive Asiatique. J’ai retrouvé mon vieil appartement de la rive européenne, acheté de la viande de bœuf, pleuré sur les quais de la Marmara en regardant les souvenirs d’un mois de liberté absolue se dissoudre dans la pluie des pavés millénaires. J’ai bu du çay avec des ombres dans les cybercafés humides de Kumkapi, acheté toutes sortes de t-shirts à moustaches et bicyclettes avec de la petite monnaie trouble, bu des jus d’orange sanguine et chanté du Brassens dans ma tête jusqu’à la folie. J’ai pris des bus bondés et passé ma monnaie vers l’avant, marché sur des autoroutes à quatre pistes, écrit dans des mosquées, pissé dans des bouteilles de Turka Cola, vu des types très pauvres avec des dents en or et des types très riches avec des mouches dans les cheveux. Et puis je suis rentré, en cargo jusqu’à Montfalcone, en huit jours huileux et inconcevables entre les îles grecques, les ombres déchiquetées des Pouilles et le violet profond de l’Adriatique supérieure. Il y avait des tortues sous la poupe du navire, disait l’adjoint du capitaine.
Je ne t’ai pas écrit depuis tout ce temps. Ou, plus exactement, je t’ai écrit régulièrement, mais n’ai rien achevé, n’ai rien envoyé. Il s’est passé pas mal de choses, depuis mon retour. De Mersin j’ai pris un bus Ulusoy à l’odeur de cuir neuf jusqu’à Istanbul, et vu sur l’écran incrusté de mon siège, simultanément dans les écrans de tous les autres passagers, simultanément dans les reflets des vitres du bus entier, l’accident mortel d’un autre bus semblable, quelque part sur la même autoroute. J’ai relu Tranströmer dans un taxi lancé à tombeau ouvert contre les ponts blancs du Bosphore, sur la rive Asiatique. J’ai retrouvé mon vieil appartement de la rive européenne, acheté de la viande de bœuf, pleuré sur les quais de la Marmara en regardant les souvenirs d’un mois de liberté absolue se dissoudre dans la pluie des pavés millénaires. J’ai bu du çay avec des ombres dans les cybercafés humides de Kumkapi, acheté toutes sortes de t-shirts à moustaches et bicyclettes avec de la petite monnaie trouble, bu des jus d’orange sanguine et chanté du Brassens dans ma tête jusqu’à la folie. J’ai pris des bus bondés et passé ma monnaie vers l’avant, marché sur des autoroutes à quatre pistes, écrit dans des mosquées, pissé dans des bouteilles de Turka Cola, vu des types très pauvres avec des dents en or et des types très riches avec des mouches dans les cheveux. Et puis je suis rentré, en cargo jusqu’à Montfalcone, en huit jours huileux et inconcevables entre les îles grecques, les ombres déchiquetées des Pouilles et le violet profond de l’Adriatique supérieure. Il y avait des tortues sous la poupe du navire, disait l’adjoint du capitaine.
 Et moi j’entamais la dernière partie de Bourlinguer, par tranches, sous les voies d’escalade en dévers de Trabenna, sur les toilettes du camping, dans l’embrasure des douches mixtes, à la lueur de la bougie, à l’arrière de notre van sur quinze kilos d’oranges, avant de m’endormir. J’aurais pu être marin, je crois. Ou vivre dans les ports, simplement, entre des litres de kérosène, des putes et des sacs de sucre de Cuba. Un bouquin pour oreiller.
Et moi j’entamais la dernière partie de Bourlinguer, par tranches, sous les voies d’escalade en dévers de Trabenna, sur les toilettes du camping, dans l’embrasure des douches mixtes, à la lueur de la bougie, à l’arrière de notre van sur quinze kilos d’oranges, avant de m’endormir. J’aurais pu être marin, je crois. Ou vivre dans les ports, simplement, entre des litres de kérosène, des putes et des sacs de sucre de Cuba. Un bouquin pour oreiller. L
L
 A ce moment-là, les Poussières du monde récoltées par Bouvier tournaient en boucle dans la
A ce moment-là, les Poussières du monde récoltées par Bouvier tournaient en boucle dans la

 Embarquer sur un cargo n’a rien de simple, et je te raconterai une autre fois comment on s’y est pris, en plusieurs jours, en plusieurs heures. Le stress qui monte, la hantise que ça ne fonctionne pas. Et puis tout va très vite. Soudain on est dans la bouche béante du monstre, à quai, dans l’ascenseur, puis dans les labyrinthes de couloirs bleus, devant de lourdes portes en fonte, contre des hublots sous les flots. Des pancartes partout, des signes, des écriteaux, de têtes de morts et des masques à gaz. Un marin en training qui nous dresse deux lits, rapidement. Deux heures du matin. Une fois au neuvième étage du SPES, en route pour l’Italie, le lendemain, à dix heures dans la loupe d’un ciel d’après-pluie, assis sur deux mille cinq cents Fiat neuves de toutes les couleurs, une fois le quai décroché, les amarres enroulées, tu peux vraiment sentir le monde glisser sous toi. De l’huile sur la fesse du monde. Et cette odeur de mazout, de peinture fraîche et de grand air iodé. La vie sur ce blindé, huit jours durant, seuls passagers au milieu des gradés italiens et des hommes de main philippins, te vaudra une nouvelle lettre, ou un après-midi dans ton Isba. David et Julien me paraissaient déjà très loin, les grimpeurs d’Antalya encore plus, le couch-surfing de Sofia presque enterré. Je me douchais à l’eau déssalée, courait sur le pont en short des San Antonio Spurs, dormait dans le ressac des Dardanelles, comptait les couleurs de la mer, regardais New York stories et puis offrait le DVD aux Philippins. On tenait des carnets. Parlait beaucoup. David et Julien, eux, tentaient de récupérer leur van à Alexandrie, traversaient un désert, suivaient le Nil jusqu’en Ethiopie. Cela je ne l’ai su que plus tard, parce qu’il n’y avait alors aucun moyen de communication. Je me détachais de plus en plus, et finissait La Pêche à la truite en Amérique.
Embarquer sur un cargo n’a rien de simple, et je te raconterai une autre fois comment on s’y est pris, en plusieurs jours, en plusieurs heures. Le stress qui monte, la hantise que ça ne fonctionne pas. Et puis tout va très vite. Soudain on est dans la bouche béante du monstre, à quai, dans l’ascenseur, puis dans les labyrinthes de couloirs bleus, devant de lourdes portes en fonte, contre des hublots sous les flots. Des pancartes partout, des signes, des écriteaux, de têtes de morts et des masques à gaz. Un marin en training qui nous dresse deux lits, rapidement. Deux heures du matin. Une fois au neuvième étage du SPES, en route pour l’Italie, le lendemain, à dix heures dans la loupe d’un ciel d’après-pluie, assis sur deux mille cinq cents Fiat neuves de toutes les couleurs, une fois le quai décroché, les amarres enroulées, tu peux vraiment sentir le monde glisser sous toi. De l’huile sur la fesse du monde. Et cette odeur de mazout, de peinture fraîche et de grand air iodé. La vie sur ce blindé, huit jours durant, seuls passagers au milieu des gradés italiens et des hommes de main philippins, te vaudra une nouvelle lettre, ou un après-midi dans ton Isba. David et Julien me paraissaient déjà très loin, les grimpeurs d’Antalya encore plus, le couch-surfing de Sofia presque enterré. Je me douchais à l’eau déssalée, courait sur le pont en short des San Antonio Spurs, dormait dans le ressac des Dardanelles, comptait les couleurs de la mer, regardais New York stories et puis offrait le DVD aux Philippins. On tenait des carnets. Parlait beaucoup. David et Julien, eux, tentaient de récupérer leur van à Alexandrie, traversaient un désert, suivaient le Nil jusqu’en Ethiopie. Cela je ne l’ai su que plus tard, parce qu’il n’y avait alors aucun moyen de communication. Je me détachais de plus en plus, et finissait La Pêche à la truite en Amérique.  Camille lisait Gatsby le magnifique en anglais. On passait du temps, du temps qui avait un poids réel, appréciable, mesurable. Au loin les côtes se faisaient plus vertes, plus montagneuses, et la Suisse était bientôt à portée de vue – entre temps ils avaient rasé les Alpes. A Ravenne, lors de notre seule escale, on est sorti dans le port immensément vide pour sauter dans un taxi et célébrer le souvenir de la libération italienne (Rome, ville ouverte…). Au musée national, les mosaïques dorées des basiliques byzantines avaient quelque chose de tes livres : un découpage bordélique et craquelé de très près, et puis, pour qui prend la peine de prendre du recul, de faire deux pas de côté, un sens doré et une vraie beauté pleine… D’Istanbul à Byzance, il y a donc un cargo vers le Nord. Et il nous restait une nuit jusqu’au mont du Faucon. Je ne voulais pas que ça s’arrête.
Camille lisait Gatsby le magnifique en anglais. On passait du temps, du temps qui avait un poids réel, appréciable, mesurable. Au loin les côtes se faisaient plus vertes, plus montagneuses, et la Suisse était bientôt à portée de vue – entre temps ils avaient rasé les Alpes. A Ravenne, lors de notre seule escale, on est sorti dans le port immensément vide pour sauter dans un taxi et célébrer le souvenir de la libération italienne (Rome, ville ouverte…). Au musée national, les mosaïques dorées des basiliques byzantines avaient quelque chose de tes livres : un découpage bordélique et craquelé de très près, et puis, pour qui prend la peine de prendre du recul, de faire deux pas de côté, un sens doré et une vraie beauté pleine… D’Istanbul à Byzance, il y a donc un cargo vers le Nord. Et il nous restait une nuit jusqu’au mont du Faucon. Je ne voulais pas que ça s’arrête.

 Des satellites tournent autour du Monde, produisant leurs propres flashes Iridium. Je crois que je suis planté sur place. Les prochains mois seront tout aussi beaux, j’en suis sûr, et la matière – sensible, physique, faiblement chargée d’ors, brûlante dans la paume – ne devrait pas manquer. Il y a ce stage éditorial, et puis la correction des carnets de guerre de Pourtalès, enfin les Archives littéraires suisses qui m’attendent pour Donzé à la fin de l’été, un livre en chantier, d’autres dans le fond des yeux, l’AJAR que tu parraine spontanément, des lectures, des journaux à faire paraître, des photos à révéler, des concerts, des Cervins à mettre aux murs, des amis à retrouver, le vent du sud à digérer… et la route à reprendre !
Des satellites tournent autour du Monde, produisant leurs propres flashes Iridium. Je crois que je suis planté sur place. Les prochains mois seront tout aussi beaux, j’en suis sûr, et la matière – sensible, physique, faiblement chargée d’ors, brûlante dans la paume – ne devrait pas manquer. Il y a ce stage éditorial, et puis la correction des carnets de guerre de Pourtalès, enfin les Archives littéraires suisses qui m’attendent pour Donzé à la fin de l’été, un livre en chantier, d’autres dans le fond des yeux, l’AJAR que tu parraine spontanément, des lectures, des journaux à faire paraître, des photos à révéler, des concerts, des Cervins à mettre aux murs, des amis à retrouver, le vent du sud à digérer… et la route à reprendre ! De JLK, dit le Papillon, à Daniel Vuataz, dit le Kid
De JLK, dit le Papillon, à Daniel Vuataz, dit le Kid Pardon, Kiddy, de t’infliger ce début de réponse si lugubre, mais il y a en toi assez de santé et de générosité, de joie de vivre et de sérieux pour absorber et filtrer les ombres rampant dans nos plus noires ténèbres. Tu liras bientôt le deuxième roman de Quentin, Notre-Dame-de-la-Merci, qui sonde lui aussi les grands fonds de la déréliction humaine en interrogeant quelques destinées
Pardon, Kiddy, de t’infliger ce début de réponse si lugubre, mais il y a en toi assez de santé et de générosité, de joie de vivre et de sérieux pour absorber et filtrer les ombres rampant dans nos plus noires ténèbres. Tu liras bientôt le deuxième roman de Quentin, Notre-Dame-de-la-Merci, qui sonde lui aussi les grands fonds de la déréliction humaine en interrogeant quelques destinées  Te retrouver lisant La Haute Route de Maurice Chappaz, que j’avais jugé assez rudement à l’époque, tant son lyrisme et ses jodlées vocales me semblaient artificielle ou disons forcées, m’a rappelé nos propres équipées entre Saas-Fee, Zermatt et Chamonix, il y a de ça plus de quarante putains d’années ! Mais ton histoire d’accident de bus m’a rappelé le premier mort que nous avons découvert, sous une avalanche de la nuit même, au pied du col du Strahlhorn, et tes varappes exotiques m’ont fait retrouver mon ami Reynald, tombé dans les séracs du bien-nommé Dolent le 15 août 1985 (l’année de naissance de Julie) ou nos grimpes marines avec Anicet Sarrasin dans les Calanques d’En Vau – mon rude compagnon passant la journée sous une pierre tant il craignait le soleil des hippies bronzant à poil tout à côté.
Te retrouver lisant La Haute Route de Maurice Chappaz, que j’avais jugé assez rudement à l’époque, tant son lyrisme et ses jodlées vocales me semblaient artificielle ou disons forcées, m’a rappelé nos propres équipées entre Saas-Fee, Zermatt et Chamonix, il y a de ça plus de quarante putains d’années ! Mais ton histoire d’accident de bus m’a rappelé le premier mort que nous avons découvert, sous une avalanche de la nuit même, au pied du col du Strahlhorn, et tes varappes exotiques m’ont fait retrouver mon ami Reynald, tombé dans les séracs du bien-nommé Dolent le 15 août 1985 (l’année de naissance de Julie) ou nos grimpes marines avec Anicet Sarrasin dans les Calanques d’En Vau – mon rude compagnon passant la journée sous une pierre tant il craignait le soleil des hippies bronzant à poil tout à côté. 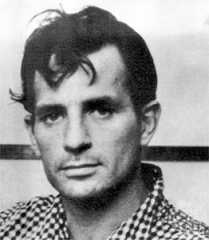 Je vous vois très bien aussi lire Jack London on the Road – et soit dit en passant, je partage tout à fait votre perplexité à l’égard du livre « culte » de Kerouac, dont le romantisme de surface ne m’a jamais scotché -, tu sais combien je partage aussi
Je vous vois très bien aussi lire Jack London on the Road – et soit dit en passant, je partage tout à fait votre perplexité à l’égard du livre « culte » de Kerouac, dont le romantisme de surface ne m’a jamais scotché -, tu sais combien je partage aussi  Ta bonne lettre te vaudra deux des trois Cervins que je t’ai promis. Le troisième te reviendra quand tu nous fileras ton tapuscrit promis pour la collection Le Passe-Muraille des éditions d’autre part. Pascal t’attend de pied ferme tout souriant. Tu sais quelle rigueur jurassienne cache ce sourire. Tu devrais absolument lire Le prochains, son dernier livre. C’est une galerie de portraits que je préfère pour ma part aux «vies minuscules » de Pierre Michon - même si c’est nettement moins ciselé en finesse et moins « gravé dans le marbre » - , à proportion de la tendresse jamais mielleuse de l’auteur et de sa générosité, de sa poésie « dans la vie » et de son tonus verbal. Ce mec est « classe », pour parler ton volapück: non seulement il ne m’en a pas voulu d’aller voir chez Olivier Morattel si j’y étais, mais il m’a complimenté en appelant mes Chemins de traverse le livre d’un « Mensch ». Je ne peux que te dire la même chose de lui : « Isch a guët Mensch »…
Ta bonne lettre te vaudra deux des trois Cervins que je t’ai promis. Le troisième te reviendra quand tu nous fileras ton tapuscrit promis pour la collection Le Passe-Muraille des éditions d’autre part. Pascal t’attend de pied ferme tout souriant. Tu sais quelle rigueur jurassienne cache ce sourire. Tu devrais absolument lire Le prochains, son dernier livre. C’est une galerie de portraits que je préfère pour ma part aux «vies minuscules » de Pierre Michon - même si c’est nettement moins ciselé en finesse et moins « gravé dans le marbre » - , à proportion de la tendresse jamais mielleuse de l’auteur et de sa générosité, de sa poésie « dans la vie » et de son tonus verbal. Ce mec est « classe », pour parler ton volapück: non seulement il ne m’en a pas voulu d’aller voir chez Olivier Morattel si j’y étais, mais il m’a complimenté en appelant mes Chemins de traverse le livre d’un « Mensch ». Je ne peux que te dire la même chose de lui : « Isch a guët Mensch »… Je ne sais pas si, dans ton ermitage fribourgeois de ces jours, tu as entendu la belle édition d’Entre les lignes que les sieurs Félix et Ciocca m’ont consacrée cette semaine. Tu peux encore la podcaster si tu veux nous entendre – moi je n’ai pas osé la réécouter. Ce que j’ai beaucoup aimé, de la part de la paire, c’est leur attention sans faille, la compétence avec laquelle ils ont préparé l’émission que mon incontinence verbale a quelque peu chahutée je crois. Ce qui est sûr est que j’avais l’impression d’être avec des amis des mots et des livres, des idées et de la vie, le comédien Frédéric Lugon a super bien lu deux ou trois de mes pages, Christian Ciocca a fait une magnifique présentation de mon opuscule après une entrée en matière non moins bienveillante de Jean-Marie Félix, bref toi qui revient d’Istambul tu sais ce que signifie l’expression ç’a été Byzance.
Je ne sais pas si, dans ton ermitage fribourgeois de ces jours, tu as entendu la belle édition d’Entre les lignes que les sieurs Félix et Ciocca m’ont consacrée cette semaine. Tu peux encore la podcaster si tu veux nous entendre – moi je n’ai pas osé la réécouter. Ce que j’ai beaucoup aimé, de la part de la paire, c’est leur attention sans faille, la compétence avec laquelle ils ont préparé l’émission que mon incontinence verbale a quelque peu chahutée je crois. Ce qui est sûr est que j’avais l’impression d’être avec des amis des mots et des livres, des idées et de la vie, le comédien Frédéric Lugon a super bien lu deux ou trois de mes pages, Christian Ciocca a fait une magnifique présentation de mon opuscule après une entrée en matière non moins bienveillante de Jean-Marie Félix, bref toi qui revient d’Istambul tu sais ce que signifie l’expression ç’a été Byzance. 
 Ta remontée du Sud en cargo, le long des côtes adriatiques, m’a rappelé ma descente le long du même littoral aux ports de marbre évoquant la splendeur vénitienne passée, en 1993, quand les Croates et les Serbes se battaient sur les crêtes, comme je l’ai raconté en détail dans L’Ambassade du papillon. Or une fois de plus je constate que tes voyages, comme les miens, se dédoublent en lectures. Là tu parles de L’Espoir d’une langue à venir, thème que je vis pour ainsi dire ces jours en lisant Rabelais, et qui me ramène à la conversation que nous avons prolongée l’autre jour avec Christian Ciocca, après l’émission, sur la terrasse du Café de la Radio, où ce nouvel ami (je crois que je peux dire ça) m’a parlé du livre de Roland de Muralt. Qui m’a rappelé une autre conversation avec Quentin sur Adorno. Et voilà que du cites Heidegger. Qui me rappelle une crise de rage de Dimitri quand je me permettais, un soir, de critiquer le philosophe pour sa pleutrerie face aux nazis. Qui me rappelle aussi que j’ai repris l’autre jour la lecture du Courage d’être de Tillich, émigré aux States dès 1933. Sur quoi tu évoques « cette saloperie de Syrie », à laquelle fait écho Jean le fou dans sa postface à mes Chemins et qui me ramène ce matin aux Carnets de Homs de Jonathan Littell que je viens d’aborder. Comme quoi tout revient toujours à la case réel – tout se tenant.
Ta remontée du Sud en cargo, le long des côtes adriatiques, m’a rappelé ma descente le long du même littoral aux ports de marbre évoquant la splendeur vénitienne passée, en 1993, quand les Croates et les Serbes se battaient sur les crêtes, comme je l’ai raconté en détail dans L’Ambassade du papillon. Or une fois de plus je constate que tes voyages, comme les miens, se dédoublent en lectures. Là tu parles de L’Espoir d’une langue à venir, thème que je vis pour ainsi dire ces jours en lisant Rabelais, et qui me ramène à la conversation que nous avons prolongée l’autre jour avec Christian Ciocca, après l’émission, sur la terrasse du Café de la Radio, où ce nouvel ami (je crois que je peux dire ça) m’a parlé du livre de Roland de Muralt. Qui m’a rappelé une autre conversation avec Quentin sur Adorno. Et voilà que du cites Heidegger. Qui me rappelle une crise de rage de Dimitri quand je me permettais, un soir, de critiquer le philosophe pour sa pleutrerie face aux nazis. Qui me rappelle aussi que j’ai repris l’autre jour la lecture du Courage d’être de Tillich, émigré aux States dès 1933. Sur quoi tu évoques « cette saloperie de Syrie », à laquelle fait écho Jean le fou dans sa postface à mes Chemins et qui me ramène ce matin aux Carnets de Homs de Jonathan Littell que je viens d’aborder. Comme quoi tout revient toujours à la case réel – tout se tenant.
 Faut-il taire ce dont on ne peut pas parler, Kiddy ? Je me le demande. N’est-ce pas une folie que de nous exposer ainsi sur la Toile et ses réseaux multiples ? Jusqu’où peut-on jouer avec le virtuel ? Que nous dit l’exhibition mondiale des webcams ? Comment penser cette destruction de l'intimité ? Pourquoi la littérature actuelle parle-t-elle si peu de ce que nous avons sous les yeux ? Un dossier récent de la revue Transfuge accuse la littérature française d’être rétrograde, mais avec des arguments tellement vieillots qu’on a l’impression que les morts s’enterrent entre eux. Ainsi parle-t-on des Bienveillantes comme d’un livre tourné vers le passé. Foutaise incroyable ! Chichis germanopratins !
Faut-il taire ce dont on ne peut pas parler, Kiddy ? Je me le demande. N’est-ce pas une folie que de nous exposer ainsi sur la Toile et ses réseaux multiples ? Jusqu’où peut-on jouer avec le virtuel ? Que nous dit l’exhibition mondiale des webcams ? Comment penser cette destruction de l'intimité ? Pourquoi la littérature actuelle parle-t-elle si peu de ce que nous avons sous les yeux ? Un dossier récent de la revue Transfuge accuse la littérature française d’être rétrograde, mais avec des arguments tellement vieillots qu’on a l’impression que les morts s’enterrent entre eux. Ainsi parle-t-on des Bienveillantes comme d’un livre tourné vers le passé. Foutaise incroyable ! Chichis germanopratins !  Lorsque j’ai retrouvé Dimitri après quinze ans de séparation, notre cher ami m’a donné à lire un petit livre d’un jeune informaticien chrétien intitulé L’Enfer d’Internet. Hélas l’essai en question n’est que la mise en garde d’un enfant de chœur, relançant les recommandations vertueuses à « nos jeunes ». Jacqueline de Romilly était plus futée, quand je lui demandais comment elle agirait avec des enfants par rapport à la télé. « Surtout ne pas interdire ! », s’est-elle aussitôt exclamée. «Ne pas dramatiser ou moraliser, mais parler, discuter, exercer le sens critique, donner des contrepoids ». Le bon sens même, quoi, que nous aurons pratiqué avec nos filles sans même y penser. Elles ont beau avoir vu toutes les horreurs imaginables: elles sont aujourd'hui bonnement équilibrées et encore romantiques à tout crin.
Lorsque j’ai retrouvé Dimitri après quinze ans de séparation, notre cher ami m’a donné à lire un petit livre d’un jeune informaticien chrétien intitulé L’Enfer d’Internet. Hélas l’essai en question n’est que la mise en garde d’un enfant de chœur, relançant les recommandations vertueuses à « nos jeunes ». Jacqueline de Romilly était plus futée, quand je lui demandais comment elle agirait avec des enfants par rapport à la télé. « Surtout ne pas interdire ! », s’est-elle aussitôt exclamée. «Ne pas dramatiser ou moraliser, mais parler, discuter, exercer le sens critique, donner des contrepoids ». Le bon sens même, quoi, que nous aurons pratiqué avec nos filles sans même y penser. Elles ont beau avoir vu toutes les horreurs imaginables: elles sont aujourd'hui bonnement équilibrées et encore romantiques à tout crin. Internet un enfer ou une poubelle, pour reprendre les termes d'Alain Finkielkraut ? Je comprends très bien les prudences hautaines d’un Philippe Sollers à l’égard
Internet un enfer ou une poubelle, pour reprendre les termes d'Alain Finkielkraut ? Je comprends très bien les prudences hautaines d’un Philippe Sollers à l’égard  D’un clic j’accède à ta bonne lettre, mon bien cher. D’un autre clic j’accède à toutes les images que toi et tes compères avez grappillées au long de votre périple. D'un clic je balance entre Hitler et le Christ. À ce propos tu devrais regarder le film Import/Export d’Ulrich Seidl, un garçon sérieux qui voit de la beauté jusque dans la pire laideur. Il y est question, notamment, d’une jeune femme qui fuit l’enfer industriel ukrainien où sa mère va rester à s’occuper de son enfant « naturel », tandis qu’elle cherche un job en Autriche. Son premier point de chute est une espèce d’immense loft subdivisé en « salons » dans lesquels des filles, larguées comme elle, s’agitent devant des oeilletons de webcams dont on entend les clients-voyeurs vociférer des quatre coins du monde. Peep-show mondial. Il faut regarder ça attentivement et y réfléchir, même si ça ne dure que trois minutes dans le film. Ce n’est pas, évidemment, toute la réalité, mais c’est un aspect de l’irréalité réelle du virtuel qui tisse le « roman » d’aujourd’hui.
D’un clic j’accède à ta bonne lettre, mon bien cher. D’un autre clic j’accède à toutes les images que toi et tes compères avez grappillées au long de votre périple. D'un clic je balance entre Hitler et le Christ. À ce propos tu devrais regarder le film Import/Export d’Ulrich Seidl, un garçon sérieux qui voit de la beauté jusque dans la pire laideur. Il y est question, notamment, d’une jeune femme qui fuit l’enfer industriel ukrainien où sa mère va rester à s’occuper de son enfant « naturel », tandis qu’elle cherche un job en Autriche. Son premier point de chute est une espèce d’immense loft subdivisé en « salons » dans lesquels des filles, larguées comme elle, s’agitent devant des oeilletons de webcams dont on entend les clients-voyeurs vociférer des quatre coins du monde. Peep-show mondial. Il faut regarder ça attentivement et y réfléchir, même si ça ne dure que trois minutes dans le film. Ce n’est pas, évidemment, toute la réalité, mais c’est un aspect de l’irréalité réelle du virtuel qui tisse le « roman » d’aujourd’hui. À part quoi la vie bonne continue. Un SMS et tu peux dire à tes enfants que tu les aimes, qui te répondent dans la minute. L’Abbaye de Thélème est partout. L’isba en est une succursale qui s’ouvrira bientôt avec 12.000 livres, une table à écrire, une bouteille de rouge, une autre de Turka Cola, des sèches pour ceux qui sèchent les Conseils du Médecin, un lit, un pot de chambre sous le lit qui se rince à la cascade - sinon toute une forêt pour la petite et la grande commission. Rousseau eût kiffé l’écart. On t’y attend, chenapan…
À part quoi la vie bonne continue. Un SMS et tu peux dire à tes enfants que tu les aimes, qui te répondent dans la minute. L’Abbaye de Thélème est partout. L’isba en est une succursale qui s’ouvrira bientôt avec 12.000 livres, une table à écrire, une bouteille de rouge, une autre de Turka Cola, des sèches pour ceux qui sèchent les Conseils du Médecin, un lit, un pot de chambre sous le lit qui se rince à la cascade - sinon toute une forêt pour la petite et la grande commission. Rousseau eût kiffé l’écart. On t’y attend, chenapan…