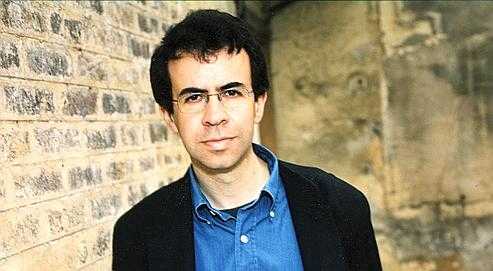Prix Goncourt 2010 sans surprise pour La Carte et le territoire, roman déjà plébiscité par le public...
À l’enterrement de Michel Houellebecq, son éditrice Teresa Cremisi sanglote dans le giron de Frédéric Beigbeder en considérant le cercueil d’enfant dans lequel les restes de l’écrivain, méchamment découpé en fines lanières par un pervers collectionneur d’art, ont été recueillis.
La scène est tirée de La Carte et le territoire, dernier roman du plus juteux « poulain » de dame Cremisi, éminence dorée de l’édition parisienne, passée de Gallimard à la tête de Flammarion et qui avait déjà « boosté » les romans précédents de l’écrivain avec un art consommé du marketing.
Résultat de la course : l’auteur le plus controversé et le plus « culte » de la littérature française du tournant du siècle, a obtenu hier le plus prestigieux des prix littéraires parisiens avec un roman caracolant, depuis quelques semaines déjà, en tête des listes de ventes. Cette « consécration » rappelle celle de Marguerite Duras, en 1984, quand L’Amant, best-seller de la rentrée, avait été «goncourtisé» de manière jugée opportuniste par d’aucuns. En ce qui concerne Houellebecq, ce Goncourt 2010 fait en outre figure de « rattrapage », en matière de reconnaissance symbolique, après que les jurés des grands prix de l’automne eurent « snobé » ses quatre romans précédents, à commencer par les Particules élémentaires, tous traduits aujourd’hui en une quarantaine de langues…
De fait, souvent honni de ses pairs français, irrités par ses provocations mais plus encore par son succès international, Michel Houellebecq est sans doute l’écrivain français considéré hors de France comme le plus représentatif de sa génération, en phase avec les nouveaux auteurs du monde entier.
Un ton nouveau
Dès Extension du domaine de la lutte, publié en 1994 par un grand découvreur des lettres contemporaines, en la personne de Maurice Nadeau, Houellebecq s’est signalé par une perception nouvelle de la réalité contemporaine, et une façon très directe de parler du monde du travail et de la sexualité, de toutes les formes de déprime et de la fuite en avant dans la course à la réussite et la recherche d’un bonheur souvent factice.
Clonage, échangisme, tourisme sexuel, dérives sectaires ou fanatiques (sa fameuse phrase sur l’islamisme dans Plateforme…), solitude de l’individu dans une société de plus en plus formatée, simulacres de la charité ou de la culture : tels sont, entre autres, les thèmes abordés par ce médium frotté de douce désespérance…
Au-delà des manoeuvres
Donné pour gagnant, la semaine passée, sur deux pleines pages du Nouvel Observateur, Michel Houellebecq a obtenu le Goncourt après une délibération-éclair d’une minute et 29 secondes, au dire du juré-secrétaire Didier Decoin, et par sept voix contre deux à Virginie Despentes. La campagne de promotion orchestrée par son éditrice, avec son consentement faussement ahuri, a fait converger stratégie de longue date et tactique de dernière ligne. À lui le pompon !
Humour panique et mélancolie
On a parlé, pour dégommer La carte et le territoire, d’un roman « consensuel » purgé des aspects «sulfureux» de ses précédents romans, comme s’il s’agissait pour l’écrivain de faire le gros dos en matou matois péchant le compliment. Or, s’il y a un peu de cette suavité composée dans la campagne de promotion de son roman, celui-ci marque une évidente évolution du regard de l’écrivain, devenant ici son propre personnage, sur le monde et sur les gens.
Surtout : Michel Houellebecq reste un observateur aigu, et parfois percutant, de la société qui noue entoure. Des menées personnelles d’un artiste, à la fois intéressant et « piégé » par un marché de l’art délirant, aux relations de plus en plus équivoques entre culture et commerce, vie privée et publicité, au royaume des marques et de la spéculation, l’écrivain joue avec son propre personnage dans une mise en abyme pleine d’humour tantôt tendre et tantôt noir. Le sentiment du temps qui passe, et du vieillissement, pondère la satire (même si l’association Dignitas en prend pour son grade) et le dessin des personnages se fait plus nuancé, leur substance plus étoffée.
Dans une chronique malveillante témoignant d’une piètre lecture, l’académicien Goncourt Tahar Ben Jelloun a parlé de la mégalomanie de l’écrivain pour le « scier ». Or c’est une tout autre image qu’en donne La Carte et le territoire, roman d’un clown triste jouant le vieillard en pyjama fripé avec une énergie et un fond de jubilation sardonique que nimbe un non moins perceptible mélancolie…
Michel Houellebecq. La Carte et le territoire. Flammarion, 428p.
SMS en coulisses ?
Un rien de temps après que l’annonce du Prix Goncourt, attribué hier à Michel Houellebecq par sept voix, contre deux à Virginie Despentes, la nouvelle tombait que le Prix Renaudot 2010 revenait à ladite romancière « trash », au 11e tour et par quatre voix, contre trois à Simonetta Greggio.
Or, eût-il pu se faire que Virginie Despentes décrochât à la fois le Goncourt et le Renaudot, à supposer par exemple que, vexés par la rumeur médiatique d’un Goncourt assuré à Houellebecq, les jurés de l’Académie reportent leur voix sur la punkette ?
Cela eût très bien pu se faire, comme cela s’est fait en 1995 où, sans concertation probable, l’écrivain russe francophone André Makine obtint coup sur coup le Prix Médicis, le prix Goncourt et le Goncourt des lycéens pour Le Testament français. De la même façon, la lauréate du Médicis 2010, Maylis de Kerangal, aurait pu décrocher à la fois le Grand Prix du roman de l’Académie française, le Femina, le Médicis et le Goncourt, puisque son (très remarquable) roman, Naissance d’un pont, figurait sur les dernières listes de ces divers prix…
Y a-t-il eu, alors, des téléphones, des billets échangés et autres SMS de concertation ? On peut le supposer. Ou pas. Et qu’importe finalement ?