 ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBER
ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBER
Alain Gerber est un écrivain fluvial. À poser quelques questions à un romancier fluvial, on s’expose à recevoir de fluviales réponses, dont voici le partiel delta…
- Vers quel ailleurs votre écriture est-elle repartie ce matin ?
— Il n’y a plus de pays qui m’attire. Ils se sont banalisés et standardisés en même temps que leurs trop désinvoltes visiteurs. Quand je partais voir ailleurs, j’avais besoin de ne plus me sentir chez moi : maintenant, je m’y sens chez les autres. Pas ceux qui habitent là : ceux qui descendent en rangs serrés des avions et des autobus. En conséquence, la réalité à laquelle il m’importe de croire encore, les climats, les lumières, un certain style de relations entre les personnes, je ne la trouve que dans des œuvres — des livres, des films, des tableaux, et comme je ne suis pas d’un naturel assez contemplatif pour me contenter de les admirer, je mets la main à la pâte. Ca me permet d’imaginer que je suis réel, moi aussi, à un moment de mon existence où, dirais-je,… tout ne porte pas à le croire !
- Comment, en vous retournant, voyez-vous votre œuvre ?
— Pas comme un ensemble structuré : plutôt une série de tentatives abandonnées un jour par lassitude ou, plus exactement, parce que je me sentais appelé ailleurs. J’insiste sur ce mot, ailleurs, parce que chacune de mes « périodes » fut un territoire, avec son passé, ses coutumes, sa culture, sa langue, ses codes sociaux, son climat, voire ses spécialités culinaires lorsqu’il s’agissait de l’espace vaguement balkanique où j’ai logé mes Citadelles de sable. Tel ou tel de mes territoires peut coïncider avec une zone géographique bien délimitée (les Etats-Unis, en particulier), mais les deux ne sont jamais superposables. Je m’attache à ce qu’ils ne puissent pas l’être. Je ne suis toujours considéré comme un cinéaste de la plume : un cinéaste américain des années 50. Un de ces types à qui les producteurs confiaient un jour un western, l’année suivante un péplum ou un film intimiste...
- Un fil rouge relie-t-il vos livres ?
- S’il y a une unité à ce patchwork, elle ne réside pas dans l’écriture, mais dans le principe qui préside à celle-ci. Elle n’est pas dans la thématique proprement dite mais dans le retour obsessionnel de thèmes que je ne peux pas ne pas traiter, jusque dans ma poésie: la fuite du temps, l’inévitable métamorphose des choses que nous aurions voulues éternelles, l’échec ou, très spécifiquement, les relations avec les pères (de 1975 à 1999), puis avec les mères (à partir de 2000). Je suis le type qui revient sans cesse sur quelques images fondatrices, plongées dans une lumière très précise, environnées d’odeurs qui ne ressemblent pas à d’autres et qui, autour de ces scènes primitives (la seule chose qui lui importe, pour être franc), tente par politesse envers son lecteur de construire une intrigue de roman.
- D’où vient La couleur orange, votre premier livre ?
— C’était un bilan des années mortes — déjà ! Je l’ai écrit pour me dire, dans une période matériellement difficile : « Elles n’ont pas été tenues, mais voilà toutes les promesses que la vie t’avait faites. » J’ai raconté, avec des scrupules rabbiniques, trois mois de ma vie dont il m’avait semblé qu’ils étaient le début de quelque chose et qui, dix ans après, n’avaient débouché sur rien d’autre qu’une inconsolable nostalgie.
Pour le reste, l’ouvrage reflète deux fascinations littéraires assez incompatibles : le roman naturaliste-behavioriste américain (Hemingway, Chandler, etc.) et la recherche formaliste, qu’elle soit du Nouveau Roman ou d’ailleurs. Trois fées se sont penchées sur ce berceau : le Hemingway de Paris est une fête, le Perec de Les Choses et le Butor de Passage de Milan. J’étais aussi fasciné à l’époque (et le suis toujours), par les grandes littératures mystico-lyriques de l’Amérique : celle du Sud avec Faulkner, de la Nouvelle-Angleterre avec Melville et Hawthorne — sans parler bien sûr du new-yorkais Thomas Wolfe dans lequel je me suis plongé au début des années 70 avec la sensation de retrouver le liquide amniotique.
—Comment avez-vous vécu l’expansion de vos territoires romanesques ?
—Comme un type lancé dans la recherche éperdue d’une terre promise où ses graines germeraient, où il récolterait enfin le genre de beaux fruits qu’il voyait pendre aux arbres des autres. La question de l’exil s’est posée après Le Plaisir des sens. Je me garderai bien de dire si ce texte est ou non réussi. Ce que je sais, c’est qu’il fut le premier (et le seul) où l’écriture m’a offert bien davantage que ce que j’avais espéré d’elle. Il y avait un livre dont je n’étais pas du tout capable, ni techniquement ni sur aucun autre plan, et cependant, je l’ai écrit. Même si ce n’était que moi qui me le décernais, c’était comme de recevoir son bâton de maréchal sur le théâtre des opérations. À part le succès (pas immodéré en l’occurrence), il ne me restait – en ce qui me concernait — rien de mieux à attendre de la littérature. Je ne pouvais que répéter Le Plaisir à l’infini, ou bien creuser un autre sillon, sachant que la grâce ne me tomberait pas dessus une deuxième fois. Ce fut le seul moment de ma carrière où, pendant deux ans, je suis resté incapable d’écrire. Je ne m’en suis sorti qu’en décidant d’accomplir ce qui, au départ, n’était pour moi qu’une parodie, et pas du tout le projet humaniste que d’aucuns ont célébré : ce Faubourg des Coups-de-trique qui était pour moi, contrairement à ce que nombre de ses lecteurs ont cru, une façon de déréaliser Belfort et d’en faire un espace strictement littéraire, une attitude à la Fellini, en quelque sorte, le Fellini d’avant La Dolce vita qui m’a toujours beaucoup inspiré.
—Qu’est-ce pour vous qu’un roman ?
—A-t-on encore le droit d’écrire des romans : j’aimerais avoir l’assurance d’en avoir déjà écrit un, après une quarantaine d’années d’écritoire ! Faute de m’être posé la question, un roman, je ne sais pas ce que c’est. Mais je sais que, pour moi, c’est la vie elle-même — je veux dire une vie avec quoi « la vraie vie » a les plus grandes peines à rivaliser. Je crois qu’un bon roman refait le monde, mieux peut-être et en tout cas de manière plus tangible que beaucoup de philosophies. L’imitation du réel, certes, n’a pas grand intérêt, mais ce que propose la littérature, avec une arrogance qui me réjouit, c’est tout le contraire: c’est que le réel devienne le toc et la contrefaçon du romanesque.
—Faites-vous une distinction entre vos romans-romans et vos romans du jazz ?
— Il y en a au moins une qui est énorme : les romans-romans, j’attends qu’ils veuillent bien frapper à ma porte ; les autres, je vais les chercher manu militari. Avec eux, je ne m’embarque pas sans biscuits. Le travail romanesque consiste essentiellement à aller chercher la vérité des personnages. En revanche, je touche peu à la matérialité des faits. Quand j’introduis des scènes et des dialogues de fiction, c’est toujours parce que les scènes et les dialogues de la réalité sont trompeurs ou équivoques. J’ai au départ, très précisément, quelque chose à dire, ce qui est très rarement le cas lorsque j’aborde mes autres livres. Là, en règle générale, je ne pars ni d’un personnage, ni d’une ébauche d’histoire, mais d’une sensation forte, d’une émotion tenace liée à une image très particulière (mon magasin d’images : essentiellement la télévision – où je consomme énormément de films). Je finis toujours par oublier ces visions fondatrices, mais je crois pouvoir dire que presque tous mes livres sont nés d’une photographie transformée en hologramme, de manière que je puisse tourner autour, accompagnée de conditions climatiques extrêmement précises et, surtout, d’une odeur qui ne ressemble exactement à aucune autre. Je peux passer des mois sans être visité par une de ces images au spectacle desquelles j’ai soudain envie de planter ma tente. Mais envie n’est pas le mot… C’est plutôt que j’ai l’impression que, dans ce lieu-là, je parviendrai à me sédentariser assez longtemps pour parvenir jusqu’au terme du livre (lequel, deux fois sur trois, m’est révélé à ce moment-là, c’est-à-dire avant que j’aie rédigé la première phrase). Pour le reste, je vais à l’aventure : je pose un décor, puis un premier personnage dans le décor et j’attends de voir ce qui va se passer. Tout dernièrement, le décor s’est révélé bosniaque, grâce à un documentaire diffusé à la télévision. J’ai décrit ce décor (au début de Si le roi savait ça). En quelques phrases, j’ai dépeint l’atmosphère qui s’en dégageait plus exactement. Tout le reste est venu de là, et d’une vague idée que j’avais d’introduire un charnier dans l’intrigue. Ma « documentation » s’est limitée à la consultation du Petit Robert des noms propres, à l’article Bosnie.
— Comment êtes-vous retombé en Enfrance, si j’ose dire ?
— On m’a poussé ! Le grand saxophoniste Jean-Louis Chautemps, un ami de longue date, et un poète au quotidien, un poète de fait, qui n’a même pas besoin d’écrire, m’a lancé ce défi, en forme de boutade, il y a déjà trois ou quatre ans. Je n’en ai tenu aucun compte, ne me sentant pas plus apte à la poésie qu’à la pratique du jazz. Et puis, en avril de l’an dernier, je ne sais trop pourquoi, au cours d’une insomnie me sont venus les deux premiers vers d’Enfrance. Je les ai notés sur un bout de papier. Le lendemain, j’ai creusé ce sillon et, à mon grand étonnement, j’ai vu que le sol se fendait sous l’étrave. Pendant trois mois, je n’ai plus écrit que de la poésie, presque à marche forcée. C’aura été l’une des expériences les plus exaltantes de toute ma vie. Cette péripétie était assez inattendue : à part celle de Jacques Réda, qui me touche profondément, je n’avais pour ainsi dire plus lu de poésie depuis le lycée. Je commence seulement à me rattraper un peu : je me découvre quelques affinités avec le Transsibérien de Cendrars, ou Zone d’Apollinaire, singulièrement. Je constate en revanche que les poètes qui me fascinent le plus (Breton, par exemple, ou le Rimbaud des Illuminations) évoluent dans un cercle qui me restera fermé à jamais. Ces auteurs sont initiés à un mystère dont je n’aperçois même pas les contours.
—Et la lecture là-dedans ?
—J’ai dévoré des livres depuis l’âge de cinq ans, en commençant par Fenimore Cooper, Jack London, Dumas et L’Ile au trésor. Vers 1985, j’ai renoncé à ce bonheur-là. J’aimais à la fois trop d’auteurs trop différents les uns des autres, après avoir découvert, entre autres les Latino-américains, les Asiatiques, les Français de l’entre-deux-guerres (Fargue, Morand, Larbaud : j’avais longtemps voulu les ignorer, alors qu’ils écrivaient spécialement pour moi !). J’avais tendance à vouloir les intégrer tous ensemble à ma propre écriture. J’étais menacé, non seulement d’écartèlement, mais de perdre mon diapason personnel. J’ai pris en catastrophe la seule mesure qui s’imposait, ne lisant plus dès lors que les livres d’amis. L’été dernier, condamné à la retraite à mon corps défendant, je m’y suis remis. J’ai lu ou relu des auteurs dont les œuvres sont inscrites au catalogue de la Pléiade : Stevenson, Melville, Simenon, Ramuz, Rimbaud. Je crois que je peux maintenant avancer le doigt sans me faire happer par la machine. Mais certains romans de Simenon n’ont pas été loin de me décourager d’écrire, comme jadis Au Cœur des ténèbres…
— Votre avant-dernier roman fait retour au Belfort de vos débuts…
— Je me demandais, n’ayant plus à écrire pour la radio, si je devais m’accrocher encore à la musique, devenue mon terreau le plus fertile depuis la fin du siècle dernier, et, accessoirement, si j’étais encore capable de parler d’autre chose que de la création et des créateurs. J’avais peur que non, aussi ai-je voulu mettre toutes les chances de mon côté pour tenter cette escapade. Les noms des rues belfortaines ont le pouvoir de me mettre en confiance. Là, je n’ai même pas besoin d’image originelle : il me suffit de ces sonorités. Ce sont en quelque sorte mes sésames intimes.
— L’envoi sera-t-il pour Marie Joséphine ?
— « Pour qui écrivez-vous ? » Le savoir est un rare privilège. Une façon de se forger un style homogène est de s’adresser à un auditoire spécifique (grâce à mon émission de radio Le jazz est un roman, j’ai eu dix ans ce privilège). Je crois cependant que la vraie question est « À qui écrivez-vous ? » Ecrivant à la personne que je connais et qui me connaît le mieux au monde, je sais d’emblée quoi ne pas dire, ce qui est l’essentiel du métier d’écrivain. Je sens quand je triche ; je me surprends quand je me regarde écrire et j’ai honte de moi… Sans elle, ou bien je parlerais tout seul, ou bien j’enverrais des bouteilles à la mer. On s’en lasse vite… Quand on mène ce genre d’entreprise, bien sûr on n’échappe pas à la solitude. Il est capital que quelqu’un vous attende à la sortie du désert. Que quelqu’un vienne vous chercher, comme à l’école, vous tire de là et entretienne autour de vous, ne serait que par sa façon d’être, le climat grâce auquel vous trouverez le courage de retourner casser les cailloux le lendemain. Je dois bien plus à Marie Joséphine qu’elle-même ne l’imagine, plus sans doute que je n’en ai moi-même conscience et bien plus en tout cas qu’une série de dédicaces ne peut le laisser entendre…
Cet entretien avec JLK a paru dans Le Passe-Muraille, No77.
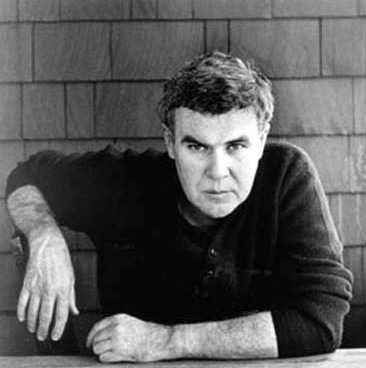
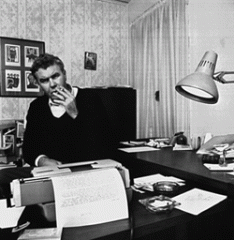 Un Tchékhov américain
Un Tchékhov américain



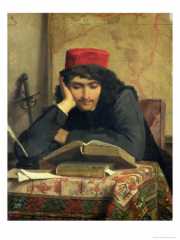 Editorial du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Visitez-nous au Salon du Livre de Genève !
Editorial du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Visitez-nous au Salon du Livre de Genève !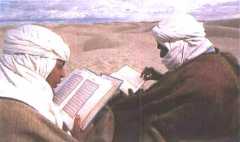 Cette interrogation portée sur la «compétence morale» de notre espèce pourrait sembler simpliste, mais la lecture attentive de cet essai limpide et grave d’un écrivain assumant le double héritage de la culture occidentale et de son homologue arabo-musulman, porte au contraire à examiner les nuances de la complexité et à dépasser les anathèmes et les exclusions réciproques ; demain, nous aimerions parler d’un tel ouvrage avec le professeur et écrivain tunisien Jalel El Gharbi, que nous accueillons dans cette livraison avec reconnaissance. Parce que c’est un vrai lecteur, un vrai passeur aussi, qui prend le temps de lire avec attention et respect.
Cette interrogation portée sur la «compétence morale» de notre espèce pourrait sembler simpliste, mais la lecture attentive de cet essai limpide et grave d’un écrivain assumant le double héritage de la culture occidentale et de son homologue arabo-musulman, porte au contraire à examiner les nuances de la complexité et à dépasser les anathèmes et les exclusions réciproques ; demain, nous aimerions parler d’un tel ouvrage avec le professeur et écrivain tunisien Jalel El Gharbi, que nous accueillons dans cette livraison avec reconnaissance. Parce que c’est un vrai lecteur, un vrai passeur aussi, qui prend le temps de lire avec attention et respect. Une fois de plus, Le Passe-Muraille tente d’assumer la vocation première qu’annonçait son titre en 1992. À la fuite en avant d’un monde énervé, à l’obsession du succès et au panurgisme, à l’emballement passager d’un «coup» éditorial à l’autre, nous continuons d’opposer, selon le goût librement affirmé de chacun, notre attachement à la littérature qui est à la fois une et infiniment diverse, moins préservée du monde qu’attentive à celui-ci, poreuse autant qu’il se peut sans se diluer dans le n’importe quoi.
Une fois de plus, Le Passe-Muraille tente d’assumer la vocation première qu’annonçait son titre en 1992. À la fuite en avant d’un monde énervé, à l’obsession du succès et au panurgisme, à l’emballement passager d’un «coup» éditorial à l’autre, nous continuons d’opposer, selon le goût librement affirmé de chacun, notre attachement à la littérature qui est à la fois une et infiniment diverse, moins préservée du monde qu’attentive à celui-ci, poreuse autant qu’il se peut sans se diluer dans le n’importe quoi. Le Passe-Muraille se refuse aux replis et aux rejets identitaires qui ne pallieront aucun dérèglement. Aujourd’hui sur papier, demain sur un site ou des blogs, nous nous efforcerons d’en assurer la survie avec nos lecteurs. (jlk)
Le Passe-Muraille se refuse aux replis et aux rejets identitaires qui ne pallieront aucun dérèglement. Aujourd’hui sur papier, demain sur un site ou des blogs, nous nous efforcerons d’en assurer la survie avec nos lecteurs. (jlk)
 De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais…
De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais… ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBER
ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBER