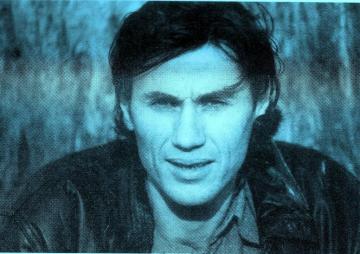A propos de La Symphonie du loup, de Marius Daniel Popescu. Prix Robert Walser 2008. Prix de littérature de la Fondation vaudoise pour la création. Réception le 6 octobre au Palais de Rumine.
Rien, ou presque, n’a été dit jusque-là, en Suisse romande, de précis et de réellement conséquent sur La Symphonie du loup, qui a fait s’extasier les uns quand les autres, l’ayant feuilleté plus ou moins paresseusement, ne faisaient que hausser les épaules. On a flairé le phénomène, et d’abord douté qu’un chauffeur de bus des Transports lausannois, qui plus est Roumain, débarqué en Suisse en 1990 sans connaissance réelle ne notre langue, puisse boucler un récit de 400 pages, certes un peu hirsute dans sa forme, mais néanmoins abouti et plus substantiel, plus vivant et plus vrai que la plupart des écrits actuels, plus encore dans notre pays qu’en francophonie variée. Les médias, toujours en quête de figures, ont exalté le personnage de Popescu, parfois au détriment du livre. Mais on a vu bien pire dans le milieu supposé faire bon accueil à un nouveau livre sortant à ce point de l’ordinaire: les plus mesquins auront ainsi insinué, comme de Jonathan Littell à propos des Bienveillantes (pensez : un Américain se mêlant d’écrire en français), que certains amis écrivains de Popescu avaient mis la main, pour ne pas dire : avaient écrit ce livre. Il n’y a pas de secret : certains amis écrivains de l’auteur, dont René-Luc Thévoz a été le premier, puis le soussigné, Michel Layaz, d’autres peut-être, ont en effet relu et parfois corrigé les pages de La symphonie du loup, dont les finitions d’ordre grammatical ou syntaxique ne sont rien, cependant, par rapport à ce que ce livre apporte d’essentiel : à savoir le souffle tout personnel et tout original de ce que Gilles Deleuze appelle «une langue étrangère dans la langue», seule formule préfigurant une écriture réellement nouvelle et surtout personnelle.
C’est cet immédiatement « étranger », cet immédiatement neuf et vif, cet immédiatement frais et fluvial, cet immédiatement bravache et chaleureux, cet immédiatement tonique et mélancolique qui m’a, pour ma part, immédiatement estomaqué dès ma première lecture des premières pages de La Symphonie évoquant, par la voix du grand-père, le premier tournant de la vie d’un adolescent de quatorze ans soudain frappé, en pleine partie de pêche, par l’annonce de la mort accidentelle de son père. Scène immédiatement mythique à mes yeux, comme la scène du baiser de Proust. Et tout aussitôt le parterre littéraire assis de se récrier et de ricaner : ah mais, voilà que ce lourdaud compare cette espèce de Roumain au divin Marcel !
Je ne sais si « cette espèce de Roumain » en aura le temps et la discipline, mais je gage que Marius Daniel Popescu pourrait bien, à travers les années, écrire sa Recherche. Inutile de dire que l’idée ne me viendrait pas, aujourd’hui, de comparer La symphonie du loup à La recherche du temps perdu, ni de prétendre, non plus, que nous tenons déjà là un chef-d’œuvre, comme d’aucuns l’ont aventuré. En revanche, Jean-Claude Lebrun, dans le premier grand article paru en France sur le livre, dans L’Humanité, me semble tout à fait dans le vrai en reconnaissant à Popescu « le souffle des grands ». D’extraordinaires séquences, dans La Symphonie du loup, relèvent en effet, comme certaines pages des Bienveillantes, de la grande littérature. J’ai déjà évoqué la première. La deuxième est la suite de l’enterrement du père avec, notamment, la déchirante évocation du désarroi titubant du garçon dont les pensées se bousculent en délire (pp.111-118) dans cette litanie récurrente de mots « qui ne devraient pas exister », le dos tourné à la tombe et sans âge : « Les mots n’ont aucune valeur dans la vie et dans la mort. Ils n’appartiennent ni au passé, ni au présent, ni au futur. Ils ne sont ni eau, ni terre, ni fleur, ni vent. Tout ce qui se passe n’a rien en commun avec eux ».
La symphonie du loup est toute faite de mots en apparence, mais les mots d’une autre langue, physique et métaphysique à la fois, des mots-gestes, des mots-soupirs, des mots-caresses, des mots-claques, des mots-désirs, tout un silence en ébullition de mots-musique, tout un tourbillon de sable-mots, tout un déferlement de hautes vagues ourlées de mots-écume traversent le livre d’un seul souffle. Et les grands épisodes se suivent comme autant de ces « blocs d’enfance » dont parle encore Gilles Deleuze, qui relèvent tantôt de l’épopée et tantôt de la chronique intime ou privée: séquences alternées, en contrepoint, des petits bateaux bricolés dans la chambre des enfants, aujourd’hui, et de cette formidable traversée du dépotoir roumain, vingt ans plus tôt, de l’étudiant juché sur le marchepied d’un train lancé à toute allure (pp.100-106) ; blocs d’enfance des mots et des choses qui s’agencent comme au domino dans les douces heures de l’apprentissage, bousculés et augmentés par le récit hallucinant de la mort d’un cheval, dans une usine désaffectée, sous les coups d’ouvriers enragés de n’avoir plus rien à faire et se vengeant sur le bouc émissaire au carré que représente le pauvre animal d’un Gitan méprisé (p.151-161), avec ces mots nous restant en travers de la gorge : « L’automne, les pommes tombent sur le squelette du cheval et sur ses sabots soudés aux plaques de tôle en acier. Tu as maintenant presque quarante ans, ta mémoire n’arrive plus à dormir, tu rêves souvent du Gitan ». Séquences tour à tour splendides et sordides, telles la merveilleuse évocation du souvenir roumain d’un commerce magique de bouteilles et de ballons (pp.139-148) et la confidence d’une entraîneuse de cabaret évoquant son morne esclavage au narrateur, ici et maintenant ; le triste avortement d’une jeune fille au pays du parti unique, et les mêmes détresses vécues par tant de frères humains, en Roumanie déglinguée ou en Suisse ripolinée. Séquences de la sexualité ne relevant plus du « petit secret » mais de la vie personnelle et collective, où la recommandation du père au fils de ne pas se masturber (non tant par souci moral que pour mieux aimer la femme et toutes les femmes…) s’enchâsse dans une évocation de la masturbation collective « sauvage » qui préfigure la masturbation « en ligne » des solitudes mondialisées. Séquences de poésie naïve, candide parfois, parfois complaisante aussi dans son désir de donner du galon à tout et n’importe quoi, où les « blocs d’enfance » participent du moins d’une sorte de collage de mots-confettis, alternant avec les scènes historiquement et socialement significatives d’un observateur acéré du socialisme au quotidien.
La symphonie du loup est un concert de voix à la fois agencé, construit et jeté, aux phases tantôt ciselées et tantôt brutes de décoffrage. A un moment donné, le narrateur se voit qualifié d’«artiste brut» pour ses travaux saugrenus de façonnier de chaises en boîtes d’allumettes, mais cette qualification ne convient guère, à vrai dire, à l’art à la fois instinctif, puissant dans son élan et souvent désordonné, velléitaire parfois, mais organiquement tenu par la même perception poétique de l’existence et par le même souffle indompté. Surtout, et c’est ce que je voudrais souligner dans le contexte d’une littérature aphone ou dévertébrée, où le « petit secret » devient la grande affaire de la machine à ne rien dire, ce livre vaut par l’immense rage d’amour (Grand Secret) qu’il manifeste, où l’égomanie amoureuse de l’écrivain éclate en multiples « je », au-delà de l’étriquement de tous les « moi ». Contre la désastreuse impuissance à aimer et admirer qui affadit et écrase tout de nos jours, ce grand livre d’amour, même imparfait à certains égards, mérite d’être aimé et admiré.
Marius Daniel Popescu. La Symphonie du loup. José Corti, 399p. Prix Robert Walser 2008. Prix de la Fondation vaudoise pour la création 2008.
Cet article a paru dans Le Passe-Muraille, livraison de juin, No 75.
-
-
Un pas le vie, un pas la mort
 En feuilletant mes Carnets de l'année 2005.
En feuilletant mes Carnets de l'année 2005.En voyant apparaître les aiguilles de Chamonix, ce matin au col des Montets, une bouffée d’émotion m’a fait vaciller au souvenir de tant d’équipées de notre bon jeune temps, puis je me suis rappelé notre dernière course avec mon ami Reynald, sur l’arête Midi-Plan, et sa mort dans la face nord du Mont Dolent, une semaine après, il y aura juste 20 ans le 15 août prochain, un pas la vie, un pas la mort…
L’agression faite au silence est plus grave qu’on ne saurait dire.***
Faire comme si tout avait du sens. Faire comme s’il y avait encore de la place pour nous dans ce monde de fous. Faire comme si ce que nous faisons était encore attendu...
Mais comme le dit le titre du dernier roman de Tabucchi : il se fait tard, de plus en plus tard...***
Tout songeur devant ce paysage qui me ramène à tout coup à ma vraie dimension.
Dominique de Roux me disait qu’on ne pouvait être dupe du monde après avoir accouché d’un enfant - ce qui faisait selon lui la supériorité de la femme -, et de même je me dis qu’on ne peut être dupe devant l’immensité de la nature, et par exemple devant ces montagnes. Là devant, je me dis, une fois de plus, qu’il est aberrant de penser que nous avons dominé la nature; parce que jamais nous ne dominerons la mort - à moins de changer de nature précisément. (A Chamonix, ce 5 août 2005) -
Lumières de Bukowski
 Les thèmes des nouvelles de Charles Bukowski, limités à ses errances d’alcoolique et à ses baises, sont d’un intérêt apparent à peu près nul et pourtant il y a, chez ce pochard graphomane, une sorte de grâce poétique tout à fait singulière.
Les thèmes des nouvelles de Charles Bukowski, limités à ses errances d’alcoolique et à ses baises, sont d’un intérêt apparent à peu près nul et pourtant il y a, chez ce pochard graphomane, une sorte de grâce poétique tout à fait singulière.
J’en vois un exemple, parmi cent autres, dans A propos d’un drapeau vietcong, qui raconte le minable épisode de la confrontation, au bord d’une autoroute, d’un camionneur à cran d’arrêt et de trois hippies auto-stoppeurs, une fille et deux garçons traînant un drapeau du vietcong.
En trois pages, Bukowski raconte une espèce de viol plus ou moins consenti qui évoque toute une Amérique brutale et veule à la fois et dont ne reste finalement que cette image de bannière abandonnée dans la lumière pure: “Il était là, dans la poussière, près des voies. La guerre continuait. Sept fourmis rouges, grand modèle, se baladaient sur le drapeau”. -
Le style d'une femme libre

Révérence à Françoise Sagan. Hommage au lendemain de sa mort.
Françoise Sagan, comme Georges Simenon, connut très tôt une gloire populaire peu compatible avec l'estime des milieux littéraires de l'ancienne société française, mal préparée aux « coups » de la publicité.
Il en a résulté, dès la parution de Bonjour tristesse, marquant une rupture beaucoup plus nette, à l'époque, que la publication de Baise-moi d'une Virginie Despentes, un scandale et un intérêt de scandale qui s'est concrétisé par un succès de vente sans doute disproportionné par rapport aux réelles qualités de l'ouvrage de la jeune fille, âgée alors de 18 ans.
Le talent était certes là, et le point de vue nouveau sur le monde, de cette enfant terrible de bourgeois cossus qui s'émancipait à l'instar de toute une génération. Mais toute une classe établie fut effarouchée au point de faire de ce premier roman un phénomène, qui poussa un François Mauriac à prendre à partie le ciel (le diable n'était-il pas envoyé sur terre en voiture de sport ?) tandis que ses pairs concluaient à la décadence.
D'autres, cependant, et non des moindres, dont un Benard de Fallois, brillant commentateur de Proust, reconnurent en Françoise Sagan un auteur authentique qui, d'un roman à l'autre, allait moduler une musique tout à fait personnelle et inimitable, d'une ligne claire et nette, sauvageonne et sensible, absolument appropriée, un ton en dessous des « destinées sentimentales » d'un Chardonne, à un milieu et à ses mœurs observés et restitués avec une constante justesse, le blues et le charme en plus.
Le personnage parisien de Sagan a sans doute faussé l'image de l'écrivain, dont on peut se demander ce que retiendra la postérité ? Certes au-dessous d'une Colette par la découpe du style, et sans la prodigieuse richesse d'observation d'un Simenon, la romancière n'en a pas moins tissé un univers tissé de pénétration lucide et de désabusement, qui restitue le ton des années de l'après-guerre français, de la bohème existentialiste aux avachissements de la gauche caviar.
Du point de vue du style, en dépit de ses errements personnels, Françoise Sagan reste enfin dans la ligne claire d'un certain classicisme français ton sur ton. Les anges qui l'ont accueillie de l’autre côté du miroir avaient la sèche au bec et le verre à la main.
Sagan par elle même
LA VIE: « On ne m'ôtera jamais de l'idée que c'est uniquement en se colletant avec les extrêmes de soi-même, avec ses contradictions, ses goûts, ses dégoûts et ses fureurs que l'on peut comprendre un tout petit peu, oh je dis bien un tout petit peu, ce que c'est que la vie, en tout cas la mienne. »
LA MORT: « Je me suis habituée peu à peu à l'idée de la mort comme à une idée plate, une solution comme une autre si cette maladie (après son accident en 1957) ne s'arrange pas. (...) Ce serait triste mais nécessaire, je suis incapable de tricher longtemps avec mon corps. Me tuer ... Dieu que l'on peut être seule parfois. »
LA SOLITUDE: « Le voilà lâché, le mot clé: la solitude. Ce petit lièvre mécanique qu'on lâche sur les cynodromes et derrière lequel se précipitent les grands lévriers de nos passions, de nos amitiés, essoufflés et avides, ce petit lièvre qu'ils ne rattrapent jamais mais qu'ils croient toujours accessible, à force. Jusqu'à ce qu'on leur rabatte la porte au nez. »
LA VITESSE: « Elle aplatit les platanes au long des routes, elle allonge et distord les lettres lumineuses des postes à essence, la nuit, elle bâillonne les cris des pneus devenus muets d'attention tout à coup, elle décoiffe aussi les chagrins: on a beau être fou d'amour, en vain, on l'est moins à 200 à l'heure. »
« La vitesse rejoint le bonheur de vivre et, par conséquent, le confus espoir de mourir. »
SON FILS: « Quand on me l'a mis dans mes bras, j'ai eu une impression d'extravagante euphorie. (...) Je sais ce que c'est d'être un arbre avec une nouvelle branche: c'est d'avoir un enfant. »
Nota bene : les romans de Françoise Sagan sont réunis dans un volume de la collection Bouquins. Un téléfilm lui a été consacré récemment, qu'on peut ne pas voir sans la moindre perte. -
Les heureux scandales d’antan

De La jument verte à Catherine Millet. Chronique de l'an 2005....
Les belles âmes sont-elles en voie de disparition ? C'est la grave question qui s’est posée à l’occasion du succès du "baise-seller" de Catherine M. auquel nul ne trouva à redire. Pas le moindre relent de scandale devant la ruée moutonnière des consommateurs sur ce livre supposé manifester la plus grande liberté de moeurs. En d'autres temps, ce récit placidement pornographique des faits et gestes d'une dame qui "baise comme elle respire" eût choqué les vigiles de la morale et suscité des poursuites. Mais en l'occurrence: à peu près rien. D'aucuns trouveront là le signe caractéristique de temps dissolus; d'autres y verront plutôt le triomphe de la tolérance. Or ce qui frappe surtout, dans le récit de Catherine Millet, est son absence totale de sensualité et de style, et l'espèce de conformité impersonnelle qui le ramène, en version chic-intello, aux magazines spécialisés.
C'est alors avec une sorte de nostalgie que nous avons retrouvé, dans l'Album Marcel Aymé de La Pléiade, la relation détaillée d'un bon vieux scandale à l'ancienne opposant quelques vraies belles âmes à l'auteur d'un livre jugé sulfureux.
En décembre 1933, après la parution de La Jument verte, dont le succès de l'époque dépasserait de beaucoup aujourd'hui celui de Catherine M., les foudres conjuguées de la soeur aînée de l'écrivain, d'un Monsieur Coquemard (sic) dirigeant le "journal de la famille française" intitulé La Femme et l'enfant, et du fameux Abbé Bethléem (re-sic) s'abattirent sur le malheureux auteur. Avertissant l'éditeur Gaston Gallimard qu'il avait décidé, après avoir "parcouru cette ordure", d'en référer au procureur de la République afin qu'il arrête la vente de cet ouvrage, le Coquemard en question ajoutait que le talent de Marcel Aymé rendait "plus infâme encore" cette Jument verte tout à fait "de nature à pourrir la jeune génération".
A la citation de ces attaques réjouissantes, nous ne saurions résister au plaisir d'ajouter celle de la réponse de Gallimard ainsi libellée: "Monsieur, permettez-moi de vous dire combien je suis surpris par votre lettre. Depuis la parution de La Jument verte, que j'ai fait soigneusement lire autour de moi, ma vieille grand-mère, contre tout espoir, vient de mettre au monde deux jumelles, et ma petite-nièce, quoique âgée seulement de cinq ans et demi, vient de mettre bas deux charmantes souris blanches". Inutile de dire que cet humour fit réagir Coquemard au point d'incriminer la mère de l'éditeur, suspectée d'être "née dans une porcherie sélectionnée pour avoir mis au monde un tel cochon", mais passons sur d'autres amabilités.
Ce qui nous semble plus intéressant, aujourd'hui, c'est, en relisant La Jument verte, de voir ce qui pouvait tant choquer à l'époque. Bien entendu, point trace de pornographie "à la Millet" dans ce roman paysan, mais une sensualité joyeusement goulue, pleine et colorée, tranquillement anticléricale aussi, qui oppose la saine verdeur du paysan Honoré et l'hypocrisie tortilleuse de son fère le vétérinaire. Le premier ne croit pas sombrer dans l'abîme pédophile en flattant au passage le téton printanier de sa fille aînée, tandis que l'autre voit le mal partout.
"Quand Honoré caressait sa femme, écrit Marcel Aymé, il invitait les blés de la plaine, la rivière, et les bois du Raicart". Alors que son frère le véto, découvrant un traité d'éducation sexuelle dans les cahiers d'écolier de son fils, et dans ce traité "la coupe d'un testicule grossi quatorze fois", croit y voir l'image du Mal et le motif de priver la garçon de dessert jusqu'à sa majorité...
Les heureux scandales ! Et combien de vérité humaine dans ces tensions, combien de gaîté dans ces profanations, combien de vie dans ce sexe relié au mystère et à la profusion du monde. L'heureux temps où l'on incriminait le talent d'un auteur supposé rendre "plus infâme encore" sa mauvaise influence ! L'heureux temps où la vertu des belles âmes rendait hommage au "vice" de l'artiste !Quant à Catherine Millet, son nouveau livre repose là-bas, sur une pile. Alors allons, repose encore un peu, Catherine Millet...
-
Les gens ordinaires
Je revois, tant d’années après, ma mère traverser la rue Centrale à pas décidés sans me voir, et je revois alors, à ma mère, là-bas, cette même émouvante beauté que je voyais à Galia quand elle ne voyait pas que je la regardais. Je voyais ma mère pour la première fois en ville, j’entends : seule en ville et sans se douter que je la voyais, et tout de suite j’avais pensé : ma petite mère.
C’était ma mère au bois en chaperon vert groseille, ma petite mère dans la forêt de la ville mais bien mise, évidemment, pas du tout à baguenauder ou à bayer aux corneilles: ma mère à son affaire comme toujours elle l’avait été, mais là, tout à coup, son apparition m’avait fait penser à ce qu’elle avait été en son enfance à elle, en son adolescence à elle et en sa jeunesse à elle, en sa vie sans nous et sans moi - en sa vie à elle ; ma mère était seule dans la ville, je la voyais préoccupée, je la voyais sans qu’elle me voie, je maintenais cette distance entre nous au lieu d’aller à sa rencontre, je m’étais même un peu dissimulé à ses yeux, je ne voulais pas qu’elle voie ma mine défaite de ces jours-là (je venais de quitter la Datcha dans un fracas de vaisselle), je ne voulais pas qu’elle me demande des nouvelles de Galia qu’elle avait finalement trouvée une bonne personne en dépit de la prévention initiale que lui inspirait de toute façon une femme séparée, je la voyais traverser la rue et je me disais pour la première fois, ah ça, ma mère a une vie à elle, et des années durant je la revis traverser ainsi la rue Centrale en me rappelant la robe verte de ma petite mère jusqu’au moment où, pour la dernière fois, dans la chapelle du Centre funéraire, je la vis dans sa petite robe bleue de veuve jamais vraiment consolée mais restée coquette.
Enfin coquette : à la paysanne, pour sortir et non pour briller, pour aller en ville avec décence et non pour se faire valoir. Or elle avait, ce jour-là, sa robe couleur d’espérance, d’un vert groseille chiné de rose très tendre et presque translucide, vert d’eau limpide ou vert libellule, pourrait-on dire, qu’elle s’était choisie pour lui, au début de la relance de la maladie de notre père, comme tout ce qu’elle avait entrepris dès la nouvelle terrible que leur avait annoncée l’oncologue - à présent je ne vis plus que pour lui, m’avait-elle dit un jour en se retenant de sangloter, et sa robe verte, le vert espérance de la jolie robe dans laquelle elle allait veiller notre père à la clinique, à chaque nouvelle opération, ce vert me restait comme un signe de vaillance contrastant, pour lors, avec mon spleen de romantique à la manque.
Ma mère traversait la rue dans les passages cloutés : elle traversait mon champ de vision de son pas décidé, traçant une ligne impeccable. Elle allait d’un point à un autre sans hésiter, et avec elle c’étaient sa mère à elle et son père qui traversaient mon champ de vision, c’était l’humanité décente dont je venais, moi l’indécent bohème, c’était la cohorte des réguliers cravatés traversant la ville en ignorant, en amont de la rue Centrale, les établissements louches du Pigalle et du Palais Mascotte où je m’attardais certains soirs, c’étaient les miens dont je m’étais bien éloigné et que le détail de mes menées nocturnes eût forcément horrifiés, mais vers lesquels je n’ai cessé de revenir depuis lors, et ma mère et mon père auxquels je ne cesse plus de parler.
Cependant je ne parlais à ma mère, en ces années-là, que sur un ton d’impatience ou de gêne. Tout ce qu’elle me serinait pour mon bien m’impatientait et me gênait à me rendre rogue, voire cruel, et de me le reprocher à moi-même redoublait ma gêne et mon impatience. J’eusse voulu la prendre dans mes bras et la cocoler, comme Galia me l’avait demandé tant de fois, au lieu de quoi je la bousculais et la repoussais. Le seul fait de la voir s’inquiéter de mon teint ou de mes fins de mois, et sa façon de me recommander ceci ou cela pour mon bien, tout en s’excusant, me hérissait au lieu de me faire sourire, et Galia la première me le fit observer en me signifiant au demeurant son penchant plus marqué pour mon père.
Ton père est le type du type bien, m’avait dit Galia au lendemain de notre rencontre que j’avais crainte un peu, ton père est le type du bon type, puis elle avait hésité un quart de seconde avant de sourire à l’évocation de ma mère, selon elle la fourmi maison qui portait un tablier même sans en porter. Et de fait, c’était l’industrieuse fourmi domestique que j’avais vu traverser la rue Centrale, ce jour-là, et avec elle toute la procession des fourmis familiales et cantonales, toutes les fourmis locales et mondiales de la multitude de ces gens que mon père disait les gens ordinaires.
Les gens ordinaires ne roulent pas en Rolls, disait mon père, qui s’étonnait d’autant plus que l’écrivain Georges Simenon, qu’il voyait parfois sortir de sa Rolls devant le traiteur chic Au Fin Bec, sur la place jouxtant l’immeuble de La Vie assurée où il avait son bureau - que ce rupin avéré, selon son expression, fût capable de parler aussi bien, et de comprendre surtout, les gens ordinaires. Notre mère utilisait aussi l’expression : les gens ordinaires, et les mères et les pères de notre mère et de notre père évoquaient de la même façon ces gens ordinaires auxquels on semblait m’assimiler ; et revoyant ma mère seule en ville, affairée à se rappeler ce qu’elle ne devait pas oublier, qu’elle avait d’ailleurs noté sur son petit carnet, je revoyais sa mère à elle, penchée sur son ouvrage, ou la mère de mon père à ses fourneaux, et cette expression des gens ordinaires commençait à diffuser elle aussi son émouvante beauté, qui me touchait en dépit de ma duplicité.
Car j’étais loin, alors, de m’identifier entièrement à ceux que mon père appelait les gens ordinaires : je restais sur mes gardes. Il y avait quelque chose, en effet, de buté, même d’un peu borné, dans la façon de ma mère de traverser la rue, qui me rappelait ce qu’il y avait de buté et de borné chez les gens du quartier des Oiseaux. Et le sort du monde ? disait une voix en moi. Et les fins dernières ? Que pensent-ils donc des fins dernières ? Et l’art ? Et la littérature ? Et L’Art et la Littérature ? Et Shakespeare comptait-il donc la moindre pour les gens ordinaires ? Le seul nom de Yorick disait-il quoi que ce fût à mon employé de père ? Et ces fameuses gens ordinaires évalueraient-elles jamais l'insondabilité abyssale de la question: to be or not to be ?
J’avais beau traiter d’imbécile et de cuistre celui qui posait en moi ces questions de cuistre et d’imbécile : elles n’en étaient pas moins là, ces questions, elles étaient en moi, elles étaient moi, c’était moi tout craché ce juge imbécile et cuistre qui se plaçait évidemment, par sa position de juge, au-dessus de ceux-là que mon père appelait les gens ordinaires. Mon père ne me disait pas de ne pas jouer au plus malin, mais c’était de cela qu’il s’agissait bel et bien : je me croyais plus malin, j’étais du côté de ces gens-là qui se croient plus malins. Tandis que les gens que mon père disait les gens ordinaires travaillaient dans leurs ateliers et leurs bureaux, je savais cette duplicité créatrice en moi, ce poids et cette grâce, cet ange et ce serpent, cette candide crevure, cet amoureux moqueur, ce fervent ricaneur qui surgissait à l’improviste et me tournait autour, me vrillait ses œillades artistes…
Après le Président qui avait, le premier, décrété devant nos mère et père qu’il me voyait en somme artiste, et fier aussi, vers mes treize ans, de voir mes premières aquarelles agréées par l’intempestif Coboye, j’eusse dû me satisfaire de cette position singulière que mes père et mère autant que mes oncles et tantes admettaient visiblement comme on avait admis mes chats bleus, mais je me trouvais plutôt, après avoir quitté la Datcha, dans la sombre disposition de me réduire à rien, scribe de rien et rapin de moins que rien juste bon à rêver au chef-d’œuvre inconnu dans ma carrée du Vieux Quartier, indigne en somme d’être assimilé aux gens ordinaires que mon père évoquait.
Mais la première lumière sur les jardins en cascades de murets en murets des anciennes vignes médiévales du Vieux Quartier, à la fenêtre de mon antre, et cette lumière, à l’instant, tant d’années plus tard, d’une fin d’après-midi que j’évoquais à ma table de l’aube, bien plus tard encore, cette lumière de mon enfance songeuse qui ne cessait d’adoucir mon adolescence rageuse, cette lumière silencieuse que je scrutais à présent pour en capter les voix enfouies, cette première et cette dernière lumière confondues me révélaient à l’instant chaque mot nouveau dans le mouvement le moins volontaire de le consigner à l’encre verte.
Ma mère avait écrit, aussi, à ma demande, ce qu’elle vivait depuis la mort de mon père, que je lirais des années plus tard dans son Cahier noir. Et mon père lui aussi, avant elle, avait écrit ce qu’il avait vécu dans ses jeunes années, que j’avais lu avant sa mort et avec lequel j’en avais parlé. Je me trouvais toujours là, dans cet angle mort où elle ne pouvait me voir, à regarder ma mère traverser la rue de son pas décidé, toujours je la reverrai, toujours je me verrai l’observer durant ces quelques minutes, ma petite mère est là seule comme une grande et je la laisse venir et passer. Ce n’est pas que je l’évite : ce n’est pas ça. Je me rappelle ce moment où, le long d’une rue du centre ville, un camarade de la Jeunesse léniniste m’a proposé, soudain agité, de traverser la rue pour ne pas avoir à croiser son père le juge V., ce valet du pouvoir, selon son expression. Or revivant le moment de voir ma mère traverser la rue Centrale, c’est tout autrement que j’interprète ma réserve, ma distance, mon attention vive aussi, mon regard à la fois amusé, surpris, mon élan suspendu, je dis bien mon élan : je reste immobile tout en me disant que je cours vers elle et l’embrasse, tout en moi court vers elle et l’embrasse comme je vais à la rencontre de ceux que mon père appelle les gens ordinaires.
(Extrait de L’Enfant prodigue, récit en chantier)
Image: Mère et fils, d'Alexandre Sokourov.
-
Ceux qui se laissent faire
Celui se plaint tout le temps et se le reproche / Celle qu’attriste le déni que subissent ses poèmes muraux écrits dans un esprit résolument favorables à l’avenir du sovkhoze / Ceux qui laissent tourner leur machine à gazon surpuissante à proximité du barbecue de leurs voisins de gauche / Celui qui hante le Jardin aux volières en refusant toute rencontre / Celle qui peint d’après nature les villas du quartier sans même demander aux voisins s’ils sont d’accord / Ceux qui ont tous les disques du Patrick Juvet des débuts / Celui qui a vécu dans le chalet nordique de Patrick Juvet après son départ pour l’étranger / Celle qui a eu un bon contact avec Patrick Juvet à l’épicerie où elle croisa aussi Yannick Noah mais quelques années plus tard / Ceux qui ont dénoncé Yannick à la Commune pour lui faire retirer son permis de séjour vu qu’il n’était là que de sept en quatorze / Celui qui photographie régulièrement les trois familles de blaireaux qu’il y a dans le petit bois jouxtant l’ancien chalet nordique de Patrick Juvet, à peu près 250 mètres au-dessus de l’ancienne résidence secondaire de Yannick Noah / Celle qui qualifie toujours Patrick Juvet de gonzesse velue / Ceux qui militent pour la réintroduction des martres dans le secteur jadis prisé par l’écrivain américain Hemingway / Celui qui te fait visiter l’ancien hôtel dans lequel Hemingway a fini L’Adieu aux armes / Celle qui jure à son ami professeur de lettre qu’elle a vu François Nourissier dans un champ de narcisses des hauts de Caux / Ceux qui ont tapé le carton avec Eric Ambler et Noël Coward dans la propriété de celui-ci que tu vois là-haut juste au-dessus des Avants / Celui qui a essuyé un refus lorsqu’il a proposé à la femme de Nourissier de laver une aquarelle de son abyssin-lièvre Pacha / Celle qui n’arrive pas à se rappeler si le parfum de la femme décédée de François Nourissier était à la tomate ou au citron / Ceux qui ont vu James Brown se rouler un joint au col de Jaman sans être sûrs que c’était bien LE James Brown qu’ils avaient sifflé la veille au Festival / Celui qui estime que la Commune devrait faire plus de pub autour de la présence de toutes ces célébrités par nos monts et vaux / Celle qui se rappelle très bien le sourire de Freddy Mercury quand elle l’a appelé par son prénom à l’abribus de Clarens où il semblait si seul / Ceux qui estiment un peu mélancoliquement que le Leonard Cohen de cet été n’était plus tout à fait le Leonard Cohen qu’ils ont connu en écoutant les 33 tours qui ont tous brûlé dans la ferme de leur communauté hippue vers 70-71, etc.Aquarelle JLK: l'ubac des préalpes de Savoie.
-
A l'écoute de François Cheng

Quelle beauté pour sauver quel monde ?
Que signifie l’affirmation de Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, selon laquelle « la beauté sauvera la monde ». De quelle beauté s’agit-il, et de quel monde ? Dans la partie conclusive des Aventuriers de l’absolu, son dernier essai sur les destinées comparées d’Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke et Marina Tsvetaeva, Tzvetan Todorov s’interroge à ce propos en esquivant le double piège de l’esthétisme et de l’idéalisme désincarné.
Dans le même esprit, quoique partant d’une expérience personnelle toute différente, François Cheng se livre lui aussi, dans son nouvel ouvrage à paraître, intitulé Cinq méditations sur la beauté, à une réflexion sur ce thème.
D’emblée, le poète et penseur chinois réunit la beauté et le mal, comme si la lumière ne pouvait trouver sens que par rapport aux ténèbres.
Pour évoquer ce qui, par la beauté, nous transporte hors de nous-mêmes, et parfois jusqu’à l’extase (au sens premier), Tzvetan Todorov citait la musique, et par exemple vécue au milieu des autres, dans un concert.
François Cheng, pour sa part, se rappelle l’émerveillement qu’il a éprouvé, en son enfance, dans le site naturel du Mont Lu (dont le nom en chinois, associé à l’idée de beauté, signifie « mystère sans fond ») où l’emmenaient chaque année ses parents, comme tant de poètes et d’artistes fascinés par ces lieux magiques.
Tout aussitôt, cependant, François Cheng associe, à cette reconnaissance de la splendeur du monde, qui nous renvoie à notre propre unicité intérieure, le rappel de son expérience non moins précoce du mal, concrétisé par les atrocités de la guerre sino-japonaise.
« Je sais que le mal, que la capacité au mal, est un fait universel qui relève de l’humanité entière », écrit encore celui qui se définit lui-même modestement comme « un phénoménologue un peu naïf », rappelant ensuite que la pensée sur le beau n’a de sens que liée à une pensée sur le vrai et sur le bien, alors même que le beau semble avoir moins de nécessité que le vrai ou le bien.
Ce qu’est la beauté ? « Elle est là, de façon omniprésente, insistante, pénétrante, tout en donnant l’impression d’être superflue, écrit encore François Cheng, c’est là son mystère, à nos yeux, le plus grand mystère »…François Cheng. Cinq méditations sur la beauté. Albin Michel, avril 2006.